Mémoires Du Chef De L'orchestre Rouge
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

SPYCATCHER by PETER WRIGHT with Paul Greengrass WILLIAM
SPYCATCHER by PETER WRIGHT with Paul Greengrass WILLIAM HEINEMANN: AUSTRALIA First published in 1987 by HEINEMANN PUBLISHERS AUSTRALIA (A division of Octopus Publishing Group/Australia Pty Ltd) 85 Abinger Street, Richmond, Victoria, 3121. Copyright (c) 1987 by Peter Wright ISBN 0-85561-166-9 All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise) without the prior written permission of the publisher. TO MY WIFE LOIS Prologue For years I had wondered what the last day would be like. In January 1976 after two decades in the top echelons of the British Security Service, MI5, it was time to rejoin the real world. I emerged for the final time from Euston Road tube station. The winter sun shone brightly as I made my way down Gower Street toward Trafalgar Square. Fifty yards on I turned into the unmarked entrance to an anonymous office block. Tucked between an art college and a hospital stood the unlikely headquarters of British Counterespionage. I showed my pass to the policeman standing discreetly in the reception alcove and took one of the specially programmed lifts which carry senior officers to the sixth-floor inner sanctum. I walked silently down the corridor to my room next to the Director-General's suite. The offices were quiet. Far below I could hear the rumble of tube trains carrying commuters to the West End. I unlocked my door. In front of me stood the essential tools of the intelligence officer’s trade - a desk, two telephones, one scrambled for outside calls, and to one side a large green metal safe with an oversized combination lock on the front. -

Rapport De Recherche #28 LES SERVICES DE RENSEIGNEMENT SOVIÉTIQUES ET RUSSES : CONSIDÉRATIONS HISTORIQUES
Centre Français de Recherche sur le Renseignement 1 LES SERVICES DE RENSEIGNEMENT SOVIÉTIQUES ET RUSSES : CONSIDÉRATIONS HISTORIQUES Colonel Igor PRELIN Rapport de recherche #28 Avril 2021 2 PRÉSENTATION DE L’AUTEUR Le colonel Igor Nicolaevich Prelin a servi toute sa carrière (1962-1991) au KGB où il a occupé successivement des fonctions au Service de contre-espionnage, au Service de renseignement (Guinée, Sénégal, Angola), à l’École de renseignement – en tant qu'instructeur il a eu Vladimir Poutine parmi ses élèves – et comme officier de presse du dernier président du KGB, le général Kriouchkov. De 1995 à 1998, le colonel Prelin est expert auprès du Comité de la Sécurité et de la Défense du Conseil de la Fédération de Russie (Moscou). Depuis, il consacre son temps à l’écriture d’essais, de romans et de scénarios, tout en poursuivant en parallèle une « carrière » d’escrimeur international. ABOUT THE AUTHOR Colonel Igor Nicolaevich Prelin served his entire career (1962-1991) in the KGB, where he successively held positions in the Counterintelligence Service, the Intelligence Service (Guinea, Senegal, Angola), the Intelligence School - as a professor he had Vladimir Putin among his students - and as press officer to the last KGB president, General Kriushkov. From 1995 to 1998, Colonel Prelin was an expert at the Committee on Security and Defense of the Council of the Russian Federation (Moscow). Since then, he has devoted his time to writing essays, novels and screenplays, while pursuing a "career" as an international fencer. RÉSUMÉ 3 LES SERVICES DE RENSEIGNEMENT SOVIÉTIQUES ET RUSSES : CONSIDÉRATIONS HISTORIQUES Les services de renseignement et de sécurité Il existe un certain nombre de traits caractéristiques soviétiques furent sans aucun doute les plus du renseignement soviétique à l’origine de son efficacité. -

AUGUST 4, 1972 More People Attend the Event
R . I, JE'/.' I t :! !! I ST.O~ ICAL ASS OC , 209 ANGE LL ST. 11 PROV . c,, R, I. 02906 Support Jewish Read By More Than Agencies 35,000 . With Your Membership People VOLUME LVI, NUMBER 23 PRIDAY,AUGUSf.f, 1972 12 PAGES lSc PER COPY U.S. Intelligence Sources Hoffman Says Everyone Premier Golda Meir Appeals In Florida Is Jewish Say Soviet U~ion Removing MJAMI BEACH - Abbh To Sadat For New Start '. loffman, one of the "Chlcap Seven" whose trial was c\JIIDected Most Of Its Warplanes with the 1968 Democratic Toward Peace In Mideast WASHINGTON - Unlt8d 1be prlnctpal disagreement Convention In Chicago, waa bac:t JERUSALEM Premier diplomacy In soft Janiuage, she States in.telllgence sources say between American and l:rraell for this one and waa staytng at Golda Meir appealed to President did not change the substance of there are "strong Indications" lnteWcence speclalt.sts seems to Plamln:.-o Park. Wben asked for Anwar el-Sadat of Egypt to Join In Israel's negodatlng terms on the that the Sovlet Union Is removing center- on whether Sovlet combat an lnterVtew; Hofhrun made It making a new start toward peace occasion of the Soviet withdrawal. from Egypt most of Its warp! anes units - what Mrs. Meir called Immediately clear that President 1n the Middle East, to "meet as Mrs. Meir warned that assigned with Sovlet fiylngcrewa "strategic forces" - are being Nixon wH his major opposition equals, and make a Joint supreme premature Judgments about a to the Egyptian air defenses. withdrawn. while George McGcnern wu "a effort to arrive at an agreed Sovlet "exodus from Egypt" These Intelligence sources American Intelligence mensch." "Ally Jew for Nixon la solution." would become a source of said It appeared that among the sources, while caudonlng that It • goy, even Golda Meir, Hoffman, In the Government's first disappointment. -

Lockenour on Perrault, 'The Red Orchestra'
H-German Lockenour on Perrault, 'The Red Orchestra' Review published on Tuesday, April 1, 1997 Gilles Perrault. The Red Orchestra. New York: Schocken Books, 1989. 494 pp. $12.95 (paper), ISBN 978-0-8052-0952-5. Reviewed by Jay B. Lockenour (Temple University) Published on H-German (April, 1997) "Soldiers of the 23rd Panzer Division, the Soviet Union salutes you. Your gay days in Paris are over now. Your comrades will already have warned you of what is happening here. Soon you will find out for yourselves." These words, blaring from loudspeakers just behind the Soviet lines, welcomed German troops to the Eastern Front. More damaging to German efforts, however, was the fact that the Soviet High Command seemed intimately acquainted with German offensive plans. During the German Operation Blue in 1942, Soviet armies always seemed to be in the right place, and when they retreated, it was always in the direction of OperationBlue 's objective, Stalingrad. The reasons for these successes may lie with the so-called Red Orchestra, the subject of the two books under review. ("Orchestra" is a common term for spy rings whose "pianists" [radio operators] play their "music" of coded messages.) The Red Orchestra, based in Paris and covering nearly all of German-occupied Europe, including Germany itself, was "conducted" by Leopold Trepper, a Polish Jew and the hero of both accounts, the first by Gilles Perrault and the second by V. E. Tarrant. Perrault's rendering is masterful, suspenseful, and reads like a thriller. Trepper and his associates were for years able to smuggle valuable information out of Germany. -

Mar AP 2018.Pub
The Voice of March/April 2018 Congregaon Kol Emeth Adar/Nissan/Iyar 5778 5130 W. Touhy Avenue Skokie, Illinois 60077 847-673-3370 www.KolEmethSkokie.org Message From The Rabbi In looking for Jewish heroes to return of Trepper and all the other spies to Moscow. speak about, I occasionally come But Trepper stayed put and continued his work. He upon a story so extraordinary that I even warned Stalin in 1941 of Germany’s plans to have to share it with a wider invade the Soviet Union, but to no avail. Stalin audience. Such is the story of willingly blinded himself to the obvious. Leopold Trepper. After June 22, 1941, when Operation Barbarossa, Born into a poor Jewish family in Poland, Trepper the German invasion of the Soviet Union took place, became a left -wing activist, organizing strikes and and Russia was now on the side of the Allies against suffering imprisonment for his efforts in this Germany, Trepper came into his own. The Germans direction. He joined the left -wing Zionist movement called his spy group Die Rote Kapelle, the Red Hashomer Hatzair, and emigrated to Palestine with Orchestra. This spy group, led by a Jew, in the heart like -minded comrades in 1924. Naturally, once he of Nazi -occupied Europe, sent information in such arrived, he organized a labor union Ichud —Unity — quantity and of such quality that the Germans but this was a union of both Jewish and Arab themselves said this work was worth 100,000 allied workers. He also joined the (illegal) Palestine troops. -

Joseph Berger: the Comintern’S and Münzenberg’S Expert on Middle Eastern Affairs
Joseph Berger: The Comintern’s and Münzenberg’s Expert on Middle Eastern Affairs von Mario Kessler Mario Kessler Joseph Berger: The Comintern’s and Münzenberg’s Expert on Middle Eastern Affairs1 Joseph Berger-Barzilai (original name Joseph Isaac Zilsnik, other form Zeliaznik), 1904– 1978, was founding member and secretary of the Communist Party of Palestine and who fell victim to Stalin’s purges.2 Berger-Barzilai was born in Cracow, Poland in 1904. In 1914, his family fled the Russian army which treathened to invade their city for Vienna, and moved in 1916 to Bielitz, Silesia. Young Joseph was brought up as an orthodox Jew and a Zionist, becoming active in the Zionist Wanderbund Blau-Weiß. He emigrated to Palestine at the age of 15 in 1919. There he worked first on road construction and then as a translator in an engenieering firm. During his life he spoke Yiddish, German, Polish, English, Hebrew, and Russian. Originally a member of the leftist Zionist organization Hashomer Hatzair, he became soon a communist, took part in the founding of one of the communist groups, the Communist Party of Palestine, in 1922, and became its secretary. It was then that he assumed the name Berger. Together with Wolf Averbukh, he was responsible for the unification of various left-wing groups that had broken with Zionism to the Palestiner Komunistishe Partey, the Palestine Communist Party, in 1923. The party had to operate under illegal conditions since the British Mandate Authority had outlawed all communist activities in May 1921. Berger became deputy secretary of the party that joined the Comintern in March 1924.3 For this mission, he was sent to Moscow. -

Spartacist No. 41-42 Winter 1987-88
· , NUMBER 41-42 ENGLISH EDITION WINTER 1987-88 .ONE DOLLAR/75 PENCE ," \0, 70th Anniversary of Russian Revolution Return to the Road of Lenin and, Trotskyl PAGE 4 e___ __ _. ...,... • :~ Where Is Gorbachev's Russia Going? PAGE 20 TheP.oland,of LU)(,emburgvs.th'e PolalJdof Pilsudski ;... ~ ;- Me.moirs ofaRevoluti0l.1ary Je·wtsl1 Worker A Review .., .. PAGE 53 2 ---"---Ta bI e of Contents -'---"..........' ..::.....-- International Class-Struggle Defense , '. Soviet Play Explodes Stalin's Mo!?cow Trials Free Mordechai Vanunu! .................... 3 'Spectre of, Trotsky Hau'nts '- " , Gorbachev's' Russia ..... : .... : ........ : ..... 35 70th Anniversary of Russian Revolution Reprinted from Workers ,vanguard No, 430, Return'to the Road of 12 June 1987 ' lenin and Trotsky! ..... , ..................... 4 Leni~'s Testament, •.....• : ••••.•.. : ~ •••....•• : .1 •• 37' , Adapted from Workers Vanguard No, 440, The Last Wo~ds of, Adolf Joffe ................... 40 , 13 November 1987' 'j' .•. : Stalinist Reformers Look to the Right Opposition:, ' Advertisement: The Campaign to \ Bound Volumes of the Russian "Rehabilitate" Bukharin ...•.... ~ .... '..... ;. 41 , Bulletin of the'OpP-osition, 1929-1941 .... 19 , Excerpted from Workers Vanguard No. 220, 1 December 1978, with introduction by Spartacist 06'bRBneHMe: nonHoe M3AaHMe pyccKoro «EilOnneTeHR In Defense of Marshal Tukhachevsky ...,..45 , Onn03M4MM» 1929-1941 ................ .' .... ,". 19 Letter and reply reprinted from Workers Vanguard No'. 321, 14 January 1983' Where Is Gorbachev's Russia -
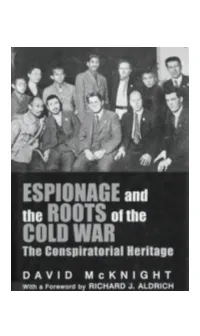
Untitled, Undated Document, Rtskhldni, 533-6-317
McKnight provides a superbly documented analysis of how the Communist International organized its clandestine activities and the guidelines for underground and covert political work that it laid out for Communist parties around the world. He provides as well case studies of Comintern conspiratorial activities and demonstrates how this covert work later overlapped with and contributed to Soviet foreign espionage undertakings. Students of both the Comintern and the various national Communist parties will have need of this book. John Earl Haynes, author of The Secret World of American Communism and Venona: Decoding Soviet Espionage in America From the 1930s to the 1950s a significant number of left-wing men and women in the United States, Britain, Europe, Australia and Canada were recruited to the Soviet intelligence services. These people were amateurs rather than professional intelligence workers, and the reasons for their success is intriguing and has never been satisfactorily explained. Using recently released Soviet archives, this book seeks to explore the foundations for these successes in the deliberately concealed tradition of underground political activity which was part of the communist movement. This tradition, which became extremely useful to Soviet intelligence, also explains the origins of the 'tradecraft' of espionage. The book seeks to contribute to the study of the causes of the early Cold War, by explaining how this underground tradition led to espionage. This book shows that while allegations of disloyalty during the Cold War were often part of a witchhunt, the Left and their liberal allies sometimes unwittingly had a number of skeletons in their own closet. David McKnight has studied and written about espionage and politics for over 15 years. -

Leopold Trepper
Books that influenced my life Three books • I include three books that influenced my thinking and hence my life. • I read these when I was an impressionable young man (in the 1960s) • The books are: “The Red Orchestra” by Gilles Perrault “The Gulag Archipelago” by Solzhenitsyn “Ulysses” by James Joyce The Red Orchestra • The book “The Red Orchestra” by Gilles Perrault was published in 1967 • “The Red Orchestra” was the name of the Soviet spy-ring in Europe during WWII • It had 279 members of many nationalities • 69 were Jews, including Palestinian Jews • It was based in Brussels and Paris • They caused at least 200,000 German casualties • Its “conductor” was Leopold Trepper Leopold Trepper • Born in Poland in 1904 • Studied at Krakow University • Became a miner and a Communist • Was imprisoned for 9 months • In 1928 moved to Palestine • Organized anti-British strikes • Was expelled and was back in France in 1930 • Became part of a Communist spy ring • In 1932 attended spy school in Moscow • In 1938 began organizing a Soviet spy ring in Brussels • In 1940 was appointed head of Soviet espionage in Europe centered in Paris Trepper’s activities • Used false identities with various passports, e.g. Leiba Domb, Jean Gilbert • Set up dummy companies, “The excellent trench coat company” in Brussels and Simexco in Paris • Used legitimate businessmen as fronts • Spoke excellent French, German and Russian • Cultivated good relations with senior SS officers, giving presents and parties (none realized he was Jewish) • Dealt in black market and bribes -

Joseph Berger: Communist Activist in Palestine and Victim of Stalinism (1904–1978) 161
159 Mario Kessler links: Mario Kessler rechts: Joseph Berger: Communist Activist in Palestine Joseph Berger: and Victim of Stalinism (1904–1978) Communist Activist in Palestine and Victim of Stalinism (1904–1978) Abstract The Polish-born Joseph Berger took part in the founding of the Palestine Communist Party. The party had to operate under illegal conditions. Berger became deputy secretary of the party that joined the Comintern in March 1924. After the first Arab-Jewish civil war in August 1929 he became secretary of the party, but was, in 1930, expelled from the country by British mandate authorities. In Berlin he worked for the League against Imperialism. In 1932 he headed the Comintern’s Near Eastern Department in Moscow. In 1934 he was dismissed from his post and expelled from the party without any given reason. In January 1935 Berger was arrested and charged with being a Trotskyite agitator. He refused to “confess” and spent the next sixteen years in various Siberian labor camps. In 1951, he was released, only to be banished to life-long exile in Siberia. His wife and his son were also persecuted on his account, and they could see him only when they were allowed to visit him in Siberia. In 1956 Berger was officially rehabilitated and allowed to leave the Soviet Union for Poland. Soon the family decided to immigrate to Israel. Berger was invited to give lectures at Bar Ilan University. Later the university appointed him as an associate professor of political science. Berger had completely abandoned his com- munist faith and had become religious. -

Pannwitz, Heinz Vol. 2 0042
• ,CLASSOLCATION MI4VAICH SYMUOL ANU NO DIS ATCH S.;E C R IZMA-:44214 TO hief, EE; Chief, SR Huo0uAATEAs FILE NO.-7.— INFO -2664r=1"1:_ COS/G, BOB., NOB .Pield file-1181 FROM Chief, Munich Base DATE 26 August 1959 uOiEcT W-WROVE,EQVAL.CARETINA OPERATIONS RF,:.."43.3--ICHECK "X" ONE) ‘0AllgTTNAs Report on the German-Controlled Interne MARKED FOR INDEXING Att_13. Communist Party Radio Network in France, 1943/44. NO INDEXING REQUIRED ACTION ncouinio See paragraph b. • INDEXING CAN BE JUDGED BY QUALIFIED•. HQ. DESK 0%0 REFERENCE.SI d a. EGmA.334, 28 May 1959 yi b. EGMA-10213, 17 Aug 1959 4,4J, 1. Forwarded herewith as Attachment A is CARETINAs account of the French Communist Party, internal, radio network -which the Germans had penetrated and were controlling, according to% grouSTTNA, during 1943 and 1944. The attached report is listed as item i. of paragraph 10 of refer- ence a. CARETINA, ,states that he and Kriminaldirektor Karl ROEMELBURG were aware that a "sleeper" radio communication net had been established in - France for the FreLch C. After Leopold TREPPERs escape,CARETINA was constantly worried about the possibility that TREPPER, by means of a French CP radio transmitter, would establish radio contact with Moscow be- fore the German DFing companies could fix the transmitter and bring it under control. This possibility offered a continuous threat to CARETINkis "MARS" radio play-back for which SUKOLOV OKENT was the principle agent. According toQAHETINA:;- it was his idea to eliminate this threat by offer- ing the French CP a . -

No. 165, July 9, 1977
25¢ WfJltNE/iSNo. 165 '''N'O''''8 July 1977 Rightist Reaction Pushes Anti-Homosexual Hy'steria More than a hundred thousand people demonstrated in San Francisco. They were protesting against the reac tionary anti-homosexual crusade of Anita Bryant, the fanatic Bible thumping bigot whb has proclaimed herself the nemesis ofdemocratic rights for homosexuals. Bryant's right-wing rampage is obscene and dangerous. Outraged "gay rights" activists have taken to the streets in response. The San Francisco protest was by far the largest, but just about every majQr American city has witnessed mobilizations in defiance of the Bryant crusade; In fact, the "gay movement"-the last gasp of New Left lifestyle radicalism--is seem ingly the most vociferous liberal/radical mobilization this side of the Vietnam war. Whether this wave' of anti-bigotry protest will have any significant effect on the American social climate depends on whether the working class can be mobilized in a fight for democratic rights through a class-struggle program to fight social oppression. The presem wave of homosexual activism was precipitated by Bryant's June 7 "Save Our Children" victory in Dade County, Florida. Appealing to the most disgusting backwardness with scare tactics designed to conjure up images of sinister homosexuals lurking in school playgrounds, Bryant suc ceeded in repealing an ordinance pro hibiting discrimination against homo sexuals. The repeal is an outrage against Ji/%dt£'k;:;;::,,~;-,->~---c-----,~'-.·.' /. elementary democratic rights, in effect Paul Hosefros/New York Times declaring "open season" on homosexu HundretJs of thousands of demonstrators turned out across the country June26 to voice their opposition to als and encouraging employers, land discrimination against homosexuals.