INSSA-2013-NEZ-LES.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Motorcycle Rear Suspension
Project Number: RD4-ABCK Motorcycle Rear Suspension A MAJOR QUALIFYING PROJECT REPORT SUBMITTED TO THE FACULTY OF WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE IN PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE BY JACOB BRYANT ALLYSA GRANT ZACHARY WALSH DATE SUBMITTED: 26 April 2018 REPORT SUBMITTED TO: Professor Robert Daniello Worcester Polytechnic Institute Abstract Motorcycle suspension is critical to ensuring both safety and comfort while riding. In recent years, older Honda CB motorcycles have become increasingly popular. While the demand has increased, the outdated suspension technology has remained the same. In order to give these classic motorcycles the safety and comfort of modern bikes, we designed, analyzed and built a modular suspension system. This system replaces the old twin-shock rear suspension with a mono- shock design that utilizes an off-the-shelf shock absorber from a modern sport bike. By using this modern shock technology combined with a mechanical linkage design, we were able to create a system that greatly improved the progressiveness and travel of the rear suspension. Acknowledgements The success of our project has been the result of many individuals over the course of the past eight months, and it is our privilege to recognize and thank these individuals for their unwavering help and support throughout this process. First and foremost, we would like to thank our Worcester Polytechnic Institute advisor, Professor Robert Daniello for his guidance throughout this project. His comments and constructive criticism regarding our design and manufacturing strategies were crucial for us in realizing our product. We would also like to thank two other groups at WPI: The Mechanical Engineering department at WPI and the Lab Staff in Washburn Shops. -

Motorcycle Safety and Intelligent Transportation Systems Gap Analysis Final Report
Motorcycle Safety and Intelligent Transportation Systems Gap Analysis Final Report www.its.dot.gov/index.htm Final Report — October 2018 FHWA-JPO-18-700 Cover Photo Source: iStockphoto.com Notice This document is disseminated under the sponsorship of the Department of Transportation in the interest of information exchange. The United States Government assumes no liability for its contents or use thereof. The U.S. Government is not endorsing any manufacturers, products, or services cited herein and any trade name that may appear in the work has been included only because it is essential to the contents of the work. Technical Report Documentation Page 2. Government Accession No. 3. Recipient’s Catalog No. FHWA-JPO-18-700 4. Title and Subtitle 5. Report Date Motorcycle Safety and Intelligent Transportation Systems Gap Analysis, Final Report October 2018 6. Performing Organization Code 7. Author(s) 8. Performing Organization Report No. Erin Flanigan, Katherine Blizzard, Aldo Tudela Rivadeneyra, Robert Campbell 9. Performing Organization Name and Address 10. Work Unit No. (TRAIS) Cambridge Systematics, Inc. 3 Bethesda Metro Center, Suite 1200 Bethesda, MD 20814 11. Contract or Grant No. DTFH61-12-D-00042 12. Sponsoring Agency Name and Address 13. Type of Report and Period Covered U.S. Department of Transportation Final Report, August 2014 to April 2017 FHWA Office of Operations (FHWA HOP) 1200 New Jersey Avenue, SE Washington, DC 20590 14. Sponsoring Agency Code FHWA HOP 15. Supplementary Notes Government Task Manager: Jeremy Gunderson, National Highway Traffic Safety Administration 16. Abstract Intelligent Transportation Systems (ITS) present an array of promising ways to improve motorcycle safety. -

The Dna of Design and Design Signature: a Perspective in Motorcycle Design
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING DESIGN, ICED13 19-22 AUGUST 2013, SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY, SEOUL, KOREA THE DNA OF DESIGN AND DESIGN SIGNATURE: A PERSPECTIVE IN MOTORCYCLE DESIGN Sushil CHANDRA Hero Motocorp Ltd, India ABSTRACT Designers have to frequently face the two terms: the DNA of design and design signature, though no scientific definitions for these two terms are available. This study attempts to formulate a scientific definition for these two terms, differentiate between these terms which are frequently used interchangeably, and explore a mathematical framework. Since the author is a practicing motorcycle designer, this mathematical code has been formulated in context of motorcycle design, but the concepts and methodology can be adopted for design in general. Finally, in context of motorcycles, DNA codes have been calculated for various makers and the results observed, by and large match with the general perceptions. At the same time, limitations faced by practicing designers in devising code have also been discussed. Keywords: DNA, design signature, design process Contact: Sushil Chandra Hero Motocorp Ltd R&D Gurgaon 122001 India [email protected] ICED13/228 1 1 INTRODUCTION DNA of design and design signatures are very commonly used jargons in the realm of design. All cars from BMW are recognizable by their front grill which is supposed to be their design signature. But the important question is-is this DNA of design an abstract thing like soul or a scientific entity? Looking at the characteristics of the biological term DNA and juxtaposing it against the world of artifacts- engineering, cultural or otherwise - DNA of design appears to be a set of characteristics defining the products of a creator and making the creator instantly recognizable. -

Expert Witness Resume
LANCE RAKE PROFESSOR DESIGN [email protected] 785 424 3117 LANCERAKE.COM BIOGRAPHY For over 40 years, I have been learning, practicing, and teaching industrial design, often at the same time. Honored as a Fulbright Senior Scholar in 2015 and currently Professor of Industrial Design at the University of Kansas, I have also taught full-time at Auburn University and Carrington Technical Institute in Auckland, New Zealand. Additionally, I have taught short courses at Konstfackskolan in Stockholm and been a visiting professor at Staffordshire University in Stoke- on-Trent, England, Halmstad University in Sweden, and the Indian Institute of Technology- Bombay in Mumbai, India. My design research has been supported by private and public grants, and findings presented at national and international design conferences and institutions. For several years I have been using my experience as both teacher and practitioner of design to serve as an expert witness in design patent infringement and product liability cases. I was a signatory to the “133 Distinguished Industrial Design Professionals and Professors” Amicus Brief supporting Apple in its case against Samsung before the Supreme Court. Working alone or in collaboration with other professionals, I have designed numerous commercial products, consumer products, aircraft and boat interiors, graphics, packaging, and exhibits. I was chosen by the editors at ID Magazine chose as one of the “Design 50”. Recently, my research efforts have been focused toward using design to create sustainable craft- based enterprises in rural communities in the US, Africa, and India. EDUCATION 1982 Master of Product Design (subsequently renamed Master of Industrial Design), 1982 North Carolina State University, Raleigh, NC 1974 B.F.A. -

Travel for a Penny a Mile: an Engineering Design Challenge Inspiring Stu- Dent Engagement and Sustainable Living
Paper ID #11577 Travel for a Penny a Mile: An Engineering Design Challenge Inspiring Stu- dent Engagement and Sustainable Living Dr. Richard M. Goff, Virginia Tech Department of Engineering Education Richard M. Goff is a former aircraft structural test engineer for the Navy, Peace Corps Volunteer, and com- puter entrepreneur. He holds a Ph.D. in Aerospace Engineering, and is currently an Associate Professor in the Department of Engineering Education at Virginia Tech. Richard has been teaching and engaging in research in multidisciplinary engineering design education for over eighteen years. Dr. Goff is the recipient of several university teaching awards, outreach awards, and best paper awards. His passion is creating engaging learning environments by bringing useful research results and industry practices into the classroom as well as using design research results to inform engineering practice. Page 26.1606.1 Page c American Society for Engineering Education, 2015 Travel for a Penny a Mile: An Engineering Design Challenge Inspiring Student Engagement and Sustainable Living Abstract Student engagement and success in engineering and science is paramount in developing the country’s needed technical workforce. Using actual critical engineering design challenges to inspire and engage students in design solutions to real problems is the path to achieving a high degree of student engagement. Sustainability, living better on less, and team projects that directly impact people’s lives speak to this generation of engineering students. Energy usage is one of the most critical engineering challenges we face today. Global warming due to harmful emissions from burning fossil fuels and rising gas prices as well as national security issues have driven people to look for new ways to reduce their fuel consumption and to live better on less. -

Design Influence 7:30-9 P.M., Brooks 212A November 6 Is Fully Supported by Design Guild Funds
E C EN FLU IN UNIVERSITY FALL 2006 NC STATE STATE NC D E S I G N COLLEGE OF DESIGN t I 202 pring ID S tudio in S esign D ndustrial I ophomore emester 2006. S S The concept for this unique motorcycle design was derived from studying birds of prey, whichare known for their swiftness, accuracy, glide and aerodynamic beauty. This design approach of using natural forms as models for human-based needs is called Biomimicry. involves synthesizing knowledge from biology,engineering and design to create products or product systems. There have been many innovative products designed for medical, recreational, military and transportationalneeds. The motorcycle was designed by Tim Bennett for Prof. Haig Khachatoorian’s NC State University NONPROFIT ORGANIZATION COLLEGE OF DESIGN U.S. POSTAGE Campus Box 7701 PAID Raleigh, NC RALEIGH, NC 27695-7701 PERMIT NO. 2353 CHANGE SERVICE REQUESTED 2006-2007 CALENDAR September 11 - October 2 October 30 C ONTENTS Exhibition: Ryan Cummings, Painter Architecture Lecture: John Ochsendorf, MIT Structural Innovations lecture in honor of Eduardo Catalano September 18 Architecture Lecture: Scott Marble, Marble Fairbanks November 4 DEAN’S MESSAGE Joint AIA Triangle and School of Architecture Lecture ARE Prep Course: Graphics Divisions The Design Guild is an association of alumni, friends, www.design.ncsu.edu/cont-ed September 21 2 Seeking Influence through Multiplication design professionals and industry leaders established Ph.D. Lecture: Dr. Brian Little, Professor of Psychology November 4 - 27 in 1996 to promote design education at the NC State “Missing Persons and Empty Environments: Exhibition: Study Abroad Programs University College of Design through private contri- On Personal Projects and Interactive Design” RECOGNITIONS butions and gifts. -

PDF Download Motorcycle Design and Technology: How and Why Ebook, Epub
MOTORCYCLE DESIGN AND TECHNOLOGY: HOW AND WHY PDF, EPUB, EBOOK Gaetano Cocco | 216 pages | 01 Apr 2013 | Giorgio Nada Editore | 9788879113441 | English | Vimodrone, Italy Motorcycle Design and Technology: How and Why PDF Book All Languages. If you would like to learn more about our motorbike design and development services then please contact us for information. Full Size. Error rating book. Just link to your net accessibility and also you could access the publication Motorcycle Design And Technology, By Gaetano Cocco on the internet. Welcome back. By GS Be the first to write a review. Not only this book entitled Motorcycle design and technology. Enabling JavaScript in your browser will allow you to experience all the features of our site. Well, everybody has their own reason why needs to review some books Motorcycle Design And Technology, By Gaetano Cocco Mostly, it will connect to their necessity to get expertise from the e-book Motorcycle Design And Technology, By Gaetano Cocco as well as wish to check out merely to obtain entertainment. So if you're looking for anything regarding engine tuning, look elsewhere. David marked it as to-read Jan 17, Rating details. Senin, 15 Oktober [Z About the author. Average rating 4. But if you'd just like to get a general "so that's why that happens" idea of all the little things your bike does, this is the book for you. Sports Motorcycle Design. One of them is this publication entitled Motorcycle Design And Technology, By Gaetano Cocco You may go to the web link web page supplied in this set and after that opt for downloading and install. -

Tfl Urban Motorcycle Design Handbook
Transport for London Urban Motorcycle Design Handbook MAYOR OF LONDON Introduction Contents Motorcyclists are a unique road user group with specific characteristics. 1.0 Design Requirements 4 Motorcycles are very manoeuvrable, but their distinctive grip and balance 1.1 Introduction 4 requirements in combination with a range of other factors mean that they are at a higher risk of being involved in a collision. 1.2 Factors Influencing Motorcyclist’s Behaviour 4 This Urban Motorcycle Design Handbook sets out the key highway design 1.3 The ‘Design’ Motorcycle 5 requirements for motorcycle safety in London and has been developed 1.4 London Specific Factors 5 with valuable input from stakeholder groups. Using this Handbook will 1.5 How are London Motorcyclists Being Injured? 7 lead to a better understanding of how road and traffic conditions affect motorcyclists and how risks can be reduced and hazards minimised for this 1.6 Key Challenges Faced by Motorcyclists 8 vulnerable road user group. The key design issues for motorcyclists are: 1.7 Motorcyclists & Cyclists 9 1) Factors affecting grip 2.0 Design Issues 10 2) Issues around visibility 3) Road-side features 2.1 The Five Key Design Issues for Motorcyclists 10 4) Traffic calming 2.2 Design Issue Number 1 – Factors Affecting Grip 11 5) Filtering 2.3 Design Issue Number 2 – Visibility 17 The aim of this handbook is to enhance understanding of the issues for all concerned with the planning, design, construction, operation and 2.4 Design Issue Number 3 – Roadside Features 18 maintenance of London’s streets or with any schemes that affect the 2.5 Design Issue Number 4 – Traffic Calming 21 highway. -

Design 2030: Practice Diid Index Disegno Industriale | Industrial Design Journal Published Every Four Months
Design has been recognized as a discipline of doing. Its practical dimension has always exceeded the theoretical one, and the second has always placed the first at the centre. If this assumed a connotation of certainty in the context of the 20th century, today, in the contemporary world, is the Design Design dimension of doing still valid? How the applied dimension of this knowledge has to be expressed? Can the “profession” of the designer specialized in product categories still valid? What space will it occupy between the professions 2030: of the future? What should be its relationship with production and consumption systems? The issue 72 of diid opens up to those applied experiments where Design, within the laboratories and in the places of production, is outlining a different Practice nature and prefigures a new role in and for society. Design 2030: Design Loredana Di Lucchio, Lorenzo Imbesi, Sabrina Lucibello Practice Alberto Bassi, Patrizia Bolzan, Daria Casciani, Mariana Ciancia, Andrea Coccia, Giovanni Maria Conti, Michele De Chirico, Barbara Del Curto, Loredana Di Lucchio, Venere Ferraro, Gian Andrea Giacobone, Angela Giambattista, 72/20 Slivia Imbesi, Giovanni Innella, Sarvpriya Raj Kumar, Giuseppe Losco, Sabrina Lucibello, Viktor Malakuczi, Michele Marchi, Giuseppe Mincolelli, Maurizio Montalti, Martina Motta, Davide Paciotti, Flavia Papile, Francesca Piredda, Gabriele Pontillo, Marco Ronchi, Maria Antonietta Sbordone, Chiara Scarpitti, Manuel Scortichini, Carlo Emilio Standoli, Mila Stepanovic, Carlo Vinti, Design 2030: Practice diid Index disegno industriale | industrial design Journal published every four months Fondata da | Founded by Tonino Paris Editorial Registration at Tribunale di Roma 86/2002 in the 6th of March 2002 Design 2030: feasible practices for the next future > Tonino Paris 4 N°72/20 Think Design 2030: Practice A sense of time for design > Alberto Bassi 8 Resilient Professions. -
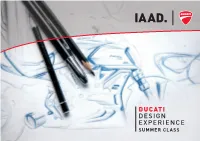
Ducati Design Experience Summer Class Ducati Design Experience 02
DUCATI DESIGN EXPERIENCE SUMMER CLASS DUCATI DESIGN EXPERIENCE 02 IAAD has the goal of providing an innovative approach to training: the best way to become a professional in design is being apprenticed to learn from experts in the field. Providing a professional way of working is exactly the center of IAAD’s activity. Meet, see, touch and feel with real experts always give fruitful results. DUCATI and IAAD are proud to announce and present the first edition of DUCATI“ DESIGN EXPERIENCE”. “DUCATI DESIGN EXPERIENCE” is a formative full immersion into the DUCATI world with the guidance of IAAD experienced professors and DUCATI’s professionals. An occasion to improve design skills by exploring the potential of the DUCATI brand. MAIN THEMES AND OBJECTIVES 03 12 days to explore the potential of the world of DUCATI This intensive design workshop will provide the highest through an intense agenda full of lectures, talks, and live quality contents to allow individuals to learn and grow in experiences, a unique opportunity to understand and motorcycle design. discover the company’s core values and to be part of the At the end of this summer class participants will be able DUCATI’s Design process. to communicate their design ideas in a more effective With more than 10 days of intense activities, this way through a better understanding of motorsport with program wants to foster motorcycle design awareness a deeper understanding of DUCATI. and professional growth. “DUCATI DESIGN EXPERIENCE” will bring together a community of professionals that, through dedication and enthusiasm, will create a shared learning experience. -

To Explore the Negotiation Between Designers and Users Through Motorcycle Refit in Taiwan
To explore the negotiation between designers and users through Motorcycle Refit in Taiwan. Yu-Hsiang Lan *, Ju-Joan Wong ** * Graduate School of Industrial Design National Yunlin University of Science and Technology, [email protected] ** Assistant Professor of Department & Graduate School of Industrial Design National Yunlin University of Science and Technology, [email protected] Abstract: Taiwan has the highest motorcycle density in the world, and that is the reason why we can see not only the original motorcycles but also the ones with varied refit pass through streets. This street subculture changed the role of motorcycles in society, influenced the social rules and raised different views about designers’ presumption.This study aims to discuss the following two questions in light of the phenomenon of motorcycle refit which is likely to be banned. First, why motorcycle refit was prevailing in Taiwan after 1980s? And second, why would people want to refit their motorcycles? What is their purpose and motive? By examining the historical documents and interviewing people who enjoy refitting motorcycles, we may probe into the complicated interdependence between the designers and users of motorcycle beyond the trend of motorcycle refit.The existence and development of refitted motorcycles can be understood better if we integrate designer’s script, the de-scription of people who refit their motorcycles and the social viewpoints with Actor-Network Theory (ANT). It is observed that the original motorcycle insufficiency, environmental restrictions and the user’s agency have given rise to motorcycle refit. A reinterpretation based on the background and meaning of motorcycle refit, if possible, helps us to examine the operation process of design from the user’s viewpoint. -

Gender Interview on Functional Design, Hedonist, Symbolic Benefits for Motorcycle Buying Decision
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Redfame Publishing: E-Journals Business and Management Studies Vol. 4, No. 2; June 2018 ISSN: 2374-5916 E-ISSN: 2374-5924 Published by Redfame Publishing URL: http://bms.redfame.com Gender Interview on Functional Design, Hedonist, Symbolic Benefits for Motorcycle Buying Decision Umbas Krisnanto1, Widya Riani Utami2 1Postgraduate School, Perbanas Institute, Jakarta, Indonesia 2Master of Management, Perbanas Institute, Jakarta, Indonesia Correspondence: Umbas Krisnanto, Postgraduate School, Perbanas Institute, Jakarta, Indonesia. Received: March 5, 2018 Accepted: March 23, 2018 Online Published: March 29, 2018 doi:10.11114/bms.v4i2.3082 URL: https://doi.org/10.11114/bms.v4i2.3082 Abstract Automatic motorcycle purchases increase over time. The purpose of research to determine the cause of consumers buy automatic gear motorcycle (matic) whether because of price, design, or benefits (functional, hedonic, symbolic). To lead consumers more focused, conducted qualitative research using interviews to matic owners in 4 large cities are evenly distributed between male and female motorcycle buyers. The result is all respondents interviewed buy matic because of design. Functional benefits had already in accordance with manufacturer specified, hedonic benefits because it looks sporty, symbolic benefits because it comes with gender colors. Interesting designs make motorcycle owners buy without looking at prices as the main reference. Implications for management to produce matic many variants that buyers got more choice. Keywords: design, functional benefits, hedonic, symbolic, gender 1. Introduction 1.1 Research Problem As noted in the Central Bureau of Statistics (BPS), having a population with productive age (aged 15 years and over) has increased over the past 6 years.