1 Charte Objectifs
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Forcalquier, Le 2 Octobre 2019
COMMUNIQUÉ DE PRESSE Forcalquier, le 2 octobre 2019 Présentation du plan de déploiement de la Fibre aux habitants de Forcalquier et de la Communauté de Communes Pays de Forcalquier - Montagne de Lure David Géhant, Conseiller Régional de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, Gérard Avril, Maire de Forcalquier, les Maires des Communes du Pays de Forcalquier, en présence de Isabelle Simon, Déléguée Régionale de Altice France, SFR région Méditerranée et Laurent Ducret, Responsable Collectivités Locales de SFR FTTH, proposent ce soir aux habitants une information sur le déploiement du réseau LaFibre04. Des caractéristiques et bénéfices de cette technologie aux modalités des travaux qui s’engagent sur ce territoire, en passant par les raccordements et les nouveaux usages induits, ces sujets seront présentés ce mercredi 2 octobre à 18h30, à l’espace culturel La Bonne Fontaine, avenue Saint-Promasse, à Forcalquier. Le plan de déploiement de la Fibre dans la Communauté de Communes Pays de Forcalquier - Montagne de Lure Après une phase d’études détaillées et de relevés terrain, en cours depuis cet été, qui consiste à identifier précisément tous les logements et locaux professionnels à adresser, le réseau Fibre FTTH (Fiber to the Home, c’est-à-dire jusqu’à chaque habitation) se déployera progressivement à partir de trois Nœuds de Raccordement Optique (NRO) qui seront installés à Forcalquier, Saint-Etienne-les-Orgues et Volx. Ces NRO desserviront eux-mêmes une trentaine de Points de Mutualisation (PM) ou armoires de rue répartis sur le territoire communal des villes de Forcalquier, Cruis, Fontienne, Lardiers, Limans, Lurs, Montlaux, Niozelles, Ongles, Pierrerue, Revest-Saint-Martin, Saint-Etienne-les-Orgues et Sigonce. -

Nouveau Territoire D'itinérance
Alpes de Haute-Provence / Provincia di Cuneo nuovo territorio da scoprire - nouveau territoire d’itinérance Produits labellisés Huile d’olive Autoroutes Patrimoine naturel remarquable Olio d’oliva Routes touristiques / Strade turistiche Autostrade Patrimonio naturale notevole Torino Torino Fromage de Banon Carignano Routes principales Espaces protégés Formaggio di Banon Route des Grandes Alpes Asti Strada principale Strada delle Grandi Alpi Aree protette Vins régionaux / Caves / Musées Variante Routes secondaires Sommets de plus de 3 000 mètres Asti Enoteche regionali / Cantine / Musei Pinerolo Strada secondaria Routes de la lavande Montagne >3.000 metri Agneau de Sisteron Strade della lavanda Rocche del Roero Voies ferrées Via Alpina Agnello di Sisteron Ferrovie Itinéraire rouge - Point d’étape Casalgrasso Montà Govone Itinerario rosso – Punto tappa Canale Vergers de la Durance Route Napoléon Ceresole Polonghera S. Stefano Roero Priocca Train des Pignes Strada Napoléon Itinéraire bleu - Point d’étape Faule Caramagna d’Alba Frutteti della Durance Piemonte Monteu Roero Les Chemins de fer Itinerario blu – Punto tappa Castellinaldo de Provence Montaldo Vezza Sommariva Roero d’Alba Magliano Point étape des sentiers de randonnée trekking Racconigi d. Bosco Alfieri Maisons de produits de pays Murello Baldissero Digne-les-Bains > Cuneo Bagnolo Moretta d’Alba Castagnito Points de vente collectifs Piemonte Sanfrè Corneliano Punto tappa dei sentieri di trekking Cavallerieone Sommariva d’Alba Aziende di prodotti locali Perno Digne-les-Bains > Cuneo Rucaski Cardè Guarene Neive Raggruppamento di produttori con vendita diretta Villanova Piobesi M. Granero Torre Monticello Solaro d’Alba 3.171 m Abbazia S. Giorgio Pocapaglia d’Alba Barbaresco Barge Staffarda Castiglione Marchés paysans C. d. -

La Fibre Poursuit Son Déploiement Dans Les Alpes Du Sud Et Arrive À Château-Arnoux-Saint-Auban !
COMMUNIQUÉ DE PRESSE Château-Arnoux-Saint-Auban, le 22 avril 2021 La fibre poursuit son déploiement dans les Alpes du Sud et arrive à Château-Arnoux-Saint-Auban ! 20 mois après le démarrage du chantier, les déploiements réalisés par Xp Fibre dans le cadre de l’AMEL porté par la Région Sud et les 3 Départements - Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence et Bouches-du- Rhône – se poursuivent : 9 Nœuds de Raccordement Optique sont en service et 160 Points de Mutualisation installés 120 000 prises fibre sont construites, dont près de 34 107 dans les Alpes-de-Haute-Provence 86 000 logements et locaux sont éligibles à la fibre, dont 23 825 dans les Alpes-de-Haute-Provence La fibre arrive à Château-Arnoux-Saint-Auban où 1 180 logements sont désormais éligibles à la fibre. Aujourd’hui, René Villard, Maire de Château-Arnoux-Saint-Auban, René Massette, Président du Conseil Départemental des Alpes-de-Haute-Provence, Patrick Vivos, Vice-président de Provence Alpes Agglomération délégué au développement de l’accès aux ressources numériques et aux services publics, Eliane Bareille, Vice-présidente de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur en charge de la ruralité et du pastoralisme, Isabelle Simon, Déléguée Régionale Méditerranée Altice France et Laurent Ducret, Responsable Relations Collectivités Locales Xp Fibre (anciennement SFR FTTH) étaient présents à Château-Arnoux-Saint-Auban pour l’arrivée de la fibre optique sur la commune. Ouverture du service fibre à Château-Arnoux-Saint-Auban Les premiers raccordements fibre sont disponibles pour les habitants et les entreprises dès ce mois-ci à Château-Arnoux-Saint-Auban après l’installation d’un Nœud de Raccordement Optique et de 10 Points de Mutualisation permettant la desserte en fibre de près de 3 000 logements. -

Les Habitants Et Intermédiaires Quant À Eux Représentent Résidences Secondaires + Dotations 30 % (25,4% Sur Le Département)
Elaboration du Schéma de Développement Economique – Diagnostic – Forcalquier ● Lure 2030 Un projet partagé, pour une économie territoriale durable 17/01/2019 Une démarche animée par Préambule ▷La démarche Forcalquier-Lure 2030 1 - Diagnostic 2 - Stratégie 3 - Feuille de route Interroger le présent Imaginer l’avenir Construire l’avenir Atelier « Idées Reçues » Ateliers thématiques Appel à initiatives Entretiens Séminaire prospectif Groupes de travail Analyse statistique 17/01/2019 Préambule « Celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut savoir où il va car il ne sait pas où il est. » Otto de Habsbourg-Lorraine ▷Ce document constitue le principal livrable de la phase DIAGNOSTIC de la démarche Forcalquier-Lure 2030. Il s’agit d’un point de départ essentiel à la réflexion stratégique. ▷Il vise à poser un regard objectivé sur le territoire, aujourd’hui et à la lumière des évolutions qu’il a connues par le passé. Il s’attache également à mettre en perspective le territoire avec ses voisins et/ou d’autres périmètres de référence (département, région). ▷Ce travail statistique et cartographique se veut donc complémentaire d’une lecture plus vivante du territoire, telle qu’elle a été construite dans l’atelier « idées reçues » ou au cours des quelques entretiens menés auprès d’acteurs économiques locaux. ▷Ce document a été élaboré par Argo&Siloe sur la base de données issues de la statistique publique et à l’appui de plusieurs contributions institutionnelles (CCI04 pour le compte de l’AD04, CMA-R PACA). ▷Les commentaires et analyses contenues n’engagent que leur auteur. 17/01/2019 3 Sommaire Cliquez sur un titre pour accéder directement a chapitre recherché 1. -

Irresistible GB.Indd
PRESS KIT « I’m off now » ALPES DE HAUTE PROVENCE 2020 « The day you set o is the day the sun shines bright ». Jean GIONO The Alpes de Haute Provence is all of these : Health, nature, culture, quality of life and exceptional landscapes : tourism is a key strategic sector for the depart- ment. It generates a large number of jobs, incomes and added value for the other economic sectors. It plays an important role in the spatial planning of the Alpes de Haute Provence. In the heart of the Région Sud – Provence-Alpes-Côte d’Azur ! We are at a crossroads… less than one hour from the Hiking 6,600 km of marked trails Mediterranean, the French Riviera, Nice, Marseille, Avignon, Briançon and a stone’s throw from Italy…. We are located in the Unesco Heritage Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Vaucluse and Hautes-Alpes departments ! Luberon Nature Regional Park Haute Provence Geopark And people even like to say that the sky seems so near that we can touch the stars. Thermalism and well-being Vauban fortification heritage Gréoux-les-Bains : 35,000 spa clients Roman bridges in Annot and Céreste Digne-les-Bains : 6,000 spa clients Roman bridges in Lurs and Ganagobie Winter Sports A reference territory for fragrances 9 alpine ski resorts and 6 Nordic skiing sites Cosmetics 16.5 to 18 million Euros ski lift turnover (average over 6925 km£ : one of the biggest departments in France 33 firms, 770 salaried workers and an internationally last 5 years) 162, 000 inhabitants famous leader, L’Occitane en Provence 260 metres : the lowest point, in the Durance valley 3,412 metres : the highest point, in the Alps (Aiguille du Chambeyron) An exceptional natural heritage A reference territory for flavours The largest canyon in Europe, The agri-food industry represents 160 firms and 1,500 2.5 million tourists The biggest high mountain lake in Europe, jobs. -

Forcalquier • Sigonce •
Commerces et services sur le parcours 10 Shops and services on the way Boucle de découverte en vélo Niveau Forcalquier Sigonce Pierrerue Niozelle Forcalquier • Sigonce • Level Commerce / Shop √ √ Pierrerue • Niozelles • découverte Pharmacie / Pharmacy √ discovery Restaurant √ √ √ Un grand circuit au coeur du Pays de Forcalquier... Distance Café / Pub √ √ √ parmi les champs de lavande et de coquelicots tout en 30 km / 19 miles / Repairshop traversant des petits villages qui ont conservé leur Réparateur √ charmes. A large loop in the heart of the Pays de Forcalquier among Dénivelé cumulé Difference of heights Taxis fields of lavender and poppies. You will also cross some Taxi Forcalquieriens - Tél. 04 92 75 34 34 - 06 07 61 47 95 charming villages during your ride. 363 m Accompagnateur / guide / Sightseeing throughout this itinerary Jean-Louis DELPIANO - Tél. 06 80 06 25 08 - e-mail : [email protected] A voir sur l’itinéraire Forcalquier : Office de Tourisme 04 92 75 10 02 Recommandations / Recommandations La vieille ville de Forcalquier est pleine de charme avec ses ruelles étroites, ses petites Vous devez partager la route avec d’autres usagers, soyez prudent, particulièrement si des enfants vous places ombragées et ses belles demeures anciennes. Faites un tour à la citadelle pour accompagnent. Attention au soleil et à la chaleur surtout en été, prévoyez eau et chapeau. admirer le paysage qui s’étire devant vous et ne manquez pas le marché du lundi matin. Respectez les règles de sécurité routière : ne roulez pas à 3 ou plus de front. Vous pouvez circuler à deux de The old city is a charming place with narrow streets, small shaded places and beautiful ancient front si aucun autre véhicule ne se présente sinon, mettez vous en file indienne. -

Niozelles 23 Octobre Entre Forcalquier Etlabrillanne Rencontres Enforêt, Animations, De La Calèches, Restauration
journée L’ Unesco a labellisé Les sylvo-gestes les quatre saisons 2011 de la journée de la J ’opte pour le covoiturage ou pour un mode Année forêt internationale de déplacement alternatif comme le vélo. 2011 J e me gare sur les parkings organisés. des forêts. J e garde mes déchets et mes mégots et je les Venez découvrir en famille les jette dans les poubelles prévues à cet effet. secrets des forêts du Luberon J e découvre le principe des toilettes sèches et de la montagne de Lure ! et je ne vais pas dans le milieu naturel… A l’occasion de cette journée conviviale, vous rencontrerez J e suis accueilli dans la forêt d’un propriétaire Ne pas jeter sur la voie publique pas jeter sur la voie Ne les acteurs et les profession- privé. Je respecte le site et ne cherche pas nels de la forêt qui vous feront à sortir des limites de la propriété. partager leur passion et leurs , La Brillanne connaissances sur les arbres, Montagne de Lure Sisteron le bois, la nature en forêt, la Gap gestion sylvicole… Revest Saint-Martin Digne Vous y comprendrez comment Sigonce les collectivités s’engagent en Lurs faveur des espaces forestiers Imprimerie de haute Provence Forcalquier Pierrerue grâ ce aux actions de leurs char- Banon tes forestières de territoire. Mane La Brillanne Entrée Niozelles Les enfants pourront participer , Niozelles à de nombreux jeux et activités libre Volx 10-17 h de découverte… et grimper aux arbres ! Karine Girault Manosque 1 Apt vignon A5 A 23 octobre Nous vous attendons Luberon nombreux pour ce jour Aix Création graphique de fête forestière ! Niozelles RENSEIGNEMENTS 04 90 04 42 00 entre Forcalquier et La Brillanne www.parcduluberon.fr www.forcalquier-lure.com rencontres en forêt, animations, jeux pour enfants, conférences et causeries, COMMISSION EUROPÉENNE démonstrations professionnelles, exposants, Fonds social européen RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Communauté de communes MAIRIE de NIOZELLES calèches, restauration.. -

Le Document Contractuel Manosque
Contrat de canal de Manosque Synthèse du Contrat de Canal de Manosque JEUDI 23 JUILLET 2009 Un canal et son territoire cultivent leur avenir Réussir le CONTRAT Sommaire I- Le territoire : DE CANAL DE MANOSQUE De château-Arnoux Saint-Auban à Corbières Le Contrat de Canal I. Le territoire : p. 1 Un territoire cohérent d’un - Le ravin du Beuvon de Manosque, signé De château-Arnoux point de vue de la gestion - Le ravin du Pont-Bernard Saint-Auban à Corbières - Le ravin du Buès entre les 39 partenaires de la ressource en eau brute - Le ravin de Peyredul du territoire composé • Un territoire cohérent d’un - Le Lauzon point de vue de la gestion ▼ des 13 communes En rive droite de la Moyenne Durance entre - Le ravin de Saint-Saturnin de la ressource en eau brute Château-Arnoux et Corbières, dans le département - Le Largue traversées par le canal • La vie et les activités du des Alpes de Haute-Provence, d’une superficie de - Le ravin de la Tuilière (ou de la Magdeleine) de Manosque, consti- territoire 270 km2 : - Le ravin de Valvéranne tuera désormais un cadre pour la gestion : du canal, • Château-Arnoux Saint-Auban - Le ravin de Couquières (ou d’Espel) II. Un projet partagé p. 7 tenant compte de l’ensemble des usages et services qu’il • Montfort - Le ravin de Drouille (ou de Saint-Martin) pour gérer la ressource • Peyruis - Le Ridau procure à la population, et de la ressource en eau dudit en eau du territoire, • Ganagobie - Le torrent du Chaffère territoire. le canal de Manosque • Lurs - Le torrent de Corbières. -

Communauté De Communes Pays De Forcalquier-Montagne De Lure
Communauté de communes PAYS DE FORCALQUIER MONTAGNE DE LURE SOMMAIRE Entrepreneuriat et 7 POTENTIEL ÉCONOMIQUE Edito LE TOURISME, 3 un pan essentiel 10 de l’économie locale Communauté de communes 4 PAYS DE FORCALQUIER ATOUTS ET SPÉCIFICITÉS MONTAGNE DE LURE 12 du territoire Un des territoires les plus Un territoire ATTRACTIFS DU NUMÉRIQUE 5 DÉPARTEMENT 14 Contact Agence Les projets de Développement Dominance du ÉCONOMIQUES ET TOURISTIQUES des Alpes SECTEUR TERTIAIRE 6 15 DU TERRITOIRE de Haute-Provence [email protected] +33 (0)4 92 31 57 29 Ressources documentaires Population : Insee, Recensement de la population 2017 Offre touristique : AD04, APIDAE, OTI, Atout France, Plateforme Accès internet et couverture réseau mobile 3G : France Très Emploi : CCI04, Insee, CLAP 2017 Class, 2018 Haut Débit, 2018 / ARCEP, 2018 Transmission d’entreprise : Enquête auprès des entreprises du Fréquentation touristique : AD04, FVT Orange, 2017 Les entreprises et le numérique : Enquête au 1er trimestre territoire réalisée en septembre 2017, CCI04 Emploi touristique : CRT PACA - JLJECO - base COMETE, 2015 2017 auprès de entreprises implantées dans une commune de la Agriculture : Agreste, recensements agricoles 2010 Consommation touristique : AD04, CRT PACA, Enquête régionale CCPFML, CCI04 Ressources forestières : Observatoire régional de la forêt méditerranéenne auprès des clientèles touristiques 2010/2011/ AD04, FVT, 2017 Ce document a été réalisé avec le concours financier de l’Etat, la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur. - Coordination : Agence de Développement -
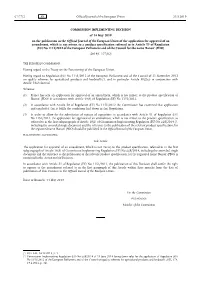
Commission Implementing Decision of 14 May 2019 On
C 177/2 EN Official Journal of the European Union 23.5.2019 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 14 May 2019 on the publication in the Official Journal of the European Union of the application for approval of an amendment, which is not minor, to a product specification referred to in Article 53 of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council for the name ‘Banon’ (PDO) (2019/C 177/02) THE EUROPEAN COMMISSION, Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, Having regard to Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs (1), and in particular Article 50(2)(a) in conjunction with Article 53(2) thereof, Whereas: (1) France has sent an application for approval of an amendment, which is not minor, to the product specification of ‘Banon’ (PDO) in accordance with Article 49(4) of Regulation (EU) No 1151/2012. (2) In accordance with Article 50 of Regulation (EU) No 1151/2012 the Commission has examined that application and concluded that it fulfils the conditions laid down in that Regulation. (3) In order to allow for the submission of notices of opposition in accordance with Article 51 of Regulation (EU) No 1151 /2012, the application for approval of an amendment, which is not minor, to the product specification, as referred to in the first subparagraph of Article 10(1) of Commission Implementing Regulation (EU) No 668/2014 (2), including the amended single document and the reference to -

TRESORERIE GENERALE Comptes De Gestion Des Communes, Des Structures Intercommunales. 1995 1075 W 0001 Communes De Braux, Le Fuge
- Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence - TRESORERIE GENERALE Comptes de gestion des communes, des structures intercommunales. 1995 1075 W 0001 Communes de Braux, Le Fugeret, Méailles, Saint-Benoît, Ubraye, Vergons, SIVOM Canton d'Annot, SIVU Orée du Mercantour : budget, compte de gestion, pièces comptables. 1075 W 0002 Communes de Cruis, Fontienne, Lardiers, Mallefougasse, Montkaux, Montsalier, Ongles, Redortiers, Revest des Brousses, La Rochegiron, Saumane, SIVU Voierie de Saint- Etienne, SI Epuration des Eaux Saumane/L'Hospitalet : budget, compte de gestion, pièces comptables. 1075 W 0003 Commune de L'Hospitalet : budget, compte de gestion, pièces comptables, pièces justificatives (collectivité témoin). 1075 W 0004 Commune de Revest-Saint-Martin : budget, compte de gestion, pièces comptables, pièces justificatives (collectivité témoin). 1075 W 0005 Commune de Pontis : budget, compte de gestion, pièces comptables, pièces justificatives (collectivité témoin). 1075 W 0006 Commune de Faucon de Barcelonnette : budget, compte de gestion, pièces comptables, pièces justificatives (collectivité témoin). 1075 W 0007 Communes de Chaudon-Norante, Blieux, Majastres, Saint- Jacques, Saint-Lions, Senez, Tartonne, Demandolx, La Garde, Archail, Barras, Le Castellard-Mélan, Draix, Entrages, Marcoux, Mirabeau, La Robine sur Galabre, Communauté de Communes des Hautes-Duyes, SIVOM canton de La Javie, SIVOM de Senez, SIVU Voie Impériale, SIT Barrême, : budget, compte de gestion, pièces comptables. 1075 W 0008 Commune de Clumanc : budget, compte de gestion, pièces comptables, pièces justificatives (collectivité témoin). 1075 W 0009 Commune de Rougon : budget, compte de gestion, pièces comptables, pièces justificatives (collectivité témoin). 1075 W 0010 Commune de Rougon : budget, compte de gestion, pièces comptables + échantillon pièces justificatives. 1075 W 0011 Commune de Beaujeu : budget, compte de gestion, pièces comptables, pièces justificatives (collectivité témoin). -
Pays De Forcalquier Montagne De Lure
PaysPays dede ForcalquierForcalquier MontagneMontagne dede LureLure Pays de Forcalquier Montagne de Lure 2009-20102009 Guide pratique Un réseau de commerces et de professionnels à votre service, et plein d’autres informations pratiques OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL Le Pays de Forcalquier Montagne de Lure, Un pays qui vit toute l’année Cartographie illustrée : ©Joseph Michalski illustrée : ©Joseph Cartographie Ce guide concerne les communes de la communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure (Cruis, Fontienne, Forcalquier, Lardiers, Limans, Lurs, Montlaux, Niozelles, Ongles, Pierrerue, Revest-Saint-Martin, Saint- Étienne-les-Orgues, Sigonce), symbolisées par sur la carte. Toutes les informations sont données à titre indicatif, sous la seule responsabilité des annonceurs et ne sauraient entraîner la responsabilité de l’offi ce de tourisme. 2 Un accueil à votre service Afi n de mieux vous servir, l’offi ce de tourisme intercommunal Pays de Forcalquier Montagne de Lure vous propose ce nou-veau guide. Vous y trouverez une multitude d’informations pratiques montrant la diversité et la qualité de nos commerces, de nos professionnels et de nos produits. Que vous soyez habitant, visiteur ou nouvel arrivant, nous l’avons pensé pour vous ! Sommaire Commerces . p. 4 à 10 Artisans . p. 11 à 12 Produits de terroir. p. 13 à 15 Loisirs & Sports. p. 16 à 18 Culture & Art . p. 19 à 21 Services : administration, éducation, formation, santé, autres professions libérales . p. 22 à 26 Côté pratique : accès Internet, lignes de cars, distributeurs de billets, marchés, numéros utiles . p. 27 Les informations sont classées par ordre alphabétique d’activité et par ordre alphabétique de communes.