Ethnologie De Personnes `` Sans Logis '' À Paris
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
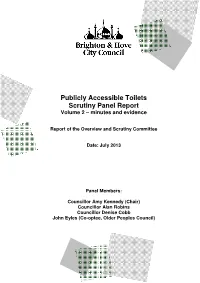
Publicly Accessible Toilets Scrutiny Panel Report Volume 2 – Minutes and Evidence
Publicly Accessible Toilets Scrutiny Panel Report Volume 2 – minutes and evidence Report of the Overview and Scrutiny Committee Date: July 2013 Panel Members: Councillor Amy Kennedy (Chair) Councillor Alan Robins Councillor Denise Cobb John Eyles (Co-optee, Older Peoples Council) 2 Contents Page No 1. Schedule of meetings p4 2. Minutes – 25.01.13 public meeting p5 3. Minutes – 11.02.13 public meeting p16 4. Minutes – 26.02.13 public meeting p29 5. Written evidence p41-64 • Briefing on the public health implications of publicly accessible toilets p41 • E-Petition on Public Toilets for the city started by Valerie Paynter of SaveHove p43 • Talk to OPC from the National Association of Crohn’s & Colitis (NACC) p45 • Written submission from a member of the IBD panel p48 • Written submission from a resident p49 • Written information on public toilets compiled by Brighton & Hove Link p50 • Written submission re: proposed public toilet cuts from Crohn’s & Colitis UK p54 3 1. Publicly Accessible Toilets Scrutiny Panel Schedule of meetings Date Purpose Private scoping meeting 25.01.13 Public meeting 11.02.13 Public meeting 26.02.13 Public meeting 4 2. Minutes of the public evidence gathering meeting -25.01.13 BRIGHTON & HOVE CITY COUNCIL SCRUTINY PANEL ON PUBLICLY ACCESSIBLE TOILETS 3.00pm 25 JANUARY 2013 BANQUETING ROOM, HOVE TOWN HALL MINUTES Present : Councillors Kennedy, Cobb, and Robins, John Eyles (Co-optee, OPC) Also in attendance : Jenny Cooke, Jan Jonker, Adam Bates, Mike Holford, Peter Castleton, Tom Hook and Karen Amsden PART ONE 1. CHAIR'S INTRODUCTION The Chair thanked everyone for coming to the first public meeting of this scrutiny panel and congratulated officers on yet again being assessed as the top local authority in the National Loo of the Year award for the third year running. -

Deep Green California: Taken Legal Action Against Hoffman for His Many I Was Being Shown a Giant Toilet in West Marin, Admitted Building-Code Violations
project news main feature futurarc interview futurarc showcase projects people commentary happenings books products/technology “If you have an iPhone with a light, maybe you atmosphere of the Last Resort for hours on can get a picture.” inspection visits—Marin county authorities have Deep Green California: taken legal action against Hoffman for his many I was being shown a giant toilet in West Marin, admitted building-code violations. He attributes a network of sunny hills hard on the San Francisco this to the changing of the guard at the building CoDes, stanDarDs, anD bay—where the air is as clean and crisp as a office—the retirement of an older generation piece of freshly unwrapped peppermint gum. This he believes deeply appreciated the dozens of Creativity in resiDential remained true even as I stood by a large cement buildings on his sprawling hillside compound: chamber the size of a tool shed filled with worms, equal parts tea shrine, Tibetan Buddhist temple, landscaping clippings, and what my host, the well- and cluttered laboratory for a lifelong salvager, BuilDinG known tea importer David Lee Hoffman, called tinkerer, and visionary. Stacks of tools and pipe by Jalel Sager Jalel Sager is a writer and PhD student in the “humanure”. As he spoke, Hoffman held a large fittings surround Buddhist statues and share Energy and Resources Group (ERG) at the University of California—Berkeley, studying climate change handful of the dark humus—mature compost— table space with pewter figures engaged in and socio-ecological systems. Previously, he was from the chamber. Bringing it to his nose, he took traditional methods of making Pu’er tea—a the founding director of the Vietnam Green Building a deep breath, exhaling happily. -

Table of Contents
editorial note index amber 832, 1028 American Dream 753 American Institute of Architects “a major modification of the human organism, 21 Club 601, 697 (AIA) 106, 150, 695, 816, 858, 869, 1066, namely its ability to pay attention, occurred when 3D printing 114, 159, 1449 2159, 2277 a major cultural innovation, domestication, was 9/11 676, 685, 844, 918–919, 1382, 1387, American Restroom Association adopted. … the house … should be viewed as 1760–1761, 2130 641, 695, 1646 Aalto, Alvar 639, 762, 772–773, 859 American Society of Heating a technical and cognitive instrument, a tool for aboriginal 1058, 1430 Refrigeration and Air Conditioning thought as well as a technology of shelter.” Abraj Al-Bait tower, Mecca 703, 786 Engineers 814, 825, 858 absolutism 900–901 American Society of Mechanical — Peter J. Wilson, The Domestication of Abu Dhabi 125, 480, 537, 1047, 1430, Engineers 290, 380, 2041, 2117 1551, 2288 American Standard 785, 1601, 1624, the Human Species (Yale, 1988). Acconci, Vito 59, 63 1673, 1675, 1680, 2279, 2281, 2286 Ackerman, James 898, 2333 American Standards Association 183 When our species domesticated itself – started acoustics 150, 203, 223, 260–261, Americans with Disabilities Act, living in permanent dwellings rather than 264–265, 267–269, 272, 274, 279, 304, 1990 1648, 1721, 1764 temporary encampments – architecture remade 348, 352, 360, 380, 485, 825, 1150 Ammannati, Bartolomeo 1936, 1963 Acropolis 900 amphitheater 1094, 1166, 1247, 2136, our sensory world in a revolution never seen acrylic 813, 842, 949, 1016, 1394 -

Public Toilets the Implications In/For Architecture by Allaa Mokdad Advisor Deirdre Hennebury
Public Toilets The Implications In/For Architecture By Allaa Mokdad Advisor Deirdre Hennebury A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Architecture in The Lawrence Technological University [2017-2018] Acknowledgments Thank you to my advisor Dr Deirdre Hennebury for all the guid- ance and support in this research inquiry; and my mom and dad and the rest of the Mokdads for all their support during the process. Preface “The toilet is the fundamental zone of interac- tion-on the most intimate level-between humans and architecture. It is the architectural space in which bodies are replenished, inspected, and culti- vated, and where one is left alone for private re- flection- to develop and affirm identity” - Koolhaas, 2014 Content Introduction 1 Abstract 2 Research Method 3 Nomenclature 4 Guiding Questions Theory 5-6 Public Toilet 7 Public 8 Private 9 Toilet Analysis 10 Introduction 11-12 Timeline 13 Definitions 14-24 London 25-31 Paris 32-38 New York 39 Conclusion 40-41 References Abstract A reflection of societal values, the public toilet is a politicized space that provides sanitation in the public realm. In addition to its role in sup- porting a basic human need through sanitation provision, the public toilet is also a space that provides solidarity in the face of congestion, a place where one develops and affirms identity [Koolhaas, 2014]. In the nineteenth century through the twen- ty-first century, the public toilet has shifted from an external urban condition to an interiorized urban issue. It once stood as a symbol of moder- nity in the congested streets of industrial cities, and progressed to be prominently featured in ac- cessibility debates. -

The Provision of Public Toilets
House of Commons Communities and Local Government The Provision of Public Toilets Twelfth Report of Session 2007–08 Report, together with formal minutes, oral and written evidence Ordered by The House of Commons to be printed 6 October 2008 HC 636 Published on 22 October 2008 by authority of the House of Commons London: The Stationery Office Limited £0.00 Communities and Local Government Committee The Communities and Local Government Committee is appointed by the House of Commons to examine the expenditure, administration, and policy of the Department for Communities and Local Government and its associated bodies. Current membership Dr Phyllis Starkey MP (Labour, Milton Keynes South West) (Chair) Sir Paul Beresford MP (Conservative, Mole Valley) Mr Clive Betts MP (Labour, Sheffield Attercliffe) John Cummings MP (Labour, Easington) Jim Dobbin MP (Labour Co-op, Heywood and Middleton) Andrew George MP (Liberal Democrat, St Ives) Mr Greg Hands MP (Conservative, Hammersmith and Fulham) Anne Main MP (Conservative, St Albans) Mr Bill Olner MP (Labour, Nuneaton) Dr John Pugh MP (Liberal Democrat, Southport) Emily Thornberry MP (Labour, Islington South and Finsbury) Powers The Committee is one of the departmental select committees, the powers of which are set out in House of Commons Standing Orders, principally in SO No 152. These are available on the Internet via www.parliament.uk. Publications The Reports and evidence of the Committee are published by The Stationery Office by Order of the House. All publications of the Committee (including press notices) are on the Internet at www.parliament.uk/clgcom Committee staff The current staff of the Committee are Huw Yardley (Clerk of the Committee), David Weir (Second Clerk), Andrew Griffiths (Second Clerk), Sara Turnbull (Inquiry Manager), Josephine Willows (Inquiry Manager), Clare Genis (Committee Assistant), Gabrielle Henderson (Senior Office Clerk), Nicola McCoy (Secretary) and Laura Kibby (Select Committee Media Officer). -

Title: Sanitary ® P100 Slim Macerator Sanitary Pump WC+2 Bath/Sink
Title: Sanitary ® P100 Slim Macerator Sanitary Pump WC+2 Bath/Sink Water Waste 3 in 1 600W UK! PRODUCT DESCRIPTION This system allows transporting sewage from the most remote areas in your house. Possible to connect 1 toilet and unlimited other sanitary devices (bath, shower, sink,) on one entry. Also suitable for dishwashers and washing machines. Includes all accessories to connect a toilet and multiple other sanitary devices. Plastic covers are included to close the entries that are unused. Up to 70m horizontal discharge, 7m vertical discharge. The shower outlet must be a minimum of 210mm above floor level. POWERFUL EFFICIENCY Macerator pumps enable you to extend your property's plumbing system, so that you can install a new toilet or other water facility wherever you want. This compact macerator pump offers reliable lifting power and macerates solids, so that water and waste can be moved to and from any point in your house. This compact pump is powerful enough to lift fluids up to 5.5m, or propel them vertically up to 60m. This means that it is typically powerful enough for use throughout the average house, but it is compact enough to be installed in even cramped locations. This macerator can also deal with plenty of waste thanks to a stainless steel cutting mechanism, which makes it easier for the pump to transport the materials. This is a durable and efficient sewage pump which lets you make the most of your property. • transports water up to 5.5 m upwards or up to 60 m far • suitable for most sanitary facilities (e.g. -

Delft University of Technology Design for Sanitation How Does
Delft University of Technology Design for Sanitation How does design influence train toilet hygiene? Loth, M. DOI 10.4233/uuid:1d5f7ea6-8464-48dd-b593-f2cba9c1f493 Publication date 2021 Document Version Final published version Citation (APA) Loth, M. (2021). Design for Sanitation: How does design influence train toilet hygiene?. https://doi.org/10.4233/uuid:1d5f7ea6-8464-48dd-b593-f2cba9c1f493 Important note To cite this publication, please use the final published version (if applicable). Please check the document version above. Copyright Other than for strictly personal use, it is not permitted to download, forward or distribute the text or part of it, without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license such as Creative Commons. Takedown policy Please contact us and provide details if you believe this document breaches copyrights. We will remove access to the work immediately and investigate your claim. This work is downloaded from Delft University of Technology. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to a maximum of 10. Design for Sanitation How does design influence train toilet hygiene? Marian Loth Design for Sanitation How does design influence train toilet hygiene? Dissertation for the purpose of obtaining the degree of doctor at Delft University of Technology by the authority of the Rector Magnificus prof.dr.ir. T.H.J.J. van der Hagen chair of the Board for Doctorates to be defended publicly on Friday 23 april 2021 at 12:30 o’clock by Maria LOTH Master of Science in Industrial Design Engineering, Delft University of Technology, the Netherlands born in Bunnik, the Netherlands This dissertation has been approved by the promotors. -

The Quest for Melbourne's Best Public Toilets Continues… ARCHITECTURAL IDEAS COMPETITION for a NEW MELBOURNE PUBLIC TOILET 1
The quest for Melbourne's best public toilets continues with the ARCHITECTURAL IDEAS COMPETITION FOR A NEW MELBOURNE PUBLIC TOILET as part of GT3, the third and mightiest incarnation of the Golden Toilet Awards Preamble: Public toilet design in the last decade has moved to a model of single stand alone toilets. This is an alternative to the bulk of Melbourne's historic public toilets that have multiple cubicles or cater for the use of several people at one time. The 'Exeloo' that has been installed in several prominent locations is a proprietary version of this function. GTIII aims to work with toilet zeitgeist and propose a single stand alone unit; however we would hope that design proposals would deal with the bearing of ones unspeakables in a public place such that it is more site specific, fun and explores the rich variety of social and personal rituals that occur in these tiny spaces. Location: The median strip on Russell Street immediately north of Bourke Street. The design should fit between (incorporate?) the existing trees and not encroach into the road carriageway. Height is limited by sensibility. This location has been investigated by council for a toilet, however, due to the approval and consultation process involved in erecting any new public convenience, the winner of this competition will not receive a commission to build their design. Of historical interest is the fact that Melbourne’s first underground public toilet, and Australia’s oldest, exists below ground, to the south of this intersection where the sculpture now sits. It has been sand filled for preservation. -

Civil Complaint
' . ' ' 1 Kevin T. Snider, CA SBN 1709881 Michael J. Peffer, CA SBN 192265 2 Matthew B. McReynolds CA SBN 234797 APR 1 4 Z016 PACIFIC JUSTICE INSTITUTE 3 212 9th Street, Suite 208 CLERK OF THE COURT Oakland, CA 95827 BY: t}OWMAN LIU 4 Tel.: (510) 834-7232 Deputy Clerk Fax:(916)834-8784 5 E-mail: [email protected] 6 Conrad Reynoldson, WA SBN 481872 WASHINGTON CIVIL & DISABILITY ADVOCATE 7 4421 51 51 A venue N mtheast Seattle, WA 98105 8 Tel. : (206) 855-3134 9 E-mail: Comad,[email protected] 10 Attorneys for Plaintiffs 11 SUPERIOR COURT OF CALIFORNIA 12 COUNTY OF SAN FRANCISCO 13 SAN FRANCISCO CHINESE CHRISTIAN Case No. CGC · 16-551486 14 UNION, RICHARD LAM, PEGGY LAM, PATRICK SULLIVAN, SYLVIA 15 COMPLAINT FOR DECLARATORY AND TERPSTRA, INJUNCTIVE RELIEF 16 Plaintiffs, [CCP §526a] 17 vs. 18 CITY AND COUNTY OF SAN FRANCISCO, 19 PIDLIP ALAN GINSBURG, GENERAL 20 MANAGER, RECREATION AND PARKS DEPARTMENT, in his official capacity, 21 Defendants. 22 23 24 25 26 27 1 Counsel of record and for service. 28 2 Application for pro hac vice pending. -1- Complaint .. COMES NOW PLAINTIFFS who allege as follows: 2 3 Introduction 4 The City and County of San Francisco has installed a three-inch hole in the center of a three- 5 foot diameter concrete base for public urination. This hole is called a pissoir. It is located at the 6 southwest quadrant of Mission Dolores Park at a busy street corner, between a sidewalk and a train 7 stop. Persons urinate into the hole in public view. -

The CIB W062 36Th International Symposium Water Supply And
Female Urinals M. Demiriz [email protected] Fachhochschule Gelsenkirchen University of Applied Sciences, D 45977 Gelsenkirchen, Germany Abstract Despite the fact that sev eral female urinals have been developed several decad es ago, they have not been successfully m arketed in Europe. Two new types of fe male urinals were developed, constructed and tested. Before developing the fe male urinals, interviews among users of public restroom s have been con ducted. Additionally, user surveys were carried out for the new fem ale urinals. Eventually, re sults of all of the surveys and long term testing will be presented and discussed Keywords Female urinal, water saving efficiency, drainage design. 1 Introduction The call for female urinals is old, which has good reasons. A lot of women are afraid of getting infected with illnesses by touching toil et seats in public restroom s. Therefore, a lot of women try to su ppress their need to urinate and co ntain their urine until they reach their own bathro om - which has been proven to result in health problems: for instance, recurrent infections of the urogenital tract wh ich may even harm the upper urinary tract [1]. Several stud ies showed that 60 percent of th e women with ureter infections have an enlarged bladder because of containing their urine [2]. Moreover, a chronic straining of the bladder can lead to the loss of the contraction ability and result in incontinence and other illnesses [3, 4]. Furthermore, using a WC m eans longer waiting time than to be e xpected for using a urinal. -

Toilets of the World Free
FREE TOILETS OF THE WORLD PDF Morna E. Gregory,Sian James | 256 pages | 01 Sep 2009 | Merrell Publishers Ltd | 9781858944999 | English | London, United Kingdom Toilets From Around the World | One Point Partitions It's the one spot in every home that all members of the family use on a regular basis, from California to Dubai. Culture, custom, habit and convenience all dictate a society's notion of what defines a Toilets of the World toilet ," even though this humble household item is often taken for granted. Toilets of the World do what we do where we Toilets of the World it, with little ado, due to the toilet's unassuming quality in our lives. It's hardly any wonder, then, that so many folks are startled when encountering their first foreign toilet. Chances are, you might be surprised at Toilets of the World of the international Toilets of the World, both public and privately maintained, that the world has Toilets of the World offer a weary traveler. Across the globe, the toilet has evolved within sets of specific cultural traditions. Since each Toilets of the World has a different concept of hygiene, access to disposable paper and water availability, our body's most natural functions have been dealt with in a variety of ways. Despite complaints about airline bathrooms, plan an international excursion and you may find that the airplane toilet was the last vestige of Toilets of the World hometown bathroom expectations. But you'll also find that the world offers a myriad of ways for one to "get down to business. -

Urination Needs and Practices Away from Home: Where Do Women Go?
SCOTT, SOHAIL & CAVILL 40th WEDC International Conference, Loughborough, UK, 2017 LOCAL ACTION WITH INTERNATIONAL COOPERATION TO IMPROVE AND SUSTAIN WATER, SANITATION AND HYGIENE SERVICES Urination needs and practices away from home: where do women go? P. Scott, M. Sohail & S. Cavill (UK) PAPER 2596 This paper places the sanitation spotlight on urination. Open urination is a cause of concern for various reasons including: public decency, public nuisance, smell, health and hygiene. Measures aimed to stop the practice focus on: 1) creating and enforcing laws; 2) changing social norms; and 3) making more urinals available. For gendered reasons, women are less likely to practice open urination, instead becoming practised at withholding urination when away from home. This paper argues that attention to urination can help cast light on gendered needs, norms and behaviours (and how these change along the human life course) in a way that the sanitation focus on defecation hasn’t. This paper is presented in conjunction with a side event at the WEDC conference titled: “Need to Wee?” Please join us there to continue the conversation. Putting the ‘urination’ back in sanitation People typically urinate four to eight times a day. In most people the bladder is able to store urine until it is convenient to go to the toilet, however there are differences based on medical conditions, disability or lifecourse status (i.e. age, pregnancy or menopause). Nevertheless, urination typically receives much less attention than defecation when we talk about sanitation. Rural sanitation approaches concentrate on ending open defecation as a first step to creating a clean and safe environment.