Ligne D'équilibre Des Glaciers
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
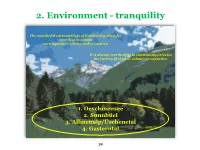
2. Environment - Tranquility
2. Environment - tranquility The wonderful surroundings of Kandersteg allow for countless locations contemplation, silence and relaxation. It is always worthwhile to consciously perceive the variety of shapes, colours or opposites. 1. Oeschinensee 2. Sunnbüel 3. Allmenalp/Üschenetal 4. Gasterntal 39 1. Oeschinensee 3 4 6 2 1 At the mountain station of the gondola lift Kandersteg-Oeschinensee Eastern view 1 Wilde Frau 3,274 m 2 Ufem Stock 3,221 m 3 Blüemlisalp-Rothorn 3,297 m 4 Blüemlisalphorn 3,661 m 5 Oeschinenhorn 3,486 m 6 Fründenhorn 3,369 m 40 7 8 1 2 3 4 5 6 1 Schwarzhorn 3,105 m 2 Roter Totz 2,848 m 3 Felsenhorn 2,782 m 4 Steghorn 3,146 m 5 Wilstrubel 3,244 m 6 Tschingellochtighorn 2,735 m 7 Gross Lohner 3,049 m 8 Chlyne Lohner 2,587 m At the mountain station of the gondola lift Kandersteg-Oeschinensee / Southwestern view 41 1 2 3 4 5 1 Blüemlisalp-Rothorn 3,297 m / 2 Blüemlisalphorn 3,661 m 3 Oeschinenhorn 3,486 m / 4 Fründenhorn 3,369 m / 5 Oeschinensee 1,578 m 42 Oeschinensee - world of contrasts 1 2 A selection Wet Humid Dry Gas Liquid Solid Humidity Seawater Glacier Rock Boulders Gravel Black Coloured White Flat Hilly Mountainous Horizontal Steep Perpendicular Plants Animals Man 1 Oeschinenhorn 3,486 m 2 Fründenhorn 3,369 m Fründenhütte SAC 2,562 m 43 1 2 3 4 5 6 Path Oeschinensee-Kandersteg 1 First 2,549 m / 2 Hohwang 2,519 m / 3 Stand 2,320 m 4 Golitschehöri 2,194 m / 5 Chilchhore 2,159 m / 6 Elsighorn 2,341 m 44 Hiking area, Nordic walking Activities Summer toboggan run at the mountain station Boat rental at the lake Oeschinen Firepits by the lake Summer Mountain tours Fishing 45 Repeating, similar structures (1/2/3) as a unit of great design value 1 2 3 4 Ski area Oeschinen / Southern view 1 Doldenhorn 3,638 m / 2 Kleindoldenhorn 3,475 m / 3 Doldenstock 3,232 m / 4 Bim spitze Stei 2,829 m 46 1 2 Activities Oeschinen Winter Ski and snowboard area with valley run Hiking, Snowshoeing Ice Walks on Oeschinensee Toboggan run to the valley station of the gondola lift Paragliding Fishing 1 Wilde Frau 3,274 m 2 Ufem Stock 3,221 m 47 2. -

Journal 1983
THE ASSOCIATION OF BRITISH MEMBERS OF THE SWISS ALPINE CLUB JOURNAL 1983 CONTENTS Diary for 1983 3 Editorial 4 Over the Kangla Jot by Miriam Baldwin 5 A Note on Schwarenbach by Paul French 7 Greenland by John Wright 12 Shorter Reports of Members Activities 13 Association activities The A.G.M. 20 Association Accounts 21 The Annual Dinner 24 The Outdoor Meets 24 Obituaries: Derek Lambley, Robert Lawrie 30 Book Reviews 31 List of past and pttsent officers 33 Complete list of members 36 Official addresses of die S.A.C. Inside back cover Officers of the Association 1982 Back cover • DIARY FOR 1983 14-16 Jan. Wasdale — P. Fleming Wed. 23 Jan. Fondue Party, E — E. Sondheimer 28-30 Jan. Glencoe — A. I. Andrews 11-13 Feb. Patterdale (Northern Dinner) — W. B. Midgely Wed. 23 Feb. Dr. Charles Clarke: Mountains and Medicine 25-27 Feb. Llanrwst — R. E. W. Casselton 18-20 March Patterdale (Maintenance Meet) — J. R. Murray Wed. 23 March Les Swindin: Some Memorable Alpine Routes 31 Mar./4 Apr. Patterdale — J. R. Murray 31 Mar./4 Apr. Llanrwst — S. M. Freeman Wed. 20 April John Wright: Antartica 29 Apr./2 May Patterdale — J. R. Murray 29 Apr./2 May Llanrwst — A. I. Andrews 29 Apr./2 May Derbyshire — D. Penlington Wed. 18 May Paddy Boulter: A trip to the Rockies 27-30 May Patterdale — J. R. Murray 27-30 May Llanrwst — R. Coatsworth 28-31 May Arran — A. I. Andrews 28 May/11 June Corsica — R. E. W. Casselton Wed. 23 June Buffet Party 24-26 June Bosigran — M. -

Guide Illustré Du Valais: Subventionné Et Approuvé Par Le Conseil D'etat Du
cant. US Kantonsbibl. 10100388E4 TA 14714 UÏDE ILLU5TRÉ VAIÄI JULES MONOD g^ÇQuatre-vingts gravures et une carte Edition entièrement nouvelle. GEORG & C'.E, EDITEURS Dépositaire pour le Valais : Librairie C.MUSSLER; SION * J^ôtel du Gracier du D^hôrce Valais — G-I^E:T:SC!M — 180Ù m. Muni de tout le confort moderne. 300 lits. J^ôtel-pension JSelvédère sur Çletsch — ROUTE DE LA FURKA — 23ÙO mètres Ravissant lieu de séjour. Dernier confort. — Lumière électri- le, poste et télégraphe dans les deux hôtels. — Voitures pour toutes directions à disposition aux hôtels et en gare de Brigue. Joseph Seiler, propriétaire. |J5I»J CARTE DU GUIDE ILLUSTRÉ DU VALAIS 24°SO' Longitude à l'Est dePerro :|jgg ZVis -l • Ä ^ ènSâveidegg - "-.X," V a<lV«fS'' F j*4i feOefiiol'nt , / --: - es \ \ „•* 'DwMnn,St.•'. \ 3TOSt3?°?^- . Iï ias^ * -' BlfÀlOuren- Y" 'HAlÊn^ndGlJP Hängende ,*«* « *-*.*.&«» •»* rv-*---r',.'iii>'.T~- .<»/»' 2.780 ^ : MitwghM.'-.. pirn. Jlßclan/fertJ' boldtxibovn \*f Jïeènfrix. 'tfifÙt . Wâgï •riràid finden Horn* i •< n y ^Bmatfdme Ä< A l -•+•*;*;•».. ri . «a» 7 , ISM« S - f -«i Y'f NeiitKoiyi/ Wï0di-ubel > V 2 Marti. 4** ,>>..Y> ^IP^entf? Y^ff^fe^^. • _ BetteiiL i • - " pilait ' u ys^è XtiUxînwFhervnht, ßeMUhSrit / ßiiachifffoiii 'Mitnï • sfJ,Sönnen,*Itdi>zi •Hart^iaoïfi,- S?" Oàs<ù-' v^Ezïejw M^CistelIa, feo/e/À ^t s; " - i - tas? ' si <; <ïderîr taldenz*ie<l Cr-odfA ZYiwxo // /, Tiofta diCrahà, > i s' "<^ Tzotmalton - . :-.••' "Y W*i<\,-\ \ :-• . / Ztvisphfyepqeri^ • '-•"'' .-. •- ,-A- « ---'" -saeA •.'" 1- I f38ZY'~~<*Sî".-."/'' Baœrhà J"B'. L- ^\ W ifï ^^Ä-St-'S Sodmiesrv \j?aA3«inAî Wbis&mies .*¥ Im>Jîi>un*£ \**>s' PtX&WO ^^ë&tî jAArpitelfa, Dom cJihofa) ,7 """ëSeura ÜPk^-to^ ^*- £j r^,,! ^üv, /•' Vi fit- • -'IP" " Explicalion des Signes. -
Berg Höhe Müm Besteigungsart Anzahl Besteigungen Aermighorn
Gipfel über 2000m (nur CH) Berg Höhe müM Besteigungsart Anzahl Besteigungen Aermighorn 2742 Klettern, Wanderung 2 Albristhorn 2762 Ski 1 Albristhubel 2124 Ski 3 Aletschorn 4193 Ski 1 ällgäuwhore 2047 Wandern 1 Alpligenmäre 2044 Ski 1 Altels 3629 Ski 1 Ammertespitz 2613 Ski 1 Ampervreilhorn 2802 Ski 1 Ankebälli 3601 Ski 1 Arnihaagen 2212 Wandern 1 Augstmatthorn 2137 Wanderung, Speed 2 Balmhorn 3689 Ski 2 Bergseeschjien 2816 Klettern 2 Besso 3668 Hochtour 1 Bietschhorn 3934 Hochtour 1 Bire 2502 Klettern 1 Blanc de Momming 3661 Hochtour 1 Blashorn 2777 Ski 1 Blüemlisalphorn 3661 Hochtour 1 Bortelhorn 3193 Hochtour 2 Breithorn 3438 Ski 4 Breitlauihorn 3655 Hochtour 1 Briefenhörnli 2165 Wandern 1 Brienzer Rothorn 2351 Wandern 1 Brisen 2404 Wandern 1 Brudelhorn 2791 Ski 2 Burgfeldeldstand 2063 Wandern, Baby 2 Bunderspitz 2546 Ski 6 Bürglen 2165 Ski 7 Chäserrugg 2262 Ski 1 Chläbdächer 2175 Ski 1 Chüenihorn 2413 Ski 1 Daubenhorn 2942 Ski 2 Dent de Nendaz 2463 Ski, Wandern, Baby 3 Doldenhorn 3643 Ski 3 Dossenhorn 3138 Hochtour 1 Dreiländerspitz 3197 Ski 1 Dreispitz 2520 Wandern 1 Faulhorn 2681 Speed 1 Fisistock, Innere 2787 Wanderung 1 Fletschhorn 3993 Hochour 1 Foggenhorn 2569 Wanderung 1 Fulenberg 2575 Wanderung 1 Furggegütsch 2197 Wandern 1 Galenstock 3586 Ski 2 Gällihorn 2284 Klettern 1 Page 1 Gipfel über 2000m (nur CH) Galmschibe 2425 Ski 2 Gamserrugg 2074 Ski 1 Gandhorn 2462 Ski 1 Gantrisch 2175 Ski,Wanderung 2 Gemmenalphorn 2061 Wanderung, Baby 2 Gemsfluh 2154 Ski 1 Gehrihorn 2130 Wanderung 2 Giglistock 2900 Ski 1 Golegghorn 3077 Hochtour 1 Gr. Diamantstock 3162 Klettern 2 Gr. -
Slapeloze Nacht Op De Balmhorn
Wie bent u? Aanmelden | Registreren NIEUWS KNOWHOW VERSLAGEN FORUM Verslagen > Slapeloze nacht op de Balmhorn Slapeloze nacht op de Balmhorn LOKATIE en een Soulo testbivak Altijd maar die poging tot oplichting aan de grens met dat wegenvignet, steeds die strenge vraag wat kom jij hier doen, zolang je maar zegt in de bergen wandelen is ‘t goed, met al die dure blinkende wagens word je eraan herinnerd hoe welstellend al die inwoners wel niet moeten zijn, constant blokrijden op links het rechter rijvak vrijwel leeg, tijdens de spits schijnbaar langere files dan ooit in België gezien, overal militaire voertuigen van het leger dat op Israël na het grootste aantal militairen per inwoner ter wereld telt en dat dan met schietoefeningen en tankmanoevres moet leren zandzakjes leggen en lawinepuin opruimen, nog altijd dienstplicht ocharme die jonge kerels, Kaartgegevens ©2011 - het dichtste berghotelnetwerk boven 2000m ter wereld, geen weide zonder kudde bruinoogvlekkoe Beschrijving goed beschermd met de hoogste melkproducteninvoertaks ter wereld, ontelbare overtoeristische Westelijk deel van de Berner Alpen nabij Kandersteg, Berner Oberland, Zwitserland. meren vaak omgeven door vier wouden en steden, geen drie bergen zonder tunnel, geen locomotief die ergens op zijn traject in cirkels omhoog wordt gedreven, geen stad zonder internationale Geschatte totale afstand Zie verslag. sporthoofdzetel of bank met jodenoplichtingsgeschiedenis, geen dal zonder gondellift en skipiste, Kaarten geen wegencol zonder tol, geen tien bergpassen zonder hoogspanningleiding, geen straat zonder Carte National de la Suisse: 273 Montana (1:50 viersterrenhotel, geen alpenhemel zonder contrails en geen stilte zonder straallawaai van een F/A- 000) 18 Hornet die de alpenweiden bombardeert met zijn imaginaire AIM-9 Sidewinder raketten. -

69 Anlagen, 205 Km Toppräparierte Pisten, 60 % Der Hauptpisten Beschneit, Saison November–Mai Skiline.Cc
Blüemlisalp, 3664 m Doldenhorn, 3643 m Balmhorn, 3698 m Altels, 3629 m Rinderhorn, 3448 m Tierhörnli, 2894 m Steghorn, 3146 m Wildstrubel / Grossstrubel, 3243 m Mittlerer Gipfel, 3244 m Wildstrubel, 3244 m Rohrbachstein, 2950 m Weisshorn, 2948 m Wildhorn, 3248 m Gletscherhorn, 2943 m Mittaghorn, 2686 m Laufbodenhorn, 2701 m Gemmipass, 2322 m Plaine Morte Rawilpass Daubensee, 2207 m Oeschinensee, 1578 m Ammertenhorn, 2666 m Iffighorn, 2378 m Schwarenbach, 2060 m Dossen, 2362 m Spittelmatte Sunnbüel, 1936 m SOS 033 736 30 63 Hohberg Tschingellochtighorn Regenboldshorn, 2193 m Bockmatti Metschstand, 2100 m 2735 m SOS 033 673 26 80 Ammertenspitz, 2613 m E2 E3 95 96 Aeugi Luegli, 2138 m Oeschinen, 1682 m Gross Lohner, 3049 m E4 Kandersteg, 1176 m 30 B4 Oberlaubhorn, 1999 m E6 11 E5 41 Engstligenalp, 1964 m Guetfläck Metschhorn, 1901 m 41 Fitzer, 2458 m Leiterli, 2001 m Bunderspitz, 2546 m 31 Blatti Steinstoss Me 033 736 30 46 First, 2549 m SOS t Stand, 2320 m s 2341 m C3 chst Agematte Brenggen 132 E1 a Leiterli, 1943 m B6 nd Simmenfälle Iffigfall 2 F6 Metschhorn, 2229 m Stand- Elsighorn, 2288 m SOS 033 673 70 99 A8 20 61 40 43 Engstligen-Wasserfälle Höchsthorn, 1903 m B3 X 283 25 Widerhubel, 2141 m press 26 Betelberg Chuenisbärgli,1730 m Hahnenmoos, 1957 m F3 132 Unter dem Birg, 1405 m 121 1 A2 Engstligenalp os B2 F2 mo A9 F8 36 e en i Mülkerblatten, 1936 m ist hn eiterl Haslerberg 232 -P SOS 033 673 70 99 a Metschmaad Metsch, 1470 m Stoss-L up -H S Metschalp, 2023 m c 84 ils i lt e m Stoss, 1634 m e C1 G W m A5 Tschätte 133 W C15 Geils, 1707 -

Tourenberichte
Tourenberichte Objekttyp: Group Zeitschrift: Jahresbericht / Akademischer Alpen-Club Zürich Band (Jahr): 104-105 (1999-2000) PDF erstellt am: 24.09.2021 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch Tourenberichte /lrnoW Barme/rfcr Winter 1998/1999: Mutteristock, Schärhorn, Pragel, Pizzo Lucendro, Cresta Rossa, Pte. Plaine Morte, Wildstrubel, Schnidehorn, Weisshorn, Zernrattcr Breithorn, Rothorn, Schneehorn Sommer 1999: Brüggler, Hertenstein, Gardasee: Sonnenplatte und andere Klettergebiete, Campo Tencia, Grand Combin, Nadelhorn, Glockenturm, Pizzo Centrale, Fluebrig, Passo del Uorao, Piz Terri Winter 1999/2000: Vorab, Fahnenstock, Rotsandnollen, Ober Zieblen. Grosses Schnierehorn, Helgenhorn, Breithornplateau. Wildhorn, Niesenhorn, Iffighorn, Piz Lagrev, Piz Scalotta, Silberen, GlarnerTödi. Piz Russein. -

Hiking in ADELBODEN -Frutigen Bernese Oberland, Swiss Alps
Hiking in ADELBODEN -Frutigen Bernese Oberland, Swiss Alps Overview: Valley walks in Adelboden with low height difference page 1 Short Alpine hikings in the surroundings of the village page 3 High-Alpine mountaintops in Adelboden easy to climb page 6 Hiking Map Adelboden.pdf Tips and remarks: The pub 'Kiosk-Treff Adelboden', Dorfstrasse 56 is the starting point of the hikings , if no other is given. All liability claims are rejected.Everybody hikes in own risk. www.alpenferien. ch: Here you find apartments and holiday homes in Adelboden Valley walks in Adelboden with low height difference Along the Engstligen river to the Engstligen waterfalls *** The Engstligen waterfalls at Adelboden are among the highest and most beautiful waterfalls in the Alps. In 2 cascade the water rushes around 5oo meters above the rockface. They are entered in the "Swiss Federal Inventory of Landscapes and Natural Monuments of National Importance".Guide Michelin de Tourisme rated the waterfalls as *** - attraction. Copyright © 2000 , F.Lauber CH3612 Steffisburg Seite 1/10 08.07.2015 /La Trail (67): Schulgässli, Oey-Schützenbrücke, Bonderlensträssli, sawmill (diversion) along the foaming Engstligen river (67) via "Müli" (Boden), Rauf Matta, Chäli (103) to the lower waterfall. Additional trail (104): Climbing over steep and rocky trail to the upper waterfall is very popular for experienced hikers, but requires hiking boots with strong and non-slip soles ( + 1h + HD 350m). Remarks: Good hiking trail along the creek through Alpine meadows and forest to the lower Engstligen waterfall. Beautiful view to eternally snow-covered Wildstrubel. Car-free from sawmill. Way 1,75h, HD 150m Chollerenschlucht ( gorge) *** Deep and narrow gorge with waterfalls and watermills and jammed boulder. -

Vogelreichtum Variété Ornithologique Panoramakarte Carte Panoramique
© Roland Gerth © Roland Gerth 1 Weintourismus Geologie Biodiversität Vogelreichtum Wasser Kultur Oenotourisme Géologie Biodiversité Variété ornithologique Eau Culture Weinmuseum – Musée de la vigne et du vin Illgraben Naturschutzgebiet Pfynwald Beobachtungsorte – Places d‘observation Thermalbadeort Leukerbad Leuk-Stadt In Siders und Salgesch, verbun- Der Erosionstrichter des Illgra- Réserve naturelle du Bois de Finges Der Brutvogelatlas der Schweiz bezeichnet die Region Leuk als eine Badekultur Leukerbad Beinhaus (Kirche) 3 den mit dem Rebweg bens mit seinen Felswänden von der intaktesten Kulturlandschaften der Schweiz und zeigt auf, dass 1 Föhrenwald, Amphibien, Libellen, 10 Bäder, 51 °C warmes, 1 Ossuaire ( église ) A Sierre et à Salquenen, reliés par mehr als 1000 m, gefärbt in hier die höchsten Artenzahlen in unserem Land gefunden werden Teiche, Steppen und Wilder natürliches Thermalwasser Bischofsschloss le sentier de la vigne et du vin beige (Rauhwacke), hellgrün Rotten L’Atlas des oiseaux nicheurs de la Suisse décrit la région de Loèche 10 bains thermaux et une eau Château de l‘évéque www.museevalaisanduvin.ch (Quartz) und grau (Kalk) vermit- comme un des paysages agricoles traditionnels le plus intacts, où Forêt de pins, amphibiens, libellu- thermale naturelle à 51°C Land- und Herrensitze telt einen Hauch von Grand l’on trouve la plus grande diversité d’espèces du pays Reb- und Weinmuseum Canyon. Zugang ab Oberems für les, étangs, steppes et le Rhône Hôtels particuliers Zumofenhaus, 3970 Salgesch sportliche Wanderer, ab Chando- -

La Montagne Au Féminin Rinderhorn 3448 M
4 1 20 année e 2 – 90 o N Mars - avril Passion Montagne Dossier La montagne au féminin iDées De courses Rinderhorn 3448 m (région Loèche-les-Bains/Kandersteg) Journal de la section des Diablerets Club Alpin Suisse CAS Club Alpino Svizzero Section lausannoise du Club Alpin Suisse Schweizer Alpen-Club et sous-sections de Château-d’Œx, Morges, Payerne et Vallorbe Club Alpin Svizzer LA MONTAGNE EST UNE PASSION LE MATéRIEL, UNE SéCURITé Passion Montagne o Section des Diablerets Club Alpin Suisse CAS Nous avons besoin de vous…. Rue Beau-Séjour 24 Case postale 5569 – 1002 Lausanne Le projet définitif de transformation de la T E-mail : [email protected] cabane Rambert, qui vous sera présenté à l’AG Internet: www.cas-diablerets.ch de la fin d’avril, devrait convenir au plus grand nombre et permettre d’aller de l’avant i Locaux de la section dans ce projet qui a pris du retard. Entrée: rue Charles-Monnard Il permet ainsi, tout en restant dans le budget annoncé à l’AG de l’automne 2013 et en Stamm évitant tout luxe inutile, de transformer Chaque vendredi, dès 19 h 30 radicalement notre cabane et la rendre ainsi D plus attrayante pour les visiteurs ainsi que Bibliothèque pour le gardien et ses aides. Ouverte le vendredi, de 20 h à 21 h 15 La nécessité de modifier profondément la cabane Rambert est Président de la section rendue absolument impérative, tant par des exigences d’hygiène, é Luc Anex, tél. 021 881 28 09 en ce qui concerne la cuisine et les conditions de stockage de la E-mail : [email protected] nourriture, que par l’amélioration indispensable de l’élimination des eaux usées et des matières sèches des WC… Secrétaire général Nous espérons, une fois obtenu l’accord définitif de l’AG de la Gérard Chessex, tél. -

Brittle Faulting in the Rawil Depression: Field Observations From
Swiss J Geosci (2010) 103:15–32 DOI 10.1007/s00015-010-0004-6 Brittle faulting in the Rawil depression: field observations from the Rezli fault zones, Helvetic nappes, Western Switzerland Deta Gasser • Neil S. Mancktelow Received: 10 January 2009 / Accepted: 2 December 2009 / Published online: 28 May 2010 Ó Swiss Geological Society 2010 Abstract The Helvetic nappes in the Swiss Alps form a of shear zones, brittle fractures and chaotic folds, in the classic fold-and-thrust belt related to overall NNW-direc- marls of anastomosing shear zones, pressure solution ted transport. In western Switzerland, the plunge of nappe seams and veins and in the sandstones of coarse breccia, fold axes and the regional distribution of units define a brittle faults and extension veins. Sharp, discrete fault broad depression, the Rawil depression, between the cul- planes within the broader fault zones cross-cut all litholo- minations of Aiguilles Rouge massif to the SW and Aar gies. Fossil fault zones in the Rezli area can act as a model massif to the NE. A compilation of data from the literature for studying processes still occurring at deeper levels in shows that, in addition to thrusts related to nappe stacking, this seismically active region. the Rawil depression is cross-cut by four sets of brittle faults: (1) NE-SW striking normal faults, (2) NW-SE Keywords Fault zone architecture Á striking normal faults and joints, (3) ENE-WSW striking Oblique-slip faulting Á Brittle deformation Á and (4) WNW-ESE striking normal plus dextral oblique- Wildhorn nappe Á Helvetic nappes Á Rawil depression slip faults.