Rapport D'information
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

La Tentation
www.kashkazi.com kashkazi vie(s) de taulard les vents n’ont pas de frontière, l’information non plus reportages dans les prisons de l’archipel sambi la tentation solitaire enquête polices des îles : le spectre des “soldats” négligés ports : l’autre affaire qui divise les politiques analyse coopération : la nouvelle arme des départementalistes comment les familles mahoraises vampirisent la démocratie politique, médias, justice étrangers la fabrique des boucs émissaires reportage hip-hop à maore, la voie des sans-voix Une partisane de Sambi, à Ngazidja, n°73 - juin / juillet 2008 lors de son élection en mai 2006. Ndzuani, Ngazidja, Mwali : 700 fc / Maore : 4 euros / Réunion, France : 5 euros / Madagascar : 2.500 ariary EN PRÉAMBULE sommaire (73) L’entente du plus fort sambi, deux ans après son élection 4 exercice du pouvoir : la tentation autocratique par Rémi Carayol 6 l’arabisation de l’économie 7 comment il a géré la crise anjouanaise D'ABORD, IL Y A L'ESPOIR. Puis la désillusion. quence sa revendication d'accepter ou non les personnes qu'on lui renvoie. Ce que fait n'importe quel autre pays. En métropole, pour éloigner les per- 8 analyse Pour l'heure, nous n'en sommes pas encore à la deuxième phase, sonnes, il faut réunir deux choses : un billet d'avion et un laissez-passer coopération régionale : la nouvelle mais la première semble déjà dépassée. Il faut bien avouer que "la nouvelle consulaire. Beaucoup de pays n'acceptaient pas de délivrer les laissez-pas- arme des départementalistes entente" franco-comorienne prônée dans le courant du mois de mai par Yves ser parce qu'ils n'avaient pas envie qu'on renvoie quelqu'un qui depuis la Jégo, ministre français de l'Outremer -ou "des Colonies", c'est selon- res- France faisait vivre tout un village.” 10 enquête semble comme deux gouttes d'eaux à la stratégie du président français polices des îles : le spectre Nicolas Sarkozy. -

RNAP DES COMORES Unité – Solidarité – Développement
UNIONRNAP DES COMORES Unité – Solidarité – Développement Vice-Présidence en charge du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche, de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme Direction Générale de l’Environnement et des Forêts Draft Stratégie d’Expansion du Système National des Aires Protégées Aux Comores 2017 – 2021 26 octobre 2017 Les opinions exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement celles du PNUD, du GEF, ni du Gouvernement Comorien. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Fouad ABDOU RABI Coordinateur du projet RNAP, PNUD/ GEF [email protected] Youssouf Elamine Y. MBECHEZI Directeur Général de l’Environnement et des forêts (DGEF) Directeur du Projet RNAP-Comores (PNUD/ GEF) [email protected] Eric LACROIX AT projet RNAP [email protected] ; [email protected] Publié par : DGEF-PNUD/ GEF Comores Droits d’auteur : ©DGEF-PNUD/ GEF Comores. © Parcs nationaux des Comores. La reproduction de cette publication à des fins non commerciales, notamment éducatives, est permise et même encouragée sans autorisation écrite préalable du détenteur des droits d’auteur à condition que la source soit dûment citée. Page de garde : Photo 1,: Îlot de la Selle, Parc national Shisiwani. © Eric Lacroix PNC Citation : DGEF Comores (2017). Stratégie d’expansion du système national des aires protégées aux Comores. 2017 - 2021. Vice-Présidence en charge du Ministère de l’agriculture, de la pêche, de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, Direction générale de l’environnement et des forêts. Projet PNUD/ GEF : Système national des aires protégées aux Comores. 158 p + Annexes 16 p. -

COMOROS: ANJOUAN ISLAND Cyclone Hellen Snapshot (As of 18 April 2014)
! p " p !( COMOROS: ANJOUAN ISLAND Cyclone Hellen Snapshot (as of 18 April 2014) NEEDS AND RESPONSE PER SECTOR: BAMBAO CAMP Needs Response % Gaps Cyclone Hellen: Comoros experienced heavy rain due to Tropical Cyclone Hellen in late March 2014. This was aggrevated by an earlier 4.8 magnitude ⛳☇ Shelter and NFIs earthquake on 12 March, resulting in land subsidence, cracks and risk of landslides at Mahale Village in Anjouan. The government therefore 330 Tents for shelter 330 100% 0 evacuated 3,030 people at risk, to a camp in Bambao Village on 31 March. Some of these people have since been accomodated by 330 Plastic Sheets 70 21% 260 relatives, leaving 1,550 people (411 primary school students, 60 pregnant women, 80 lactating women and 282 children less than 5 years) 750 Mattresses 100 13% 650 remaining in the camp, who require assistance. The Directorate General of the Civil Protection (DGSC) is leading the response with the 660 Blankets 440 67% 220 assistance of OCHA, UNDP, UNICEF, UNFPA, WHO, PIROI/Red Crescent and local NGOs (Maeecha, CAP). The return of the displaced ⛳☈ Food people is dependent on the scientific results of a geo-seismic survey scheduled in the coming days. No gaps until Food Ration (twice a day) Available until 30/4/14 100% In addition, one of the roads past Mahale village is cracked, cutting off access to the capital for 4 villages (Harembo, Hajoho, Handrouva and 30/4/14 Jimlime) with a population of 10,000 people. The health facility for these villages is functional but has a shortage of medical supplies and the ⛳☊ Health school is not operational due to inaccessibility of the area . -

Evaluation of Dubai Cares' Support to Quality Basic
VALUATION OF UBAI ARES E D C ’ SUPPORT TO QUALITY BASIC EDUCATION IN COMOROS ISLANDS FINAL REPORT JANUARY 2015 EVALUATION OF DUBAI CARES’ SUPPORT TO QUALITY BASIC EDUCATION IN COMOROS ISLANDS Contents Acronyms and abbreviations ........................................................................................................ 4 Executive summary ...................................................................................................................... 6 Brief program description and context ............................................................................................... 6 Purpose and expected use of the evaluation ..................................................................................... 6 Objectives of the evaluation ............................................................................................................... 6 Evaluation methodology ..................................................................................................................... 6 Principal findings and conclusions ...................................................................................................... 7 Key recommendations ........................................................................................................................ 7 Lessons learned for future programs .................................................................................................. 8 I. Audience and use of the evaluation ................................................................................... -

Géographie De La Filariose De Bancroft Dans Les Îles D'anjouan Et De Mayotte
J. BRUNHES - Entomologie Médicale- G. DANDOY GEOGRAPHIE DE LA FILARIOSE DE BANCROFT - Géographie- DANS LES ÎLES D'ANJOUAN ET DE MAYOTTE -ARCHIPEL DES COMDRES- OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE OUTRE-MER _____1 CENTRE DE TANANARIVE - MADAGASCAR - B.P. 434 1 MAI lQ71 OFFICE DE LA RECHERCHE SCIEI~IFIQUE ET TECHNIQUE OUTRE-MER CENTRE DE TilNil.N.i\RIVE GEOGRAPHIE DE lui FIILRIOSE DE BAnCROFT DANS LES ILES D' ANJOUAN ET DE MA YOTTE (Archipel des Comores) par Jacques BRUNHES et Gérard DANDOY Mai 197'3 GEOGRAPHIE DE Lil FILARIOSE DI~ BANCROFT DANS LES ILES D'ANJOUAN ET DE I~iYOTTE (Archipel des Comores) L'archipel des Conores, et plus particulièrenent les îles de Mohéli, Mayotte et Anjouan ont, depuis le début du XIXe siècle, la réputation de payer un très lourd tribut à la filariose de Bancroft. Très récewaent, à la suite de deux enquêtes parasitologiques et en tomologiques qui ont été effectuées à Anjouan (PROD'HON, 1969) et à la Grande Comore (BRUNHES, 1969), un laboratoire de recherches a été installé sur l'île de Mayotte afin d'étudier, en collaboration avec le Service de Santé des Co mores, l'importance, la répartition et la transmission de la filariose. Les résultats de cette étude qui s'est déroulée de février 1971 à février 1972 doivent servir de base à la préparation d'une campagne destinée à interrompre la transmission de la oaladie.(1) Nous présenterons ici succintement les résultats de ce travail qui ont été publiés par ailleurs en détail (BRUNHES et al, 1972) et nous essaie rons de dégager les principaux facteurs qui conditionnent une transmission intense. -
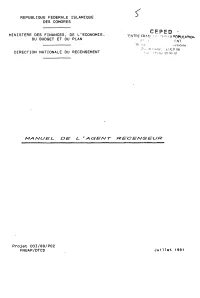
Com-1991-Rec-M1 Manuel Recenseur.Pdf
REPUBLIQUE FEDERALE ISLAMIQUE DES COMORES CEPED -- MINISTERE DES FINANCES, DE L'ECONOMIE, 'ENTRé FRI\~)( ..... ,(',.Q 1 A POPUlAT'CM. DU BUDGET ET DU PLAN ::1 rfoNT 1~;. :1), , •. >(j(lcme 7'" lU rJl..\t\I:: .tlJ[X 06 DIRECTION NATIONALE DU RECENSEMENT l ,,1 11 \ c!r; Ti (lo 111 MANUEL DE L'AGENT RECENSEUR Projet COI/89/P02 FNUAP/DTCD Juillet 1991 A V A N T PRO P 0 S Ce manuel a pour but de vous guider dans votre tâche d'agent recen seur. Il contient les instructions concernant la manière dont vous devez exécuter votre travail. Vous ne devez donc rien ignorer de son contenu. Pour cela, lisez-le attentivement. Si certaines parties de ce manuel vous semble peu claires, posez des questions à votre contrôleur. Les instructions contenues dans ce manuel doivent être exécutées à la lettre. Référez-vous à votre contrôleur chaque fois que, sur le ter rain, vous rencontrez des difficultés pour appliquer ces instructions. Le succès final de ce recensement de la population et de l'habitat repose sur vous. Travaillez donc consciencieusement, rapidement et bien; écrivez très lisiblement sur les questionnaires. PLA N D U MAN U E L CHAPITRE 1 - PRESENTATION DU RECENSEMENT . 1.1 - QU'EST QU'UN RECENSEMENT DE LA POPULATION 1.2 - OBJECTIF DU RECENSEMENT ....... 1.3 - ORGANISATION DE LA COLLECTE ..... 1.3.1 - Personnel chargé du recensement. 1 1.3.2 - Le matériel de l'agent recenseur 2 1.3.3 - la méthode de collecte ... 2 CHAPITRE II - INSTRUCTIONS GENERALES . .. ..... 3 2.1 - MISSION ET COMPORTEMENT DE L'AGENT RECENSEUR 3 2.2 - OBLIGATIONS DE L'AGENT RECENSEUR. -

World Bank Document
2-ocumnen of The World Bank FOR OMJCIL USE ONLY Rhmt Ne.5598-COK Public Disclosure Authorized COMOROS Public Disclosure Authorized EDUCATION SECTOR %,1EMORANDUM June 25, 1985 Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Education and Manpower Development Division Easte-rn and Southe-rn Africa Regional Office _Tb1, I w a TsU daow mmabee y epkts _1-yIn te pmwf of ther eail m lb fso "m _ftf be dban vItd_ WW Boo mjd_r CURRENCYEQUIVALENTS US$1 FCCFA 483 (October, 1984) ABBREVIATIONS AfDB African Development Bank BAC Baccalaureate BEPE = Education Projects Implementation Unit (Bureau d'Execution des Projets d'Education) CADER - Center for Assistance to Rural Development (Centre d'Appui au Developpement Rural) CEFADER = Federal Center for Assistance to Rural Development (Centre Federal d'Appui au Developpement Rural) FAC = French Technical Assistance Program (Fonds d'Aide et de Cooperation) INE - lational Institute of Education (Institut National d'Education) HEN Ministry of National Education, Culture, Youth, and Sports (Ministare de l'Education Nationale, de la Culture, de la Jeunesse, et des Sports) eEDERAI Ii-AMIC REPUBLIC OF THE COMOROS FISCAL YEAR January 1 - December 31 COMOROS EDUCAIION SECTOR MEMORANDUM TABLE OF CONTENTS Pae No BASIC DATA PREFACE Summary and Recommendations ............................... i I. INTRODUCTION ......................................... 1 Geographic and Socio-Economic Setting .... ............1 - The Country ........................................ I - Political and Institutional Structure .I - The Population ..................... ,,, 2 - Schooling and Educational Level. 3 - The Labor Force. 5 - Recent Development and Prospects. 6 II. GOVERM!ENT POLICIES FOR THE SECTOR AND PROPOSED POLICIES COR-RECTIVEMEASURES. 7 Bank's Knowledge of the Sector .7 Education Financin. 7 - Budgetary Expenditures in Education. -

Approche Socio-Économique D'anjouan
-i 4 Approche socio-économique d’Anjouan: ‘L -LE travail que l’on va lire constitue le fruit d’une enquête ethnographique, sociologique et économilque orga- nisée par la division des sciences humaines de 1’O.R.S. T.O.M. à la demande du ministère d’Etat chargé des ter- ’ ritoires d’outre-mer de 1960 à 1961 (I). Cette enquête aboutit à la réalisation de quatre études complémentaires : IO Ethnographie u classique )) de deux villages, l’un M’Jimandra sur le littoral Nord-Ouest de la baie d’Anjouan, l’autre Ongoujou, dans la presqu’île de Niomnakélé, au Sud de l’île ; 2’ Sociologie urbaine de la capitale, Mutsamudu ; 3” Etudes de iséries de budgets familiaux à Mutsamudu et à Ongoujou ; 4” Monographie d’une région de domaines de plan- tation : Patsi. Ces études avaient été précédées d’une tournée générale de prise de contact à Anjouan et dans les autres îles de l’Archipel des Comores. Elles furent menées avec inter- prète, apprentissage de la langue, informateurs et inser- ßi tion du chercheur dans la vie de la société comorienne. Nous’ ne saurions trop remercier, ici, toutes les personnes qui, à Anjouan et dans les autres îles, nous ont accepté, et sans lesquelles ce travail n’aurait pu voir le jour. b Après une introduction générale, l’analyse socio-écono- mique enst menée à partir de la description de trois ((ter- (1) O.R.S.T.O.M.. : office de lu recherche scientifique et technique I outre-mer, établissement public français, Paris. CARTE OE SITUATION CANAL ANJOUAN Q C fi QFOMEONl MAYOTTE 23ooohab. -

Anjouan Sustainable Development Project --3,500
APPENDIX D A.1.D. EVALUATION SVMMASY - PART I IS' q 6jo 4 0 rt. woaE Fl~LlhlGour Tnls Fom. mAtjTHE ArrAcnEt 2. USE LETTEH OUAilTY TYf'C, t.OT 'IIOT IAATRIX' f YPf IDENTIFICATION DATA- A. Aoporllng A.I.D. Llnll: 8. Was Evaluallon Schodulod In Currant R' C. Evaluarlon Tirnlng Annual Evaluatlon Plan7 M~ss~onor AlDlW Offm yes 130 S:lpped G Ad lloc 0 Intorim 0 Final [X1 (ESa 2 I Evaluation Plan Submlsslon Date: FY 0 -- - E, post n lher r 0. Actlvlly or A~llVlll0~Evalurlod ILlsl lh. lollowlng Inlormrllm lor ptol.c~(u)or proqram(s) avalua~od;II mt applicable, Ilrl 11t;u and dale 01 IM avrIua~hreml.~-... .1 Prolect No. ProJect Program Tills :Irsl PROAG Most Recent 'lamed LOP ,mount Obligals ~r E ulvalont PACD Cost (000) la Dale (000) 602-0002 Anjouan Sustainable Development Project --3,500 ACTIONS E. Actlon Dee-roved Bv Mlsslon AID/-tar ame of Officer Re- late Acllon Acllon(s) Requlred ,onslblo lor Action o be Complelec 1. Copies of the evaluation will be heryl Ander- 28 April sent to CDIE (as required) with a special on Kiai covering memo from the REDS0 Director highlighting the relevance of the findings for other projects in high rainfall, steep regions of countries in the tropics. Copies with the covering memo will also be sent to relevant USAID missions in the ESA region. 2. An abbreviated Project Assistance Completion heryl Ander- !8 April. 9 Report (PACR) will be prepared to address all on Kiai Handbook 3 requirements not covered by the final evaluation and this PES. -
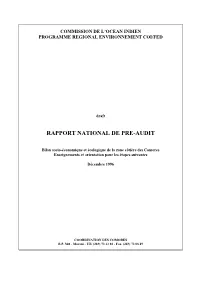
I Contexte Et Elements D'execution Du Programme
COMMISSION DE L’OCEAN INDIEN PROGRAMME REGIONAL ENVIRONNEMENT COI/FED draft RAPPORT NATIONAL DE PRE-AUDIT Bilan socio-économique et écologique de la zone côtière des Comores Enseignements et orientation pour les étapes suivantes Décembre 1996 COORDINATION DES COMORES B.P. 860 - Moroni - Tél. (269) 73 13 88 - Fax. (269) 73 08 49 ABREVIATIONS ET SIGLES BTP Bâtiments et Travaux Publics BM Banque Mondiale CN-COM Coordination Nationale des Comores du Programme Régional Environnement COI/FED CEFADER Centre Fédéral de Développement Rural CICE Comité Interministériel Consultatif de l’Environnement CIRAD Centre International de Recherche en Agronomie pour le Développement CITES CNCDD Comité National de Coordination pour le Développement Durable CNDRS Centre National de Documentation et de Recherche Scientifique COI Commission de l’Océan Indien CRCDD Comité Régional de Coordination pour le Développement Durable DCP Dispositif de Concentration des Poissons DGE Direction Générale de l’Environnement DGP Direction Générale de la Pêche DGTH Direction Générale du Tourisme et Hôtellerie DGUH Direction Générale de l’Urbanisme et de l’Habitat DP Devis Programme EIE Etude d’Impact Environnemental FADC Fonds d’Appui au Développement Communautaire EAF Afrique de l’Est (Eastern AFrica) FED Fonds Européen pour le Développement FIDA Fonds International pour le Développement Agricole GEF Fonds pour l’environnement mondial (Global Environment Facility) GIZC Gestion Intégrée de la Zone Côtière GREEN Groupe de Renforcement des Efforts Environnementaux Nationaux GT -

Visite Du Chef De L'etat Sur La Route Dindri-Lingoni
Paraît tous LLaa GGaazdzesee Ctotmttoree es les jours sauf les week-end Quotidien Indépendant d’Informations Générales 20 ème année - N° 3509 - Mercredi 06 Novembre 2019 - Prix : 200 Fc INFRASTRUCTURE ROUTIÈRES Visite du chef de l’Etat sur la route Dindri-Lingoni Visite de la route de Lingoni par le président Azali ENVIRONNEMENT Prières aux heures officielles Du 06 au 10 Niovembre 2019 Garantir l’accès à l’eau à 80% Lever du soleil: 05h 33mn dans l’ensemble de l’archipel Coucher du soleil: LIRE PAGE 3 18h 08mn Fadjr : 04h 20mn Dhouhr : 11h 54mn Visitez le site de la Gazette Ansr : 15h 23mn Maghrib: 18h 11mn www.lagazettedescomores.com Incha: 19h 25mn La Gazette des Comores. Tel :( 0269) 763 26 20 Courriel : [email protected] SOCIÉTÉ LGDC du Mercredi 06 Novembre 2019 - Page 2 CHANGEMENT CLIMATIQUE Lancement d’un projet d’apprivoisement en eau résilient à Anjouan Le président de la République défi. Une fierté de voir le gouverne - contribution annoncée du a pris part au lancement du projet ment comorien et le Programme des Gouvernement de l’ordre de 3,5 « assurer un apprivoisement en Nations Unies pour le millions d’euros. China Geo- eau résilient au changement cli - Développement, partenaire histo - Engineering Corporation contribue - matique » à Vouani au sud de rique agir de concert pour l’amélio - ra en nature à hauteur de 1,9 Mutsamudu. Il consiste à assurer ration des conditions de vie des millions de dollars, ainsi que le à la population comorienne un comoriens et comoriennes. Il s’agit Fonds arabe pour le développement accès à l’eau potable ainsi que les de la concrétisation d’une vision économique et social avec 290 agriculteurs. -

Contribution À La Gestion Des Risques De Catastrophes Naturelles : Cas Des Inondations Aux Comores
Contribution à la gestion des risques de catastrophes naturelles : cas des inondations aux Comores Présenté par ANWADHUI MANSOUROU Pour l’obtention du Master en Développement de l’Université Senghor Département Environnement Spécialité Gestion de l’Environnement Le 12 mars 2013 Directeur Dr. Arona DIEDHIOU Devant le jury composé de : Directeur de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) Dr. Martin YELKOUNI Directeur du Département environnement, Université Senghor, Président Alexandrie, Egypte Pr. Marianne VON FRENCKELL Directrice du département des sciences, et gestion de Membre l’Environnement. Université de Liège-Campus d’Arlon, Belgique Dr. Arona DIEDHIOU Directeur de Recherche de l’IRD ; (Institut de Recherche pour le Membre Développement)-Grenoble, France Remerciements Au terme de ce travail, je tiens à exprimer mes sincères reconnaissances à toutes celles et à tous ceux, qui de près ou de loin, ont contribué à sa réalisation. Je remercie M. Fouad Ben Mouhadji, Vice-Président de l’Union des Comores chargé du Ministère de la Production, de l’Environnement, de l’Energie, de l’Industrie et de l’Artisanat pour sa contribution financière. Je remercie tout le personnel administratif et le corps professoral de l’Université Senghor qui ont fait que ces deux ans d’expérience soient enrichissants tant sur le plan académique et professionnel que sur le plan culturel et social. J’exprime ma reconnaissance au Dr. Arona DIEDHIOU, LTHE-IRD- Université de Grenoble en France et Manon Jozroland, qui m’ont permis de parfaire ce travail en m’apportant des remarques sur son fond et en corrigeant mes nombreuses fautes et erreurs. Mes remerciements vont également à l’ensemble du personnel du Programme de Nations Unies pour le Développement (PNUD) en Union des Comores et plus particulièrement à : Mme.