Rapport AOAA Mission Anjouan 2
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
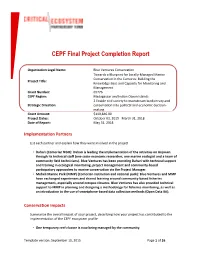
CEPF Final Project Completion Report
CEPF Final Project Completion Report Organization Legal Name: Blue Ventures Conservation Towards a Blueprint for Locally-Managed Marine Conservation in the Comoros: Building the Project Title: Knowledge Base and Capacity for Monitoring and Management Grant Number: 65776 CEPF Region: Madagascar and Indian Ocean Islands 2 Enable civil society to mainstream biodiversity and Strategic Direction: conservation into political and economic decision- making. Grant Amount: $149,846.00 Project Dates: October 01, 2015 - March 31, 2018 Date of Report: May 31, 2018 Implementation Partners List each partner and explain how they were involved in the project • Dahari (Comorian NGO): Dahari is leading the implementation of the activities on Anjouan through its technical staff (one socio-economic researcher, one marine ecologist and a team of community field technicians). Blue Ventures has been providing Dahari with technical support and training in ecological monitoring, project management and community-based participatory approaches to marine conservation via the Project Manager. • Moheli Marine Park (MMP) (Comorian institution and national park): Blue Ventures and MMP have exchanged experiences and shared learning around community-based fisheries management, especially around octopus closures. Blue Ventures has also provided technical support to MMP in planning and designing a methodology for fisheries monitoring, as well as an introduction to the use of smartphone-based data collection methods (Open Data Kit). Conservation Impacts Summarize the overall impact of your project, describing how your project has contributed to the implementation of the CEPF ecosystem profile • One temporary reef closure is now being managed by the community. Template version: September 10, 2015 Page 1 of 16 • The creation of a fisherwomen’s association is filling the previous lack of representation of reef gleaning fisheries. -

Socmon Comoros NOAA
© C3 Madagascar and Indian Ocean Islands Programme 2010 C3 Madagascar and Indian Ocean Islands Programme is a collaborative initiative between Community Centred Conservation (C3), a non-profit company registered in England no. 5606924 and local partner organizations. The study described in this report was funded by the NOAA Coral Reef Conservation Program. Suggested citation: C3 Madagascar and Indian Ocean Islands Programme (2010) SOCIO- ECONOMIC ASSESSMENT AND IDENTIFICATION OF POTENTIAL SITES FOR COMMUNITY-BASED CORAL REEF MANAGEMENT IN THE COMOROS. A Report Submitted to the NOAA Coral Reef Conservation Program, USA 22pp FOR MORE INFORMATION C3 Madagascar and Indian Ocean NOAA Coral Reef Conservation Program Islands Programme (Comoros) Office of Response and Restoration BP8310 Moroni NOAA National Ocean Service Iconi 1305 East-West Highway Union of Comoros Silver Spring, MD 20910 T. +269 773 75 04 USA CORDIO East Africa Community Centred Conservation #9 Kibaki Flats, Kenyatta Beach, (C3) Bamburi Beach www.c-3.org.uk PO BOX 10135 Mombasa 80101, Kenya [email protected] [email protected] Cover photo: Lobster fishers in northern Grande Comore SOCIO-ECONOMIC ASSESSMENT AND IDENTIFICATION OF POTENTIAL SITES FOR COMMUNITY-BASED CORAL REEF MANAGEMENT IN THE COMOROS Edited by Chris Poonian Community Centred Conservation (C3) Moroni 2010 ACKNOWLEDGEMENTS This report is the culmination of the advice, cooperation, hard work and expertise of many people. In particular, acknowledgments are due to the following for their contributions: COMMUNITY CENTRED -

Niveaux D'anticorps Contre La Protéine Circumsporozoïtique De
Ann. Parasitol. Hum. Comp., Mots-clés : Épidémiologie du paludisme. Anticorps anti-CS pro 1991, 66 : n° 4, 179-184. téine de Plasmodium falciparum. Anopheles gambiae. Anopheles funestus. Comores. Mémoire. Key-words: Malaria epidemiology. Plasmodium falciparum CS- protein antibodies. Anopheles gambiae. Anopheles funestus. Comoros. NIVEAUX D’ANTICORPS CONTRE LA PROTÉINE CIRCUMSPOROZOÏTIQUE DE PLASMODIUM FALCIPARUM ET LEUR UTILISATION EN TANT QU’INDICATEURS ÉPIDÉMIOLOGIQUES DE LA TRANSMISSION DU PALUDISME EN RFI DES COMORES G. SABATINELLI*, R. ROMI*, S. BLANCHY** R ésumé -------------------------------------------------------------------------------------- Une enquête épidémiologique pour déterminer les niveaux d’anti Les prévalences d’Ac-CS dans l’échantillon de population examinée corps contre la protéine circumsporozoïtique de Plasmodium fal passe de 5,5 % chez les enfants de 3-4 ans à 40 % chez ceux ciparum (Ac-CS) a été menée au début de la saison des pluies de 5 ans. Dès 6-7 ans, on enregistre une augmentation progressive 1988, dans 21 villages de la RFI des Comores, conjointement à de la prévalence qui atteint un plateau après 30 ans. La détermi une évaluation des densités résiduelles anophéliennes. Des préva nation des niveaux d’Ac-CS se révèle une méthode très utile pour lences d’Ac-CS très différentes ont été relevées dans la population évaluer les niveaux de transmission du paludisme, particulièrement des villages choisis, comme l’ont été les densités moyennes d’Ano dans les situations épidémiologiques où une évaluation entomolo- pheles gambiae et d’Anopheles funestus par chambre. Les diffé gique fiable est difficile à effectuer. rences sont conditionnées par les situations écologiques locales. Summary: Antibodies levels to Plasmodium falciparum circumsporozoitic protein as epidemiological indicators of malaria transmission in the FIR of Comoros. -

UNION DES COMORES Unité – Solidarité – Développement
UNION DES COMORES Unité – Solidarité – Développement --------- ! DIRECTION GENERALE DE L’ANACEP ---------- _________________________________________________ PROJET DE FILETS SOCIAUX DE SECURITES Accord de Financement N° D0320 -KM RAPPORT SEMESTRIEL D’ACTIVITES N° 05 Période du 1 er juillet au 31 décembre 2017 Février 2018 1 SIGLES ET ABREVIATIONS ACTP : Argent Contre Travail Productif ACTC : Argent Contre Travail en réponses aux Catastrophes AG : Assemblée Générale AGEX : Agence d’Exécution ANACEP : Agence Nationale de Conception et d’Exécution des Projets AGP : Agence de Paiement ANO: Avis de Non Objection AVD : Agent Villageois de Développement ANJE : Amélioration du Nourrisson et du Jeune Enfant BE : Bureau d’Etudes BM : Banque Mondiale CCC : Comité Central de Coordination CG : Comité de Gestion CGES : Cadre de Gestion Environnementale et Sociale CGSP : Cellule de Gestion de Sous Projet CI : Consultant Individuel CP : Comité de Pilotage CPR : Cadre de politique de Réinstallation CPS Comité de Protection Sociale CR : Comité Régional DAO : Dossier d’appel d’offre DEN : Directeur Exécutif National DGSC : Direction Générale de la Sécurité Civile DP : Demande de Proposition DER : Directeur Exécutif Régional DNO : Demande de Non Objection DSP : Dossier de sous- projet FFSE : Facilitateur chargé du Suivi Evaluation HIMO : Haute Intensité de Main d’Œuvres IDB : Infrastructure de Bases IDB C : Infrastructure De Base en réponse aux Catastrophes IEC : Information Education et Communication MDP : Mémoire Descriptif du Projet MWL : île de Mohéli -

Union Des Comores)
COLLOQUE DEGEZOI Les obstacles à la gestion de l'eau sur l'île d'Anjouan (Union des Comores) Le cas du projet AEP Sima Nicolas WALZER Docteur en sciences sociales Laboratoire ORACLE (Université de La Réunion) 1. Le projet AEP Sima et ses difficultés Dans le cadre du projet « Eco-gestes et éco-savoirs dans l’Océan Indien » financé par la Région Réunion et que nous dirigeons, nous avons eu le plaisir d’effectuer deux missions sur l’île d’Anjouan (Union des Comores), la première en juillet 2013 et la seconde en septembre 2013 pour un total de près d’un mois. Notre activité présentait un volet recherche et un volet enseignement. L’ensemble s’intitulait Pérennité de la gestion de l’eau par les usagers. Péninsule de Sima (six villages) sur l'île d'Anjouan (Union des Comores) / Projet d'Acheminement en Eau Potable. Nous assurâmes quatre-vingts heures d’enseignement à Mutsamudu ; il s’agissait de former les cinq animateurs du Projet d'Acheminement en Eau Potable à Sima via des cours de communication, de gestion et résolution de conflits, d’argumentation, des jeux de rôles et des mises en situation. Sur le plan de la recherche, nous fîmes soutenir quatre mémoires1 (l’un des animateurs n’ayant pas pu mener à son terme son travail). Grâce à ces mémoires, nos journées sur le terrain ont été grandement facilitées. Le 1 Mohamed Maenrouf Issiaka a soutenu avec succès en septembre 2013 un mémoire intitulé : Les risques liés au maintien d’un réseau parallèle dans le village de Bimbini. -

Ebauche Du Fonctionnement Hydrogeologique De L'île D
EBAUCHE DU FONCTIONNEMENT HYDROGEOLOGIQUE DE L’ÎLE D’ANJOUAN (COMORES) : Typologie des ressources en eau disponibles et discussion sur l’impact de la déforestation Arnaud CHARMOILLE* (*) Docteur en Hydrogéologie, bénévole pour l’ONG AVSF, [email protected] 1 A propos du projet ECDD Le projet ECDD est mis en œuvre par la Bristol Conservation & Science Foundation (une unité opérationnelle de la Bristol, Clifton & West of England Zoological Society Ltd.) en partenariat avec Durrell Wildlife Conservation Trust, Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières, le Gouvernement de l’Union des Comores et l’Administration de l’île d’Anjouan. Le financement extérieur provient, entre autres, du Gouvernement du RU, par l’intermédiaire du Darwin Initiative, l’Agence Française de Développement et le Fonds pour l’Environnement Mondial (à travers le projet PoWPA). Le projet œuvre avec des consultants de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature et l’Université de Cranfield. About the ECDD project The ECDD project is run by Bristol Conservation & Science Foundation (an operating unit of Bristol, Clifton & West of England Zoological Society Ltd.) in partnership with Durrell Wildlife Conservation Trust, Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières, the Government of the Union of the Comoros and the Administration of the Island of Anjouan. External funding comes from the UK government through the Darwin Initiative scheme, the French Development Agency and the Global Environment Facility (through the PoWPA project) amongst others. The project works with consultants from the International Union for the Conservation of Nature and Cranfield University. 2 Sommaire 1. Éléments de contexte : Géographie, climat, géologie .............................................................. 10 A. -

RNAP DES COMORES Unité – Solidarité – Développement
UNIONRNAP DES COMORES Unité – Solidarité – Développement Vice-Présidence en charge du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche, de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme Direction Générale de l’Environnement et des Forêts Draft Stratégie d’Expansion du Système National des Aires Protégées Aux Comores 2017 – 2021 26 octobre 2017 Les opinions exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement celles du PNUD, du GEF, ni du Gouvernement Comorien. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Fouad ABDOU RABI Coordinateur du projet RNAP, PNUD/ GEF [email protected] Youssouf Elamine Y. MBECHEZI Directeur Général de l’Environnement et des forêts (DGEF) Directeur du Projet RNAP-Comores (PNUD/ GEF) [email protected] Eric LACROIX AT projet RNAP [email protected] ; [email protected] Publié par : DGEF-PNUD/ GEF Comores Droits d’auteur : ©DGEF-PNUD/ GEF Comores. © Parcs nationaux des Comores. La reproduction de cette publication à des fins non commerciales, notamment éducatives, est permise et même encouragée sans autorisation écrite préalable du détenteur des droits d’auteur à condition que la source soit dûment citée. Page de garde : Photo 1,: Îlot de la Selle, Parc national Shisiwani. © Eric Lacroix PNC Citation : DGEF Comores (2017). Stratégie d’expansion du système national des aires protégées aux Comores. 2017 - 2021. Vice-Présidence en charge du Ministère de l’agriculture, de la pêche, de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, Direction générale de l’environnement et des forêts. Projet PNUD/ GEF : Système national des aires protégées aux Comores. 158 p + Annexes 16 p. -

Ile Autonome De La Grande - Comore ______
UNION DES COMORES __________ ILE AUTONOME DE LA GRANDE - COMORE ___________ CREDIT / IDA 3868 - COM Fonds d'Appui au Développement Communautaire (FADC) Secrétariat Exécutif Régional BP 2494 Moroni/Magoudjou - Bd Said Mohamed Cheikh Tél. : (269) 73 2 8 89/73 28 78 - Fax : 73 28 89 Email : [email protected] ______________________________________________________ Communauté de BANDADAOUENI P LAN DE D EVELOPPEMENT L OCAL 200 8 – 201 2 1 Résumé du rapport Ce document est le rapport sur le Plan de Développement Local (PDL) de la communauté de Bandadaouè ni . C’est un village situé dans l e Sud de l’île de l’île Autonome de la Grande - Comore et qui appartient à la préfecture de Mbadjini/ Est dont le chef lieu est la ville de Foumbouni . Ce rapport e st le fruit d’un travail intense d’enquêtes et d’analyses des données socio - économiques du village qui a réuni toutes les différentes couches sociales : jeunes, femmes, hommes, notables et personnes vuln érables. Le travail a été fait 20 jours durant et co nsiste à identifier et analyser secteur par secteur les potentialités, les contraintes et à dégager les solutions pour relever le défi en matière de développement communautaire. Il comporte quatre grande s parties : une première partie porte sur la justi fication et la méthodologie du PDL. La deuxième partie porte sur la présentation du village et l’organisation socioculturelle. La troisième partie est consacrée à l’analyse des potentialités, des problèmes et des solutions ainsi qu’à l’établissement d’un p lan d’investissement quinquennal du village . -

Coastal Construction and Destruction in Times of Climate Change on Anjouan, Comoros Beate M.W
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Electronic Publication Information Center Natural Resources Forum 40 (2016) 112–126 DOI: 10.1111/1477-8947.12102 Considering the locals: coastal construction and destruction in times of climate change on Anjouan, Comoros Beate M.W. Ratter, Jan Petzold and Kamardine Sinane Abstract The current discussion of anticipated climate change impacts and future sea level rise is particularly relevant to small island states. An increase in natural hazards, such as floods and storm waves, is likely to have a devastating impact on small islands’ coastlines, severely affecting targeted sustainable development. Coastal erosion, notably human- induced erosion, has been an ongoing threat to small island biodiversity, resources, infrastructure, and settlements, as well as society at large. In the context of climate change, the problem of coastal erosion and the debate surrounding it is gaining momentum. Before attributing associated impacts to climate change, current human activities need to be analysed, focusing not only on geomorphological and climatological aspects, but also on political and traditional cul- tural frameworks. The objective of this paper is to demonstrate the importance of the social-political-ecological systems analysis for adaptation strategies, and thus for future sustainable development. Coastal use is based on human con- structs of the coast, as well as local perceptions and values ascribed to the coast. We use the case study of Anjouan, Comoros to differentiate between constructive and destructive practices on the coast, from both a mental and technical perspective. Beach erosion is described as more than a resource problem that manifests itself locally rather than nationally. -

Les Comores, Une Destination En Devenir Touristique
CONFERENCE DES BAILLEURS DE FONDS EN FAVEUR DES COMORES Ile Maurice, le 8 décembre 2005 Les Comores, une destination en devenir touristique DOCUMENT CADRE STRATEGIE TOURISTIQUE 1 « La tradition rapportée depuis la nuit des temps raconte que le roi Salomon et la reine Bilqis de Saba (appelée Sada au Yémen septentrionale) ont passé leur voyage de noces sur l’île de Ngazidja. Eperdument amoureux, le couple a escaladé le volcan Karthala et la reine jeta sa bague dans le cratère, promettant de revenir un jour sur ces lieux magiques et aux paysages lunaires. Aucun guide ne peut présenter les Comores aussi bien que par cette légende immuable. » Ahmed Ali Amir, Le Tourisme : un secteur promoteur, Agence Comorienne de Presse, 25 octobre 2005 2 TABLE DES MATIERES Introduction 6 Carte générale de situation des Comores 7 Fiche d’identité de l’Union des Comores 8 1- ELEMENTS DE CADRAGE 9 1.1 La Conférence des Partenaires des Comores : vers des pistes concrètes de développement économique 9 1.1.1 Contexte politique et économique local 9 1.1.1.1 Un nouveau cadre institutionnel pour l’archipel des Comores 9 1.1.1.2 Une économie encore fragile 9 1.1.2 Vers une stratégie de réduction de la pauvreté 10 1.1.3 La Conférence des partenaires : un consensus pour poser les bases d’un développement économique 11 1.2 Un contexte touristique mondial, régional et local favorable pour l’Union des Comores 12 1.2.1 Poids et perspectives de l’industrie touristique mondiale 12 1.2.1.1 Les arrivées internationales dans le monde depuis 1950 12 1.2.1.2 Les recettes du tourisme -

COMOROS: ANJOUAN ISLAND Cyclone Hellen Snapshot (As of 18 April 2014)
! p " p !( COMOROS: ANJOUAN ISLAND Cyclone Hellen Snapshot (as of 18 April 2014) NEEDS AND RESPONSE PER SECTOR: BAMBAO CAMP Needs Response % Gaps Cyclone Hellen: Comoros experienced heavy rain due to Tropical Cyclone Hellen in late March 2014. This was aggrevated by an earlier 4.8 magnitude ⛳☇ Shelter and NFIs earthquake on 12 March, resulting in land subsidence, cracks and risk of landslides at Mahale Village in Anjouan. The government therefore 330 Tents for shelter 330 100% 0 evacuated 3,030 people at risk, to a camp in Bambao Village on 31 March. Some of these people have since been accomodated by 330 Plastic Sheets 70 21% 260 relatives, leaving 1,550 people (411 primary school students, 60 pregnant women, 80 lactating women and 282 children less than 5 years) 750 Mattresses 100 13% 650 remaining in the camp, who require assistance. The Directorate General of the Civil Protection (DGSC) is leading the response with the 660 Blankets 440 67% 220 assistance of OCHA, UNDP, UNICEF, UNFPA, WHO, PIROI/Red Crescent and local NGOs (Maeecha, CAP). The return of the displaced ⛳☈ Food people is dependent on the scientific results of a geo-seismic survey scheduled in the coming days. No gaps until Food Ration (twice a day) Available until 30/4/14 100% In addition, one of the roads past Mahale village is cracked, cutting off access to the capital for 4 villages (Harembo, Hajoho, Handrouva and 30/4/14 Jimlime) with a population of 10,000 people. The health facility for these villages is functional but has a shortage of medical supplies and the ⛳☊ Health school is not operational due to inaccessibility of the area . -

Evaluation of Dubai Cares' Support to Quality Basic
VALUATION OF UBAI ARES E D C ’ SUPPORT TO QUALITY BASIC EDUCATION IN COMOROS ISLANDS FINAL REPORT JANUARY 2015 EVALUATION OF DUBAI CARES’ SUPPORT TO QUALITY BASIC EDUCATION IN COMOROS ISLANDS Contents Acronyms and abbreviations ........................................................................................................ 4 Executive summary ...................................................................................................................... 6 Brief program description and context ............................................................................................... 6 Purpose and expected use of the evaluation ..................................................................................... 6 Objectives of the evaluation ............................................................................................................... 6 Evaluation methodology ..................................................................................................................... 6 Principal findings and conclusions ...................................................................................................... 7 Key recommendations ........................................................................................................................ 7 Lessons learned for future programs .................................................................................................. 8 I. Audience and use of the evaluation ...................................................................................