Madagascar) Faculte Des Lettres Et Sciences Humaines
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
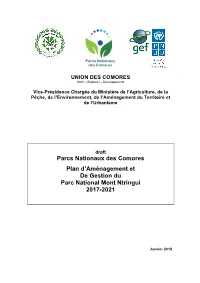
Parc National Mont Ntringui 2017-2021
Parcs Nationaux RNAPdes Comores UNION DES COMORES Unité – Solidarité – Développement Vice-Présidence Chargée du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche, de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme draft Parcs Nationaux des Comores Plan d’Aménagement et De Gestion du Parc National Mont Ntringui 2017-2021 Janvier 2018 Les avis et opinions exprimés dans ce document sont celles des auteurs, et ne reflètent pas forcément les vues de la Vice-Présidence - Ministère de l’Agriculture, de la Pêche, de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme, ni du PNUD, ni du FEM (UNDP et GEF) Mandaté Par L’Union des Comores, Vice-Présidence Chargée du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche, de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme, Parcs nationaux des Comores Et le Programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD Fonds Mondial pour l’Environnement, FEM Maison du PNUD, Hamramba BP. 648, Moroni, Union des Comores T +269 7731558/9, F +269 7731577 www.undp.org Titre du Projet d’appui RNAP Développement d’un réseau national d’aires protégées terrestres et marines représentatives du patrimoine naturel unique des Comores et cogérées par les communautés villageoises locales. PIMS : 4950, ID ATLAS : 00090485 Citation : Parcs nationaux des Comores (2017). Plan d’Aménagement et de Gestion du Parc national Mont Ntringui. 2017-2021. 94 p + annexes 84 p. Pour tous renseignements ou corrections : Lacroix Eric, Consultant international UNDP [email protected] Fouad Abdou Rabi, Coordinateur RNAP [email protected] Plan d’aménagement et de gestion du Parc national Ntringui – 2018 2 Avant-propos Depuis 1994 le souhait des Comoriennes et Comoriens et de leurs amis du monde entier est de mettre en place un Système pour la protection et le développement des aires protégées des Comores. -

Centre Souscentreserie Numéro Nom Et Prenom
Centre SousCentreSerie Numéro Nom et Prenom MORONI Chezani A1 2292 SAID SAMIR BEN YOUSSOUF MORONI Chezani A1 2293 ADJIDINE ALI ABDOU MORONI Chezani A1 2297 FAHADI RADJABOU MORONI Chezani A4 2321 AMINA ASSOUMANI MORONI Chezani A4 2333 BAHADJATI MAOULIDA MORONI Chezani A4 2334 BAIHAKIYI ALI ACHIRAFI MORONI Chezani A4 2349 EL-ANZIZE BACAR MORONI Chezani A4 2352 FAOUDIA ALI MORONI Chezani A4 2358 FATOUMA MAOULIDA MORONI Chezani A4 2415 NAIMA SOILIHI HAMADI MORONI Chezani A4 2445 ABDALLAH SAID MMADINA NABHANI MORONI Chezani A4 2449 ABOUHARIA AHAMADA MORONI Chezani A4 2450 ABOURATA ABDEREMANE MORONI Chezani A4 2451 AHAMADA BACAR MOUKLATI MORONI Chezani A4 2457 ANRAFA ISSIHAKA MORONI Chezani A4 2458 ANSOIR SAID AHAMADA MORONI Chezani A4 2459 ANTOISSI AHAMADA SOILIHI MORONI Chezani D 2509 NADJATE HACHIM MORONI Chezani D 2513 BABY BEN ALI MSA MORONI Dembeni A1 427 FAZLAT IBRAHIM MORONI Dembeni A1 464 KASSIM YOUSSOUF MORONI Dembeni A1 471 MOZDATI MMADI ADAM MORONI Dembeni A1 475 SALAMA MMADI ALI MORONI Dembeni A4 559 FOUAD BACAR SOILIHI ABDOU MORONI Dembeni A4 561 HAMIDA IBRAHIM MORONI Dembeni A4 562 HAMIDOU BACAR MORONI Dembeni D 588 ABDOURAHAMANE YOUSSOUF MORONI Dembeni D 605 SOIDROUDINE IBRAHIMA MORONI FoumboudzivouniA1 640 ABDOU YOUSSOUF MORONI FoumboudzivouniA1 642 ACHRAFI MMADI DJAE MORONI FoumboudzivouniA1 643 AHAMADA MOUIGNI MORONI FoumboudzivouniA1 654 FAIDATIE ABDALLAH MHADJOU MORONI FoumbouniA4 766 ABDOUCHAKOUR ZAINOUDINE MORONI FoumbouniA4 771 ALI KARIHILA RABOUANTI MORONI FoumbouniA4 800 KARI BEN CHAFION BENJI MORONI FoumbouniA4 840 -
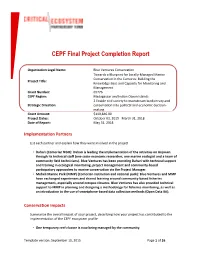
CEPF Final Project Completion Report
CEPF Final Project Completion Report Organization Legal Name: Blue Ventures Conservation Towards a Blueprint for Locally-Managed Marine Conservation in the Comoros: Building the Project Title: Knowledge Base and Capacity for Monitoring and Management Grant Number: 65776 CEPF Region: Madagascar and Indian Ocean Islands 2 Enable civil society to mainstream biodiversity and Strategic Direction: conservation into political and economic decision- making. Grant Amount: $149,846.00 Project Dates: October 01, 2015 - March 31, 2018 Date of Report: May 31, 2018 Implementation Partners List each partner and explain how they were involved in the project • Dahari (Comorian NGO): Dahari is leading the implementation of the activities on Anjouan through its technical staff (one socio-economic researcher, one marine ecologist and a team of community field technicians). Blue Ventures has been providing Dahari with technical support and training in ecological monitoring, project management and community-based participatory approaches to marine conservation via the Project Manager. • Moheli Marine Park (MMP) (Comorian institution and national park): Blue Ventures and MMP have exchanged experiences and shared learning around community-based fisheries management, especially around octopus closures. Blue Ventures has also provided technical support to MMP in planning and designing a methodology for fisheries monitoring, as well as an introduction to the use of smartphone-based data collection methods (Open Data Kit). Conservation Impacts Summarize the overall impact of your project, describing how your project has contributed to the implementation of the CEPF ecosystem profile • One temporary reef closure is now being managed by the community. Template version: September 10, 2015 Page 1 of 16 • The creation of a fisherwomen’s association is filling the previous lack of representation of reef gleaning fisheries. -

Indian Ocean Islands Comoros & Mayotte
Indian Ocean Islands Comoros & Mayotte 26th September to 4th October 2020 (9 days) Mayotte Scops Owl by Daniel Keith Danckwerts Sprinkled through the tropical seas off East Africa are a series of volcanic and coralline islands where paradise is defined in a most exquisite beauty! On our exploration of these idyllic isles, we will search for birds in the most spectacular scenery; be it rugged forest-clad volcanic peaks, verdant forest patches or white, shell-laden beaches fringed by warm water and teeming marine life. Island wildlife is generally susceptible to extinction, however, and the islands of this area are no exception with birds like the unfortunate Dodo serving as stark reminders of Mans’ heavy hand. The Comoros Archipelago, in particular, consists of a series of volcanic islands off the central-east African coast. They are divided between the Union of the Comoros – a sovereign nation formed by the three islands of Grande Comoro, Anjouan & Mohéli – and the French overseas department of Mayotte. The vast evergreen forests that once dominated these islands have largely been removed, leaving only a few remaining pockets of RBL Indian Ocean Islands – Comoros Itinerary 2 pristine habitat. Collectively, the four islands boast roughly 24 endemic species but this will likely reach a staggering 40 with further research. The addition of incredible scenery, a series of easily approachable active volcanoes and particularly friendly locals have made these islands an enticing and rewarding experience. We welcome you to join us as we island-hop with binoculars in hand on our quest to find the birds of these heavenly Indian Ocean isles. -

Leprosy on Anjouan (Comoros): Persistent Hyper-Endemicity Despite Decades of Solid Control Efforts
Lepr Rev (2017) 88, 334–342 Leprosy on Anjouan (Comoros): persistent hyper-endemicity despite decades of solid control efforts EPCO HASKER*, ABDALLAH BACO**, ASSOUMANI YOUNOUSSA**, ABOUBACAR MZEMBABA**, SAVERIO GRILLONE**, TINE DEMEULENAERE***, GUIDO GROENEN****, PHILIP SUFFYS***** & BOUKE C. DE JONG* *Institute of Tropical Medicine, Belgium **Leprosy and TB control program, Comoros ***Damien Foundation, Belgium ****BELTA-TBnet, Belgium *****Laboratory of Molecular Biology Applied to Mycobacteria, Oswaldo Cruz Institute, Fiocruz, Rio de Janeiro, Brazil Accepted for publication 3 May 2017 Summary Introduction: Despite decades of solid leprosy control efforts, the disease remains highly endemic on the island of Anjouan, Comoros. Among a population of less than 400,000 over 300 new leprosy patients are diagnosed on average annually. Methods: We analysed routine data for the period of 2000–2015 for trends in epidemiological parameters and clustering in time and space. Results: Leprosy incidence remains high (7·4/10,000 per year, on average) with no indications of an imminent decrease. Increasing coverage of active case finding has led to increasing numbers of leprosy patients being detected over the past 8 years. The proportion of new patients presenting with visible deformities has consistently been low (2·4% on average). The proportion of children among new patients exceeds 30%, without any trend towards a decrease. At macro-level clusters in time and space were observed scattered across the island, without a clear pattern. Discussion: The leprosy epidemic on Anjouan continues unabated despite the activities of a well-organised control programme. There appears to be a need to further scale up case finding efforts and organise them in a more systematic manner. -

Effects of Human Disturbance on the Mongoose Lemur Eulemur Mongoz in Comoros: Implications and Potential for the Conservation of a Critically Endangered Species
Effects of human disturbance on the mongoose lemur Eulemur mongoz in Comoros: implications and potential for the conservation of a Critically Endangered species B AKRI N ADHUROU,ROBERTA R IGHINI,MARCO G AMBA,PAOLA L AIOLO A HMED O ULEDI and C RISTINA G IACOMA Abstract The decline of the mongoose lemur Eulemur mon- conversion of forests into farmland, habitat loss and frag- goz has resulted in a change of its conservation status from mentation, hunting for meat, and direct persecution as agri- Vulnerable to Critically Endangered. Assessing the current cultural pests (Schwitzer et al., ). Shortage of essential threats to the species and the attitudes of the people coexist- resources, poverty and food insecurity often accentuate an- ing with it is fundamental to understanding whether and thropogenic pressures. Human well-being is dependent on how human impacts may affect populations. A question- biodiversity (Naeem et al., ) but many activities deemed naire-based analysis was used to study the impact of agricul- indispensable for human subsistence lead to biodiversity ture and other subsistence activities, and local educational losses (Díaz et al., ; Reuter et al., ). Damage to initiatives, on lemur abundance, group size and compos- crops, livestock or human life by wildlife provides sufficient ition in the Comoros. On the islands of Mohéli and motivation for people to eradicate potential animal compe- Anjouan we recorded lemurs in groups, the size titors (Ogada et al., ) and to reduce the quantity and and composition of which depended both on environmental quality of natural habitats on private and communal lands parameters and the magnitude and type of anthropogenic (Albers & Ferraro, ). -

Socmon Comoros NOAA
© C3 Madagascar and Indian Ocean Islands Programme 2010 C3 Madagascar and Indian Ocean Islands Programme is a collaborative initiative between Community Centred Conservation (C3), a non-profit company registered in England no. 5606924 and local partner organizations. The study described in this report was funded by the NOAA Coral Reef Conservation Program. Suggested citation: C3 Madagascar and Indian Ocean Islands Programme (2010) SOCIO- ECONOMIC ASSESSMENT AND IDENTIFICATION OF POTENTIAL SITES FOR COMMUNITY-BASED CORAL REEF MANAGEMENT IN THE COMOROS. A Report Submitted to the NOAA Coral Reef Conservation Program, USA 22pp FOR MORE INFORMATION C3 Madagascar and Indian Ocean NOAA Coral Reef Conservation Program Islands Programme (Comoros) Office of Response and Restoration BP8310 Moroni NOAA National Ocean Service Iconi 1305 East-West Highway Union of Comoros Silver Spring, MD 20910 T. +269 773 75 04 USA CORDIO East Africa Community Centred Conservation #9 Kibaki Flats, Kenyatta Beach, (C3) Bamburi Beach www.c-3.org.uk PO BOX 10135 Mombasa 80101, Kenya [email protected] [email protected] Cover photo: Lobster fishers in northern Grande Comore SOCIO-ECONOMIC ASSESSMENT AND IDENTIFICATION OF POTENTIAL SITES FOR COMMUNITY-BASED CORAL REEF MANAGEMENT IN THE COMOROS Edited by Chris Poonian Community Centred Conservation (C3) Moroni 2010 ACKNOWLEDGEMENTS This report is the culmination of the advice, cooperation, hard work and expertise of many people. In particular, acknowledgments are due to the following for their contributions: COMMUNITY CENTRED -

Niveaux D'anticorps Contre La Protéine Circumsporozoïtique De
Ann. Parasitol. Hum. Comp., Mots-clés : Épidémiologie du paludisme. Anticorps anti-CS pro 1991, 66 : n° 4, 179-184. téine de Plasmodium falciparum. Anopheles gambiae. Anopheles funestus. Comores. Mémoire. Key-words: Malaria epidemiology. Plasmodium falciparum CS- protein antibodies. Anopheles gambiae. Anopheles funestus. Comoros. NIVEAUX D’ANTICORPS CONTRE LA PROTÉINE CIRCUMSPOROZOÏTIQUE DE PLASMODIUM FALCIPARUM ET LEUR UTILISATION EN TANT QU’INDICATEURS ÉPIDÉMIOLOGIQUES DE LA TRANSMISSION DU PALUDISME EN RFI DES COMORES G. SABATINELLI*, R. ROMI*, S. BLANCHY** R ésumé -------------------------------------------------------------------------------------- Une enquête épidémiologique pour déterminer les niveaux d’anti Les prévalences d’Ac-CS dans l’échantillon de population examinée corps contre la protéine circumsporozoïtique de Plasmodium fal passe de 5,5 % chez les enfants de 3-4 ans à 40 % chez ceux ciparum (Ac-CS) a été menée au début de la saison des pluies de 5 ans. Dès 6-7 ans, on enregistre une augmentation progressive 1988, dans 21 villages de la RFI des Comores, conjointement à de la prévalence qui atteint un plateau après 30 ans. La détermi une évaluation des densités résiduelles anophéliennes. Des préva nation des niveaux d’Ac-CS se révèle une méthode très utile pour lences d’Ac-CS très différentes ont été relevées dans la population évaluer les niveaux de transmission du paludisme, particulièrement des villages choisis, comme l’ont été les densités moyennes d’Ano dans les situations épidémiologiques où une évaluation entomolo- pheles gambiae et d’Anopheles funestus par chambre. Les diffé gique fiable est difficile à effectuer. rences sont conditionnées par les situations écologiques locales. Summary: Antibodies levels to Plasmodium falciparum circumsporozoitic protein as epidemiological indicators of malaria transmission in the FIR of Comoros. -

UNION DES COMORES Unité – Solidarité – Développement
UNION DES COMORES Unité – Solidarité – Développement --------- ! DIRECTION GENERALE DE L’ANACEP ---------- _________________________________________________ PROJET DE FILETS SOCIAUX DE SECURITES Accord de Financement N° D0320 -KM RAPPORT SEMESTRIEL D’ACTIVITES N° 05 Période du 1 er juillet au 31 décembre 2017 Février 2018 1 SIGLES ET ABREVIATIONS ACTP : Argent Contre Travail Productif ACTC : Argent Contre Travail en réponses aux Catastrophes AG : Assemblée Générale AGEX : Agence d’Exécution ANACEP : Agence Nationale de Conception et d’Exécution des Projets AGP : Agence de Paiement ANO: Avis de Non Objection AVD : Agent Villageois de Développement ANJE : Amélioration du Nourrisson et du Jeune Enfant BE : Bureau d’Etudes BM : Banque Mondiale CCC : Comité Central de Coordination CG : Comité de Gestion CGES : Cadre de Gestion Environnementale et Sociale CGSP : Cellule de Gestion de Sous Projet CI : Consultant Individuel CP : Comité de Pilotage CPR : Cadre de politique de Réinstallation CPS Comité de Protection Sociale CR : Comité Régional DAO : Dossier d’appel d’offre DEN : Directeur Exécutif National DGSC : Direction Générale de la Sécurité Civile DP : Demande de Proposition DER : Directeur Exécutif Régional DNO : Demande de Non Objection DSP : Dossier de sous- projet FFSE : Facilitateur chargé du Suivi Evaluation HIMO : Haute Intensité de Main d’Œuvres IDB : Infrastructure de Bases IDB C : Infrastructure De Base en réponse aux Catastrophes IEC : Information Education et Communication MDP : Mémoire Descriptif du Projet MWL : île de Mohéli -
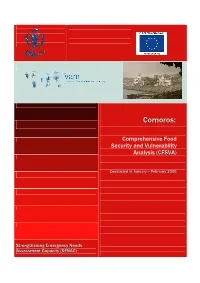
Comoros: Comprehensive Food Security and Vulnerability Analysis (CFSVA)
CCoommoorrooss:: Comprehensive Food Security and Vulnerability Analysis (CFSVA) Conducted in January – February 2006 Strengthening Emergency Needs Assessment Capacity (SENAC) 2 Comoros: Comprehensive Food Security and Vulnerability Analysis (CFSVA) Prepared by Tango International March, 2006 © World Food Programme, Vulnerability Analysis and Mapping Branch (ODAV) This study was prepared under the umbrella of the “Strengthening Emergency Needs Assessment Capacity” (SENAC) project. The SENAC project aims to reinforce WFP’s capacity to assess humanitarian needs in the food sector during emergencies and the immediate aftermath through accurate and impartial needs assessments. For any queries on this document or the SENAC project, please contact [email protected] or Krystyna Bednarska, Country Director Madagascar: [email protected] Eric Kenefick Regional VAM Officer Johannesburg: [email protected] For information on the VAM unit, please visit us at http://vam.wfp.org/ United Nations World Food Programme Headquarters: Via C.G. Viola 68, Parco de’ Medici, 00148, Rome, Italy This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union. 3 4 Comoros: Comprehensive Food Security and Vulnerability Analysis (CFSVA) Conducted January-February 2006 5 6 Acknowledgements The authors of this report would like to thank the United Nations-Comoros staff in Moroni for their assistance and support throughout the mission. Particular appreciation is due to Ms. Guiseppina Mazza, the UNDP Resident Representative, who assured our logistic and material support. In addition, we would like to acknowledge the efforts of the UN staff on Anjouan (Houmadi Abdallah) and on Mohéli (Nafion Mohammed). -

21 3 223 225 Golovatch Comores.P65
Arthropoda Selecta 21(3): 223225 © ARTHROPODA SELECTA, 2012 New records of millipedes from the Comoro Islands (Diplopoda) Íîâûå íàõîäêè ìíîãîíîæåê-äèïëîïîä ñ Êîìîðñêèõ îñòðîâîâ (Diplopoda) C. Rollard1 & S.I. Golovatch2 Ê. Ðîëëàð1, Ñ.È. Ãîëîâà÷2 1 Muséum national dHistoire naturelle, Département Systématique & Evolution, UMR 7205 OSEB, Section Arthropodes, 57 rue Cuvier, CP 53, 75005 Paris, France. 2 Institute for Problems of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences, Leninsky pr. 33, Moscow 119071, Russia. 2 Èíñòèòóò ïðîáëåì ýêîëîãèè è ýâîëþöèè ÐÀÍ, Ëåíèíñêèé ïð. 33, Ìîñêâà 119071 Ðîññèÿ. KEY WORDS: Diplopoda, fauna, Comoros. ÊËÞ×ÅÂÛÅ ÑËÎÂÀ: Diplopoda, ôàóíà, Êîìîðñêèå îñòðîâà. ABSTRACT. A small collection of diplopods from MW05, Lake Dziani Boundouni, degraded dry forest (60 m), the Comoros contains nine species, two of which repre- 31.10.2008.; 1 juv.: Mohéli, MW16, Chalet St Antoine, natural sent new island records. The fauna (16 species) is forest on crest (700 m), 4.11.2008. confirmed to be depauperate and dominated by anthro- REMARKS. This pantropical species is quite com- pochore species, but several seem to be local endemics mon on all of the islands of the Comoro Archipelago (4) or subendemics (3). [VandenSpiegel & Golovatch, 2007]. ÐÅÇÞÌÅ. Íåáîëüøîé ìàòåðèàë äèïëîïîä ñ Êî- ìîðñêèõ îñòðîâîâ ñîäåðæèò äåâÿòü âèäîâ, äâà èç Family Pachybolidae êîòîðûõ âïåðâûå óêàçàíû äëÿ îäíîãî èç îñòðîâîâ. Ïîäòâåðæäàåòñÿ, ÷òî ôàóíà (16 âèäîâ) îáåäíåíà è â íåé äîìèíèðóþò àíòðîïîõîðíûå âèäû, íî â åå ñî- Leptogoniulus sorornus (Butler, 1876) ñòàâå, î÷åâèäíî, åñòü è ìåñòíûå ýíäåìèêè (4) è ñóáýíäåìèêè (3). MATERIAL. 1 juv.: Anjouan, ND16, Hajoho Bay, back beach, degraded forest (2 m), 16.11.2010; 1 $: Grande Comore, NG01, Mt Dima Kora, Lake Hantsangoma, banana plants (1000 m), Introduction 19.10.2008. -

Annotated UNDP-GEF Project Document Template
United Nations Development Programme Project Document Least Developed Country Fund (LDCF) Project title: Strengthening Comoros resilience against climate change and variability related disaster. Country: Implementing Partner: Management Arrangements: National Implementation Modality Union of Comoros UNDP (NIM) UNDAF/Country Programme Outcome: Outcome 4 – By 2019, the most vulnerable populations ensure their resilience to climate change and crises. UNDP Strategic Plan Output: insert either 1.3, 1.4, 1.5 or 2.5 see item 5 under further information in the opening section of the annotated template UNDP Social and Environmental Screening Category: UNDP Gender Marker: 2. Low Atlas Project ID/Award ID number: 00103394 Atlas Output ID/Project ID number: 00105390 UNDP-GEF PIMS ID number: 5445 GEF ID number: 6912 Planned start date: this is defined as the expected Planned end date: 60 months project document signature date LPAC date: Brief project description: The Union of Comoros (Comoros) is comprised of four islands, namely Ngazidja (or Grande Comore), Mwali (Mohéli), Ndzuani (Anjouan) and Maoré (Mayotte). However, the project will only focus on three of the four islands, excluding Maoré from the project area. Comoros is a small island developing state (SIDS) with a population of ~8000 and is one of the most densely populated countries in Africa. Being a SIDS, the Comoros is characterised by limited resources and poor economic resilience. The Comorian population is predominantly dependent upon subsistence livelihoods based on traditional crops and reliant upon natural resources. Existing land use practices connected to natural resource management are poorly managed resulting in food and water insecurity. Furthermore, because of its geographical position and climatic factors, the Comoros is vulnerable to natural disasters such as tropical storms, floods, rising sea level, volcanic eruptions, earthquakes and landslides.