B.P. 392 – 75232 PARIS Cedex 05
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Complex Mating Behavior in Adelosgryllus Rubricephalus
Complex mating behavior in Adelosgryllus rubricephalus... 325 Complex mating behavior in Adelosgryllus rubricephalus (Orthoptera, Phalangopsidae, Grylloidea) Edison Zefa1,2, Luciano de P. Martins2 & Neucir Szinwelski3 1. Departamento de Zoologia e Genética, Instituto de Biologia, Universidade Federal de Pelotas (UFPel), 96010-900 Capão do Leão, RS, Brazil. ([email protected]) 2. Departamento de Biologia, Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista (UNESP), Avenida 24-A, 1515, Caixa Postal 199, 13506-900 Rio Claro, SP, Brazil. ([email protected]) 3. Depto. de Biologia Animal, Universidade Federal de Viçosa (UFV), Avenida Peter Henry Rolfs, s/n, Campus Universitário, 36570- 000 Viçosa, MG, Brazil. ([email protected]) ABSTRACT. We describe the mating behavior of Adelosgryllus rubricephalus Mesa & Zefa, 2004. In trials carried out in laboratory we verified the following mating sequence: (1) sexual recognition by antennation; (2) courtship with male turning his abdomen towards the female, performing mediolateral antennae vibration, jerking its body antero-posteriorly and stridulating intermittently, while receptive female drums on the male’s abdomen tip, cerci and hind-tibia with her palpi or foretarsi; the male then stops and stays motionless for some seconds, extrudes the spermatophore and both restart the behavioral sequence described above; (3) copulation: male underneath female; with his tegmina inclined forward, and joins his genitalia to the female’s to promote sperm transference ; the female steps off the male, occurring a brief end-to-end position; (4) postcopulation: without guarding behavior; male retains the spermatophore and eats it. We quantified elapsed time of each behavioral sequence and discussed its implications in the observed mating behavior. KEYWORDS. Insecta, Phalangopsidae, crickets, courtship, copulation. -

Proceedings of the United States National Museum
PROCEEDINGS OF THE UNITED STATES NATIONAL MUSEUM issued i^.^vU Qy^ iy the SMITHSONIAN INSTITUTION U. S. NATIONAL MUSEUM Vol. 106 Washington : 1956 No. 3366 ' ' • ... _ - " -'» : -: . ,. ., •;-- . '- ..- , - ;-_- .-rw f SOME CRICKETS FROM SOUTH AMERICA (GRYLLOIDEA AND TRIDACTYLOIDEA) By LuciEN Chopard* Through the kindness of Dr. Ashley B. Gurncy, I have been able to examine an important collection of Giylloidea and Tridactyloidea ^ belonging to the U. S, National Museum. Three ma,in lots of specimens comprise the collection: 1. Material collected in northwestern Bolivia by Dr. William M. Mann in 1921-1922 while a member of the Mulford Biological Ex- ploration of the Amazon Basin. A list of his headquarters stations and a map of his itinerary are shown by Snyder (1926) and a popular account of the expedition is given by MacCreagh (1926). 2. Material taken at Pucallpa on the Rio Ucayali and at other Peruvian locahties by Jos6 M. Schunke in 1948-1949 and obtained for the U. S. National Museiun by Dr. Gurney. 3. Material collected in 1949-1950 at Tingo Maria, Peril, and nearby localities by Dr. Harry A. Allard, a retired botanist of the U. S. Department of Agriculture who was engaged primarily in col- lecting plants. All of the principal collecting sites represented by this material are in the drainage of the Amazon River. Some 500 miles separate the area worked over by Allard and Schunke from that where Mann collected. A few Brazilian and Chilean specimens are also included. The following localities are represented: Bolivia: Blanca Flor; Cachuela Esperauza; Caiiamina; Cavinas; Coroico; Covendo; Espia; Huachi; Ivon; Ixiamas; Lower Madidi 'Of the Museum National d'Histoire Naturelle, Paiis (MXHK). -
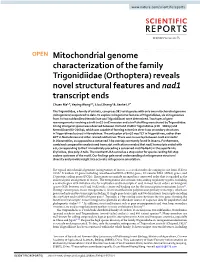
Mitochondrial Genome Characterization of the Family Trigonidiidae
www.nature.com/scientificreports OPEN Mitochondrial genome characterization of the family Trigonidiidae (Orthoptera) reveals novel structural features and nad1 transcript ends Chuan Ma1,3, Yeying Wang2,3, Licui Zhang1 & Jianke Li1* The Trigonidiidae, a family of crickets, comprises 981 valid species with only one mitochondrial genome (mitogenome) sequenced to date. To explore mitogenome features of Trigonidiidae, six mitogenomes from its two subfamilies (Nemobiinae and Trigonidiinae) were determined. Two types of gene rearrangements involving a trnN-trnS1-trnE inversion and a trnV shufing were shared by Trigonidiidae. A long intergenic spacer was observed between trnQ and trnM in Trigonidiinae (210−369 bp) and Nemobiinae (80–216 bp), which was capable of forming extensive stem-loop secondary structures in Trigonidiinae but not in Nemobiinae. The anticodon of trnS1 was TCT in Trigonidiinae, rather than GCT in Nemobiinae and other related subfamilies. There was no overlap between nad4 and nad4l in Dianemobius, as opposed to a conserved 7-bp overlap commonly found in insects. Furthermore, combined comparative analysis and transcript verifcation revealed that nad1 transcripts ended with a U, corresponding to the T immediately preceding a conserved motif GAGAC in the superfamily Grylloidea, plus poly-A tails. The resultant UAA served as a stop codon for species lacking full stop codons upstream of the motif. Our fndings gain novel understanding of mitogenome structural diversity and provide insight into accurate mitogenome annotation. Te typical mitochondrial genome (mitogenome) of insects is a circular molecule ranging in size from 15 kb to 18 kb1. It harbors 37 genes including two ribosomal RNA (rRNA) genes, 22 transfer RNA (tRNA) genes, and 13 protein-coding genes (PCGs). -

Systematics and Acoustics of North American Anaxipha (Gryllidae: Trigonidiinae) by Thomas J
Systematics and acoustics of North American Anaxipha (Gryllidae: Trigonidiinae) by Thomas J. Walker and David H. Funk Journal of Orthoptera Research 23(1): 1-38. 2014. Front cover Back cover In brief: This paper provides valid scientific names for the 13 species known to occur in North America and uses their songs and files to question the prevailing view of how frequency is determined in the songs of most crickets. Supplementary materials: All supplementary materials are accessible here as well as from the Full Text and PDF versions on BioOne. Press “Page Down” to view page 1 of the article. T.J. WALKER AND D.H.Journal FUNK of Orthoptera Research 2014, 23(1): 1-381 Systematics and acoustics of North American Anaxipha (Gryllidae: Trigonidiinae) THOMAS J. WALKER AND DAVID H. FUNK [TW] Department of Entomology and Nematology, University of Florida, Gainesville, FL 32611, USA. Email: [email protected] [DF] Stroud Water Research Center, Avondale, Pennsylvania, 19311, USA. Email: [email protected] Abstract Introduction The genus Anaxipha has at least 13 North American species, eight of which Some 163 species of tiny brownish crickets are nominally in the are described here. Ten species fall into these three species groups: exigua trigonidiine genus Anaxipha (OSFO 2013), but Otte & Perez-Gelabert group (exigua Say, scia Hebard and n. spp. thomasi, tinnulacita, tinnulenta, (2009, p. 127) suggest that the genus is "in serious need of revi- and tinnula); delicatula group (delicatula Scudder and vernalis n. sp.); litarena sion" and that "the taxonomy of the Trigonidiinae as a whole is in a group (litarena Fulton and rosamacula n.sp.). -

Trigonidium (Trigonidium) Cicindeloides Rambur
ISSN: 1989-6581 López Colón et al. (2017) www.aegaweb.com/arquivos_entomoloxicos ARQUIVOS ENTOMOLÓXICOS, 18: 217-218 NOTA / NOTE Presencia de Trigonidium (Trigonidium) cicindeloides Rambur, 1838 en Jaén (Andalucía) (Orthoptera, Trigonidiidae). José Ignacio López Colón 1, Pablo Bahillo de la Puebla 2 & Toni Pérez Fernández 3 1 Plaza de Madrid, 2, 1ºD. E-28523 Rivas-Vaciamadrid (Madrid, ESPAÑA). e-mail: [email protected] 2 Departamento de Biología-Geología, I.E.S. Antonio Trueba. E-48901 Baracaldo (Vizcaya, ESPAÑA). e-mail: [email protected] 3 Grupo de Espeleología de Villacarrillo (G.E.V.). Plaza 28 de Febrero, 5, 1º-2ª. E-23300 Villacarrillo (Jaén, ESPAÑA). e-mail: [email protected] Resumen: Se comunica la presencia en la provincia de Jaén (Andalucía) de Trigonidium (Trigonidium) cicindeloides Rambur, 1838 (Orthoptera, Trigonidiidae), de donde no se conocía. Palabras clave: Orthoptera, Trigonidiidae, Trigonidium cicindeloides, Jaén, España, Faunística. Abstract: Ocurrence of Trigonidium (Trigonidium) cicindeloides Rambur, 1838 in Jaen (Andalusia) (Orthoptera, Trigonidiidae). The presence of Trigonidium (Trigonidium) cicindeloides Rambur, 1838 (Orthoptera, Trigonidiidae) in the province of Jaen (Andalusia), where it was so far unknown from, is reported. Key words: Orthoptera, Trigonidiidae, Trigonidium cicindeloides, Jaen, Spain, Faunistics. Recibido: 4 de octubre de 2017 Publicado on-line: 27 de noviembre de 2017 Aceptado: 28 de octubre de 2017 Trigonidium (Trigonidium) cicindeloides Rambur, 1838 (Orthoptera, Trigonidiidae) es un pequeño ortóptero, difícil de ver, presente en herbazales de ribera, cañizos y junqueras, y que también vive sobre la vegetación cercana a canales de riego o balsas (SERRANO et al., 2015). Es una especie aparentemente rara en la Península Ibérica, debido a su modo de vida y a la falta de prospecciones con la metodología adecuada, aunque no parece serlo en los hábitats que le son propicios y están bien conservados (David Lluciá, com. -

Arthropod Survey of 'Öpae 'Ula and Adjacent Summit Areas of the Ko
Arthropod Survey of ‘Öpae ‘ula and Adjacent Summit Areas of the Ko‘olau Mountains, O‘ahu, Hawai‘i David J. Preston , Dan A. Polhemus, Keith T. Arakaki, and Myra K. K. McShane Hawaii Biological Survey, Bishop Museum, 1525 Bernice Street Honolulu, Hawaii, 96817-2704, USA Submitted to Hawaii Department of Land And Natural Recourses Division Of Forestry And Wildlife Hawaii Natural Area Reserve System 1151 Punchbowl Street, Room 325 Honolulu, Hawaii 96813 June 2004 Contribution No.2004-010 to the Hawaii Biological Survey 1 TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION ................................................................................................................................2 METHODS............................................................................................................................................2 COLLECTION SITES .........................................................................................................................2 Table 1: Collection sites .......................................................................................................................3 Figure 1. Sample sites...........................................................................................................................4 RESULTS..............................................................................................................................................4 Table 2: Insects and related arthropods collected from the upper Käluanui drainage, Ko’olau Mountains..............................................................................................................................................6 -

Trigonidium) Cicindeloides Rambur 1839 (Orthoptera: Grillidae) Para Galicia (España
Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.), nº 51 (31/12/2012): 341‒342. NOTAS CIENTÍFICAS Primera cita de Trigonidium (Trigonidium) cicindeloides Rambur 1839 (Orthoptera: Grillidae) para Galicia (España) Rubén Pino Pérez1; Juan José Pino Pérez2 & Adrián Pino-Cancelas3 1 Sierra Poniente, 1B -36940 Cangas (Pontevedra, España) ‒ [email protected] 2 Avda. de Vigo, 50, 1º - 36940 Cangas (Pontevedra, España) 3 Rúa dos Heroes de 1617, s/n - 36940 Cangas (Pontevedra, España) Resumen: Se aporta la primera cita para Galicia del gríllido Trigonidium (Trigonidium) cicindeloides Rambur 1839 y se propone en base a los datos aportados su distribución potencial en la región. Palabras clave: Orthoptera, Gryllidae, Trigonidium cicindeloides, España, Galicia. First record of Trigonidium (Trigonidium) cicindeloides Rambur 1839 (Insecta, Orthoptera) from Galicia (Spain) Abstract: Trigonidium (Trigonidium) cicindeloides Rambur 1839 is recorded from Galicia for the first time and its potential distribution in the region is commented upon. Key words: Orthoptera, Gryllidae, Trigonidium cicindeloides, Spain, Galicia. Introducción El subgénero nominotípico Trigonidium Rambur, 1839, cuenta con Todos los ejemplares se encuentran depositados en la colec- una sola especie, T. (T.) cicindeloides Rambur, 1839, distribuida por el ción LOU-Arthr del Centro de Investigaciones Forestales de Lourizán sur de Europa [Grecia, Albania, Croacia, Bosnia Herzegovina, Serbia, (Pontevedra). Kosovo y Montenegro, Italia, Francia, España y Portugal e islas medi- Los ejemplares observados de día, fueron recogidos entre las terráneas de Córcega, Creta, Chipre, Archipiélago de Dodecaneso, 15:00 y las 17:00, con fuerte actividad de ninfas y adultos y temperatu- Baleares, Malta, Cerdeña y Sicilia (Audinet, 1839: 351; Walker 1869: ra por encima de 30ºC. -

Orthoptera: Ensifera) and a Possible Role of F Supergroup Wolbachia in Bush Crickets
RATE OF DIVERSIFICATION IN CRICKETS (ORTHOPTERA: ENSIFERA) AND A POSSIBLE ROLE OF F SUPERGROUP WOLBACHIA IN BUSH CRICKETS by KANCHANA PANARAM Presented to the Faculty of the Graduate School of The University of Texas at Arlington in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY THE UNIVERSITY OF TEXAS AT ARLINGTON August 2007 Copyright © by Kanchana Panaram 2007 All Rights Reserved ACKNOWLEDGEMENTS I would not have reached my highest education that I can possibly reach without help and support from so many people. I must thank my parent and siblings for all supports that have giving me until this very day. My fiancé, Vinod Krishnan always encourages me that I can accomplish everything if I have a will and he has given me the will power I need. Conducting research and publication preparation are highly challenging tasks for me, and I would not have accomplished this far with out help from my mentors. I greatly am greatly indebted to my major advisor, Dr. Jeremy L. Marshall who has provided me research resources and knowledge, motivated me and lead me to this final stage of my study, my committee members Drs. Esther Betrán, Paul Chippindale, Elena de La Casa-Esperon, James V. Robinson and Graduate Advisor, Dr. Daniel Formanowicz for taking time to help me going through graduate school processes. In addition, I am very thankful for receiving great training in vector biology research and help from Drs. Jaroslaw and Elzbieta Krzywinski during my last year at UTA. Friends are one of the important factors of my happiness during my 4 years at UTA. -

Crickets of New Caledonia (Insecta, Orthoptera, Grylloidea): a Key to Genera, with Diagnoses of Extant Genera and Descriptions of New Taxa
Crickets of New Caledonia (Insecta, Orthoptera, Grylloidea): a key to genera, with diagnoses of extant genera and descriptions of new taxa Laure DESUTTER-GRANDCOLAS Institut de Systématique, Évolution et Biodiversité, ISYEB – UMR 7205 CNRS, MNHN, UPMC, EPHE, Muséum national d’Histoire naturelle, Sorbonne Universités, case postale 50, 57 rue Cuvier, F-75231 Paris cedex 05 (France) [email protected] Jérémy ANSO Institut de Systématique, Évolution et Biodiversité, ISYEB – UMR 7205 CNRS, MNHN, UPMC, EPHE, Muséum national d’Histoire naturelle, Sorbonne Universités, case postale 50, 57 rue Cuvier, F-75231 Paris cedex 05 (France) and Institut méditerranéen de Biodiversité et d’Écologie marine et continentale (IMBE), Aix-Marseille Université, UMR CNRS, IRD, UAPV, Centre IRD Nouméa, BP A5, 98848 Nouméa Cedex, (Nouvelle-Calédonie) Hervé JOURDAN Institut méditerranéen de Biodiversité et d’Écologie marine et continentale (IMBE), Aix-Marseille Université, UMR CNRS, IRD, UAPV, Centre IRD Nouméa, boîte postale A5, 98848 Nouméa Cedex (Nouvelle-Calédonie) Published on 30 December 2016 urn:lsid:zoobank.org:pub:9E796669-C345-42D6-B0F9-95288DB701EE Desutter-Grandcolas L., Anso J. & Jourdan H. 2016. — Crickets of New Caledonia (Insecta, Orthoptera, Grylloidea): a key to genera, with diagnoses of extant genera and descriptions of new taxa. Zoosystema 38 (4): 405-452. https:// doi.org/10.5252/z2016n4a1 ABSTRACT Crickets (Insecta, Orthoptera, Gryllidea) are amongst the most abundant and diverse insects in New Caledonia: 40 genera are recorded today from the Archipelago and 180 cricket species have been reported; 19 genera and more than 90% of the species are endemic. Owing to this diversity, crickets prove an interesting model to test evolutionary hypotheses about New Caledonia and its fauna. -
Laying the Foundations of Evolutionary and Systematic Studies in Crickets (Insecta, Orthoptera): a Multilocus Phylogenetic Analysis
Cladistics Cladistics 32 (2016) 54–81 10.1111/cla.12114 Laying the foundations of evolutionary and systematic studies in crickets (Insecta, Orthoptera): a multilocus phylogenetic analysis Ioana C. Chintauan-Marquiera,†,Frederic Legendrea,†, Sylvain Hugelb, Tony Robillarda, Philippe Grandcolasa, Andre Nela, Dario Zucconc and Laure Desutter-Grandcolasa,* aInstitut de Systematique, Evolution, Biodiversite, ISYEB - UMR 7205 CNRS, UPMC, EPHE, Museum national d’Histoire naturelle, Sorbonne Universites, CP 50, 45, rue Buffon, Paris 75005, France; bINCI, UPR3212 CNRS, Universite de Strasbourg, 21, rue Rene Descartes, Strasbourg F-67084, France; cService de Systematique Moleculaire, UMS2700 MNHN-CNRS, Departement Systematique et Evolution, Museum national d’Histoire naturelle, Paris Cedex 05, France Accepted 27 January 2015 Abstract Orthoptera have been used for decades for numerous evolutionary questions but several of its constituent groups, notably crickets, still suffer from a lack of a robust phylogenetic hypothesis. We propose the first phylogenetic hypothesis for the evolu- tion of crickets sensu lato, based on analysis of 205 species, representing 88% of the subfamilies and 71% tribes currently listed in the database Orthoptera Species File (OSF). We reconstructed parsimony, maximum likelihood and Bayesian phylogenies using fragments of 18S, 28SA, 28SD, H3, 12S, 16S, and cytb (~3600 bp). Our results support the monophyly of the cricket clade, and its subdivision into two clades: mole crickets and ant-loving crickets on the one hand, and all the other crickets on the other (i.e. crickets sensu stricto). Crickets sensu stricto form seven monophyletic clades, which support part of the OSF fami- lies, “subfamily groups”, or subfamilies: the mole crickets (OSF Gryllotalpidae), the scaly crickets (OSF Mogoplistidae), and the true crickets (OSF Gryllidae) are recovered as monophyletic. -
Far Eastern Entomologist Number 394: 25-36 ISSN 1026-051X
Far Eastern Entomologist Number 394: 25-36 ISSN 1026-051X December 2019 https://doi.org/10.25221/fee.394.2 http://zoobank.org/References/5CAFD37F-AD8F-4598-B0AF-CE598D22F7A5 CRICKETS (ORTHOPTERA: GRYLLOIDEA) FROM ZHEJIANG PROVINCE, CHINA Fei Xu, Hao-Yu Liu* College of Life Sciences,Hebei University, Baoding 071002, Hebei Province, China. *Corresponding author, E-mail: [email protected] Summary. A checklist of 58 species from 37 genera, 13 subfamilies and 4 families of crickets recorded from Zhejiang Province of China is given, based on the published data and the material deposited in the Museum, Hebei University, Baoding, China (MHBU). Penta- centrus transversus Liu et Shi, 2015 and Valiatrella sororia sororia (Gorochov, 2002) are recorded from this province for the first time. The biodiversity of crickets in four provinces of China (Zhejiang, Hebei, Hunan, and Shaanxi) was compared. Key words: Gryllidae, Phalangopsidae, Mogoplistidae, Trigonidiidae, fauna, new record, China. Ф. Сюй, Х. Ю. Лю. Сверчковые (Orthoptera: Grylloidea) провинции Чжэцзян, Китай // Дальневосточный энтомолог. 2019. N 294. С. 25-36. Резюме. Для провинции Чжэцзян приводится аннотированный список 58 видов из 37 родов, 13 подсемейств и 4 семейств сверчковых, составленные на основе литератур- ных данных и коллекций Музея Хэбейского университета. Впервые для этой провинции приводятся Pentacentrus transversus Liu et Shi, 2015 и Valiatrella sororia sororia (Goro- chov, 2002). Сравнивается разнообразие сверчковых китайских провинций Чжецзян, Хэбэй, Хунань и Шэньси. INTRODUCTION Zhejiang Province, located on the southeast coast of China, east to the East China Sea, south to Fujian Province, west to Anhui Province and Jiangxi Province, and north to Shanghai and Jiangsu provinces (Fig. 1). -
A Taxonomic Study on the Bornean and Filipinos Sword-Tailed Crickets from the Genus Rhicnogryllus Chopard, 1925 (Orthoptera
A taxonomic study on the Bornean and Filipinos sword-tailed crickets from the genus Rhicnogryllus Chopard, 1925 (Orthoptera: Trigonidiinae) Running title: Rhicnogryllus from Borneo and Philippines Ming Kai Tan, Jessica Baroga-Barbecho, Razy Japir, Arthur Chung, Rodzay Bin Haji Abdul Wahab, Sheryl Yap To cite this version: Ming Kai Tan, Jessica Baroga-Barbecho, Razy Japir, Arthur Chung, Rodzay Bin Haji Abdul Wahab, et al.. A taxonomic study on the Bornean and Filipinos sword-tailed crickets from the genus Rhic- nogryllus Chopard, 1925 (Orthoptera: Trigonidiinae) Running title: Rhicnogryllus from Borneo and Philippines. 2020. hal-02946316 HAL Id: hal-02946316 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02946316 Preprint submitted on 23 Sep 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. A taxonomic study on the Bornean and Filipinos sword-tailed crickets from the genus Rhicnogryllus Chopard, 1925 (Orthoptera: Trigonidiinae) Running title: Rhicnogryllus from Borneo and Philippines Ming Kai Tan 1*, Jessica B. Baroga-Barbecho 2, Razy Japir 3, Arthur Y.