Télécharger En Format
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

644 CANADA YEAR BOOK Governments. the Primary Basis For
644 CANADA YEAR BOOK governments. The primary basis for the division is important issue of law that ought to be decided by the found in Section 2 ofthe criminal code. The attorney court. Leave to appeal may also be given by a general of a province is given responsibility for provincial appellate court when one of itsjudgments proceedings under the criminal code. The attorney is sought to be questioned in the Supreme Court of general of Canada is given responsibility for criminal Canada. proceedings in Northwest Territories and Yukon, and The court will review cases coming from the 10 for proceedings under federal statutes other than the provincial courts of appeal and from the appeal criminal code. Provincial statute and municipal division ofthe Federal Court of Canada. The court is bylaw prosecutions are the responsibility ofthe also required to consider and advise on questions provincial attorney general. referred to it by the Governor-in-Council. It may also Prosecutions may be carried out by the police or advise the Senate or the House of Commons on by lawyers, depending on the practice ofthe attorney private bills referred to the court under any rules or general responsible. If he prosecutes using lawyers, orders of the Senate or of the House of Commons. the attorney general may rely on full-time staff The Supreme Court sits only in Ottawa and its lawyers, or he may engage the services of a private sessions are open to the public. A quorum consists of practitioner for individual cases. five members, but the full court of nine sits in most A breakdown of criminal prosecution expenditures cases; however, in a few cases, five are assigned to sit, by level of government in 1981-82 shows that 75% and sometimes seven, when a member is ill or was paid by the provinces (excluding Alberta), 24% disqualifies himself Since most of the cases have by the federal government and 1% by the territories. -

Ideology and Judging in the Supreme Court of Canada
Osgoode Hall Law Journal Volume 26 Issue 4 Volume 26, Number 4 (Winter 1988) Article 4 10-1-1988 Ideology and Judging in the Supreme Court of Canada Robert Martin Follow this and additional works at: https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/ohlj Part of the Courts Commons Article This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 4.0 License. Citation Information Martin, Robert. "Ideology and Judging in the Supreme Court of Canada." Osgoode Hall Law Journal 26.4 (1988) : 797-832. https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/ohlj/vol26/iss4/4 This Article is brought to you for free and open access by the Journals at Osgoode Digital Commons. It has been accepted for inclusion in Osgoode Hall Law Journal by an authorized editor of Osgoode Digital Commons. Ideology and Judging in the Supreme Court of Canada Abstract The purpose of this article is to advance some hypotheses about the way the Supreme Court of Canada operates as a state institution. The analysis is based on the period since 1948. The first hypothesis is that the judges of the Supreme Court of Canada belong to the dominant class in Canadian society. The second hypothesis is that they contribute to the dominance of their class primarily on the ideological plane. Keywords Canada. Supreme Court--Officials and employees--History; Judges; Canada Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 4.0 License. This article is available in Osgoode Hall Law Journal: https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/ohlj/vol26/iss4/4 IDEOLOGY AND JUDGING IN THE SUPREME COURT OF CANADA* By ROBERT MARTIN" The purpose of this article is to advance some hypotheses about the way the Supreme Court of Canada operates as a state institution. -
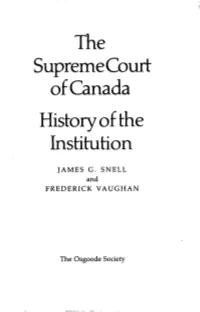
The Supremecourt History Of
The SupremeCourt of Canada History of the Institution JAMES G. SNELL and FREDERICK VAUGHAN The Osgoode Society 0 The Osgoode Society 1985 Printed in Canada ISBN 0-8020-34179 (cloth) Canadian Cataloguing in Publication Data Snell, James G. The Supreme Court of Canada lncludes bibliographical references and index. ISBN 0-802@34179 (bound). - ISBN 08020-3418-7 (pbk.) 1. Canada. Supreme Court - History. I. Vaughan, Frederick. 11. Osgoode Society. 111. Title. ~~8244.5661985 347.71'035 C85-398533-1 Picture credits: all pictures are from the Supreme Court photographic collection except the following: Duff - private collection of David R. Williams, Q.c.;Rand - Public Archives of Canada PA@~I; Laskin - Gilbert Studios, Toronto; Dickson - Michael Bedford, Ottawa. This book has been published with the help of a grant from the Social Science Federation of Canada, using funds provided by the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada. THE SUPREME COURT OF CANADA History of the Institution Unknown and uncelebrated by the public, overshadowed and frequently overruled by the Privy Council, the Supreme Court of Canada before 1949 occupied a rather humble place in Canadian jurisprudence as an intermediate court of appeal. Today its name more accurately reflects its function: it is the court of ultimate appeal and the arbiter of Canada's constitutionalquestions. Appointment to its bench is the highest achieve- ment to which a member of the legal profession can aspire. This history traces the development of the Supreme Court of Canada from its establishment in the earliest days following Confederation, through itsattainment of independence from the Judicial Committeeof the Privy Council in 1949, to the adoption of the Constitution Act, 1982. -

'Atlantic Seat' on the Supreme Court of Canada: an Endangered Species?
Osgoode Hall Law School of York University Osgoode Digital Commons Research Papers, Working Papers, Conference All Papers Papers 2017 The Atl‘ antic Seat’ on the Supreme Court of Canada: An Endangered Species? Philip Girard Osgoode Hall Law School of York University, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/all_papers Part of the Law Commons Repository Citation Girard, Philip, "The A‘ tlantic Seat’ on the Supreme Court of Canada: An Endangered Species?" (2017). All Papers. 277. https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/all_papers/277 This Working Paper is brought to you for free and open access by the Research Papers, Working Papers, Conference Papers at Osgoode Digital Commons. It has been accepted for inclusion in All Papers by an authorized administrator of Osgoode Digital Commons. “The ‘Atlantic Seat’ on the Supreme Court of Canada: An Endangered Species?” Philip Girard* I. Introduction The sigh of relief on the Atlantic coast could be heard all the way to Ottawa on October 17, 2016. On that day, Prime Minister Justin Trudeau announced the nomination of Justice Malcolm Rowe of the Newfoundland and Labrador Court of Appeal to the Supreme Court of Canada seat vacated by Justice Thomas Cromwell. Justice Cromwell’s replacement was to be the first appointed pursuant to a new process put in place by the Trudeau government. When that process was unveiled on August 2, 2016, Trudeau announced that the position would be open to any qualified Canadian lawyer or judge who was functionally bilingual and “representative of the diversity of our great country.” A further clarification stated that “[a]pplications are being accepted from across Canada in order to allow for a selection process that ensures outstanding individuals are considered for appointment to the Supreme Court of Canada,” confirming that Atlantic Canadians did not have a lock on the position.1 People on the east coast generally take most things in stride, but this proposed change created a considerable outcry. -

La Question De L'autonomie Des Francophones Hors Québec
La question de l’autonomie des francophones hors Québec : Trois décennies d’activisme judiciaire en matière de droits linguistiques au Canada Stéphanie Chouinard Thèse présentée à la Faculté des études supérieures et postdoctorales dans le cadre des exigences du programme de Doctorat en science politique École d’études politiques Faculté des Sciences sociales Université d’Ottawa © Stéphanie Chouinard, Ottawa, Canada, 2016 Résumé La thèse étudie la question de l’autonomie des francophones hors Québec au regard de trente ans d’activisme judiciaire dans le domaine des droits linguistiques depuis l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés. Nous étudions la jurisprudence importante dans ce domaine, provenant majoritairement de la Cour suprême du Canada et la possibilité, pour les juges, de faire avancer une norme d’autonomie pour les francophones hors Québec (FHQ). La thèse démontre que l’interprétation des droits linguistiques par les juges est contrainte par des éléments contextuels comme les traditions étatiques du compromis politique et du fédéralisme. Ces traditions étatiques conditionnent les représentations que se font les juges des droits linguistiques et créent des effets de « dépendance au sentier » dans le domaine de la jurisprudence, limitant la possibilité, pour les juges, de faire avancer une norme d’autonomie pour les FHQ. Les juges peuvent toutefois réviser ces éléments de dépendance au sentier afin de présenter de nouvelles représentations des droits linguistiques dans la jurisprudence, instigatrices de « points tournants », voire de nouveaux paradigmes d’interprétation, dans l’évolution des droits linguistiques. La thèse permet de voir que l’activisme judiciaire dans le domaine des droits linguistiques demeure soumis aux éléments structurants du régime linguistique canadien. -

RCAA-Annual-Report-1985-1986.Pdf
THE 1987 ANNUAL MEETING WILL BE HELD AT CFB SHILO, MAN. 18—20 SEPTEMBER Under the Distinguished Patronage of Her Excellency The Right Honourable Jeanne Sauvé, CC CMM CD Governor General of Canada Vice — Patrons Her Honour the Li eutenant-Governor of Alberta His Honour the Li eutenant—Governor of British Columbia Her Honour the Li eutenant—Governor of Manitoba His Honour the Li eutenant—Governor of New Brunswick His Honour the Li eutenant—Governor of Newfoundland His Honour the Li eutenant—Governor of Nova Scotia His Honour the Lieutenant—Governor of Ontario His Honour the Lieutenant—Governor of Prince Edward Island His Honour the Li eutenant—Governor of Quebec His Honour the Li eutenant—Governor of Saskatchewan TABLE OF CONTENTS Page Patron and Vice—Patrons 1 Photo of PresIdent 4 Officers and Executive Comittee 1986/87 5—6 Past Presidents 7—8 Past Colonels Corirnandant 8 Life Members 9—10 Honorary Life Members and Past Secretaries 10—11 Photo of delegates and members attending 1985 Meeting 12 Presidents Opening Address 13—15 Allocution du Président 15—17 Address by Colonel Comandant 18—19 Allocution du Colonel Corrrnandant 19—20 Minutes of 1985 Meeting 20—21 Comittee Reports Competitions and photos of presentation of awards 22—26 Financial 27 Regimental Affairs 28-29 Historical Sites 30—31 CISS 31—32 Treasurers Report 32—33 History Reprint 33—34 NRQS 35 —3— TABLE OF CONTENTS (Contd) Page Area Reports Atlantic 36—39 Secteur de 1 *est 39—42 Central 42—43 Prairie 43—47 Pacific 47—48 Syndicate Reports Resolutions 48—51 Position Paper 51 Constitution 51 Presentations of interest 55 Message to Her Majesty the Queen 55 Photos of Meeting 56—57 Guest night 58 Report of Nominating Comittee 58—59 Comittees for 1986—87 59 Delegates and Members attending 1986 Meeting 60—61 —4- Colonel E.A. -

Opinion Writing and Authorship on the Supreme Court of Canada Kelly Bodwin, Jeffrey S
Opinion Writing and Authorship – SCC. Please do not quote or cite without permission. Opinion Writing and Authorship on the Supreme Court of Canada Kelly Bodwin, Jeffrey S. Rosenthal and Albert H. Yoon♠ Revised: August 2012 Abstract In contrast to other branches of government, the Supreme Court of Canada operates with relatively lean staffing. For most of the Court’s history, its justices alone determined which cases to review, heard oral argument, and wrote opinions. Only since 1967 have justices have been aided in these responsibilities by law clerks. While interest abounds in the relationship between justices and their clerks – particularly the writing of opinions – very little is known. This article analyzes the text of the Court’s opinions to better understand judicial authorship. We find that justices possess distinct writing styles, allowing us to distinguish them from one another. Their writing styles also provide insight into how clerks influence the writing of opinions. Most justices in the modern era possess a more variable writing style than their predecessors, both within and across years, providing strong evidence that clerks are increasingly involved in the writing of judicial opinions. ♠ University of North Carolina, Department of Statistics; University of Toronto, Department of Statistics; University of Toronto Faculty of Law, respectively. Order of authors listed in alphabetical order. We would like to thank Ben Alarie, Ian Caines, Andrew Green, Helen Levy, Ed Morgan, Todd Peppers, Simon Stern, and Michael Tribelcock, and two anonymous reviewers for the University of Toronto Law Journal. Rosenthal was supported in part by NSERC, and Yoon was supported in part by the Russell Sage Foundation. -

Beyond a Reasonable Doubt: Does It Apply to Finding the Law As Well As the Facts?
TSpace Research Repository tspace.library.utoronto.ca Beyond a Reasonable Doubt: Does it Apply to Finding the Law as Well as the Facts? Martin Friedland Version Publisher’s Version Citation Martin Friedland, "Beyond a Reasonable Doubt: Does it Apply to (published version) Finding the Law as Well as the Facts?" (2015) 62 Criminal Law Quarterly 452. Copyright / License Reproduced from Criminal Law Quarterly. ‘Beyond a Reasonable Doubt: Does it Apply to Finding the Law as Well as the Facts? ’ (2015) [62] CLQ [452], by permission of Thomson Reuters Canada Limited. How to cite TSpace items Always cite the published version, so the author(s) will receive recognition through services that track citation counts, e.g. Scopus. If you need to cite the page number of the author manuscript from TSpace because you cannot access the published version, then cite the TSpace version in addition to the published version using the permanent URI (handle) found on the record page. This article was made openly accessible by U of T Faculty. Please tell us how this access benefits you. Your story matters. Beyond a Reasonable Doubt:Does it Apply to Finding the Law asWell as the Facts? Martin Friedland* 1. Introduction About a year ago I published an article in the Criminal Law Quarterly in which I examined the concept of proof beyond a reasonable doubt in criminal trials.1 I looked at its application to the proof of facts, historically, comparatively, and analytically. The standard of proof of facts Ð everyone agrees Ð plays a crucial role in the criminal process. -

A New Beginning 1975-1982
10 A New Beginning 1975-1982 No previous statutory enactments had greater impact on the institutional development of the Supreme Court than the two that occurred during the years between 1975 and 1982. The first, in 1975, was the culmination of a long series of amendments to the Supreme Court Act eliminating appeals as of right and granting the Court almost complete control over its docket. The second was the historic adoption in 1982 of a new constitution in which the Court was virtually entrenched and given a vital new mandate. The first development had been sought eagerly by the Court for many years; the second event was thrust upon the justices by federal and provincial politicians. Throughout these years the Supreme Court was caught in the crossfires of federal-provincial disputes more frequently than in any previous period. As well, the composition of the Court changed with the departure of several justices. Between the summer of 1977and the winter of 1980 five members of the Court retired or resigned. Prime Minister Trudeau gave little indication in the selection of the replacements that he was particu- larly sensitive to the Court's emerging new public-law mandate. The appointments followed traditional regional considerations. Wilfred Jud- son, an Ontario representative, was replaced by Willard Z. Estey from Toronto;' and Yves Pratte of Quebec City replaced Louis-Philippe de Grandprk. Estey was born and educated in Saskatchewan; after complet- ing graduate studies at Harvard, he practised law in Toronto. He quickly achieved prominence in corporate litigation, but left the practice in 1973 234 The Supreme Court of Canada for a position on the Ontario Court of Appeal. -

La Question De L'autonomie Des Francophones Hors Québec : Trois
La question de l’autonomie des francophones hors Québec : Trois décennies d’activisme judiciaire en matière de droits linguistiques au Canada Stéphanie Chouinard Thèse présentée à la Faculté des études supérieures et postdoctorales dans le cadre des exigences du programme de Doctorat en science politique École d’études politiques Faculté des Sciences sociales Université d’Ottawa © Stéphanie Chouinard, Ottawa, Canada, 2016 Résumé La thèse étudie la question de l’autonomie des francophones hors Québec au regard de trente ans d’activisme judiciaire dans le domaine des droits linguistiques depuis l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés. Nous étudions la jurisprudence importante dans ce domaine, provenant majoritairement de la Cour suprême du Canada et la possibilité, pour les juges, de faire avancer une norme d’autonomie pour les francophones hors Québec (FHQ). La thèse démontre que l’interprétation des droits linguistiques par les juges est contrainte par des éléments contextuels comme les traditions étatiques du compromis politique et du fédéralisme. Ces traditions étatiques conditionnent les représentations que se font les juges des droits linguistiques et créent des effets de « dépendance au sentier » dans le domaine de la jurisprudence, limitant la possibilité, pour les juges, de faire avancer une norme d’autonomie pour les FHQ. Les juges peuvent toutefois réviser ces éléments de dépendance au sentier afin de présenter de nouvelles représentations des droits linguistiques dans la jurisprudence, instigatrices de « points tournants », voire de nouveaux paradigmes d’interprétation, dans l’évolution des droits linguistiques. La thèse permet de voir que l’activisme judiciaire dans le domaine des droits linguistiques demeure soumis aux éléments structurants du régime linguistique canadien. -

Altering the Judicial Mind and the Process of Constitution-Making In
1990) ALTERING THE JUDICIAL MIND 521 ALTERINGTHE JUDICIAL MIND AND THE PROCESSOF CONSTITUTION-MAKINGIN CANADA* BRUCE P. ELMAN** This essay deals with the alteration of the Supreme Cette itude a pour sujet /es changementsd 'attitude Coun of Canada 's approach when confronted with de la Cour supreme du Canada envers /es prisumies alleged violalionsof dvil libenies in thepre-Charter and violations des droits de la personne durant la piriode post-Chartereras. It is noted that cenain statutes, such pricidant la Charte et cel/e qui la suit. JI est re/eve que as the Lord's Day Act, wereupheld under the Canadian certaines lois, la Loi du dimanchepar exemple, ont iti Bill of Rights, but have since been struck down under maintenuessous le Bill of Rightscanadien puis annulies the Charter of Rights and Freedoms under relatively au nom de la Chane des droits et libertes, dans des cir indistinguishabledrcumstances. 71reau1hor assens that constancesa peu pres identiques. L'auteurpropose que the changes in the approach to civil libenies, and the ces nouvellesfarons de percevoir /es droits de la per consequent changes in the Supreme Coun 's decisions, sonne sont attribuablesaux changementsd 'attitudede are the result of a change in judicial attitudes. Among la magistrature. Panni lesfacteurs qui ontjoui un role the factors responsiblefor acting as a catalystfor this catalyseura ce sujet, I 'auteurreconnait le changement shift in attitude, the author identifies and discusses the de ''principe '' qu 'expliquela constitutionalisationdes change in ''principle -

Royal Canadian Artillery Association Report 1983
‘ National Defense JCo I Defence nationale ROYAL CANADIAN ARTILLERY ASSOCIATION FORMED 1876 REPORT 1983-1984 L’ASSOCIATION DE L’ARTILLERIE ROYALE CANADIENNE FONDEE 1876 RAPPORT 1983-1984 (inac THE 1985 ANNUAL tEETING WILL BE HELD AT CFB SHILO, MAN. 19-21 SEP ?1?€d %z.uzdi€m iddée’iy cia&n Under the Distinguished Patronage of Her Excellency The Right Honourable Jeanne Sauve, CC CMM CD Governor General of Canada Vice - Patrons Her Honour the Lieutenant-Governor of Alberta His Honour the Lieutenant-Governor of British Columbia Her Honour the Lieutenant-Governor of Manitoba His Honour the Lieutenant-Governor of New Brunswick His Honour the Lieutenant-Governor of Newfoundland His Honour the Lieutenant-Governor of Nova Scotia His Honour the Lieutenant-Governor of Ontario His Honour the Lieutenant-Governor of Prince Edward Island His Honour the Lieutenant-Governor of Quebec His Honour the Lieutenant-Governor of Saskatchewan -2- TABLE OF CONTENTS Page Patron and Vice Patrons 1 Photo of President 4 Officers and Executive Committee 1983-84 5 Photo of the Executive Committee 1983-84 7 Past Presidents 8 Life Members 10 Honourary Life Members and Past Secretaries 11-12 Photo of delegates and members attending 1984 meeting 13 President’s Opening Address 14 Business arising from 1983 Minutes 15-17 Life Membership 17 Address by the Colonel Commandant 18-22 Allocution au Colonel Commandant 23-27 Address by Director of Artillery 28-31 Presentation du Directeur de l’artillerje 32-35 Committee Reports Competitions and photos of presentation of awards 36-40