Gazella Leptoceros
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Summary of Protected Areas in Chad
CHAD Community Based Integrated Ecosystem Management Project Under PROADEL GEF Project Brief Africa Regional Office Public Disclosure Authorized AFTS4 Date: September 24, 2002 Team Leader: Noel Rene Chabeuf Sector Manager: Joseph Baah-Dwomoh Country Director: Ali Khadr Project ID: P066998 Lending Instrument: Adaptable Program Loan (APL) Sector(s): Other social services (60%), Sub- national government administration (20%), Central government administration (20%) Theme(s): Decentralization (P), Rural services Public Disclosure Authorized and infrastructure (P), Other human development (P), Participation and civic engagement (S), Poverty strategy, analysis and monitoring (S) Global Supplemental ID: P078138 Team Leader: Noel Rene Chabeuf Sector Manager/Director: Joseph Baah-Dwomoh Lending Instrument: Adaptable Program Loan (APL) Focal Area: M - Multi-focal area Supplement Fully Blended? No Sector(s): General agriculture, fishing and forestry sector (100%) Theme(s): Biodiversity (P) , Water resource Public Disclosure Authorized management (S), Other environment and natural resources management (S) Program Financing Data Estimated APL Indicative Financing Plan Implementation Period Borrower (Bank FY) IDA Others GEF Total Commitment Closing US$ m % US$ m US$ m Date Date APL 1 23.00 50.0 17.00 6.00 46.00 11/12/2003 10/31/2008 Government of Chad Loan/ Credit APL 2 20.00 40.0 30.00 0 50.00 07/15/2007 06/30/2012 Government of Chad Loan/ Credit Public Disclosure Authorized APL 3 20.00 33.3 40.00 0 60.00 03/15/2011 12/31/2015 Government of Chad Loan/ Credit Total 63.00 93.00 156.00 1 [ ] Loan [X] Credit [X] Grant [ ] Guarantee [ ] Other: APL2 and APL3 IDA amounts are indicative. -

Status, Trends and Future Dynamics of Biodiversity and Ecosystems Underpinning Nature’S Contributions to People 1
CHAPTER 3 . STATUS, TRENDS AND FUTURE DYNAMICS OF BIODIVERSITY AND ECOSYSTEMS UNDERPINNING NATURE’S CONTRIBUTIONS TO PEOPLE 1 CHAPTER 2 CHAPTER 3 STATUS, TRENDS AND FUTURE DYNAMICS CHAPTER OF BIODIVERSITY AND 3 ECOSYSTEMS UNDERPINNING NATURE’S CONTRIBUTIONS CHAPTER TO PEOPLE 4 Coordinating Lead Authors Review Editors: Marie-Christine Cormier-Salem (France), Jonas Ngouhouo-Poufoun (Cameroon) Amy E. Dunham (United States of America), Christopher Gordon (Ghana) 3 CHAPTER This chapter should be cited as: Cormier-Salem, M-C., Dunham, A. E., Lead Authors Gordon, C., Belhabib, D., Bennas, N., Dyhia Belhabib (Canada), Nard Bennas Duminil, J., Egoh, B. N., Mohamed- (Morocco), Jérôme Duminil (France), Elahamer, A. E., Moise, B. F. E., Gillson, L., 5 Benis N. Egoh (Cameroon), Aisha Elfaki Haddane, B., Mensah, A., Mourad, A., Mohamed Elahamer (Sudan), Bakwo Fils Randrianasolo, H., Razaindratsima, O. H., Eric Moise (Cameroon), Lindsey Gillson Taleb, M. S., Shemdoe, R., Dowo, G., (United Kingdom), Brahim Haddane Amekugbe, M., Burgess, N., Foden, W., (Morocco), Adelina Mensah (Ghana), Ahmim Niskanen, L., Mentzel, C., Njabo, K. Y., CHAPTER Mourad (Algeria), Harison Randrianasolo Maoela, M. A., Marchant, R., Walters, M., (Madagascar), Onja H. Razaindratsima and Yao, A. C. Chapter 3: Status, trends (Madagascar), Mohammed Sghir Taleb and future dynamics of biodiversity (Morocco), Riziki Shemdoe (Tanzania) and ecosystems underpinning nature’s 6 contributions to people. In IPBES (2018): Fellow: The IPBES regional assessment report on biodiversity and ecosystem services for Gregory Dowo (Zimbabwe) Africa. Archer, E., Dziba, L., Mulongoy, K. J., Maoela, M. A., and Walters, M. (eds.). CHAPTER Contributing Authors: Secretariat of the Intergovernmental Millicent Amekugbe (Ghana), Neil Burgess Science-Policy Platform on Biodiversity (United Kingdom), Wendy Foden (South and Ecosystem Services, Bonn, Germany, Africa), Leo Niskanen (Finland), Christine pp. -
Gazella Leptoceros
Gazella leptoceros Tassili N’Ajjer : Erg Tihodaïne. Algeria. © François Lecouat Pierre Devillers, Roseline C. Beudels-Jamar, , René-Marie Lafontaine and Jean Devillers-Terschuren Institut royal des Sciences naturelles de Belgique 71 Diagram of horns of Rhime (a) and Admi (b). Pease, 1896. The Antelopes of Eastern Algeria. Zoological Society. 72 Gazella leptoceros 1. TAXONOMY AND NOMENCLATURE 1.1. Taxonomy. Gazella leptoceros belongs to the tribe Antilopini, sub-family Antilopinae, family Bovidae, which comprises about twenty species in genera Gazella , Antilope , Procapra , Antidorcas , Litocranius , and Ammodorcas (O’Reagan, 1984; Corbet and Hill, 1986; Groves, 1988). Genus Gazella comprises one extinct species, and from 10 to 15 surviving species, usually divided into three sub-genera, Nanger , Gazella, and Trachelocele (Corbet, 1978; O’Reagan, 1984; Corbet and Hill, 1986; Groves, 1988). Gazella leptoceros is either included in the sub-genus Gazella (Groves, 1969; O’Reagan, 1984), or considered as forming, along with the Asian gazelle Gazella subgutturosa , the sub-genus Trachelocele (Groves, 1988). The Gazella leptoceros. Sidi Toui National Parks. Tunisia. species comprises two sub-species, Gazella leptoceros leptoceros of © Renata Molcanova the Western Desert of Lower Egypt and northeastern Libya, and Gazella leptoceros loderi of the western and middle Sahara. These two forms seem geographically isolated from each other and ecologically distinct, so that they must, from a conservation biology point of view, be treated separately. 1.2. Nomenclature. 1.2.1. Scientific name. Gazella leptoceros (Cuvier, 1842) Gazella leptoceros leptoceros (Cuvier, 1842) Gazella leptoceros loderi (Thomas, 1894) 1.2.2. Synonyms. Antilope leptoceros, Leptoceros abuharab, Leptoceros cuvieri, Gazella loderi, Gazella subgutturosa loderi, Gazella dorcas, var. -

586 PROTECTION of ENDANGERED SPECIES of ANIMALS and PLANTS ORDINANCE Gazette Number Version Date Long Title LN 206 Of
Chapter: 586 PROTECTION OF ENDANGERED SPECIES OF Gazette Number Version Date ANIMALS AND PLANTS ORDINANCE Long title L.N. 206 of 2006 01/12/2006 An Ordinance to give effect in Hong Kong to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora signed in Washington D.C. on 3 March 1973; to regulate the import, introduction from the sea, export, re-export, and possession or control of certain endangered species of animals and plants and parts and derivatives of those species; and to provide for incidental and connected matters. [1 December 2006] L.N. 206 of 2006 (Originally 3 of 2006) Part: 1 PRELIMINARY L.N. 206 of 2006 01/12/2006 Section: 1 Short title L.N. 206 of 2006 01/12/2006 (1) This Ordinance may be cited as the Protection of Endangered Species of Animals and Plants Ordinance. (2) (Omitted as spent) Section: 2 Interpretation L.N. 130 of 2007 01/07/2007 Remarks: For the saving and transitional provisions relating to the amendments made by the Resolution of the Legislative Council (L.N. 130 of 2007), see paragraph (12) of that Resolution. (1) In this Ordinance, unless the context otherwise requires— "advertisement" (廣告), in relation to a specimen of a scheduled species, means any form of advertising that describes, makes reference or alludes in any other way to that scheduled species or specimen— (a) whether directly or indirectly; (b) whether orally, in writing in any language, diagrammatically, pictorially, by the use of symbols or photographs, or in any combination of them; and (c) whether or not the -
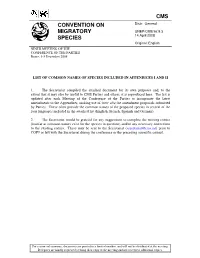
List of Common Names of Species Included in Appendices I and Ii
CMS Distr: General CONVENTION ON MIGRATORY UNEP/CMS/Inf.9.3 14 April 2008 SPECIES Original: English NINTH MEETING OF THE CONFERENCE OF THE PARTIES Rome, 1-5 December 2008 LIST OF COMMON NAMES OF SPECIES INCLUDED IN APPENDICES I AND II 1. The Secretariat compiled the attached document for its own purposes and, to the extent that it may also be useful to CMS Parties and others, it is reproduced here. The list is updated after each Meeting of the Conference of the Parties to incorporate the latest amendments to the Appendices, making use of inter alia the amendment proposals submitted by Parties. These often provide the common names of the proposed species in several of the four languages included in the attached list (English, French, Spanish and German). 2. The Secretariat would be grateful for any suggestions to complete the missing entries (insofar as common names exist for the species in question) and/or any necessary corrections to the existing entries. These may be sent to the Secretariat ( [email protected] ) prior to COP9 or left with the Secretariat during the conference or the preceding scientific council. For reasons of economy, documents are printed in a limited number, and will not be distributed at the meeting. Delegates are kindly requested to bring their copy to the meeting and not to request additional copies. List of Common Names, CMS Appendices I and II (with effect from May 2006) App. Taxon English French Spanish German I/II Accipitridae * eagles and hawks aigles, buses éperviers, milans, águilas, halcones y gavilanes -

Invasive Species
This document contains chapters extracted from the Egyptian State of Environment Reports for 2007 and 2008 that deal specifically with biodiversity. The complete reports are available at: http://www.eeaa.gov.eg/English/info/report_search.asp Biodiversity Introduction: Biodiversity is the sphere of life on earth that encompasses ecosystems, natural habitats, fauna and flora, microbial species, and genetic resource. Biodiversity provides food, fuel, construction materials, waste purification and decomposition, climate regulation, alleviation of disasters, renewal of soil fertility, disease combating, keeping genetic resources (crops, breeds, animal wealth, medicine and other products). For that reason, biodiversity is the basis of life prosperity, the means of human lives and cultures, and by its conservation, we keep humanity, providing its treasures for the existing and future generations. The Arab Republic of Egypt has paid special attention in the last 2 decades for natural resources conservation issues, and has enacted legislation to conserve natural heritage with support of political leadership to assure integration of development sectors with environment protection, and conserving natural resources for the existing and future generations. The promulgation of law no 102 of 1983 on protected areas was in tandem with the declaration of Ras Mohamed, the first national park in Egypt, in south Sinai, followed by establishment of 27 protectorates all over Egypt covering 15% of Egypt's total area. Since 1980 until now, many skills and experiences have been gained to improve protected areas management and biodiversity conservation. The first phase, during eighties, was distinguished by comprehensive protection, while the second phase during nineties, was distinguished by conservation and sustainable development, and currently the main target is comprehensive ecosystem management which depends on applying integrated ecosystem for human being welfare, as well as achieving 2010 target (reducing the rate of biodiversity loss). -

Protection of Endangered Species of Animals and Plants Ordinance
PROTECTION OF ENDANGERED SPECIES OF ANIMALS AND PLANTS ORDINANCE T-2 Cap. 586 PROTECTION OF ENDANGERED SPECIES OF ANIMALS AND PLANTS ORDINANCE (Cap. 586) Contents Section Page PART 1 PRELIMINARY 1. Short title 1-2 2. Interpretation 1-2 3. Meaning of “in transit” 1-16 4. Application to hybrids 1-16 PART 2 REGULATION OF APPENDIX I SPECIES 5. Restriction on import of specimens of 2-2 Appendix I species 6. Restriction on introduction from the sea of 2-4 specimens of Appendix I species 7. Restriction on export of specimens of 2-4 Appendix I species 8. Restriction on re-export of specimens of 2-6 Appendix I species Last updated date 1.8.2018 PROTECTION OF ENDANGERED SPECIES OF ANIMALS AND PLANTS ORDINANCE T-4 Cap. 586 Section Page 9. Restriction on possession or control of 2-6 specimens of Appendix I species 10. (Repealed) 2-8 PART 3 REGULATION OF APPENDIX II SPECIES AND APPENDIX III SPECIES 11. Restriction on import of specimens of 3-2 Appendix II species and Appendix III species 12. Restriction on introduction from the sea of 3-4 specimens of Appendix II species 13. Restriction on export of specimens of 3-4 Appendix II species and Appendix III species 14. Restriction on re-export of specimens of 3-6 Appendix II species and Appendix III species 15. Restriction on possession or control of 3-8 specimens of Appendix II species 16. (Repealed) 3-8 PART 4 CIRCUMSTANCES IN WHICH DEALINGS IN SCHEDULED SPECIES WITHOUT LICENCE ARE PERMITTED 17. Import of pre-Convention specimens 4-2 18. -

American Scientist the Magazine of Sigma Xi, the Scientific Research Society
A reprint from American Scientist the magazine of Sigma Xi, The Scientific Research Society This reprint is provided for personal and noncommercial use. For any other use, please send a request to Permissions, American Scientist, P.O. Box 13975, Research Triangle Park, NC, 27709, U.S.A., or by electronic mail to [email protected]. ©Sigma Xi, The Scientific Research Society and other rightsholders FEATURE ARTICLE Modern Lessons from Ancient Food Webs From the Cambrian Burgess Shale to ancient Egypt, food webs share surprising structural attributes. When redundancy is lost, the threat of extinction grows. Justin D. Yeakel and Jennifer A. Dunne bout 10,000 years ago, one patterns of feeding interactions be- systems is more complete when we could have mistaken the tween and among species (food web unite the detailed but temporally lim- Egyptian landscape for that structure) and changes in species’ ited knowledge of modern ecological of East Africa today. Instead abundance over time (dynamics) of systems with the wealth of informa- Aof vast arid deserts, the region north of the Egyptian mammal community is tion obtained from historical and pale- Aswan held enough annual precipita- providing insight into how this ecosys- ontological contexts. tion to support large herbivores that tem unraveled in the face of both cli- Recent investigations into the struc- are strongly tied to standing bodies of matic and human-induced pressures. ture and dynamics of past and contem- water, including zebra, elephant, and But the observed community collapse porary food webs has shown that there rhinoceros. Lions, wild dogs, giraffes, in Egypt is just a small piece of a much is a certain fixedness in the patterns and wildebeest filled out the savanna- larger story that describes the rise and of species interactions, independent woodland landscape, while the earliest fall of animal communities over the of species identity, habitat, and time. -

Henry Kayondo Hoof Stock Department Emirates Park Zoo Abu Dhabi (United Arab Emirates) ABSTRACT Management of a Mixed Species Ex
Henry Kayondo Hoof stock Department Emirates Park Zoo Abu Dhabi (United Arab Emirates) ABSTRACT Management of a mixed species exhibit WITHOUT rotation, at Emirates Park Zoo (United Arab Emirates “UAE”) In the wild animals stay together in harmony, this coexistence is being introduced by captive wildlife husbandry practices through using mixed specie enclosures or exhibits however, managing a Mixed enclosure exhibit is one of the most common challenges that is faced by organizations carrying out wildlife husbandry all over the world and these may include Zoos, Sanctuaries, Rescue and Rehabilitation Centers. Emirates Park Zoo has got one of the most successful mixed species enclosures called the Giraffe Park with an area of 1712.78 m2 and this area is housing Three female Giraffes, seven Rhim Gazelle, Two Ostriches, 19 Guinea fowls, seven Fallow Deer’s, Two Zebras and three Crowned Cranes. All these animals do exist in harmony and there is breeding success of some individual species. Being a mixed specie enclosure one expects many challenges that have to be addressed if coexistence is to take place and this is done by the provision of minimum requirements needed by individual species in this environment BUT still one has to put in mind that all species have to share most of the ecological requirements, so we archived it as follows; We made sure that this enclosure is large enough to cater for different specie distances like their contact distance, Flight distance and social distance and if any of these distances were compromised, then coexistence would seize to exist. Of more importance still we made sure that these mixed specie animals have relating habitats and relating mode of feeding behaviors in this way we had herbivores that include browsers/arboreal and grazers, all together diurnals. -

Tunisian Mammal Tour
T UNISI A N M A M M A L T O UR - A Ten Day Search For The Rare and Endangered Mammals of The Pre-Saharan Savannah and Northern Sahara Sahara Desert: Djebil National Park in the late afternoon. Steve Morgan 1/12/13 Tunisian Mammal Tour 1 Background and Objectives In February 2013 a group of mammal enthusiasts had been lucky enough to see Sand Cat, together with a strong supporting cast of other highly desirable species, in a ten day tour led by Tarek Nefzi, a leading Tunisian naturalist and wuldlife guide. Since Sand Cat was a species I was extremely keen to see myself, I contacted Tarek some while later to see about organising my own trip to attempt to repeat the first group's earlier success. In consultation with Tarek I set up an itinerary that not only gave me a decent shot at the cat but which also provided good opportunities for other rare species. The trip was set for 19/11/13 to 29/11/13. The principal target was the Sand Cat, a rare and elusive species that relatively few Europeans had seen in the wild. (As far as I was aware few had even tried to see it!). But I had other important targets too, including Fennec Fox, Ruppell's Fox, Addax, Scimitar- horned Oryx, Dorca's Gazelle, Dama Gazelle and Rhim Gazelle. The "wanted list" extended also to Barbary Sheep, though with the most likely site, Chaambi, being currently hors de combat due to security problems, I expected that to be virtually impossible. -

Status, Trends and Future Dynamics of Biodiversity and Ecosystems Underpinning Nature’S Contributions to People 1
CHAPTER 3 . STATUS, TRENDS AND FUTURE DYNAMICS OF BIODIVERSITY AND ECOSYSTEMS UNDERPINNING NATURE’S CONTRIBUTIONS TO PEOPLE 1 CHAPTER 2 CHAPTER 3 STATUS, TRENDS AND CHAPTER FUTURE DYNAMICS OF BIODIVERSITY AND 3 ECOSYSTEMS UNDERPINNING NATURE’S CONTRIBUTIONS CHAPTER TO PEOPLE 4 Coordinating Lead Authors Review Editors: Marie-Christine Cormier-Salem (France), Jonas Ngouhouo-Poufoun (Cameroon) Amy E. Dunham (United States of America), Christopher Gordon (Ghana) This chapter should be cited as: CHAPTER Cormier-Salem, M-C., Dunham, A. E., Lead Authors Gordon, C., Belhabib, D., Bennas, N., Dyhia Belhabib (Canada), Nard Bennas Duminil, J., Egoh, B. N., Mohamed- (Morocco), Jérôme Duminil (France), Elahamer, A. E., Moise, B. F. E., Gillson, L., 5 Benis N. Egoh (Cameroon), Aisha Elfaki Haddane, B., Mensah, A., Mourad, A., Mohamed Elahamer (Sudan), Bakwo Fils Randrianasolo, H., Razafindratsima, O. H., 3Eric Moise (Cameroon), Lindsey Gillson Taleb, M. S., Shemdoe, R., Dowo, G., (United Kingdom), Brahim Haddane Amekugbe, M., Burgess, N., Foden, W., (Morocco), Adelina Mensah (Ghana), Ahmim Niskanen, L., Mentzel, C., Njabo, K. Y., CHAPTER Mourad (Algeria), Harison Randrianasolo Maoela, M. A., Marchant, R., Walters, M., (Madagascar), Onja H. Razafindratsima and Yao, A. C. Chapter 3: Status, trends (Madagascar), Mohammed Sghir Taleb and future dynamics of biodiversity (Morocco), Riziki Shemdoe (Tanzania) and ecosystems underpinning nature’s 6 contributions to people. In IPBES (2018): Fellow: The IPBES regional assessment report on biodiversity and ecosystem services for Gregory Dowo (Zimbabwe) Africa. Archer, E., Dziba, L., Mulongoy, K. J., Maoela, M. A., and Walters, M. (eds.). CHAPTER Contributing Authors: Secretariat of the Intergovernmental Millicent Amekugbe (Ghana), Neil Burgess Science-Policy Platform on Biodiversity (United Kingdom), Wendy Foden (South and Ecosystem Services, Bonn, Germany, Africa), Leo Niskanen (Finland), Christine pp. -

Cop14 Prop. 12
CoP14 Prop. 12 CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D'EXTINCTION ____________________ Quatorzième session de la Conférence des Parties La Haye (Pays-Bas), 3 – 15 juin 2007 EXAMEN DES PROPOSITIONS D'AMENDEMENT DES ANNEXES I ET II A. Proposition Inscription de l’espèce Gazella leptoceros (gazelle du Sahara) à l’Annexe I. B. Auteur de la proposition Algérie C. Justificatif Espèce menacée de disparition et endémique de l’Afrique du Nord (disparue au Maroc). 1. Taxonomie 1.1 Classe: Mammalia 1.2 Ordre: Artiodactyla 1.3 Famille: Bovidae 1.4 Genre, espèce ou sous-espèce, et auteur et année: Gazella leptoceros loderi (Thomas, 1894) 1.5 Synonymes scientifiques: Antilope leptoceros, Leptoceros cuvieri, Gazella loderi, Gazella subgutturosa loderi, Gazella dorcas, var. 4 1.6 Noms communs: français: leptocère, gazelle des sables, gazelle des dunes, gazelle blanche, rhim, gazelle à longues cornes anglais: slender-horned gazelle, Loder’s gazelle, sand gazelle, Algerian sand gazelle, rhim espagnol: gazela de la arena 1.7 Numéros de code: --- 2. Vue d'ensemble La Gazella leptoceros loderi est une antilope typiquement saharienne, liée aux déserts de sable, et caractéristique du Sahara central (Dragesco-Joffe, 1993). Par rapport à la répartition des grandes zones d’ergs sahariens (Walter et Breckle, 1986), elle semble manquer dans les complexes les plus occidentaux. Le centre de gravité de sa distribution se trouve dans le Grand Erg Occidental, le Grand Erg Oriental, de la zone sableuse qui s’étend de la Hamada de Tinrhert en Algérie au Fezzan en Jamahiriya arabe libyenne et les ergs plus petits du pourtour des massifs centro-sahariens du Hoggar et du Tassili des Ajjers.