Mme Dominique BONA M. Patrick GRAINVILLE
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Narrative and Representation in French Colonial Literature of Indochina
Louisiana State University LSU Digital Commons LSU Historical Dissertations and Theses Graduate School 1994 Narrative and Representation in French Colonial Literature of Indochina. Jean Marie turcotte Walls Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_disstheses Recommended Citation Walls, Jean Marie turcotte, "Narrative and Representation in French Colonial Literature of Indochina." (1994). LSU Historical Dissertations and Theses. 5703. https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_disstheses/5703 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at LSU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in LSU Historical Dissertations and Theses by an authorized administrator of LSU Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. INFORMATION TO USERS This manuscript has been reproduced from the microfilm master. UMI films the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in typewriter face, while others may be from any type of computer printer. The quality of this reproduction is dependent upon the qualify of the copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are reproduced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand corner and continuing from left to right in equal sections with small overlaps. -

Roger-Michel ALLEMAND Patrick Grainville, « Entre L'aigle Pêcheur Et
Roger-Michel ALLEMAND , « Patrick Grainville, “entre l’aigle pêcheur et le cobra royal” », @nalyses , hiver 2008 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Roger-Michel ALLEMAND Patrick Grainville, « entre l’aigle pêcheur et le cobra royal » « To die, to sleep; To sleep : perchance to dream »1 R.-M. A. : En quoi le lieu de votre enfance a-t-il été matriciel pour votre œuvre? P. G. : Il est vrai qu’on a des origines et qu’on se définit par rapport à des lieux, à la matière des lieux, à des éléments. C’est quelque chose qui compte chez moi, mais cela dit, pour m’en affranchir. J’ai un lien très conflictuel au pays natal, dont je dépends probablement du point de vue affectif, et dans mes romans, je n’ai eu de cesse de m’en libérer, d’attaquer la Normandie, de la transfigurer, de la transformer, de la métamorphoser. Comme je vous le disais la dernière fois, l’estuaire de la Seine, où je suis né, a joué un rôle essentiel : c’est un lieu qui s’en va, qui s’effondre; les falaises partent à l’eau, se délitent; c’est la grande dégringolade de toutes les prairies, qui basculent à la mer. Tout cela a joué sans aucun doute : ce mélange de luxuriance, de fécondité et de dissolution, de destruction dans un vau-l’eau généralisé, où l’estuaire est à la fois une matrice et une tombe, avec en plus tous les moments épiques de son Histoire et le retour vers les origines qu’il symbolise 2. R.-M. A. -
Nos Conférenciers, Depuis 2002
Nos conférenciers, depuis 2002 Sarah Biasini, Mathieu Laine, Nicolas Zufferey 2021 Théraulaz Pierre Assouline, Marc Atallah, Saphia Azzeddine, Bartabas, Dominique Bourg, Dominique Cardon, Johann Chapoutot, Hervé de Crécy, Charles Dantzig, Fatou Diome, Elisa Shua Dusapin, Raphaël Enthoven, Dominique 2020 Fernandez, Jérôme Garcin, Laurent Gaudé, Olivier Guez, Oscar Lalo, Jean-François Mayer, Claude Nicollier, Amélie Nothomb, Erik Orsenna, Brigitte Rosset, Pablo Servigne, Leïla Slimani, Sam Stourdzé, Serge Tisseron, Yvette Maxime d'Aboville, Isabelle Attané, Isabelle Autissier, Muriel Barbery, Claire Berest, Michel Bonnin, Pascal Bruckner, François Busnel, Philippe Claudel, Corinne Chaponnière, Marcel Cottier, François Curiel, Thierry Davila, Laurence Debray, François-Henri Désérable, Marc Donnadieu, Elisa Shua Dusapin, Alice Ekman, Frédéric Elsig, Max Engammare, Olivier Fatio, Alice Ferney, Ferrante Ferranti, Dominique Fernandez, Michèle Fotoussi, Alain Françon, Laurent Gaudé, 2019 Vincent Goossaert, David Greilsammer, Olivier Guez, Francis Hallé, Clément Hervieu-Léger, Jean-François Huchet, Nancy Huston, John Jackson, Dan Jemmett, Thierry Kellner, Alexandre Lacroix, Martine Lusardy, Louis Martinet, Diane Mazloum, Matthieu Mégevand, Nicolas Meylan, Fabrice Midal, Dominique Missika, Françoise Nyssen, Yves Oltramare, Héloïse d'Ormesson, Erik Orsenna, Lucienne Peiry, Didier Ruef, Lydie Salvayre, Louis de Saussure, Leila Slimani, Sylvain Tesson, Ralph Toledano, Pascal Vandenberghe, Trinh Xuan Thuan, Gabriella Zalapì, Nicolas Zufferey Christophe -

Revue D'études Françaises French Studies Journal
Revue d’Études Françaises French Studies Journal ~ 2.ª série, nº 9, 2016 Instituto de Estudos Franceses da Faculdade de Letras da Universidade do Porto INTERCÂMBIO Revue d’Études Françaises French Studies Journal 2.ª série, nº 9, 2016 FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DO PORTO Título: Intercâmbio 2ª série, vol. 9, 2016 Propriedade: Instituto de Estudos Franceses da Faculdade de Letras da Universidade do Porto Diretor: José Domingues de Almeida Organizadores do presente número Ana Paula Coutinho (Universidade do Porto – ILC Margarida Losa) José Domingues de Almeida (Universidade do Porto – ILC Margarida Losa) Maria de Fátima Outeirinho (Universidade do Porto – ILC Margarida Losa) Comissão Científica da revista Cristina Robalo Cordeiro (Un. Coimbra) Jean-Yves Mollier (Un. de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines) Paul Aron (Un. Libre de Bruxelles) Charles Bonn (Un. Lyon 2) Joëlle Gleize (Un. Marseille-Aix-en-Provence) Francisco Lafarga (Un. Barcelona) Marc Quaghebeur (Archives et Musée de la Littérature – Bruxelles) Periodicidade: Anual ISSN 0873-366X Capa de Luís Mendes Sede e redação: Faculdade de Letras da Universidade do Porto Via Panorâmica, s/n – 4150-564 Porto - Portugal Correio eletrónico: [email protected] URL: http://ler.letras.up.pt/site/default.aspx?qry=id05id1184&sum=si Les auteurs des articles publiés dans ce numéro sont tenus pour seuls responsables du contenu de leurs textes. TABLE DES MATIÈRES Éditorial – Littérature en langue française : la parole aux médiateurs universitaires CRISTINA ÁLVARES……………………………………………………………….…...…8 -

Liste De Nouveautés LN 4-16
n o u v e a u t é s BIBLIOTHÈQUEn CENTRALE DE PRÊT PAR CORRESPONDANCE SERVICE DU L IVRE ET DES B IBLIOTHEQUES 140 , RUE DE BERCY 75012 PARIS Tél. : 01 43 45 54 19 [email protected] 4-16 ADULTES Cher Lecteur, FLASH SUR... PATRICK GRAINVILLE _____ 3 romans __________________________ 4 ON AIME - LA PRESSE EN PARLE ________ 5 L’acheminement des colis demeure un sujet ON AIME - LA PRESSE EN PARLE ________ 9 qui nous tient particulièrement à cœur car c’est un romans de détente_________________ 10 paramètre essentiel de la qualité de nos romans régionaux __________________ 11 prestations. romans d’aventures - historiques ______ 12 Voici donc quelques informations importantes policiers - espionnage - suspense _____ 12 à retenir : SF - fantasy - fantastique - épouvante _ 14 littérature - philosophie _____________ 16 Les 3 Centres de tri SNCF de Nantes, Rennes, langues – linguistique ______________ 16 Tours sont regroupés sur une plate-forme GEODIS société __________________________ 16 située à RENNES depuis fin mai 2016. syndicalisme _____________________ 17 Les autres centres de tri vont être concernés ON AIME - LA PRESSE EN PARLE ________ 18 par des regroupements à l’identique à l’automne, monde du travail – économie ________ 19 dès début octobre. éducation - enseignement ___________ 19 sciences et techniques ______________ 20 Il est désormais INDISPENSABLE que Les corps - santé - médecine ____________ 20 adresses complètes figurent sur les étiquettes psychologie - psychanalyse ___________ 21 réversibles utilisées pour le transport de vos colis. écologie _________________________ 21 animaux – nature _________________ 22 Ces indications sont d’autant plus collections _______________________ 22 importantes que le personnel de GEODIS ne loisirs créatifs - jardinage ___________ 23 possède pas la connaissance des services de la bricolage – vie pratique _____________ 24 SNCF comme c’était le cas des agents des CRT. -

Débats Littérature
Racines de Ciel Du 31 août au 2 septembre 2012 Rencontres littéraires au Lycée Fesch Ajaccio café littéraire poésie libraires éditeurs jeune public rencontres débats littérature Un salon du livre à vocation euro-méditerranéenne Les invités 18 auteurs… Tahar Ben Jelloun (éd. Gallimard, Prix et Juré Goncourt) Colette Fellous (éd. Gallimard, productrice de “Carnet nomade” sur France Culture) Jean-Baptiste Predali (éd. Actes Sud, journaliste à la chaîne parlementaire LCP) Patrick Grainville (éd. Seuil, Prix Goncourt) Nathalie Kuperman (éd. Gallimard) Jean-Noël Schiffano (éd. Gallimard, directeur de la collection “Continents Noirs” aux éd. Gallimard) Marco Biancarelli (éd. Actes Sud) Canesi & Rahmani (éd. Naïve) Jean-Noël Pancrazi (éd. Gallimard, Prix Médicis et Juré Renaudot) Pierre Assouline (éd. Gallimard, Juré Goncourt) … dont 7 animent les débats Mohamed Aïssaoui (éd. Gallimard, Prix Renaudot de l’essai, journaliste au Figaro Littéraire) Kebir Ammi (éd. Gallimard) Azouz Begag (éd. Albin Michel) ancien ministre délégué à la promotion de l’égalité des chances Dominique Memmi (éd. Colonna, éd. Dadoclem) Sébastien Pisani (éd. Teramo) François Xavier Renucci (éd. Albiana) Jean Rouaud (éd. Gallimard, Prix Goncourt 1 psychanalyste Ursula Renard 1 éditrice Danica Urbani, (éd. bilingue Dadoclem) 3 traducteurs François-Michel Durazzo (traducteur du corse et d’autres langues romanes) Jean-Raymond Fanlo (traducteur de Cervantés en français) Paulu-Michele Filippi (traduction corse-français) Des visiteurs de prestige consultés en vue de la création -

Les Mille Lectures D'hiver
les mille lectures d’hiver une bibliographie sélective du 6 décembre 2006 au 31 mars 2007 “mille lectures d’hiver” est porté par la Région Centre CRLL Centre 02 54 72 27 49 www.crlcentre.org BP 80122 - Quartier Rochambeau 41106 VENDÔME cedex Vassilis Alexakis livres. Professeur à l’université de Téhéran, il est arrêté en Romancier et dessinateur grec. 1973 et torturé par les services secrets du shah. On lui interdit d’exercer dans la fonction publique. Il organise des Né le 25 décembre 1943 à Santorin en Grèce. A l’âge de 17 ateliers d’écriture et des cours de littérature dans le sous- ans, il arrive en France et entre à l’École de journalisme de sol de sa maison, puis réussit à s’enfuir de son pays. Quand Lille. Après un retour en Grèce en 1968, Vassilis Alexakis, il y rentre, après le renversement du shah, il devient la cible séjourne ensuite périodiquement dans ces deux pays. des défenseurs de la république islamique et est à nouveau L’écrivain grec est aussi journaliste, dessinateur, cinéaste. incarcéré en 1981 et 1982. Il s’échappe d’Iran à l’automne Il a quinze ouvrages de type varié à son actif : romans, 1996, après avoir été victime d’une tentative de meurtre. nouvelles et aphorismes ainsi qu’ un recueil de dessins. Depuis 1998, Reza Baraheni vit au Canada où il enseigne la En 1995, il obtient le prix Médicis pour l’ouvrage La langue littérature comparée à l’université de Toronto. Il est l’auteur maternelle. de plus de cinquante livres écrits en persan et en anglais et ses oeuvres ont été traduites dans une douzaine de Paris-Athènes, Paris : Stock, 2006 langues. -

Le Printemps Du Livre De Cassis La MEVA Hôtel Martin Sauveur - 4 Rue Séverin Icard -13260 Cassis Tél
Printemps du livre Cassis du 30 mai au 2 juin avec la participation de nombreux écrivains : Tahar Ben Jelloun Serge Joncour Régis Wargnier Alexandre Jardin Vanessa Schneider Pierre Palmade Cali Arnaud Le Guerne Pierre Ducrozet Elizabeth Tchoungui Eric Emmanuel Schmitt Laurent Seksik Jean-Jacques Annaud Olivier Pourriol Serge Moati Luciano Melis Rudy Ricciotti Rencontres Littéraires conçues et animées par Patrick POIVRE D’ARVOR et Marc Fourny VENDREDI 31 MAI À 11H30 Cour d’Honneur de la Mairie de Cassis INAUGURATION par Danielle Milon, Maire de Cassis Officier de la Légion d’Honneur Vice-Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence Vice-Présidente du Conseil Départemental En présence des écrivains invités et de nombreuses personnalités. 11h30 à 12h00 : Jazz avec «Le Trio Tenderly» EXPOSITION D’UNE COLLECTION PRIVÉE DE PEINTURES aux Salles Voûtées de la Mairie des œuvres de Jean Peter TRIPP «Au commencement était le verbe...» du 30 Mai au 10 Juin 2019 inclus Printemps du livre Cassis du 30 mai au 2 juin Le Printemps du Livre de Cassis, créé en 1986 par Danielle Milon, fête ses trente et un ans cette année. Il conjugue littérature, musique, arts plastiques, photographie et cinéma. Cette véritable fête de l’écriture se déclinera cette année encore sur un week-end de quatre jours, pour le week-end de l’Ascension, dans le cadre magique de l’amphithéâtre de la Fondation Camargo. A l’occasion du Printemps du Livre de Cassis, création d’une étiquette spéciale par Nicolas Bontoux Bodin, Château de Fontblanche. Retour en images sur l’édition -

Curriculum Vitae
CURRICULUM VITAE Dr. YVETTE A. GUILLEMIN YOUNG, PhD, Emerita Professor of French Language, Culture & Literatures EMAIL ADDRESS: [email protected] EDUCATION The University of Kansas, Lawrence, USA (1987-91) PhD in French Literature (emphasis: Middle Ages & Breton Literature) Kansas State University, Manhattan, USA (1984-86) M.A. in French, with thesis & Minor in Spanish Longwood College, Virginia, USA (1978) MLA (Modern Languages Association) Certification Universities of Rennes & Bordeaux, France (1964-65) CAPES cursus (Pedagogy) University of Rennes, France (1961-64) Licence ès Lettres (M.A.) in Spanish & Minor in Latin Collège de Jeunes Filles, Lorient, France (1961) Baccalauréat Philosophie & Classiques TEACHING EXPERIENCE Desert Sun Academy (Aug 2016-May 2017) Developing First Grade French Immersion Program (First in Arizona) University of Wisconsin, Oshkosh (Sept 1991-May 2010) Professor (French) The University of Kansas, Lawrence (1987-91) Graduate Lecturer (French) 1 Kansas State University, Manhattan (1984-86) Graduate Lecturer (Spanish & French) Busan National University, South Korea (1980-83) Assistant Professor (French) Laurentius Gymnasium, Neuendettelsau bei Ansbach, Germany (1975-77) High School Teacher (French) Lycée Guez de Balzac, Angoulême, & Lycée de Vannes, France (1964-69) High School Teacher (Spanish & Latin) Collège de Jonzac, France (1964) High School Teacher (Spanish) PUBLICATIONS • All publications are peer-reviewed, with the exception of those preceded by an asterisk. BOOKS “Pierre-Jakez Hélias, Bigouden Universel.” Co-authored. Compiled by Francis Favereau. Published by Presses Universitaires de Rennes (2001) “Immram.” * Collection of bilingual poetry for display at the International Conference on Women Writers, University of Wichita. Atelier des Deux Hermines (1995) “Le sens du merveilleux chez Pierre-Jakez Hélias.” Doctoral dissertation. -
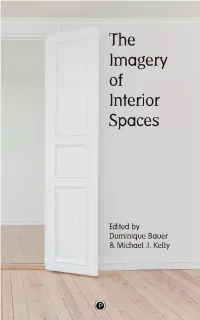
The Imagery of Interior Spaces
the imagery of interior spaces Before you start to read this book, take this moment to think about making a donation to punctum books, an independent non-profit press, @ https://punctumbooks.com/support/ If you’re reading the e-book, you can click on the image below to go directly to our donations site. Any amount, no matter the size, is appreciated and will help us to keep our ship of fools afloat. Contri- butions from dedicated readers will also help us to keep our commons open and to cultivate new work that can’t find a welcoming port elsewhere. Our ad- venture is not possible without your support. Vive la Open Access. Fig. 1. Hieronymus Bosch, Ship of Fools (1490–1500) the imagery of interior spaces. Copyright © 2019 by the editors and au- thors. This work carries a Creative Commons BY-NC-SA 4.0 International li- cense, which means that you are free to copy and redistribute the material in any medium or format, and you may also remix, transform and build upon the material, as long as you clearly attribute the work to the authors (but not in a way that suggests the authors or punctum books endorses you and your work), you do not use this work for commercial gain in any form whatsoever, and that for any remixing and transformation, you distribute your rebuild under the same license. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ First published in 2019 by punctum books, Earth, Milky Way. https://punctumbooks.com ISBN-13: 978-1-950192-19-9 (print) ISBN-13: 978-1-950192-20-5 (ePDF) doi: 10.21983/P3.0248.1.00 lccn: 2019937173 Library of Congress Cataloging Data is available from the Library of Congress Book design: Vincent W.J. -

NEW FICTION French, German, Italian, Polish, Russian, Spanish
NEW FICTION French, German, Italian, Polish, Russian, Spanish OCTOBER 2018 CATALOGUE New Foreign Fiction October 2018 ABOUT GRANT & CUTLER AT FOYLES Established in 1936, Grant & Cutler was the largest independent foreign-language bookseller in the UK. In 2011 the firm merged with Foyles and now operates from our new, flagship store in London’s Charing Cross Road. Foyles was founded in 1903 and is an iconic name in UK bookselling, winning the National Bookseller of the Year award in 2013 and Children’s Bookseller of the Year award in 2012. Our foreign language range includes popular fiction and classics, children’s books, translations, language-learning material, dictionaries and reference and books on culture, politics and history. With access to the Foyles stock of more than 200,000 titles, we can also supply books on any subject and not just foreign languages. A selection of the languages on offer: Albanian, Arabic, Bengali, Bulgarian, Chinese, Czech, Danish, Dutch, Farsi, Finnish, French, German, Gujarati, Hungarian, Italian, Japanese, Kurdish, Latvian, Lithuanian, Norwegian, Panjabi, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Somali, Spanish, Swedish, Tamil, Turkish, Urdu, Vietnamese. ABOUT THIS CATALOGUE This catalogue lists a selection of recently published foreign fiction, as well as translations from English, translations from other languages and recent paperback reprints. All editions are paperback unless otherwise specified. Titles are listed on our website and can be ordered there. PRICES & DISCOUNTS Prices are given in British pounds and are correct at the time of cataloguing. They may change due to increases by publishers and to fluctuations in exchange rates. Public Library customers will receive a discount of 20% on orders for fiction. -

Anniversaire Du Grand Prix Du Roman
100e ANNIVERSAIRE DU GRAND PRIX DU ROMAN DOSSIER DE PRESSE Académie française Contact : 23, quai de Conti Secrétariat de l’Académie française 75006 Paris tél : 01-44-41-43-00 www.academie-francaise.fr [email protected] SOMMAIRE § PETIT HISTORIQUE Ø La création p. 3 Ø Les particularités des premiers prix et leur empreinte p. 3 Ø Délibérations et attribution du prix de 1915 à 1960 p. 4 Ø L’organisation des années 1960 p. 5 Ø Le règlement de 1984 p. 6 Ø Règles et usage des règles de 1985 à nos jours p. 7 Encadré : Le Prix du roman en quelques dates p. 7 § L’ATTRIBUTION ACTUELLE DU GRAND PRIX DU ROMAN p. 8 Encadré : Définition, règlement, modalités de vote p. 9 § LES CENT DEUX LAURÉATS Ø Palmarès p. 10 Ø Destinées académiques p. 13 Ø Autres récompenses littéraires des lauréats p. 14 Ø Quelques particularités (Prix Nobel, âge des lauréats, répartition homme/femme, premiers romans, nationalité des lauréats) p. 16 DATES À RETENIR § Attribution du Grand Prix du roman du centenaire : le jeudi 29 octobre 2015 § Table ronde sur l’histoire du Prix à la Fondation Singer-Polignac : le mardi 20 octobre 2015. PETIT HISTORIQUE Ø La création Le Prix du roman de l’Académie française, dont le projet de création date de mars 1914, a été décerné pour la première fois en juillet 1915. Pareilles dates seraient très surprenantes si elles ne résultaient d’un processus antérieur. Il faut remonter quatre à cinq ans plus tôt. À ce moment-là, l’Académie française vient de bénéficier de deux legs importants (les legs Charruau et Broquette- Gonin) dont les revenus sont en tout ou partie librement disponibles.