C a R T E C O M M U N A
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

La Carte Du Gers Touristique
Les Offices de Tourisme Destination Gers La carte du Gers touristique The Tourist Information Center, your guide for the holidays Armagnac Montesquiou Cazaubon ✪ BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE MIRANDE- vous invite au voyage… ASTARAC OFFICE DE TOURISME ET DU THERMALISME DU GRAND ARMAGNAC +33 (0)7 80 01 90 65 - [email protected] Classé catégorie II www.tourisme-mirande-astarac.com Seissan ✪ BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE VAL DE GERS The Map of Tourism in the Gers +33 (0)5 62 69 52 13 - [email protected] www.grand-armagnac.com Condom +33 (0)5 62 66 12 22 - [email protected] OFFICE DE TOURISME DE LA TÉNARÈZE www.valdegerstourisme.fr is your invitation to travel… Classé catégorie I Arrats et Save +33 (0)5 62 28 00 80 - [email protected] Cologne www.tourisme-condom.com Ligardes OFFICE DE TOURISME BASTIDES DE LOMAGNE LOT-ET-GARONNE Éauze OFFICE DE TOURISME ET DU THERMALISME DU GRAND Gazaupouy +33 (0)5 62 06 99 30 ARMAGNAC [email protected] Sainte-Mère Classé catégorie II Larroque www.tourisme-bastidesdelomagne.fr sur-l’Osse Gimont +33 (0)5 62 09 85 62 - [email protected] OFFICE DE TOURISME COTEAUX ARRATS GIMONE www.grand-armagnac.com Castéra- Classé catégorie III Pont de CastelnaCastelnau-suru-sur Lartigue Lectourois Gondrin l’Auvignonl’Auvignon ✪ Marsolan BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE +33 (0)5 62 67 77 87 - [email protected] Classé catégorie II www.tourisme-3cag-gers.com Castelnau d’Auzan Labarrère Isle-Jourdain (L’) +33 (0)5 62 29 15 89 - [email protected] -

C99 Official Journal
Official Journal C 99 of the European Union Volume 63 English edition Information and Notices 26 March 2020 Contents II Information INFORMATION FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2020/C 99/01 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9701 — Infravia/Iliad/Iliad 73) (1) . 1 2020/C 99/02 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9646 — Macquarie/Aberdeen/Pentacom/JV) (1) . 2 2020/C 99/03 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9680 — La Voix du Nord/SIM/Mediacontact/Roof Media) (1) . 3 2020/C 99/04 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9749 — Glencore Energy UK/Ørsted LNG Business) (1) . 4 IV Notices NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2020/C 99/05 Euro exchange rates — 25 March 2020 . 5 2020/C 99/06 Summary of European Commission Decisions on authorisations for the placing on the market for the use and/or for use of substances listed in Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) (Published pursuant to Article 64(9) of Regulation (EC) No 1907/2006) (1) . 6 EN (1) Text with EEA relevance. V Announcements PROCEDURES RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF COMPETITION POLICY European Commission 2020/C 99/07 Prior notification of a concentration (Case M.9769 — VW Group/Munich RE Group/JV) Candidate case for simplified procedure (1) . 7 OTHER ACTS European Commission 2020/C 99/08 Publication of a communication of approval of a standard amendment to a product specification for a name in the wine sector referred to in Article 17(2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 . -

(EU) 2021/335 of 23 February 2021 Amending the Annex To
25.2.2021 EN Offi cial Jour nal of the European Uni on L 66/5 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2021/335 of 23 February 2021 amending the Annex to Implementing Decision (EU) 2020/1809 concerning certain protective measures in relation to outbreaks of highly pathogenic avian influenza in certain Member States (notified under document C(2021) 1386) (Text with EEA relevance) THE EUROPEAN COMMISSION, Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, Having regard to Council Directive 89/662/EEC of 11 December 1989 concerning veterinary checks in intra-Community trade with a view to the completion of the internal market (1), and in particular Article 9(4) thereof, Having regard to Council Directive 90/425/EEC of 26 June 1990 concerning veterinary checks applicable in intra-Union trade in certain live animals and products with a view to the completion of the internal market (2), and in particular Article 10(4) thereof, Having regard to Council Directive 2005/94/EC of 20 December 2005 on Community measures for the control of avian influenza and repealing Directive 92/40/EEC (3), and in particular Article 63(4) thereof, Whereas: (1) Commission Implementing Decision (EU) 2020/1809 (4) was adopted following outbreaks of highly pathogenic avian influenza (HPAI) in holdings where poultry or other captive birds were kept in certain Member States and the establishment of protection and surveillance zones by those Member States in accordance with Council Directive 2005/94/EC. (2) Implementing Decision (EU) 2020/1809 provides that the protection and surveillance zones established by the Member States listed in the Annex to that Implementing Decision, in accordance with Directive 2005/94/EC, are to comprise at least the areas listed as protection and surveillance zones in that Annex. -

10-Juillet-2017.Pdf
LE MOT DU MAIRE.................................... Chères Lannepaxiennes, chers Lannepaxiens, Le Conseil Municipal a voté le budget de l’année en cours. La commission communale des finances s’est réunie à plusieurs reprises afin d'établir les nouvelles priorités, cette année encore notre marge de manœuvre fut très serrée. Malgré un autofinancement de 96 293€, nous avons augmenté légèrement les impôts afin de pouvoir concrétiser nos projets. Dans l'édition de juillet 2016, je vous informais qu'une simple rénovation de la salle des fêtes avait été retenue, puisqu'une nouvelle construction était trop coûteuse. Ce projet de rénovation a été étudié en concertation avec les élus ainsi qu'avec Monsieur FRAIRET, conseiller départemental, dans l'objectif d'étendre son utilisation de façon supra-communal. A ce jour, je suis en mesure de vous informer que notre demande de subvention (la plus importante) nous a été refusée pour l'année 2017 par manque crédits et projet non prioritaire. Nous sommes donc invités à renouveller notre demande l'année prochaine. Les principaux travaux prévus au budget de cette année étant cette rénovation, 2017 sera une année sans dépense importante en investissement sur le budget de la commune. Suite à l'achat du terrain au lieu-dit St Roch, et après la validation de la carte communale, nous allons pouvoir continuer les études sur le projet du lotissement communal. J'ai l'honneur de vous informer que l'enquête publique commune concernant la carte communale et le zonage assainissement se déroulera du 11 août au 11 septembre, l'avis d'enquête sera publié dans les journaux ultérieurement. -

SIAEP Armagnac-Ténarèze (Siren : 253200240)
Groupement Mise à jour le 01/07/2021 SIAEP Armagnac-Ténarèze (Siren : 253200240) FICHE SIGNALETIQUE BANATIC Données générales Nature juridique Syndicat mixte fermé Syndicat à la carte oui Commune siège Eauze Arrondissement Condom Département Gers Interdépartemental non Date de création Date de création 02/02/1967 Date d'effet 15/09/2008 Organe délibérant Mode de répartition des sièges Autre cas Nom du président M. Nicolas MELIET Coordonnées du siège Complément d'adresse du siège Mairie Numéro et libellé dans la voie Distribution spéciale Code postal - Ville 32800 EAUZE Téléphone Fax Courriel Site internet Profil financier Mode de financement Aucune contribution budgétaire Bonification de la DGF non Dotation de solidarité communautaire (DSC) non Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) non Autre taxe non Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) non Autre redevance non Population 1/3 Groupement Mise à jour le 01/07/2021 Population totale regroupée 12 077 Densité moyenne 25,98 Périmètres Nombre total de membres : 16 - Dont 14 communes membres : Dept Commune (N° SIREN) Population 32 Beaumont (213200371) 140 32 Bretagne-d'Armagnac (213200645) 422 32 Castelnau d'Auzan Labarrère (200057586) 1 257 32 Cazeneuve (213201007) 159 32 Eauze (213201197) 4 013 32 Fourcès (213201338) 263 32 Gondrin (213201494) 1 230 32 Lagraulet-du-Gers (213201809) 578 32 Larressingle (213201940) 218 32 Larroque-sur-l'Osse (213201973) 235 32 Lauraët (213202039) 254 32 Montréal (213202906) 1 200 32 Mouchan (213202922) 409 32 Réans (213203409) 293 - Dont -
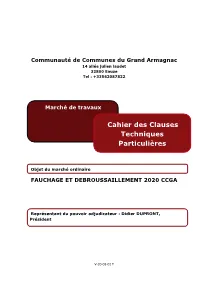
Cahier Des Clauses Techniques Particulières
Communauté de Communes du Grand Armagnac 14 allée julien laudet 32800 Eauze Tel : +33562087822 Marché de travaux Cahier des Clauses Techniques Particulières Objet du marché ordinaire FAUCHAGE ET DEBROUSSAILLEMENT 2020 CCGA Représentant du pouvoir adjudicateur : Didier DUPRONT, Président V-20-01-01 T SOMMAIRE ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE ARTICLE 2 : ALLOTISSEMENT ARTICLE 3 : NATURE DE LA PRESTATION ARTICLE 3.1 : LOT N°1 ARTICLE 3.2 : LOT N°2 ARTICLE 3.3 : LOT N°3 ARTICLE 3.4 : LOT N°4 ARTICLE 3.5 : LOT N°5 ARTICLE 4 : EXIGENCES TECHNIQUES ARTICLE 5 : EXIGENCES FONCTIONNELLES ARTICLE 6 : PRESCRIPTIONS GENERALES V-20-01-01 T ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE Le présent marché a pour objet le fauchage et le débroussaillement des voies communales reconnues d’intérêt communautaire sur le territoire de la CCGA : BASCOUS, DEMU, NOULENS, RAMOUZENS, SEAILLES, COURRENSAN, GONDRIN, LANNEPAX, BRETAGNE D’ARMAGNAC, CASTELNAU D’AUZAN LABARRERE, EAUZE, AYZIEU, CAMPAGNE D’ARMAGNAC, CAZAUBON, LAREE, LIAS D’ARMAGNAC, MARGUESTAU, REANS, CASTEX D’ARMAGNAC, LANNEMAIGNAN, MAULEON D’ARMAGNAC, MONCLAR D’ARMAGNAC, PANJAS. Il se décompose en plusieurs phases : - 1ère intervention dite « passe de sécurité » : Le démarrage s’effectuera obligatoirement le 27 avril 2020, fauchage des accotements avec dégagements de visibilité au droit des carrefours et dans les courbes ; - 2ème intervention dite « passe de confort »: Le démarrage s’effectuera le 24 juin 2020, fauchage des accotements seuls. - Débroussaillement : Les conditions d’exécution seront précisées dans chaque -

Arrete Liste Electorale Annexe.Pdf
ANNEXE à l’arrêté du 17 août 2020 ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE DE GESTION COLLEGE DES MAIRES / DES PRESIDENTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX LISTE ELECTORALE POUR L'ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE DE GESTION DU GERS COLLEGE DES MAIRES Commune Nom du (de la )Maire Prénom Nombre de voix Commune de AIGNAN PERES Gérard 8 Commune de ANTRAS SOUARD Olivier 1 Commune de ARBLADE-LE-BAS LEBLOND Stéphane 2 Commune de ARBLADE-LE-HAUT VERRIER Jean-Marie 2 Commune de ARMENTIEUX LARRIBAT Patrick 2 Commune de ARROUEDE SEREUSE Christophe 1 Commune de AUBIET FOSSE Jean-Luc 9 Commune de AUCH LAPREBENDE Christian 289 Commune de AUGNAX PETIT Claude 1 Commune de AURADE LARROQUE Francis 6 Commune de AURENSAN DUPOUTS Roland 1 Commune de AURIMONT FAURE Jacques 1 Commune de AUTERRIVE PENSIVY Bernard 3 Commune de AUX-AUSSAT ESTEREZ Michel 1 Commune de AVENSAC TARRIBLE Michel 1 Commune de AVEZAN DURREY Joël 1 Commune de AYGUETINTE BALLERINI Francis 1 Commune de AYZIEU DUFFAU Jean Claude 2 Commune de BAJONNETTE LAFFONT Alexandre 1 Commune de BARCELONNE-DU-GERS BERDOULET Cédric 6 Commune de BARRAN JOULLIE Nicole 7 Commune de BARS BALECH Régis 1 Commune de BASCOUS GALISSON Nicolas 1 Commune de BASSOUES GATELET Claude 4 Commune de BAZIAN COELHO Véronique 2 Commune de BAZUGUES JAMMET Jean-Noël 2 Commune de BEAUMARCHES CASTET Gérard 7 Commune de BEAUMONT DHAINAUT Annie 1 Commune de BECCAS CANO Pierre 1 Commune de BELLEGARDE-ADOULINS GERAULT Jean-Philippe 1 Commune de BELLOC-SAINT-CLAMENS LADOIS Claudine 1 Commune de BELMONT DOAT Jean-Pierre -

Arrêté Du 10 Août 2016
ANNEXE 1 à l’arrêté inter préfectoral n° du délivrant l’autorisation unique pluriannuelle à l’Organisme Unique de Gestion Collective Neste et rivières de Gascogne sur le périmètre Neste et rivières de Gascogne au titre du code de l’environnement Prélèvements en eau superficielle en période d’étiage Départ Type de Commune Débit demandé Volume Débit réservé UG Demandeur Raison Sociale Adresse C.P. Commune Siret ID PPT Milieu Prélevé X en lambert 93 Y en Lambert 93 usage Alternatif Num Compteur ement ressource Prélèvement (l/s) demandé (m3) (l/s) cours d'eau rte de 32 96 ABADIE Christian 32300 MIRANDE ### 1622 GRANDE BAISE MIRANDE 490 499 6 272 832 IRR 1/1 11,00 44 000 09AEI502530 316,6 réalimenté Montesquiou cours d'eau QUARTIER 65 96 ABADIE Francis 65190 BEGOLE ### 2912 GRANDE BAISE MONTASTRUC 484 037 6 238 952 IRR 1/3 10,00 40 000 05WLI43924 320 réalimenté LAPOUTGE cours d'eau QUARTIER 65 96 ABADIE Francis 65190 BEGOLE ### 23096 GRANDE BAISE BONNEFONT 484 426 6 241 288 IRR 2/3 10,00 40 000 47,4 réalimenté LAPOUTGE cours d'eau QUARTIER 65 96 ABADIE Francis 65190 BEGOLE ### 6692 GRANDE BAISE MONTASTRUC 484 119 6 238 526 IRR 3/3 10,00 40 000 60,6 réalimenté LAPOUTGE cours d'eau non 47 97 ABADIE Francis Montfaucon 47170 MEZIN ### 2795 gélise MEZIN 478 815 6 331 950 IRR 1/1 8,33 11 000 47,4 réalimenté cours d'eau 32 96 ABADIE Guy Aux Aussats 32170 MIELAN 388461881 1921 BOUES AUX AUSSAT 480 577 6 262 936 IRR 1/2 13,00 52 000 12ACI102451 68,7 réalimenté cours d'eau 32 96 ABADIE Guy Aux Aussats 32170 MIELAN 388461881 23567 BOUES MIELAN 480 386 -

COMMUNE DE CAMPAGNE D'armagnac Rapport De
Département du GERS COMMUNE DE CAMPAGNE D’ARMAGNAC Rapport de Présentation Pièce n°1 Élaboration février 2013 ÉLABORATION Soumis à Enquête Publique : du 27-11-12 au 27-12-12 Carte Communale approuvée : - par Délibération du Conseil Municipal le - Par la Préfecture le CARTECOMMUNALE LACOSTE Michel GEOMETRE EXPERT FONCIER 4 Place de la Garlande 32720 BARCELONNE DU GERS C a L "#$# Table des matières Table des matières ...................................................................................................... 2 PREAMBULE................................................................................................................ 4 Avis ............................................................................................................................ 5 INTRODUCTION........................................................................................................... 8 1 PRESENTATION DE LA COMMUNE .......................................................................... 9 1.1 Situation géographique ............................................................................................ 9 1.2 Cadre administratif ..................................................................................................10 1.2.1 Commune ................................................................................................................................. 10 1.2.2 Intercommunalité ..................................................................................................................... 11 -

Plan De Prevention Des Risques Retrait Gonflement Des Sols Argileux (Ppr Rga)
PRÉFET DU GERS DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DU GERS PLAN DE PREVENTION DES RISQUES RETRAIT GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX (PPR RGA) NOTE DE PRESENTATION Communes de AYGUETINTE, BASCOUS, BEAUCAIRE, BERAUT, BERRAC, BLAZIERT, BONAS, BRETAGNE-D'ARMAGNAC, CASTELNAU-D'ARBIEU, CASTELNAU- D'AUZAN, CASTELNAU-SUR-L'AUVIGNON, CASTERA-VERDUZAN, CAUSSENS, CAZENEUVE, CEZAN, CONDOM, COURRENSAN, DEMU, DURAN, EAUZE, FOURCES, GAUDONVILLE, GAZAUPOUY, GONDRIN, JEGUN, LABARRERE, LAGARDE, LAGARDERE, LAGRAULET-DU-GERS, LANNEPAX, LARRESSINGLE, LARROQUE-SAINT-SERNIN, LAURAET, LAVARDENS, LECTOURE, LIGARDES, MAIGNAUT-TAUZIA, MARSOLAN, MAUROUX, MAUVEZIN, MERENS, MONTREAL, NOULENS, PESSAN, PRECHAC, RAMOUZENS, REJAUMONT, LA ROMIEU, ROQUELAURE, ROQUES, ROZES, SAINT-CLAR, SAINT-ORENS-POUY-PETIT, SAINT-PAUL-DE-BAISE, SAINT- PUY, SANSAN, SARRANT, LA SAUVETAT, SEAILLES, TERRAUBE, VALENCE- SUR-BAISE et VIC-FEZENSAC . Prévoir consiste à projeter dans l'avenir Un jour tout sera bien, voilà notre espérance ; ce qu'on a perçu dans le passé. Tout est bien aujourd’hui, voilà l’illusion. Henri Bergson Voltaire Poème sur le désastre de Lisbonne Ne pas prévoir, c’est déjà gémir. Léonard de Vinci A - NOTE DE PRÉSENTATION.............................................................................................. 4 1 . INTRODUCTION............................................................................................................. 4 2 . PRÉSENTATION DE LA ZONE ÉTUDIÉE................................................................... 5 2.1. Limites géographique -

Matricule Demandeur De Plan De Chasse Commune De Rattachement
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU GERS Tableau récapitulatif des décisions d'attribution de plans de chasse individuels Campagne 2020-2021 Dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 425-6 à L. 425-13 et R. 425-1-1 à R. 425-17 du code de l'environnement, le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs du Gers a pris les décisions individuelles d'attribution de plan de chasse. NUMERO_ARRETE Matricule Demandeur de plan de chasse Commune de rattachement ESPECE ATTRIBUTION 32-2020- 01002101 01002101 STOCCO MARCEL ANSAN CHE 9 32-2020- 01002402 01002402 ONF ANSAN CHE 2 32-2020- 01014101 01014101 FRANCOIS HENRI AUGNAX CHE 4 32-2020- 01023101 01023101 COLLIN FRANCIS AVEZAN CHE 7 32-2020- 01026101 01026101 CHAUME SEBASTIEN BAJONNETTE CHE 6 32-2020- 01047101 01047101 CASTAING JACQUES BERRAC CHE 14 32-2020- 01055101 01055101 NAZARIES ERIC BIVES CHE 9 32-2020- 01056101 01056101 MANFREDI LAURENT BLANQUEFORT CHE 3 32-2020- 01057101 01057101 PANCHERI GUY BLAZIERT CHE 9 32-2020- 01066101 01066101 CAPDEVILLE CHRISTIAN BRUGNENS CHE 12 32-2020- 01069101 01069101 LANNES DIDIER CADEILHAN CHE 6 32-2020- 01078101 01078101 SOLANA CLAUDE CASTELNAU D ARBIEU CHE 15 32-2020- 01078302 01078302 LEBOUCHER JACQUES CASTELNAU D ARBIEU CHE 5 32-2020- 01080101 01080101 DULONG RENE CASTELNAU SUR L AUVIGNON CERF 1 32-2020- 01080101 01080101 DULONG RENE CASTELNAU SUR L AUVIGNON CHE 16 32-2020- 01082101 01082101 SANUDO ROGER CASTERA LECTOUROIS CHE 30 32-2020- 01082402 01082402 ONF CASTERA LECTOUROIS CHE 2 32-2020- 01084302 01084302 -

Communes Code Postal Sictom
COMMUNES CODE POSTAL SICTOM AIGNAN 32290 OUEST AIRE SUR ADOUR 40800 OUEST ANSAN 32270 EST ANTRAS 32360 CENTRE ARBLADE LE BAS 32720 OUEST ARBLADE LE HAUT 32110 OUEST ARDIZAS 32430 EST ARMENTIEUX 32230 SMCD ARMOUS ET CAU 32230 SMCD ARROUEDE 32140 SUD-EST AUBIET 32270 EST AUGNAX 32120 EST AUJAN MOURNEDE 32300 SMCD AURADÉ 32600 EST AURENSAN 32400 OUEST AURIMONT 32450 SUD-EST AUSSOS 32140 SUD-EST AUTERIVE 32550 CENTRE AUX AUSSAT 32170 SMCD AVENSAC 32120 EST AVERON BERGELLE 32290 OUEST AVEZAN 32380 SIDEL AYGUETINTE 32410 CONDOM AYZIEU 32110 OUEST BAHUS SOUBIRAN 40320 OUEST BAJONNETTE 32120 EST BARCELONNE DU GERS 32720 OUEST BARCUGNAN 32170 SMCD BARRAN 32350 CENTRE BARS 32300 SMCD BASCOUS 32190 CONDOM BASSOUES 32320 SMCD BAZIAN 32320 CONDOM BAZUGUES 32170 SMCD BEAUCAIRE 32410 CONDOM BEAUMARCHES 32160 OUEST BEAUMONT 32100 CONDOM BEAUPUY 32600 EST BECCAS 32730 SMCD BEDECHAN 32450 SUD-EST COMMUNES CODE POSTAL SICTOM BELLEGARDE ADOULINS 32140 SUD-EST BELLOC SAINT CLAMENS 32300 SMCD BELMONT 32190 CONDOM BERAUT 32100 CONDOM BERDOUES 32300 SMCD BERNEDE 32400 OUEST BERRAC 32480 SIDEL BETCAVE AGUIN 32420 SUD-EST BETOUS 32110 OUEST BETPLAN 32730 SMCD BEZERIL 32130 SUD-EST BEZOLLES 32310 CONDOM BEZUES BAJON 32140 SUD-EST BIRAN 32350 CENTRE BIVES 32380 SIDEL BLANQUEFORT 32270 EST BLAZIERT 32100 CONDOM BLOUSSON SERIAN 32230 SMCD BONAS 32410 CONDOM BOUCAGNERES 32550 CENTRE BOULAUR 32450 SUD-EST BOUROUILLAN 32370 OUEST BOUZON GELLENAVE 32290 OUEST BRETAGNE D'ARMAGNAC 32800 CONDOM BRUGNENS 32500 SIDEL BUANES 40320 OUEST CABAS LOUMASSES 32140 SUD-EST CADEILHAN