Dossier N¡8-Vignerons
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Gruissan, Vignes Et Étangs
00-CouveN54 12/05/07 16:45 Page 1 N°54 - Mai 2007 MENSUEL D’INFORMATIONS MUNICIPALES Gruissan, vignes et étangs : Centenaire de la Révolte des Vignerons du Midi Lo Bolegadís Grussanòt 00-CouveN54 12/05/07 16:45 Page 2 La nouvelle passerelle du Port Le chantier a débuté Comme annoncé lors des Rencontres citoyennes de mars dernier, le Conseil municipal a décidé de lancer les travaux pour le remplacement de la passerelle du port de plaisance. La passerelle, posée en 1977, a subi des dom- mages le 14 juillet 2005. Son confortement avait alors été réalisé. Un moment très suivi par la population, Aujourd’hui, la Commune a décidé de la remplacer la dépose de l’ancienne passerelle par un ouvrage plus esthétique, s’intégrant parfai- céder en pied de passerelle. sage est délimité sur les quais pour permettre aux tement dans le site. Un ouvrage qui sera en cohé- Voici l'échéancier prévisionnel des travaux à venir piétons d’y circuler. rence avec les nombreuses améliorations réalisées sur ce chantier : Un ponton est mis en service au niveau du pont sur les quais du port depuis plusieurs années. Elle • Semaine 14 : dépose de la passerelle existante et routier pour maintenir la circulation entre Rive sera plus facilement franchissable pour les piétons création des appuis de la nouvelle passerelle. Gauche et Rive Droite. Toutefois, la circulation des et les personnes handicapées avec une hauteur • Semaine 23 ou 24 : pose de la nouvelle passerelle. piétons peut être interrompue lors des opérations réduite. Elle permettra bien entendu la circulation • Semaine 25 ou 26 : pose des dalles de béton de grutage et de travaux importants par souci de portuaire. -
1907 Dans L'aude
Px-présentation 24/05/07 10:55 Page 1 Vignerons en révolte 1907 dans l’Aude Exposition réalisée par les Archives départementales de l'Aude 2007 / Réalisation et impression t2p numéric - 04 68 77 22 22 / Scénographie : Marc Raymond architecte D.P.L.G. - Toulouse D.P.L.G. architecte Raymond : Marc - 04 68 77 22 / Scénographie t2p numéric et impression 2007 / Réalisation Px11-100x221 21/05/07 15:07 Page 1 Au pied des remparts de Carcassonne e dimanche en dimanche, le nombre des manifestants augmente de manière démesurée. Pour les municipalités qui les accueillent, Dles enjeux sont d’importance : montrer leur solidarité avec le mouvement (certains maires, tel Jules Sauzède proche d’Albert Sarraut, sont embarrassés et préfèrent laisser le devant de la scène à leur premier adjoint), frapper l’opinion et impressionner la presse régionale et nationale par la majesté des décors et l’importance donnée au défilé des délégations, assurer le bon déroulement de la journée par une organisation irréprochable. La manifestation de Carcassonne est à cet égard exemplaire. 26 mai 1907 : manifestation à Carcas- sonne (220 000 à 250 000 personnes) Le 26 mai, le meeting doit se tenir à Carcassonne. Le préfet a prévu d’impor- tantes forces de l’ordre mais il veut que leur présence soit discrète : « Il est pré- férable de cacher, autant que possible, la vue des uniformes aux manifestants. Ils en prennent ombrage comme d’une mesure de défiance et d’hostilité et en deviennent plus irritables ». La municipalité de Carcassonne tient à témoigner sa solidarité aux manifestants. C’est Gaston Faucilhon, premier adjoint de la commune de Carcassonne, qui préside à l’organisation du meeting : Jules Sauzède, député et également maire de la ville, est absent, retenu à l’Assemblée nationale. -

Désinformation, Rumeurs Et Nouvelles Faussées Autour De La Révolte Des Vignerons Languedociens En 1907 Stéphane Le Bras
Désinformation, rumeurs et nouvelles faussées autour de la révolte des vignerons languedociens en 1907 Stéphane Le Bras To cite this version: Stéphane Le Bras. Désinformation, rumeurs et nouvelles faussées autour de la révolte des vignerons languedociens en 1907. Ph. Bourdin et S. Le Bras. Les fausses nouvelles. Un millénaire de bruits et de rumeurs dans l’espace public français, PUBP, p. 121-p.142, 2018. halshs-01956734 HAL Id: halshs-01956734 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01956734 Submitted on 16 Dec 2018 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. S. Le Bras, « Désinformation, rumeurs et nouvelles faussées autour de la révolte des vignerons languedociens en 1907 », in Ph. Bourdin et S. Le Bras (dir.), Les fausses nouvelles. Un millénaire de bruits et de rumeurs dans l’espace public français, Clermont-Ferrand, PUBP, 2018, p. 121-142. Ceci est une version intermédiaire du texte final. Elle contient probablement des coquilles Désinformation, rumeurs et nouvelles faussées autour de la révolte des vignerons languedociens en 1907. La fabrication d’un mythe Stéphane Le Bras Université Clermont-Auvergne, CHEC En 1976, le Languedoc viticole est secoué par un nouveau mouvement de mécontentement. -
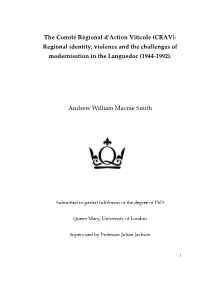
The Comité Régional D'action Viticole (CRAV): Regional Identity, Violence and the Challenges of Modernisation in the Languedoc (1944-1992)
The Comité Régional d'Action Viticole (CRAV): Regional identity, violence and the challenges of modernisation in the Languedoc (1944-1992). Andrew William Macrae Smith Submitted in partial fulfilment of the degree of PhD Queen Mary, University of London Supervised by Professor Julian Jackson 1 Abstract This thesis analyses the Comité Régional d’Action Viticole (CRAV), an active force in the French wine industry since the mid-1960s that has consistently mobilised militant winegrowers in response to economic crisis. Their role has expanded to represent not only the Midi’s viticultural heritage, but also a peculiar brand of regional nationalism. They invoked the memory of the "Grande révolte" of 1907, which saw hundreds of thousands mobilise against foreign wine imports, financial speculation and ineffective regulation. The legacy of 1907 will be considered in the context of its regionalist significance and the development of political Occitanisme, binding Oc and Vine at the beginning of the century. The prominent role of winegrowing since 1907 had seen a compact between winegrowers, local elites and the Socialist Party develop. Yet, this began to slowly disintegrate as government programmes targeted the amelioration of Languedoc wine from the early 1970s. Whilst this project embittered winegrowers, events like the shootout at Montredon in 1976 and the torching of a Leclerc store in 1984 saw the CRAV breach the frontiers of acceptability and alienate traditional supporters. Demographic change, economic development and the stain of violent protest all chipped away at the CRAV's rebellious appeal. This regional compact will be analysed both to gauge the impact of development upon regional identity and to understand changing conceptions of modernity in the agricultural South. -

Introduction from Tradition to Terrorism
Introduction From tradition to terrorism Wine producers, we appeal to you to revolt. We are at the point of no return. Show yourselves to be the worthy successors of the rebels of 1907, when people died so that future generations might earn their living from the land. Let us make sure that our children can know winegrowing.1 When five masked men stood issuing threats of blood and chaos to the French establishment in March 2007, they called on the French public to support them in their violent crusade. This call to arms was issued in the vernacular of a cause a century old, invoking heritage, pride and a very classical interpretation of piety. Yet, these were men in balaclavas, recording in a secret location after having coerced a local journalist to cover the taping. Their threats were more reminiscent of an Al-Qaeda broadcast than something born of the French Republic. Unsurprisingly, they received wide coverage as newspapers discovered the Comité Régional d’Action Viticole (CRAV) for the first time in years, ending an unjustified obscurity outside of the Languedoc: in the New York Times an op-ed piece noted that ‘a new acronym [had] entered the lexicon of terror’;2 the BBC spoke of ‘guerrilla’ winemakers who were invoking the spirit of ‘the French Resistance’3 and in Paris, Le Figaro warned that after this warning these hooded men could not back down, reminding readers that the group had killed before.4 Indeed they had, although this observation only touched upon the history of a group whose evolution is an interesting allegory of the Midi’s post-war experience. -

Le Spectacle
1 Sommaire Introduction et historique .................................................................. 3 Les protagonistes .............................................................................. 4 Le spectacle ..................................................................................... 5 La presse ......................................................................................... 6 L’équipe artistique ............................................................................ 7 Artscénicum Théâtre ......................................................................... 8 FICHE TECHNIQUE ............................................................................ 9 CONTACTS ....................................................................................... 9 2 Introduction et historique En ce début de 20 ème siècle, on a dans le Midi, le sentiment que beaucoup de choses ne vont plus comme avant. La culture de la vigne jadis si prospère goûte peu à peu et inexorablement l’amertume de la pauvreté. Après avoir combattu toutes sortes de calamités - la grande épidémie de Phylloxéra entre 1875 et 1890 a ravagé les trois quarts des plantations - de s’être maintes fois relevés, on se trouve devant la persistante mévente du vin, impuissants et démunis. Pourtant un homme, Marcelin Albert simple paysan de l’Aude, ne s’avoue pas vaincu. Ce touche à tout qui est aussi cafetier et directeur d’une troupe de théâtre, s’émeut de la misère qui grandit. Alors qu’on le traite de fou, il va pendant près de 7 ans, avec l’obstination -

SECTORISATION DES COMMUNES DE L'aude Mise À Jour Du 23/03/2020
SECTORISATION DES COMMUNES DE L'AUDE Mise à jour du 23/03/2020 Code NUM COMMUNES commune COLLEGES LYCEES POSTAL INSEE AGEL (34) 34210 34004 Département de l'Hérault LEZIGNAN - LPO Ernest FERROUL AIGNE (34) 34210 34006 Département de l'Hérault LEZIGNAN - LPO Ernest FERROUL AIGUES-VIVES 11800 11001 CAPENDU - de l'Alaric LEZIGNAN - LPO Ernest FERROUL AIGUES-VIVES (34) 34210 34007 Département de l'Hérault LEZIGNAN - LPO Ernest FERROUL AIROUX 11320 11002 CASTELNAUDARY - Les Fontanilles CASTELNAUDARY - LPO Germaine TILLION AJAC 11300 11003 LIMOUX - Joseph Delteil LIMOUX - LPO Jacques RUFFIÉ ALAIGNE 11240 11004 LIMOUX - Joseph Delteil LIMOUX - LPO Jacques RUFFIÉ ALAIRAC 11290 11005 CARCASSONNE - Varsovie CARCASSONNE - Lycée Paul SABATIER ALBAS 11360 11006 SIGEAN -des Corbières Maritimes NARBONNE - Lycée Docteur LACROIX ALBIERES 11330 11007 COUIZA - Jean-Baptiste Bieules LIMOUX - LPO Jacques RUFFIÉ ALET-LES-BAINS 11580 11008 COUIZA - Jean-Baptiste Bieules LIMOUX - LPO Jacques RUFFIÉ ALZONNE 11170 11009 BRAM - Saint Exupéry CASTELNAUDARY - LPO Germaine TILLION ANTUGNAC 11190 11010 COUIZA - Jean-Baptiste Bieules LIMOUX - LPO Jacques RUFFIÉ ARAGON 11600 11011 CARCASSONNE - Le Bastion CARCASSONNE - Lycée Paul SABATIER ARGELIERS 11120 11012 SAINT-NAZAIRE - Marcelin Albert LEZIGNAN - LPO Ernest FERROUL ARGENS-MINERVOIS 11200 11013 LEZIGNAN - Joseph Anglade LEZIGNAN - LPO Ernest FERROUL ARMISSAN 11110 11014 COURSAN - Les Mailheuls NARBONNE - LPO Louise MICHEL ARQUES 11190 11015 COUIZA - Jean-Baptiste Bieules LIMOUX - LPO Jacques RUFFIÉ ARQUETTES-EN-VAL -

Language, Politics and Identity in the Grande Révolte of 1907
“From the soil we have come, to the soil we shall go and from the soil we want to live”: Language, politics and identity in the Grande Révolte of 1907. Andrew W.M. Smith (UCL), James W. Hawkey (Bristol) Published in Modern and Contemporary France, 23:3 (2015), pp.307-326. DOI:10.1080/09639489.2015.1043983 This is an archived post-print copy of the article (ie final draft post-refereeing) Abstract During the summer of 1907, France experienced one of its largest social disturbances since the Revolution, as the winegrowers of the Languedoc-Roussillon led a mass protest movement that paralysed the region and challenged the state. Although the Grande Révolte evoked references to the Albigensian Crusade, and juxtaposed North and South, it never fully represented a moment of Occitan regionalist rising. The failure of the cultural organisation the Félibrige to fully engage with protesters led to a fissure between political and cultural expressions of Occitan identity that marked the movement thereafter. By combining linguistic anthropology and historical analysis, we are able to foreground a key aspect of national identity formation as it occurred in 1907. Considering the impact of the Grande Révolte on the identity and language of the Midi offers us an insight into the development of regionalism both within and beyond the borders of the French nation. * * * The winegrowers' Grande Révolte comprised a series of large-scale protests in response to a pronounced and enduring economic downturn in the Languedoc-Roussillon. As wine prices remained depressed, protesters filled the streets of the region’s cities, culminating in the gathering of an estimated 600,000 people in Montpellier on 9th June, 1907.