En Géologie De L'ingénieur
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
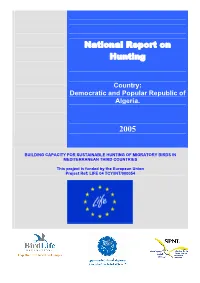
National Report on Hunting 2005
National Report on Hunting Country: Democratic and Popular Republic of Algeria. 2005 BUILDING CAPACITY FOR SUSTAINABLE HUNTING OF MIGRATORY BIRDS IN MEDITERRANEAN THIRD COUNTRIES This project is funded by the European Union Project Ref: LIFE 04 TCY/INT/000054 National Report on Hunting Country: Democratic and Popular Republic of Algeria Prepared by: Dr Mohammed BELHAMRA 2005 SOMMAIRE A/ La chasse et les activités de chasse 1. Noms et coordonnées gèo-rèfèrentielles des principales zones de chasse 2. Liste des espèces d’oiseaux migrateurs chassées 3. Nombre d’oiseaux chassés par espèce et par localité 4. Détails relatifs aux méthodes de chasse utilisées 5. Estimation de la charge en plomb introduite dans l’environnement à travers l’exercice de la chasse. 6. Types de chasseurs et nombres de chasseurs part type 7. Nombre de chasseurs enregistrés en 2004/2005 et estimation du nombre de braconniers 8. Noms et adresses des associations de chasseurs nationales et locales et détails relatifs à leurs membres 9. Appréciation des activités de chasse touristique 10. Détails relatifs aux bagues d’oiseaux retrouvées sur des oiseaux tués dans le cadre de la chasse 11. Appréciations des donnés manquantes et du besoin de recherche en matière de chasse des oiseaux migrateurs. B/ La législation en matière de chasse des oiseaux migrateurs et application de la réglementation en vigueur 1. organisation de la gestion de la chasse (responsabilités des institution gouvernementales, des association de chasseurs et autres organisations de chasseurs et autre organisation, formes de collaboration par exemple en matière de formation et livraison de chasse, etc.). 2. principale législation pertinente en matière de chasse des oiseaux migrateurs et les limitations fixées en ce qui concerne les périodes de chasse, le nombre d’oiseaux par espèce et par période de chasse autorisée, les espèces gibier, les espèces protégées, 2 restriction en ce qui concerne les horaires, les zones, la fréquence et les méthodes de chasse, etc. -

Thèse BASSIN TIMGAD 2021.Pdf
République algérienne démocratique et populaire Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Université de MOSTEPHA BEN BOULAID BATNA 2 Institut des Sciences de la Terre et de l'Univers Département de Géologie THÈSE En vue de l'obtention du diplôme de DOCTORAT DE TROISIÈME CYCLE OPTION Gestion des ressources en eau Thème ETUDE HYDROGEOLOGIQUE DU BASSIN NEOGENE DE TIMGAD (WILAYA DE BATNA -- NORD-EST ALGERIEN) Présentée par: LEBCHEK SOUMIA Soutenue publiquement le : 28 /01 / 2021 Devant le jury composé de : BRINIS Nafaa MCA Président Université de BATNA 2 MENANI Med Redha Prof Rapporteur Université de BATNA 2 DRIAS Tarek Prof Examinateur Université de BATNA 2 KHEDIDJA Abdelhamid MCA Examinateur Université de BATNA 2 CHABOUR Nabil Prof Examinateur Université de Constantine 1 HADJI Rihab MCA Examinateur Université de Sétif 1 Dédicace Je dédie ce modeste travail et ma profonde gratitude A ma chère maman ; A la mémoire de mon cher père ; A la mémoire de mon très cher frère Yousef ; A la mémoire de ma chère sœur Saliha ; A mon oncle Abdelhakim ; A mes sœurs et mes frères; A mes belles-sœurs et mes beaux-frères; A mes chères nièces et mes chers neveux: Raoua Assil, Med Anes, Abederrahim safi, Ali Zakarya, Meriem Dalia, Adam, Meriem, Hibat errahmane et Djaoued Ibrahim ; A toute ma famille ; A mes chers amis. II Remerciement Je voudrai, en premier lieu, témoigner mes vifs et sincères remerciements à dieu tout Puissant de m’avoir permis de mener à terme ce travail. En préambule à cette thèse, je souhaite adresser ici tous mes remerciements aux personnes qui m’ont apporté leur aide et qui ont ainsi contribué à l'élaboration de ce travail. -

Aba Nombre Circonscriptions Électoralcs Et Composition En Communes De Siéges & Pourvoir
25ame ANNEE. — N° 44 Mercredi 29 octobre 1986 Ay\j SI AS gal ABAN bic SeMo, ObVel , - TUNIGIE ABONNEMENT ANNUEL ‘ALGERIE MAROC ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: MAURITANIE SECRETARIAT GENERAL Abonnements et publicité : Edition originale .. .. .. .. .. 100 D.A. 150 DA. Edition originale IMPRIMERIE OFFICIELLE et satraduction........ .. 200 D.A. 300 DA. 7 9 et 13 Av. A. Benbarek — ALGER (frais d'expédition | tg}, ; 65-18-15 a 17 — C.C.P. 3200-50 ALGER en sus) Edition originale, le numéro : 2,50 dinars ; Edition originale et sa traduction, le numéro : 5 dinars. — Numéros des années antérleures : suivant baréme. Les tables sont fourntes gratul »ment aux abonnés. Priére dé joindre les derniéres bandes . pour renouveliement et réclamation. Changement d'adresse : ajouter 3 dinars. Tarif des insertions : 20 dinars la ligne JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANGAISE) SOMMAIRE DECRETS des ceuvres sociales au ministére de fa protection sociale, p. 1230. Décret n° 86-265 du 28 octobre 1986 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de Décret du 30 septembre 1986 mettant fin aux siéges & pourvoir pour l’élection a l’Assemblée fonctions du directeur des constructions au populaire nationale, p. 1217. , ministére de la formation professionnelle et du travail, p. 1230. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 30 septembre 1986 mettant fin aux fonctions du directeur général da la planification Décret du 30 septembre 1986 mettant fin aux et de. la gestion industrielle au ministére de fonctions du directeur de la sécurité sociale et lindustrie lourde,.p. -

Bouhmama W. KHENCHELA
République Algérienne démocratique et populaire Ministère de l’enseignement supérieur et de La Recherche scientifique. Université El Hadj Lakhdar -Batna- Faculté des sciences Département des sciences de la Terre et de l’univers. Mémoire de fin d’étude en vue de l’obtention de diplôme De Magister en Aménagement de Territoire. Option : La Dynamique des Milieux Physiques et Risques Naturels. Par : HOUBIB Hanane Analyse Multicritères des composantes du Milieu à l’aide des techniques de la géomatique pour un aménagement intégré de la vallée de Oued Mellagou- Bouhmama W. KHENCHELA- Devant la commission d’examen composée de : Pr : DRIDI Hadda Professeur Université de Batna Présidente Dr : HADJAB Makhloufi Maître de conférences A Université de M’sila Examinateur Dr : BEN MESSOUD Hassen Docteur Université de Batna Examinateur Pr : KALLA Mehdi Professeur Université de Batna Rapporteur Année universitaire : 2012-2013. Merci à dieu qui nous a données le pouvoir, la patience, et la volonté pour terminer ce modeste travaille. *ا * Qu'il me soit permit de remercier ici ; profondément et sincèrement tous ceux qui , de prés comme de loin à l'université de Batna et tous les services concernés à Khenckela et Bouhmama , qui m'ont aidé a la réalisation de ma thèse et en particulier: Monsieur le professeur KALLA Mehdi qui a été mon promoteur ; qui a bien voulu suivre et diriger patiemment ce travail. Ses conseils , ses justes critiques témoignant de l'intérêt qu'il me portait ont été un encouragement permanant. Nous tenons à exprimer notre profonde reconnaissance aux Monsieur Bouden et tout les gens de l’ANRH de Batna et Constantine pour les données climatiques qu’ils nous ont fournies et Monsieur Aksel au subdivision de Forêts a Bouhmama. -

Forets, Geosystemes Et Dynamique Du Milieu : Le Cas De L'aures
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE UNIVERSITE DES FRERES MENTOURI-CONSTANTINE- FACULTE DES SCIENES DE LA TERRE, DE LA GEOGRAPHIE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DEPARTEMENT DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE N° d’ordre : Série : THESE Présentée pour l’obtention du diplôme de Doctorat d’Etat en Aménagement du Territoire- Option Géographie Physique- FORETS, GEOSYSTEMES ET DYNAMIQUE DU MILIEU : LE CAS DE L’AURES Par Mohammed Kamel-Eddine MEHARZI Devant le jury : Président : Salah Eddine CHERRAD Professeur Uni. CONSTANTINE Rapporteur : Mohammed El Hadi LAROUK Professeur Uni. CONSTANTINE Examinateurs : Allaoua ANSAR Professeur Uni. CONSTANTINE Salah BOUCHEMEL Professeur Uni. Oum El Bouaghi Mohammed SAHLI Maître de conférences E.N.S. CONSTANTINE 2010 1 TABLE DES MATIERES AVANT-PROPOS 7 INTRODUCTION GENERALE 9 PREMIERE PARTIE 14 HOMOGENIETE ET INDIVIDUALITE CHAPITRE I. LES GRANDS TRAITS DU MASSIF DE L’AURES 17 1. Une topographie simple 17 1.1-Des chaînons et des barres très élevées: les anticlinaux 18 - Djebel Metlili 18 - Djebel Haouidja 19 - Djebel el Azreg 20 - Djebel Ahmar Kheddou 21 - Djebel Ichmoul/Chélia 22 - Djebel Bezaz 23 1.2 - Les synclinaux 24 - Synclinal d'El Kantara 24 - Synclinal d’oued Fédhala 25 - Synclinal de Bouzina 25 - Synclinal de Rhassyra 26 - Synclinal d’Aoures 27 - Synclinal de Tirhezo Ferradj/Djehfa 27 1.3 - Les chaînons Ouest/Est 27 - Partie sud: Gueheb et Guerguitt 28 - Partie Nord: Delaa et Islef Bou Larouah 29 Conclusion 29 2. Le réseau hydrographique: 30 2.1. Des bassins-versants méridionaux très nets: 30 - Oued el Arab: un réseau dendritique 30 - Oued el Abiod: un oued dompté 33 - Oued Abdi: Un tracé encaissé 34 - Oued Fédhala: un bassin très lâche. -

Décret Exécutif N° 12-428 Du 16 Décembre 2012 Portant Déclaration
9 Safar 1434 7 23 décembre 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 DECRETS Décret exécutif n° 12-428 du 2 Safar 1434 Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 16 décembre 2012 portant correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; déclaration d’utilité publique les opérations de réalisation des projets entrant dans le cadre de la Vu le décret présidentiel n°12-325 du 16 Chaoual 1433 production, du transport et de la distribution de correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du l’électricité et du gaz. Premier ministre ; ———— Vu le décret présidentiel n°12-326 du 17 Chaoual 1433 Le Premier ministre, correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Sur le rapport conjoint du ministre des finances et le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret exécutif n°93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3°et 125 n°91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles (alinéa 2) ; relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n°90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et Après approbation du Président de la République ; complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n°91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant Décrète : les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Article 1er. – En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n°91-11du 27 avril 1991, et conformément Vu la loi n°98-04 du 20 Safar 1419 correspondant -

Communes of Algeria
S.No. Commune HASC Population 1 Abadla DZ.BC.AB 10,845 2 Abalissa DZ.TM.AB 6,484 3 Abi Youcef DZ.TO.AU 7,743 4 Abou El Hassen DZ.CH.AH 20,164 5 Achaacha DZ.MG.AC 31,360 6 Adekar DZ.BJ.AD 13,495 7 Adrar DZ.AR.AD 43,903 8 Afir DZ.BM.AF 12,613 9 Aflou DZ.LG.AF 53,260 10 Aghbal DZ.TP.AG 6,606 11 Aghbalou DZ.BU.AG 19,530 12 Aghlal DZ.AT.AG 6,841 13 Aghni-Goughrane DZ.TO.AG 10,833 14 Aghrib DZ.TO.AR 13,408 15 Ahl El Ksar DZ.BU.AK 12,315 16 Ahmed Rachedi DZ.ML.AR 14,489 17 Ahmer El Ain DZ.TP.AA 25,633 18 Ahnif DZ.BU.AF 10,268 19 Ain Abessa DZ.SF.AB 15,058 20 Ain Abid DZ.CO.AA 25,958 21 Ain Adden DZ.SB.AA 2,319 22 Ain Arnat DZ.SF.AA 30,129 23 Ain Azel DZ.SF.AZ 41,073 24 Ain Bebouche DZ.OB.AC 14,597 25 Ain Beida DZ.OB.AB 92,197 26 Ain Beida DZ.OG.AB 14,500 27 Ain Beida Harriche DZ.ML.AB 18,513 28 Ain Ben Beida DZ.GL.AB 8,269 29 Ain Benian DZ.AD.AN 4,677 30 Ain Benian DZ.AL.AB 52,343 31 Ain Ben Khelil DZ.NA.AB 3,776 32 Ain-Bessem DZ.BU.AB 36,830 33 Ain Biya DZ.OR.AB 26,253 34 Ain Bouchekif DZ.TR.AB 12,386 35 Ain Boucif DZ.MD.AB 24,434 36 Ain Boudinar DZ.MG.AB 5,241 37 Ain Bouihi DZ.AD.AB 13,920 38 Ain Bouziane DZ.SK.AB 8,381 39 Ain Charchar DZ.SK.AC 13,717 40 Ain Chouhada DZ.DJ.AC 8,337 41 Ain Defla DZ.AD.AD 52,276 42 Ain Deheb DZ.TR.AD 25,366 43 Aïn Djasser DZ.BT.AD 13,232 44 Aïn El Arbaa DZ.AT.AA 12,443 45 Ain El Assel DZ.ET.AA 12,482 www.downloadexcelfiles.com 46 Ain El Berd DZ.SB.AB 13,779 47 Ain El Berda DZ.AN.AB 17,446 48 Ain El Diss DZ.OB.AD 2,741 49 Ain El Fakroun DZ.OB.AF 47,237 50 Ain El Hadid DZ.TR.AH 13,358 51 Ain El Hadjar DZ.BU.AH -

Northeastern Algeria)
Journal of Materials and JMES, 2017 Volume 8, Issue 5, Page 1546-1553 Environmental Sciences ISSN : 2028-2508 Copyright © 2017, University of Mohammed Premier http://www.jmaterenvironsci.com/ Oujda Morocco http://www.jmaterenvironsci.com/ Physico-Chemical And Therapeutic Characteristics Of The Thermo-Mineral Waters of Khenchela Region (Northeastern Algeria) * Ch. Berkani , B. Houha Faculty of Natural and Life Sciences, Department of Ecology and Environment, Laboratory Water, Environment and Renewable Energy, University of Abbes Laghrour, Khenchela, Algeria. Abstract Received 08 Dec 2016, Revised 24 Jan 2017, This study is carried out on three thermal stations in Khenchela region, Accepted 28 Jan 2017 Hammam Essalihine: two thermo-mineral springs, Hammam El Knif and Keywords Hammam Djaarir. The first two resorts have all the facilities in terms of equipement but the resort Hammam Djaarire has only one room. The aim of Thermo-mineral water; this study is to determine the physical, chemical and therapeutic characteristics Therapeutic virtues; of the thermo-mineral waters in the region of Khenchela. Thermalism in Thermalism; Khenchela region is an ancestral medicine using natural mineral waters for Physico-chemistry; several medical utilities. The thermo-mineral waters of Khenchela region are Spas of Algeria; sodium chloride nature, and they are rich of sulphates and magnesium. They fit with a total of nine therapeutic indications from the twelve known globally. 1. Introduction Thermalism in Algeria is not a phenomenon of the contemporary era. The use of thermal waters for therapeutic purposes dates back to the dawn of time. Already the Romans had known how to "domesticate" the waters that sprang from the subsoil, certainly archaic, for lacking any scientific basis. -

Variability Analysis of Temporal and Spatial Annual Rainfall in the Massif of Aures (East of Algeria)
Geographia Technica, Vol. 14, Issue 1, 2019, pp 36 to 48 VARIABILITY ANALYSIS OF TEMPORAL AND SPATIAL ANNUAL RAINFALL IN THE MASSIF OF AURES (EAST OF ALGERIA) Adel KHENTOUCHE1, Hadda DRIDI1 DOI: 10.21163/GT_2019. 141.03 ABSTRACT: The spatial and temporal variations of precipitation in the Aures Massif of Algeria from 1974 to 2009 were investigated using a geostatistical approach. This diachronic approach did not allow a real cyclical differentiation but reveals two phases obvious distinct wet and dry, very marked. Annual rainfall variability is associated with disruption stationary in the series. The use of the rainfall index (PCI) clearly explains the state of variability and the temporal behavior of the annual rains. The climate of the region was in the semi-arid upper floor, and had considerable rainfall. However, this situation has been reversed since 1991. It is predicted that rainfall will decrease from 50 to 105 mm/year on altitudes and the foothills, from 13 to 50 on Saharan areas. Statistical tests reveal breaks around 1991-1994.we notice a severe drought which began in 1991. The results indicated that the spatial pattern of precipitation was primarily the local climate effect significant type, and inside the massif, altitude and latitude are the two factors that control this variability that installs and starts to take the form of climate change Key-words: Variability, Drought, Breaking, Rain phase, Standardized index of rain. 1. INTRODUCTION Precipitation is one of the most important climate factors affecting human economies and terrestrial ecosystems (Xoplaki et al., 2004; Santos et al., 2007; Pauling et al., 2006). -

Option : Hydrogeologie Et Protection Des Eaux Souterraine « Etude Geophysique Et Hydrogeologique Dans La Region De Khenchela
اــــــر اـــاــــــــــ اــــــاــــــ اــــــــــــــ REPUBLIQUE AGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L4ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE UNIVERSITE MENTOURI- CONSTANTINE Faculté des sciences de la terre, de la géographie et de L’aménagement du territoire DEPARTEMENT DES SCIENCES DE LA TERRE N° d’ordre : Série : MEMOIRE PRESENTE EN VUE DE L’OBTENTION DU DIPLOME DE MAGISTER EN HYDROGEOLOGIE OPTION : HYDROGEOLOGIE ET PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINE Thème : « ETUDE GEOPHYSIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE DANS LA REGION DE KHENCHELA, CAS DE KHEIRANE ET TAOUZIENT, Impact socio-économique». Présenté par : Sous la direction de : BOUAICHA FOUED Mr. SHOUT HOUCINE professeur Jury: Mr. MARMI RAMADAN Professeur président de jury Mr. SHOUT HOUCINE Professeur encadreur Mr. BOUDOUKHA ABDERAHMAN Professeur examinateur Mr. BENABBAS CHAOUKI Maître de conférence examinateur Année 2009 D é d i c a c e Dieu seul et ma conscience savait combien mon émotion est indicible pour exprimer ma profonde reconnaissance à mes parents et ma famille, pour le soutien et l’aide précieuse qu’ils m’ont apportés durant mes années d’étude. La quintessence de ce mémoire leur y est offerte. Je dédie ce travail aussi à : Toute ma promotion en post-graduation. Tous mes proches et tous mes amis fidèles, et qui m’aidé pour la réalisation de ce travail surtout HOUARI MORAD. 1 AVANT PROPOS Monsieur SHOUT. H, à qui j’exprime ma profonde gratitude pour la confiance qu’il m’a témoignée en acceptant de suivre pas à pas ce travail. Les conseils qu’ils m’ont prodigués, les critiques constructives et ses remarques subtiles qui m’ont permis d’acquérir les bases indispensables pour la conduite d’une telle étude, ont été pour moi un encouragement permanent et ont permis la concrétisation de ce mémoire. -

Examen Des Situations Sécuritaire, Sanitaire, Élections Locales Et Rentrée Sociale
LE CHIFFRE DU JOUR ENPI: " Le Fugitif " 16 146 Quarante-deux (42) personnes ont trouvé la mort et 1337 autres ont été LE MAGHREB blessées dans 1150 accidents de la circulation survenus à travers le Réouverture des souscriptions au Abdelmoumen territoire national durant la période du 25 au 31 juillet, indique, mardi, un communiqué de la Protection civile. Le Quotidien de l’Économie Ould Kaddour programme LPL dans 40 wilayas (P4) SELON LE JOURNAL DE L'AFRIQUE: extradé à Alger Les laboratoires vendent les vaccins plus chers à l'Afrique qu'à l'Europe (P3) initié notamment par le vaccin Sinopharm, les pays afri- PAR : AMMAR ZITOUNI l'Organisation Mondiale de la cains ont dû mettre la main à la Santé (OMS), devait permettre des poche, parfois de façon excessive : campagnes de vaccination à des pour le Sénégal, qui désirait 200 Les pays africains prix abordables. Et alors que 520 000 doses du vaccin chinois, le LE MAGHREB millions de doses devaient être prix unitaire a été de 20 dollars. paieraient plus livrées avant la fin de l'année Qu'en est-il des prix européens ? chers leurs vaccins 2021, le dispositif a montré ses Le vaccin Pfizer coûtait, avant limites, et à peine 15 % de l'objec- l'augmentation annoncée hier, une Le Quotidien de l’Économie que les pays tif a été rempli. quinzaine d'euros aux pays euro- européens, alors péens, tandis que le Moderna s'éle- L'AFRIQUE OBLIGÉE DE SE vait à une vingtaine d'euros. que les populations TOURNER VERS PÉKIN ET Résultat : plusieurs pays ont arrêté africaines peinent MOSCOU de négocier avec les laboratoires RÉUNION PÉRIODIQUE DU HAUT CONSEIL DE SÉCURITÉ " Les laboratoires sont plus préoc- pharmaceutiques, mécontents des à se faire vacciner. -

Study of the Climate Changes Impact on the Spatio- Temporal Variability of Precipitation in the Eastern Part of the Saharan Atla
Analele Universităţii din Oradea, Seria Geografie Year XXVII, no. 1/2017 (June), pp. 70-83 ISSN 1221-1273, E-ISSN 2065-3409 Article no. 271108-725 STUDY OF THE CLIMATE CHANGES IMPACT ON THE SPATIO- TEMPORAL VARIABILITY OF PRECIPITATION IN THE EASTERN PART OF THE SAHARAN ATLAS; CASE OF THE BELEZMA, THE AURES AND NEMEMCHA, AND THEIR BORDERS. GEOMATICS AND GEOSTATISTICAL APPROACH Tahar Chaouch IMEN Doctorant, Laboratoire LRNAT, University of Batna, 05 Avenue Chahid Boukhlouf 05000, Algeria e-mail: [email protected] Kalla MAHDI Pr. Laboratoire LRNAT, University of Batna, 05 Avenue Chahid Boukhlouf 05000, Algeria e-mail: [email protected] Abstract: The survey and the characterization of the climatic variability at the reduced scales prove to be fundamental for understanding the impacts of the climatic changes on the projects of development and the local vulnerability. One of the main contributions of this study is to analyze the spatio-temporal variability of rainfall series in the oriental termination of the Saharan Atlas that integrates three major mountain ranges and their borders to know: The Belezma, the Aures and the Nememchas during 44 years (from 1969 to 2013) with correction methods, rainfall indices, geostatistical analysis and interpolation (inverse Distance weighting). The results show that climate especially show a significant interannual variations in the region of survey between the north slopes area and the South, an alternation of wet and dry periods and a reduction in the values of the rainfall during the last years. Temporal analysis at sites shows that precipitation is stationary in the mountainous regions as stations of Chelia, Yabous, Ain mimoune, Boudella and Ouledchelih, which record maximum values; in contrast the zones of plain stations present minimal values during the study period.