Forets, Geosystemes Et Dynamique Du Milieu : Le Cas De L'aures
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Marchés De Gros De Fruits Et Légumes Tableau N° 02
Tableau N° 01 : Marchés de gros de fruits et légumes Nbre de Carreaux ou Etals Statut Nbre de Commune Mode de gestion Superficie commerçants d’implantation Juridique Occupés vides Oued Chaaba communal Adjudication 31449 35 49 120* Seriana « taga » communal / 37270 / 42 Non Exploité - des commerçants activent au niveau de ce marché sans disposé de carreaux. Tableau N° 02 : Marchés de détail couverts et de proximité a- Marchés couverts : Commune Superficie Statut Mode de Date de Etat du Nombre de Carreaux Nombre de wilaya d’implantation (m2) gestion création marché* commerçants Juridique Occupés Vides Obs Batna 700 Communal location / opérationnel 64 07 64 / « centre ville » Batna « cité kechida marché 2500 Communal / / opérationnel 67 46 67 / couvert » Batna Arris 312 Communal adjudication / opérationnel 12 11 12 / Barika« Rue 1200 Communal / / opérationnel 02 34 02 / Bouradi Smail » Chemora 392.95 Communal adjudication / opérationnel 10 10 10 Total 137 wilaya 05 / / / / / 171 137 / b- Marchés de proximité : Nombre de carreaux Nombre de Obs Etat du Commune Superficie Statut Mode de Date de commerçants wilaya marché* d'implantation (m2) juridique gestion création occupés vides 42 locaux Batna « cite Non / 2106 Communal / / / + 162 / kechida » opérationnel carreaux Batna « Parc a / 1500 Communal Adjudication / opérationnel 144 41 144 forage » Batna « cité la / 5000 Communal / 02/07/1996 opérationnel 22 124 22 gare » / Menaa 1000 Communal Adjudication 30/08/2003 opérationnel 17 53 17 / Tazoult 3575 Communal Adjudication 21/02/1999 opérationnel -

Journal Officiel N°2020-59
N° 59 Dimanche 16 Safar 1442 59ème ANNEE Correspondant au 4 octobre 2020 JJOOUURRNNAALL OOFFFFIICCIIEELL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie ETRANGER DIRECTION ET REDACTION Tunisie SECRETARIAT GENERAL ABONNEMENT Maroc (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Mauritanie Abonnement et publicité: 1 An 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Edition originale................................... 1090,00 D.A 2675,00 D.A Tél : 021.54.35..06 à 09 Fax : 021.54.35.12 Edition originale et sa traduction.... 2180,00 D.A 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 Clé 68 ALGER (Frais d'expédition en sus) BADR : Rib 00 300 060000201930048 ETRANGER : (Compte devises) BADR : 003 00 060000014720242 Edition originale, le numéro : 14,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 28,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne 16 Safar 1442 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 4 octobre 2020 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 20-274 du 11 Safar 1442 correspondant au 29 septembre 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-459 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 fixant les règles applicables aux -

Rapport Sur Les Priorités Et La Planification Année 2021
République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère des Ressources en Eau Rapport sur les priorités et la planification Année 2021 Volume 2 Octobre/ 2020 Table des matières Contenu Section 1. Message du ministre .......................................................................................4 1.1 Message du ministre ...................................................................................................4 1.2 Déclaration du Secrétaire Général ..............................................................................5 Section 2. Au sujet du portefeuille...................................................................................6 2.1 La mission ...................................................................................................................6 - Production de l’eau domestique, industrielle et agricole, y compris la production et l’utilisation de l’eau de mer dessalée, de l’eau saumâtre et des eaux usées Épurées ;6 2.2 Le ministère ................................................................................................................7 2.3 Fiche Portefeuille ........................................................................................................9 Gestionnaire responsable : Ministre des Ressources en Eau ...............................................9 2.4 Planification des activités pour l’année 2021 ...........................................................11 Section 3. Planification détaillée du programme 01 ......................................................12 -
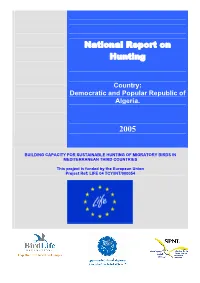
National Report on Hunting 2005
National Report on Hunting Country: Democratic and Popular Republic of Algeria. 2005 BUILDING CAPACITY FOR SUSTAINABLE HUNTING OF MIGRATORY BIRDS IN MEDITERRANEAN THIRD COUNTRIES This project is funded by the European Union Project Ref: LIFE 04 TCY/INT/000054 National Report on Hunting Country: Democratic and Popular Republic of Algeria Prepared by: Dr Mohammed BELHAMRA 2005 SOMMAIRE A/ La chasse et les activités de chasse 1. Noms et coordonnées gèo-rèfèrentielles des principales zones de chasse 2. Liste des espèces d’oiseaux migrateurs chassées 3. Nombre d’oiseaux chassés par espèce et par localité 4. Détails relatifs aux méthodes de chasse utilisées 5. Estimation de la charge en plomb introduite dans l’environnement à travers l’exercice de la chasse. 6. Types de chasseurs et nombres de chasseurs part type 7. Nombre de chasseurs enregistrés en 2004/2005 et estimation du nombre de braconniers 8. Noms et adresses des associations de chasseurs nationales et locales et détails relatifs à leurs membres 9. Appréciation des activités de chasse touristique 10. Détails relatifs aux bagues d’oiseaux retrouvées sur des oiseaux tués dans le cadre de la chasse 11. Appréciations des donnés manquantes et du besoin de recherche en matière de chasse des oiseaux migrateurs. B/ La législation en matière de chasse des oiseaux migrateurs et application de la réglementation en vigueur 1. organisation de la gestion de la chasse (responsabilités des institution gouvernementales, des association de chasseurs et autres organisations de chasseurs et autre organisation, formes de collaboration par exemple en matière de formation et livraison de chasse, etc.). 2. principale législation pertinente en matière de chasse des oiseaux migrateurs et les limitations fixées en ce qui concerne les périodes de chasse, le nombre d’oiseaux par espèce et par période de chasse autorisée, les espèces gibier, les espèces protégées, 2 restriction en ce qui concerne les horaires, les zones, la fréquence et les méthodes de chasse, etc. -

Journal Officiel = De La Republique Algerienne Democratique Et Populaire Conventions Et Accords Internationaux - Lois Et Decrets
No 22 ~ Mercredi 14 Moharram 1421 ~ . 39 ANNEE correspondant au 19 avril 2000 Pee nls 43 Ub! sess Sbykelig bte é yr celyly S\,\n JOURNAL OFFICIEL = DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS. ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANCAISE) Algérie ; ER DIRECTION ET REDACTION: Tunisie ETRANGER SECRETARIAT GENERAL ABONNEMENT Maroc (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libyeye que le Maghreb) ” , Mauritanie Abonnement et publicité: : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An- 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 a 17 - C.C.P. 3200-50 | Edition originale.....ccccsesseeees 856,00 D.A| 2140,00 D.A _ ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ . BADR: 060.300.0007 68/KG Edition originale et sa traduction}1712,00 D.A|. .4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d'expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 10,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 20,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant baréme. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Priére de joindre la derniére bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22.14 Moharram 1421 19 avril 2000 SOMMAIRE | | ; ARRETES, DECISIONS ET AVIS | MINISTERE DES FINANCES Arrété du 13 Ramadhan 1420 correspondant au 21 décembre 1999 modifiant et complétant l'arrété du 26 Rajab 1416 -correspondant au 19 décembre 1995 portant création des inspections des impéts dans les wilayas relevant de la _,direction régionale des imp6ts de Chlef... -

Republique Algérienne Démocratique Et Populaire
REPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR & DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE UNIVERSITÉ MENTOURI FACULTÉ DES SCIENCES DE LA TERRE, DE GÉOGRAPHIE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE N° d'Ordre ……………… Série ............................ THESE POUR L'OBTENTION DU DIPLOME DE DOCTORAT D'ÉTAT OPTION: URBANISME Présentée par : BENABBAS MOUSSADEK THÈME DEVELOPPEMENT URBAIN ET ARCHITECTURAL DANS L’AURES CENTRAL ET CHOIX DU MODE D’URBANISATION Sous la direction du: Pr BOUDRAA AHMED Jury d'Examen Président: S. KERADA M.C Université de Constantine Rapporteur: A. BOUDRAA Pr Université de Batna Examinateur: B. AMRI M.C Université de Batna Examinateur: S. CHAOUCHE M.C Université de Constantine Soutenue, Le 09 Juillet 2012 A la mémoire de ma Grande mère Remerciements Je tiens tout d'abord a remercier mon directeur de thèse, Boudraa Ahmed, Professeur au département des sciences sociologiques, section des sciences sociales, Université El hadj Lakhdar, Batna, pour avoir accepter de m'accompagner tout au long de ce projet de thèse, pour sa confiance, son amitié et son soutien. Merci à Amri Brahim, Kerada Salah-Eddine et Chaouche Salah pour avoir accepter de faire partie du jury de cette thèse. Pour leurs conseils et leur amitié, je remercie entre autre Aourra Ali, Zemmouri Nour Eddine, et Metmer Med Laid. Merci a Marc Cote pour m'avoir donné le temps d’entretiens, d'orientations durant mes séjours de stage à Aix-en Provence et des éléments importants pour la compréhension du contexte que j'ai eu l'occasion d'étudier. Mes remerciements les plus sincères, s'adressent au personnel, gestionnaire du département d'architecture de Constantine, surtout, Mme Safieddine Rouag Djamila, chargée de la post graduation. -

Palmier Dattier. Cochenille Blanche, Infestation, Prédateurs, Echelle D'iperti
Recherche Agronomique (1999), 5, 1-10 INRAA IMPACT OF THE ENTOMOPHAGOUS FAUNA ON THE Parlatoria Blanchardii TARG POPULATION IN THE BISKRA REGION Part 1 s. MOHAMMEDI' and A. SALHI- 1 - D.SA. de Biskra 2 - S.R.P.V. Filiache - Biskra. Abstract : Date palni tree is facing many problems and constraints snch as water stress, excess of salinity, deseases, pests, etc... Among the most important pests Parlatoria blanchardii communly known as the white cochineal is spread in Biskra région. Aims ofthis study were to measure its spread, to identify its natural predators and to measure there impact on this pest. Iperti's scale vim iised to measure overrun ofParlatoria blanchardii on date palms. Most predators ofthis pest living in the study area were identified and there impact measured. Results show that spread of Parlatoria blanchardii is not uniform ail over the study area. More over a close rela- tionship wasfound between it's spread and those ofpredators siich as, Cybocephaliis palmanum and Pharoscvmus semislobu.sus. Key words : Date palm tree, White cochineal, Spread, Predators, îperti scale. Résumé : Le palmier dattier est confronté à de nombreux problèmes et contraintes tels que le déficit hydrique, les excès de salinité, les maladies, les insectes nuisibles, etc... Parmi ces derniers, Parlatoria blanchardii Targ communément appelée la Cochenille blanche est répandue au niveau de la région de Biskra. Les objectifs de cette étude visent une évaluation de Vinfestation des palmeraies de la wilaya de Biskra par la Cochenille blanche, l'identification de ses prédateurs naturels et leur impact. L'échelle d'Iperti a été utilisée pour mesurer les taux d'infestation par Parlatoria hlnnchardii. -

Préface De Mr Hocine MAZOUZ Le Wali De La Wilaya De Batna
Préface de Mr Hocine MAZOUZ Le Wali de la Wilaya de Batna Je suis particulièrement honoré de préfacer le premier an- nuaire régional des entreprises qui constitue un outil précieux en ma- tière d’information et de communication pour les opérateurs écono- miques de la wilaya de Batna, et les opérateurs étrangers, souhaitant investir dans les secteurs de l’agriculture, l’industrie, le tourisme dans notre région. L’élaboration de l’annuaire des entreprises est venue répon- dre aux besoins des opérateurs économiques et s’inscrit pleinement dans la politique de communication développée par ces secteurs. Cette initiative à permis la compilation d’une base de don- nées importante inventoriant les entreprises publiques et privés acti- vant dans différentes branches d’activité de la région de la wilaya de Batna. L’annuaire, qui répertorie l’ensemble des entreprises, opé- rant dans la wilaya de Batna dans tous les secteurs, sera diffusé à l’en- semble des institutions nationales ainsi qu’aux représentations diplo- matiques. Par ailleurs, il constitue un espace publicitaire pour les opé- rateurs qui y figurent ainsi que pour d’autres qui voudraient se faire connaitre dans notre secteur à travers des publicités que nous leur ré- serverons dans nos prochaines éditions. Conscient des enjeux et des défis à relever, l’exploitation des données continuellement actualisées et insérées dans les prochains annuaires, permettra aux opérateurs, promoteurs et investisseurs de prendre connaissance aux programmes de développement de la wilaya de Batna, ainsi que l’opportunité en matière d’investissement dont la finalité s’inscrit autour des axes ci-après. -

Soutenue Devant Le Jury Composé De : THEME
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHESCIENTIFIQUE UNIVERSITE MOSTAFA BEN BOULAID BATNA2 INSTITUT DES SCIENCES DE LA TERRE ET DE L’UNIVERS DEPARTEMENT DE LA GEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE THESE Présentée en vue de l’obtention du diplôme de Doctorat en sciences Filière : Géographie et aménagement du territoire THEME Présentée par : Baziz Nafissa Soutenue devant le jury composé de : Dridi Hadda Professeur Université Batna 2 Présidente Kalla Mahdi Professeur Université Batna 2 Rapporteur Guettouche Mohammed Said Professeur USTHB Examinateur Boutiba Makhlouf Professeur USTHB Examinateur Boudoukha Abderrahmane Professeur Université Batna 2 Examinateur Benmessaoud Hassen Professeur Université Batna 1 Examinateur Année universitaire 2017/2018 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHESCIENTIFIQUE UNIVERSITE MOSTAFA BEN BOULAID BATNA2 INSTITUT DES SCIENCES DE LA TERRE ET DE L’UNIVERS DEPARTEMENT DE LA GEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE THESE Présentée en vue de l’obtention du diplôme de Doctorat en sciences Filière : Géographie et aménagement du territoire THEME Présentée par : Baziz Nafissa Soutenue devant le jury composé de : Dridi Hadda Professeur Université Batna 2 Présidente Kalla Mahdi Professeur Université Batna 2 Rapporteur Guettouche Mohammed Said Professeur USTHB Examinateur Boutiba Makhlouf Professeur USTHB Examinateur Boudoukha Abderrahmane Professeur Université Batna 2 Examinateur Benmessaoud -

The Sand Filterers
1 The sand filterers Majnoun, the passionate lover of Leila, wandering in the desert, was seen one day filtering sand in his hands. “What are you looking for?” He was asked. “I am looking for Leila.” “How can you expect to find such a pure pearl like Leila in this dust?” “I look for Leila everywhere”, replied Majnoun, “hoping to find her one day, somewhere.” Farid Eddin Attar, as reported by Emile Dermenghem, Spiritual Masters’ Collection. 2 Introduction Whatever judgment passed in the future on Mostefa Ben Boulaid, Bachir Chihani or Adjel Adjoul, a place in the mythical Algerian revolution will be devoted to them. Many controversies will arise concerning the nature of this place. As for me, I only hope to be faithful to their truth. To achieve this, I think time has come to unveil the history of the Aures- Nememcha insurrection and rid it of its slag, reaching deep in its genuine reality which makes it fascinating. The events told here go from November 1st, 1954 to June 1959. They depict rather normal facts, sometimes mean, often grandiose, and men who discover their humanity and whose everyday life in the bush is scrutinized as if by a scanner. As it is known, it is not easy to revive part of contemporary History, particularly the one concerning the Aures Nememcha insurrection of November 1954. I have started gleaning testimonies in 1969, leaving aside those dealing with propaganda or exonerating partiality. I have confronted facts and witnesses, through an unyielding search for truth, bearing in mind that each witness, consciously or not, is victim of his own implication. -

Thèse BASSIN TIMGAD 2021.Pdf
République algérienne démocratique et populaire Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Université de MOSTEPHA BEN BOULAID BATNA 2 Institut des Sciences de la Terre et de l'Univers Département de Géologie THÈSE En vue de l'obtention du diplôme de DOCTORAT DE TROISIÈME CYCLE OPTION Gestion des ressources en eau Thème ETUDE HYDROGEOLOGIQUE DU BASSIN NEOGENE DE TIMGAD (WILAYA DE BATNA -- NORD-EST ALGERIEN) Présentée par: LEBCHEK SOUMIA Soutenue publiquement le : 28 /01 / 2021 Devant le jury composé de : BRINIS Nafaa MCA Président Université de BATNA 2 MENANI Med Redha Prof Rapporteur Université de BATNA 2 DRIAS Tarek Prof Examinateur Université de BATNA 2 KHEDIDJA Abdelhamid MCA Examinateur Université de BATNA 2 CHABOUR Nabil Prof Examinateur Université de Constantine 1 HADJI Rihab MCA Examinateur Université de Sétif 1 Dédicace Je dédie ce modeste travail et ma profonde gratitude A ma chère maman ; A la mémoire de mon cher père ; A la mémoire de mon très cher frère Yousef ; A la mémoire de ma chère sœur Saliha ; A mon oncle Abdelhakim ; A mes sœurs et mes frères; A mes belles-sœurs et mes beaux-frères; A mes chères nièces et mes chers neveux: Raoua Assil, Med Anes, Abederrahim safi, Ali Zakarya, Meriem Dalia, Adam, Meriem, Hibat errahmane et Djaoued Ibrahim ; A toute ma famille ; A mes chers amis. II Remerciement Je voudrai, en premier lieu, témoigner mes vifs et sincères remerciements à dieu tout Puissant de m’avoir permis de mener à terme ce travail. En préambule à cette thèse, je souhaite adresser ici tous mes remerciements aux personnes qui m’ont apporté leur aide et qui ont ainsi contribué à l'élaboration de ce travail. -

Thèse Agronomie 2017.Pdf
الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE العلمي البحث و العالي التعليم وزارة MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Université Mohamed Khider Biskra Faculté des Sciences Exactes et Sciences de la Nature et de la Vie Département des sciences agronomiques N° d’orde :…… Série :………... THESE EN VUE DE L’OBTENTION DU DIPLOME DE DOCTORAT EN SCIENCES AGRONOMIQUES PAR : AOUIDANE Laiche THEME Origines de la salinisation des eaux et des sols d’une zone à climat semi-aride : Cas de Remila (W. Khenchela) Soutenue bibliquement le : 08/11/2017 Devant le jury : M. BARKAT Djamel Pro. Président Université Biskra M. BELHAMRA Mohamed Pro. Directeur de Thèse Université Biskra M. CHEBBAH Mohamed Pro. Examinateur Centre Universitaire Mila M. SAKAA Bachir MRA Examinateur CRSTRA Biskra Mme. BOUCHEHAM Nora MRA Examinatrice CRSTRA Biskra Résumé La plaine de Remila couvre 250 km2 dans une cuvette synclinale à remplissage Mio-Plio- Quaternaire où la nappe du Plio-Quaternaire constitue la principale source d’approvisionnement en eau potable et l’irrigation agricole. Un total de 86 échantillons d’eau des forages et 200 échantillons du sol ont été prélevés durant deux compagnes ; basses eaux 2013 et hautes eaux 2014, dans le cadre d’analyser les éléments majeurs, mineurs, des isotopes stables (18O, 2H) et granulométrie. Les résultats d’analyse de nos eaux ont été traités par deux méthodes : classique avec une interprétation géochimique des données brutes et une deuxième méthode ; analyse compositionnelle des données (Compositional Data Analysis). Les deux méthodes induites que l’aquifère est contrôlé par différents processus géochimiques : (I) la dissolution des roches évaporitiques (II) réaction d’échange et échange inverse des cations (III) la dissolution congruente des carbonates, et (VI) la partie nord-est de la région est semis sous l’intrusion saline des eaux de Sabkha.