Daniel COLARD (*)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Humanitarian Imperialism: Using Human Rights to Sell War
Bricmont, J. (2006). Humanitarian imperialism: Using human rights to sell war. New York: Monthly Review Press. Preface to the English Edition Two sorts of sentiments inspire political action: hope and indignation. This book is largely the product of the latter sentiment, but the aim of its publication is to encourage the former. A brief and subjective overview of the political evolution of the past twenty years can explain the source of my indignation. The collapse of the Soviet Union can be compared to the fall of Napoleon. Both were the product of major revolutions whose ideals they symbolized, rightly or wrongly, and which they defended more or less effectively while betraying them in various ways. If their natures were complex, the consequences of their fall were relatively simple and led to a general triumph of reaction, with the United Stales today playing a role analogous to that of the Holy Alliance nearly two centuries ago.1 There is no need to be an admirer of the Soviet Union (or of Napoleon) to make this observation. My generation, that of 1968, wanted to overcome the shortcomings of the Soviet system, but certainly did not mean to take the great leap backwards which actually took place and to which, in its overwhelming majority, it has easily adapted.2 A discussion of the causes of these failures would require several books. Suffice it to say that for all sorts of reasons, some of which will be touched on in what follows, I did not follow the evolution of the majority of my generation and have preserved what it would call my youthful illusions, at least some of them. -

Les Facéties D'alexandre Adler
En somme, Adler a croisé Serge July, Claude Imbert, Bernard-Henri Lévy, Alain Duhamel, Jean-François Revel, Jacques Attali, Denis Jeambar, Jean-Marie Cavada, Laure Adler, Jean-Marie Colombani, Alain Minc, Edwy Plenel et Yves de Chaisemartin dans un cadre purement professionnel... qui en dit long sur la profession en question. Telle une araignée « affamée », « l‘expert » tisse la toile de son cercle proche, puis de son réseau d‘amitiés. Toutes ces portes d‘entrée sur le monde médiatique et politique lui permettent de toujours trouver tribune pour Les facéties d‘Alexandre Adler : ses proses, micro pour ses paroles et caméra pour ses gesticulations. Expert en variations et médiacrate tous terrains Un parcours politique « cohérent » Appelant à voter communiste lors des élections « Vous occupez, pour longtemps, toutes les places, européennes de juin 1979 [4], encarté chez les votre réseau contrôle toutes les voies d‘accès et communistes jusqu‘en 1980 [5], appartenant « corps et refoule les nouveaux, le style que vous imprimez au biens [...à] la Gauche française », s‘insurgeant contre les pouvoir intellectuel que vous exercez enterre tout technocrates de droite, ces « fascistes en cravates [qui] possible et tout futur. Du haut de la pyramide, peuplent les cabinets ministériels » [6] ; il a, comme amoncellement d‘escroqueries et d‘impudences, vous beaucoup, sous le règne de François Mitterrand, vendu son déclarez froidement, en écartant ceux qui voudraient âme à la mondialisation de l‘économie de marché et s‘est regarder par eux-mêmes qu‘il n‘y a rien à voir et que le morne désert s‘étend à l‘infini. -

Western Europe
Western Europe Great Britain National Affairs A STRANGE DICHOTOMY marked the year. While the country enjoyed continued prosperity and stability, the government—especially Prime Minister Tony Blair—incurred increasing unpopularity, albeit not to a degree that would threaten Labour's continuance in office. The sustained growth of the economy and low interest rates softened the impact of tax increases on disposable income, although opinion polls did register discontent, particularly over local taxation. Chancellor of the Exchequer Gordon Brown's pre-budget report in December indicated that receipts were lower than anticipated while costs associated with the Iraq war had pushed spending above expectations. Nevertheless, Brown adhered to his "golden rule" that over the economic cycle the government should borrow only to invest. Employment reached a record high of 28.1 million, and the number of people applying for unemployment benefits dropped steadily, reaching 917,800 in November, 7,900 lower than a year before. High employment raised the threat of wage inflation. The burden of interest payments on the growing public debt raised similar concerns. In July, interest rates were cut a quarter-percent to 3.50 percent to stim- ulate the economy, but in December this was reversed for the first time in almost four years; rates went back up to 3.75 percent so as to coun- teract the danger of rises in house prices and personal debt. Politically, satisfaction with the government continued to decline from its peak of about 55 percent just after 9/11 to about 25 percent in De- cember 2003. The results of local elections held in May registered the po- litical fallout: Labour lost a combined 800 seats, and the Conservatives, winning the largest share of the vote, gained about 500. -

1 a GORBACHEV EPIPHANY 1. Interview with Reagan In
Notes 1 A GORBACHEV EPIPHANY 1. Interview with Reagan in Washington Post, 26 Feb. 1988, A18. 2. A. W. DePorte, Europe Between the Superpowers: The Enduring Balance (New Haven and London, Yale University Press, 1979), xii. 3. With some exceptions, for example, Michael Howard, 'The Gorbachev Challenge and the Defense of the West', Survival (Nov.-Dec. 1988). 4. Time, 4 Jan. 1988, 16. 5. New York Times, 16 May 1989, AI, A10. 6. Nezavisimaia gazeta, 8 July 1994, 1. Gorbachev's account of the 'political trial of the ex-President' is in his Memoirs (New York and London, Doubleday, 1995), 681-3. 2 THE OLD REGIME OF THE SOVIET COMMUNISTS: FOREIGN POLICY IN THE COLD WAR 1. Quoted in B. H. Sumner, Russia and the Balkans, 1870-1880 (Oxford Uni versity Press, 1937), 98. V. P. Potemkin (ed.), Istoriia diplomatii (Moscow, Gosudarstvennoe sotsialno-ekonomicheskoe izdatelstvo, 1941),470-71 trans lates Gorchakov's original French se recueille as sosredotochivaetsia (to be concentrated, fixed, focused). 2. Arkady N. Shevchenko, Breaking with Moscow (New York, Knopf, 1985), 156. Jon Jacobson, When the Soviet Union Entered World Politics (Berkeley, Los Angeles, University of California Press), 104. 3. Andrei Gromyko, Memories, trans. Harold Shukman (London and Sydney, 1989), 342-3. 4. Voprosy istorii, No.1 (1945), 4. 5. Khrushchev Remembers: The Last Testament (New York, Little, Brown, 1976), 393. 6. A. W. DePorte, De Gaulle's Foreign Policy, 1944-1946 (Cambridge, MA, Harvard University Press, 1968),29-44. Georges Bidault, Resistance (London, Weidenfeld and Nicolson, 1965), 147-9. 7. E. S. Varga, Izmeneniia v ekonomike kapitalizma v itoge vtoroi mirovoi voiny (Moscow, 1946), 226-68. -

Batı Kamuoyu, AKP‑IŞİD İlişkileri Ve Kürt Sorunu
Batı Kamuoyu, AKP‑IŞİD İlişkileri ve Kürt Sorunu Taner Timur, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi emekli öğretim üyesi, e-posta: [email protected] Geçen yıl Ekim ayında Fransız Başbakanı Manuel Valls, ülkelerinin tarihte benzeri görülmemiş bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu söylüyor ve bu tehlikeyi de “bazı Fransızların, gerekirse kendi ülkelerini vurmak için terör eğitimi almak üzere dış ülkelere gitmeleri”nde görüyordu.1 Çok geçmeden de bu kaygısında ne kadar haklı olduğu anlaşıldı: 7 Ocak 2015’te, iki İslamcı terörist Charlie Hebdo bürosunu basıyor ve Fransa’nın en popüler mizahçılarını katlediyordu. Bu iğrenç cinayet sadece Fransa’da değil, bütün dünyada büyük tepkiler yarattı ve gözler IŞİD adlı kanlı yapıya çevrildi. ABD’nin Irak’ı işgalinin yarattığı anarşi ortamı, sonunda bölgedeki tüm kin ve intikam duygularını cihat bayrağı altında toplamış ve dünyaya meydan okuyan bir “İslam Devleti” ortaya çıkmıştı. Öyle ki İran’ın mollaları dahi bu yeni cihatçılar karşısında çok “ılımlı” görünüyorlardı. Ve varılan noktada da, IŞİD radikalizmi, Obama ile Putin’i bile bu tehlikeye karşı nesnel müttefikler haline getirdi. Rus uçakları Suriye’de Cihatçı hedefleri bombalamaya başlayınca, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry “Rusya’nın bu meseleye odaklanmayı seçmesinden memnunuz” diyordu.2 Binlerce kilometre uzaktaki ülkeleri bile bu kadar ürküten bu cinayet şebekesine karşı, onunla sınır komşusu Türkiye’nin izlediği politika ne oldu? Bölgedeki gelişmeleri yakından izleyen hemen bütün gözlemciler IŞİD’in bu hale gelmesinde AKP iktidarının rol oynadığını, ya da en azından sınır kontrolünde çok gevşek davranarak bu gelişmeye zemin hazırladığını düşünüyorlar. Neden olarak da Erdoğan’ın Müslüman Kardeşler eksenli politikasının iflas etmesini ve bu iflasın katılaştırdığı Esad düşmanlığını ileri sürüyorlar. -

WORLD INSTITUTIONAL INVESTOR FORUM Geneva - January 20Th, 2017
WORLD INSTITUTIONAL INVESTOR FORUM Geneva - January 20th, 2017 This event is sponsored by PROGRAMME 08:30 Registration & Breakfast 09:00 Welcoming Speech Grégoire Haenni (Institutional Circle, CPEG) 09:10 Investment opportunities in alternative risk premia Speaker: Cliff Asness (AQR, Founder) 10:00 Macroeconomic picture of the world (presentations and panel) Short macroeconomic introduction: Frank Brosens (Tatonic, Co-Founder) Speaker: Emil Nguy (Income Partners, Founder and CIO) Speaker: Aidan Corcoran (KKR, Strategist) Moderator: Claus Christjansen (LD Pensions, CIO) 11:15 Pause 11:30 Outlook for political risks Speaker: Alexandre Adler (historian, journalist and expert of geopolitics) 12:30 Lunch Introduction: Valérie Baudson (Amundi, Member of the Executive Committee) 14:00 How does technology impact the global economy? Speaker: Jacques Bughin (McKinsey Institute, Senior Partner) 15:00 Pause 15:30 Institutional Circle Consensus Speaker: Anne-Valère Amo (Institutional Circle, Lombard Odier) 16:00 Key asset allocation decisions for 2017 Speaker: Elisabeth Bourqui (Head of ABB Group Pension Management) Speaker: Vincent Mortier (Global Dep.CIO Amundi) Moderator: Sinikka Demare (Institutional Circle, SDemare Advisory) 17:00 Closing remarks Grégoire Haenni (Institutional Circle, CPEG) 17:10 Drinks SPEAKERS SPEAKERS Alexandre ADLER Historian, journalist and expert of geopolitics Alexandre Adler is a French historian, journalist and expert of contemporary geopolitics, the former USSR, and the Middle East. He is a Chevalier de l’Ordre de la Légion d’Honneur (2002). M. Adler is a history graduate of the École normale supérieure (1969-1974). He directed the Chair for International Relations of France’s Ministry of Defense Interarmy College of Defense (1992–1998) where he remains a professor of higher military learning. -

WORLD INSTITUTIONAL INVESTOR FORUM Geneva - January 23Rd, 2018
WORLD INSTITUTIONAL INVESTOR FORUM Geneva - January 23rd, 2018 2018 Global Exclusive Sponsor: PROGRAMME 08:30 Registration & breakfast 09:00 Welcoming speech Grégoire Haenni (Founder of Institutional Circle, CPEG) 09:15 Macroeconomic picture of the world Speakers: Charles Gave (Founder, Gavekal), Emil Nguy (Founder, Income Partners) 10:05 Coffee break 10:25 Global private markets overview Speaker: Roberto Cagnati (Managing director, Partners Group) 10:45 Tactical asset allocation for 2018 Panelists: Emil Nguy (Income Partners), Charles Gave (Gavekal), Roberto Cagnati (Partners Group) Moderator: Grégoire Haenni ( Founder of Institutional Circle, CPEG) 11:15 Outlook on geopolitical risks Speaker: Alexandre Adler (Historian, journalist & geopolitical expert) 12:00 Lunch 13:45 Active vs passive strategies Panelists: Alan Hofmeyr (Partner, Marshall Wace), Laurent Trottier (Global Head of ETF, Index & Smart Beta Management, Amundi), Sinikka Demaré (Founder, SDemaré Advisory), Moderator: Anne-Valère Amo (Institutional Circle, Lombard Odier) 14:30 Climate change: responsibility, challenges and opportunities Standalone presentations & panel Speakers/panelists: Alexandre Ménard (Partner, McKinsey), Peter Damgaard Jensen (Chair, Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC)), Laurent Trottier (Amundi) Moderator: Antoine Prudent (Founder, InPact Advisory) 15:40 Coffee break 16:00 Everything you always wanted to know about blockchain but were afraid to ask Speaker: Arek Wylegalski (Founder, Fly Venture) Fintech: why could the blockchain be a game changer? Speaker: Steve Waterhouse (Partner, Orchid Lab) 16:45 Closing remarks Grégoire Haenni (Founder of Institutional Circle, CPEG) SPEAKERS SPEAKERS Alexandre ADLER Historian, journalist & geopolitical expert Alexandre Adler is a French historian, journalist and expert of contemporary geopolitics, the former USSR, and the Middle East. He is a Chevalier de l’Ordre de la Légion d’Honneur (2002). -

The Use of Racist, Antisemitic and Xenophobic Arguments in Political Discourse
The use of racist, antisemitic and xenophobic arguments in political discourse Jean-Yves Camus ECRI: European Commission against Racism and Intolerance March 2005 The opinions expressed in this work are the responsibility of the author and do not necessarily reflect the official policy of the Council of Europe or of any of the mechanisms or monitoring bodies established by it. ECRI (European Commission against Racism and Intolerance) Council of Europe F-67075 Strasbourg Cedex © Council of Europe, 2005 Printed at the Council of Europe Foreword The European Commission against cal discourse or of a discourse otherwise Racism and Intolerance (ECRI) is a mecha- impacting on racism and intolerance within nism which was established by the first public opinion. It was agreed that the analy- Summit of Heads of State and Governments sis should cover the European Parliament of the Council of Europe (October 1993). elections of June 2004, and national or local ECRI's task is to combat racism, xenopho- elections, which took place between June bia, antisemitism and intolerance at the 2003 and June 2004 in at least three Council level of greater Europe and from the per- of Europe member States. The study was spective of the protection of human rights. forwarded by the consultant to ECRI at its ECRI is composed of independent and plenary meeting from 14-17 December 2004. impartial members, nominated on the basis ECRI decided to adopt at its plenary of their moral authority and recognized meeting from 15-17 March 2005 a Declara- expertise in dealing with matters related to tion on the issue and to publish it together the fight against racism and intolerance. -

The Iranian Moment
The Iranian Moment Frédéric Tellier Policy Focus #52 | February 2006 Patrick Clawson, Series Editor All rights reserved. Printed in the United States of America. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher. © 2006 by the Washington Institute for Near East Policy. All rights reserved. Translated and adapted from “Le moment Iranien,” in L’heure de l’Iran, originally published in 2005 by Editions Ellipses. Th e English-language edition is lawful and authorized by special arrangement with Editions Ellipses. Published in 2006 in the United States of America by the Washington Institute for Near East Policy, 1828 L Street NW, Suite 1050, Washington, DC 20036. Design by Daniel Kohan, Sensical Design and Communication Front cover: Iranian president Mahmoud Ahmadinejad delivers a speech in the city of Zahedan on December 14, 2005. Copyright AP Wide World Photos/Saman Aqvami About the Author Frédéric Tellier is a researcher at the Institute for International and Strategic Studies in Paris. A specialist on Iran and its geopolitical environment, he has authored numerous works on political and religious developments in that country as well as on regional security and proliferation issues. He appears frequently in the French media as a commentator on Iran. In 1999–2001, Mr. Tellier served as a science and cultural attaché at the French embassy in Tehran. He later served as a civilian strategic analyst in charge of Iranian politics and nuclear activities with the French Minis- try of Defense, working at the Offi ce for Prospective and Strategic Studies within the Directorate for Military Intelligence. -

Les « Nouveaux Réactionnaires ». Trajectoire Sociopolitique Et Surface Médiatique De Deux Intellectuels Hétéronomes : Alexandre Adler Et Alain Finkielkraut
Les « nouveaux réactionnaires ». Trajectoire sociopolitique et surface médiatique de deux intellectuels hétéronomes : Alexandre Adler et Alain Finkielkraut. Julien Giry Université de Rennes 1 – IDPSP Docteur en Science Politique – ATER en Science Politique « Je tenais effectivement à remercier la télévision française de m'avoir si souvent invité afin que je puisse m'y plaindre d'ailleurs de ne pas y passer »1 Alexandre Adler et Alain Finkielkraut incarnent à eux deux, tant par leurs trajectoires sociopolitiques que leur surface médiatique, une manifestation typique de ces « nouveaux réactionnaires » que nous pouvons qualifier d'intellectuels hétéronomes2. En effet, ces acteurs multipositionnés semblent d'abord présenter une trajectoire ou une carrière militante, au sens sociologique du terme, similaire dans la mesure où tous les deux se sont progressivement détachés de leurs engagements radicaux à gauche pour évoluer vers le néoconservatisme. Pour Adler, il s'est agi de délaisser, en plusieurs étapes sur lesquelles nous reviendrons en détails, le communisme stalino-brejnevien au profit du néoconservatisme ainsi que d'un soutien à la droite atlantiste et à Nicolas Sarkozy lors de l'élection présidentielle de 20073. Quant à Finkielkraut, depuis une « conscience gauchiste », dans une tendance maoïste, et un « engagement anti-autoritaire »4 qui l'ont poussé sur les barricades de Mai 68, celui-ci concède aujourd'hui son attachement au conservatisme et au rejet du marxisme, des « bobos », de la GPA et du consumérisme ambiant qui forment le « système » actuel5. Par ailleurs, il revendique son amitié avec Renaud Camus, le théoricien de droite radicale du « grand remplacement »6. En cela, la trajectoire de Finkielkraut est identique à celle des néoconservateurs américains, eux aussi juifs pour l'essentiel, de première génération tels 1 Comme le disait un autre « nouveau réactionnaire ». -
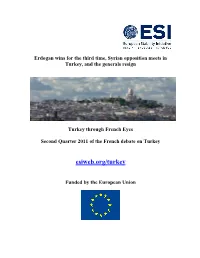
Esiweb.Org/Turkey
Erdogan wins for the third time, Syrian opposition meets in Turkey, and the generals resign Turkey through French Eyes Second Quarter 2011 of the French debate on Turkey esiweb.org/turkey Funded by the European Union Table of Contents May ..................................................................................................................................... 3 1 May 2011 – Turkey on the march on Africa ............................................................................ 3 2 May 2011 – Images of Armenian memories ............................................................................ 5 3 May 2011 – Turkey demands visa liberalisation ..................................................................... 6 4 May 2011 –French government opposes tougher sanctions on Armenian genocide denial .... 6 9 May 2011 – Reactions to the canal .......................................................................................... 6 13 May 2011 – Domestic violence on the rise ............................................................................ 7 14 May 2011 – Fethiye Cetin, a writer of mixed heritage .......................................................... 8 16 May 2011 – Protests against online censorship ..................................................................... 9 18 May – Celebrating Turkish culture in France ........................................................................ 9 20 May 2011 – New wave of violence in the Kurdish region of Turkey .................................... 9 23 May 2011 – -

Bernard Kouchner
LeMonde Job: WMQ0407--0001-0 WAS LMQ0407-1 Op.: XX Rev.: 03-07-99 T.: 11:10 S.: 111,06-Cmp.:03,11, Base : LMQPAG 34Fap: 100 No: 0327 Lcp: 700 CMYK LE MONDE TÉLÉVISION RADIO VIDEO DVD SEMAINE DU 5 AU 11 JUILLET 1999 MARIE-CHRISTIANE MAREK ENQUÊTE MEKTOUB BD EN VIDEO Son magazine Depuis un an, la guerre Paroles marocaines sur Arte, « Blake et de mode est déclarée entre la avec un film de Nabil Ayouch Mortimer », sur Paris chaîne Planète et le inspiré d’un fait réel, entre «Tintin», Première puissant câblo-opérateur polar et « Les Malheurs a Planète tangue est devenu France-Télécom Câble. road-movie. de Sophie », un grand rendez-vous. Pages 4-5 Page 13 etc. : une vidéothèque Entre raffinement luxueux de la littérature européenne sur le câble et simplicité. Page 6 de jeunesse. Page 37 a Arte chante « O sole mio » Sous le soleil de Naples Créée à la fin du XIXe siècle, O sole mio est devenue la chanson la plus célèbre du monde. Arte consacre une Thema à l’histoire d’un genre musical, la canzonetta napolitaine. Page 33 55e ANNÉE – No 16932 – 7,50 F - 1,14 EURO FRANCE MÉTROPOLITAINE DIMANCHE 4 - LUNDI 5 JUILLET 1999 FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY – DIRECTEUR : JEAN-MARIE COLOMBANI M. Kouchner : « Il faut tout créer au Kosovo » La liberté de M. Bonnet b Nommé haut représentant de l’ONU pour le Kosovo, Bernard Kouchner explique au « Monde » b comment il conçoit sa mission « La sécurité des deux communautés est une tâche urgente » a L’ancien préfet b Hashim Thaçi, chef de l’UCK, l’assure de son soutien pour mettre en place l’administration civile REUTERS de Corse, remis LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL des Nations unies, Kofi Annan, a an- en liberté, menace noncé vendredi 2 juillet avoir Un Tour de France « trouvé l’homme qu’il cherchait » de faire des révélations et désigné Bernard Kouchner pour être le haut représentant de l’ONU a me en grand danger au Kosovo.