Consortium for Development Partnerships (CDP)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

1. KAYES : 2. KOULIKORO District De Kolokani District De Koulikoro
MINISTERE DE LA SANTE REPUBLIQUE DU MALI ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE UN PEUPLE UN BUT UNE FOI SECRETARIAT GENERAL RAPPORT JOURNALIER DE LA GESTION DE L’EPIDEMIE DE MENINGITE AU MALI JOURNEE DU 18 MARS 2016 1. KAYES : La situation épidémiologique est de 0 cas et 0 décès. 2. KOULIKORO District de Kolokani Nombre de cas présumé : 2 Nombre de décès : 0 Village de Guiyogo, aire de santé de Guiyoyo, district de Koulokani, 4 ans Village de Guidiou, aire de santé Guidiou, 4 ans, sexe féminin, 58 ans Les prélèvements de LCR ont été effectués et envoyés à l’INRSP de Bamako District de Koulikoro Nombre de cas présumé : 2 Nombre de décès : 0 Quartier Souban, aire de santé du CSCOM Central, district de Koulikoro, sexe féminin, 11 mois et sexe masculin, 4ans, Les prélèvements de LCR ont été effectués et envoyés à l’INRSP de Bamako District de Ouéléssébougou Nombre de cas présumé : 0 cas Nombre de décès : 0 ; Nombre de personnes hospitalisées en traitement : 3 Actions en cours : - Poursuite de la surveillance active et de la prise en charge des cas ; - Poursuite des activités d’information, de sensibilisation et de communication sur les radios locales, médias nationaux, médias sociaux et électroniques ; - Tenue de la réunion du Comité de gestion des épidémies et catastrophes au cabinet du MSHP. 3. SIKASSO La situation épidémiologique est de 0 cas et 0 décès. 4. SEGOU : La situation épidémiologique est de 0 cas et 0 décès. 5. MOPTI : La situation épidémiologique est de 0 cas et 0 décès. 6. TOMBOUCTOU : La situation épidémiologique est de 0 cas et 0 décès. -

340102-Fre.Pdf (433.2Kb)
r 1 RAPPORT DE MISSION [-a mission que nous venons de terminer avait pour but de mener une enquête dans quelques localités du Mali pour avoir une idée sur la vente éventuelle de I'ivermectine au Mali et le suivi de la distribution du médicament par les acteurs sur le terrain. En effet sur ordre de mission No 26/OCPlZone Ouest du3l/01196 avec le véhicule NU 61 40874 nous avons debuté un périple dans les régions de Koulikoro, Ségou et Sikasso et le district de Bamako, en vue de vérifier la vente de l'ivermectine dans les pharmacies, les dépôts de médicament ou avec les marchands ambulants de médicaments. Durant notre périple, nous avons visité : 3 Régions : Koulikoro, Ségou, Sikasso 1 District : Bamako 17 Cercles Koulikoro (06 Cercles), Ségou (05 Cercles), Sikasso (06 Cercles). 1. Koulikoro l. Baraouli 1. Koutiala 2. Kati 2. Ségou 2. Sikasso 3. Kolokani 3. Macina 3. Kadiolo 4. Banamba 4. Niono 4. Bougouni 5. Kangaba 5. Bla 5. Yanfolila 6. Dioila 6. Kolondiéba avec environ Il4 pharmacies et dépôts de médicaments, sans compter les marchands ambulants se trouvant à travers les 40 marchés que nous avons eu à visiter (voir détails en annexe). Malgré notre fouille, nous n'avons pas trouvé un seul comprimé de mectizan en vente ni dans les pharmacies, ni dans les dépôts de produits pharmaceutiques ni avec les marchands ambulants qui ne connaissent d'ailleurs pas le produit. Dans les centres de santé où nous avons cherché à acheter, on nous a fait savoir que ce médicament n'est jamais vendu et qu'il se donne gratuitement à la population. -

FINAL REPORT Quantitative Instrument to Measure Commune
FINAL REPORT Quantitative Instrument to Measure Commune Effectiveness Prepared for United States Agency for International Development (USAID) Mali Mission, Democracy and Governance (DG) Team Prepared by Dr. Lynette Wood, Team Leader Leslie Fox, Senior Democracy and Governance Specialist ARD, Inc. 159 Bank Street, Third Floor Burlington, VT 05401 USA Telephone: (802) 658-3890 FAX: (802) 658-4247 in cooperation with Bakary Doumbia, Survey and Data Management Specialist InfoStat, Bamako, Mali under the USAID Broadening Access and Strengthening Input Market Systems (BASIS) indefinite quantity contract November 2000 Table of Contents ACRONYMS AND ABBREVIATIONS.......................................................................... i EXECUTIVE SUMMARY............................................................................................... ii 1 INDICATORS OF AN EFFECTIVE COMMUNE............................................... 1 1.1 THE DEMOCRATIC GOVERNANCE STRATEGIC OBJECTIVE..............................................1 1.2 THE EFFECTIVE COMMUNE: A DEVELOPMENT HYPOTHESIS..........................................2 1.2.1 The Development Problem: The Sound of One Hand Clapping ............................ 3 1.3 THE STRATEGIC GOAL – THE COMMUNE AS AN EFFECTIVE ARENA OF DEMOCRATIC LOCAL GOVERNANCE ............................................................................4 1.3.1 The Logic Underlying the Strategic Goal........................................................... 4 1.3.2 Illustrative Indicators: Measuring Performance at the -

BORDEREAU D'envoi N°2021- IMEN-DRH-Dfecej
l.Guindo MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE REPUBLIQUE DU MALI Un Peuple - Un But - Une Foi DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES *****-):***** DU SECTEUR DE L'EDUCATION *-1,******** DIVISION FORMATION, EMPLO(/ ET COMPETENCES \) SECTION FORMATION, PERFECTIONNEMENT ~;:~~CRUTEMENT1 Le Directeur des Ressources Humaines 11-) Monsieur le Directeur National de la Fonction Publique des Collectivités Territoriales. -Barnako- ,003246 BORDEREAU D'ENVOI N°2021- IMEN-DRH-DFECEj DESIGNATION Nombre OBSERVATIONS de pièces Demandes d'autorisation de participation au concours d'entrée à l'Ecole Normale Supérieure formulées par certains agents du Ministère de l'Education Nationale dont Monsieur Mady SIDIBE, N°Mle 0201916CT13, Maître de 1 'Enseignemen t Fondamental Avis en service au CAP de Banankabougou ....................................... 01 favorable. Liste jointe ................................................................................. 22 TOTAL 23 t. LISTE DE CERTAINS ENSEIGNANTS EN SERVICE AU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE AYANT DEMANDE UNE AUTORISATION DE PARTICIPATION AU CONCOURS A L'ENSUP ANNEE UNIVERSITAIRE 2020-2021 DU 10 JUIN 2021 N° PRENOMS NOM N°MLE CORPS CAP/ETAB AE ECOLE FILIERE 1 Mady SlDIBE 0201916CTI3 MEF CAP Kayes RG AE Kayes ENSUP Anglais 2 François DOUYON 0203134CT14 MEF CAP Ouélessébougou AE Kati ENSUP Anglais 3 Modibo FOFANA 0203145CT14 MEF CAP Ouélessébougou AE Kati ENSUP Anglais 4 Djibril TANGARA 0203388CTI4 MEF CAP Ouélessébougou AE Kati ENSUP Anglais 5 Bakari KEÏTA 0203187CT14 MEF CAP Ouélessébougou AE Kati ENSUP Anglais -

Annuaire Statistique 2015 Du Secteur Développement Rural
MINISTERE DE L’AGRICULTURE REPUBLIQUE DU MALI ----------------- Un Peuple - Un But – Une Foi SECRETARIAT GENERAL ----------------- ----------------- CELLULE DE PLANIFICATION ET DE STATISTIQUE / SECTEUR DEVELOPPEMENT RURAL Annuaire Statistique 2015 du Secteur Développement Rural Juin 2016 1 LISTE DES TABLEAUX Tableau 1 : Répartition de la population par région selon le genre en 2015 ............................................................ 10 Tableau 2 : Population agricole par région selon le genre en 2015 ........................................................................ 10 Tableau 3 : Répartition de la Population agricole selon la situation de résidence par région en 2015 .............. 10 Tableau 4 : Répartition de la population agricole par tranche d'âge et par sexe en 2015 ................................. 11 Tableau 5 : Répartition de la population agricole par tranche d'âge et par Région en 2015 ...................................... 11 Tableau 6 : Population agricole par tranche d'âge et selon la situation de résidence en 2015 ............. 12 Tableau 7 : Pluviométrie décadaire enregistrée par station et par mois en 2015 ..................................................... 15 Tableau 8 : Pluviométrie décadaire enregistrée par station et par mois en 2015 (suite) ................................... 16 Tableau 9 : Pluviométrie enregistrée par mois 2015 ........................................................................................ 17 Tableau 10 : Pluviométrie enregistrée par station en 2015 et sa comparaison à -

Districts Sanitaires De Kati Et De Kala
NAME OF PROGRAMME: Programme intégré de lutte contre la mortalité infantile LOCATION: Districts Sanitaires de Kati et de Kalabancoro, Région de Koulikoro, Mali DATE OF INVESTIGATION: From 13st January 2015 to 30st January 2015 AUTHOR: Issiaka Traore, Goita Ousmane, Marie Biotteau TYPE OF INVESTIGATION: SQUEAC TYPE OF PROGRAMME: OTP for SAM IMPLEMENTING ORGANISATION: International Rescue Committee (IRC) 1 SOMMAIRE SOMMAIRE ............................................................................................................................................................................. 2 REMERCIEMENTS ................................................................................................................................................................. 3 ACRONYMES .......................................................................................................................................................................... 4 RESUME .................................................................................................................................................................................. 5 OBJECTIFS .............................................................................................................................................................................. 7 1. INTRODUCTION ............................................................................................................................................................. 8 2. CONTEXTE .................................................................................................................................................................... -

9781464804335.Pdf
Land Delivery Systems in West African Cities Land Delivery Systems in West African Cities The Example of Bamako, Mali Alain Durand-Lasserve, Maÿlis Durand-Lasserve, and Harris Selod A copublication of the Agence Française de Développement and the World Bank © 2015 International Bank for Reconstruction and Development / Th e World Bank 1818 H Street NW, Washington, DC 20433 Telephone: 202-473-1000; Internet: www.worldbank.org Some rights reserved 1 2 3 4 18 17 16 15 Th is work is a product of the staff of Th e World Bank with external contributions. Th e fi ndings, interpretations, and conclusions expressed in this work do not necessarily refl ect the views of Th e World Bank, its Board of Executive Directors, or the governments they represent, or the Agence Française de Développement. Th e World Bank does not guarantee the accuracy of the data included in this work. Th e boundaries, colors, denominations, and other information shown on any map in this work do not imply any judgment on the part of Th e World Bank concerning the legal status of any territory or the endorsement or acceptance of such boundaries. Nothing herein shall constitute or be considered to be a limitation upon or waiver of the privileges and immunities of Th e World Bank, all of which are specifi cally reserved. Rights and Permissions Th is work is available under the Creative Commons Attribution 3.0 IGO license (CC BY 3.0 IGO) http:// creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo. Under the Creative Commons Attribution license, you are free to copy, distribute, transmit, and adapt this work, including for commercial purposes, under the following conditions: Attribution—Please cite the work as follows: Durand-Lasserve, Alain, Maÿlis Durand-Lasserve, and Harris Selod. -

USAID/ Mali SIRA
USAID/ Mali SIRA Selective Integrated Reading Activity Quarterly Report April to June 2018 July 30, 2018 Submitted to USAID/Mali by Education Development Center, Inc. in accordance with Task Order No. AID-688-TO-16-00005 under IDIQC No. AID-OAA-I-14- 00053. This report is made possible by the support of the American People jointly through the United States Agency for International Development (USAID) and the Government of Mali. The contents of this report are the sole responsibility of Education Development Center, Inc. (EDC) and, its partners and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government. Table of Contents ACRONYMS ...................................................................................................................................... 2 I. Executive Summary ................................................................................................................. 3 II. Key Activities and Results ....................................................................................................... 5 II.A. – Intermediate Result 1: Classroom Early Grade Reading Instruction Improved ........................ 5 II.A.1. Sub-Result 1.1: Student’s access to evidence-based, conflict and gender sensitive, early Grade reading material increased .................................................................................................. 5 II.A.2. Sub IR1.2: Inservice teacher training in evidence-based early Grade reading improved ..... 6 II.A.3. Sub-Result 1.3: Teacher coaching and supervision -
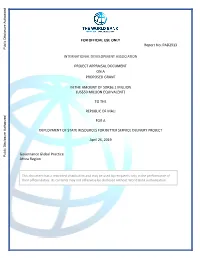
Decentralization in Mali ...54
FOR OFFICIAL USE ONLY Report No: PAD2913 Public Disclosure Authorized INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION PROJECT APPRAISAL DOCUMENT ON A PROPOSED GRANT IN THE AMOUNT OF SDR36.1 MILLION (US$50 MILLION EQUIVALENT) TO THE Public Disclosure Authorized REPUBLIC OF MALI FOR A DEPLOYMENT OF STATE RESOURCES FOR BETTER SERVICE DELIVERY PROJECT April 26, 2019 Governance Global Practice Public Disclosure Authorized Africa Region This document has a restricted distribution and may be used by recipients only in the performance of their official duties. Its contents may not otherwise be disclosed without World Bank authorization. Public Disclosure Authorized CURRENCY EQUIVALENTS (Exchange Rate Effective March 31, 2019) Currency Unit = FCFA 584.45 FCFA = US$1 1.39 US$ = SDR 1 FISCAL YEAR January 1 - December 31 Regional Vice President: Hafez M. H. Ghanem Country Director: Soukeyna Kane Senior Global Practice Director: Deborah L. Wetzel Practice Manager: Alexandre Arrobbio Task Team Leaders: Fabienne Mroczka, Christian Vang Eghoff, Tahirou Kalam SELECTED ABBREVIATIONS AND ACRONYMS AFD French Development Agency (Agence Française de Développement) ANICT National Local Government Investment Agency (Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales) ADR Regional Development Agency (Agence Regionale de Developpement) ASA Advisory Services and Analytics ASACO Communal Health Association (Associations de Santé Communautaire) AWPB Annual Work Plans and Budget BVG Office of the Auditor General ((Bureau du Verificateur) CCC Communal Support -

Tj (1 I4f}Tma~O- BORDEREAU D'envoi N'2021- 11' IMEN-DRH-DFE~
I.Guindo MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE REPUBLIQUE DU MALI -10.-****'''*****''''"* Un Peuple - Un But - Une Foi DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES *********** DU SECTEUR DE L'EDUCATION *-k******** DIVISION FORMATION, EMPLOI ff ET COMPETENCES ********* SECTION FORMATION, ; PERFECTIONNEMENT ET RECRUTEMENT !f ****** Le Directeur des Ressources Humaines //-) Monsieur le Directeur National de la Fonction Publique des Collectivités Territoriales. tJ (1 i4f}tma~o- BORDEREAU D'ENVOI N'2021- 11' IMEN-DRH-DFE~ DESIGNATION Nombre OBSERVATIONS de pièces Demandes d'autorisation de participation au concours d'entrée à l'Ecole Normale Supérieure formulées par certains agents du Ministère de l'Education Nationale dont Monsieur Amadou N SANOGO, N°Mle 0201053CT7, Maître de l'Enseignement Avis Fondamental en service au CAP de Niéria __ . 01 favorable. Liste jointe . 21 TOTAL 22 , . '"." 0'/ • . - - 'J ;:,' ~\ ...... / LISTE DE CERTAINS ENSEIGNANTS EN SERVICE AU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE AYANT DEMANDE UNE AUTORISATION DE PARTICIPATION AU CONCOURS A L'ENSUP ANNEE UNIVERSITAIRE 2020-2021 DU 10 JUIN 2021 ) PRENOMS NOM N°MLE CORPS CAP/ETAB AE ECOLE FILIERE 1 Amadou N SANOGO 0201053CT7 MEF CAP Nièna AE Sikasso Ensup Histoire-Geographie ? Souleymane KONE 020004 1 CT7 MEF CAP Nièna AE Sikasso Ensup H istoire-Geograph ie 3 SINALl DIARRA 02001 J5CT9 MEF CAP Nièna AE Sikasso Ensup Histoire-Geographie 4 Moumine TRAORE 0202288CTl3 MEF CAP Nièna AE Sikasso Ensup Histoire-Geographie 5 Lassina OUONGO 0201287CTlI MEF CAP Sikasso AE Sikasso Ensup Histoire-Geographie -

Region De Koulikoro
Répartition par commune de la population résidente et des ménages Taux Nombre Nombre Nombre Population Population d'accroissement de de d’hommes en 2009 en 1998 annuel moyen ménages femmes (1998-2009) Cercle de Kati Tiele 2 838 9 220 9 476 18 696 14 871 2,1 Yelekebougou 1 071 3 525 3 732 7 257 10 368 -3,2 Cercle de Kolokani REGION DE KOULIKORO Kolokani 7 891 27 928 29 379 57 307 33 558 5,0 Didieni 4 965 17 073 17 842 34 915 25 421 2,9 En 2009, la région de Koulikoro compte 2 418 305 habitants répartis dans 366 811 ména- ème Guihoyo 2 278 8 041 8 646 16 687 14 917 1,0 ges, ce qui la place au 2 rang national. La population de Koulikoro est composée de Massantola 5 025 17 935 17 630 35 565 29 101 1,8 1 198 841 hommes et de 1 219 464 femmes, soit 98 hommes pour 100 femmes. Les fem- Nonkon 2 548 9 289 9 190 18 479 14 743 2,1 mes représentent 50,4% de la population contre 49,6% pour les hommes. Nossombougou 2 927 10 084 11 028 21 112 17 373 1,8 La population de Koulikoro a été multipliée par près de 1,5 depuis 1998, ce qui représente Ouolodo 1 462 4 935 5 032 9 967 9 328 0,6 un taux de croissance annuel moyen de 4%. Cette croissance est la plus importante jamais Sagabala 2 258 7 623 8 388 16 011 15 258 0,4 constatée depuis 1976. -

423 17 Mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU
17 Mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 423 ARRETES MINISTERE DE L’ENERGIE ET DE L’EAU MINISTERE DES DOMAINES DE L’ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES ARRETE INTERMINISTERIEL N° 2016-3449/MEE -MATDRE-SG DU 28 SEPTEMBRE 2016 PORTANT ARRETE N°2016-3431/MDEAF-SG 27 SEPTEMBRE CREATION ET MODALITES DE 2016 FIXANT LA DATE D’OUVERTURE DES FONCTIONNEMENT DU COMITE DU BASSIN DU TRAVAUX CADASTRAUX DES COMMUNES DU SOUROU PORTION NATIONALE DU MALI DISTRICT DE BAMAKO ET DES COMMUNES DE MORIBABOUGOU, N’GABAKORO DROIT, LE MINISTRE DE L’ENERGIE ET DE L’EAU ; SANGAREBOUGOU, DIALAKORODJI, MANDÉ, DOGODOUMAN, KALABAN-KORO ET LE MINISTRE DE L’ADMINISTRATION BAGUINÉDA. TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA REFORME DE L’ETAT; LE MINISTRE DES DOMAINES DE L’ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES, ARRETENT : ARRETE : ARTICLE 1 : Il est mis en place auprès des administrations en charge de l’eau et des collectivités territoriales, un organe ARTICLE 1 : Sont ouverts à compter du 1er octobre 2016, consultatif pour la gestion des ressources en eau du bassin les travaux cadastraux des Communes du District de du Sourou, dénommé « Comité de Bassin du Sourou ». Bamako et des Communes de Moribabougou, N’Gabakoro droit, Sangarebougou, Dialakorodji, Mandé, Dogodouman, ARTICLE 2 : le présent Arrêté fixe la dénomination, la Kalaban-koro et Baguinéda. délimitation et le fonctionnement du Comité de Bassin du Sourou conformément aux dispositions de l’article 69 de ARTICLE 2 : Les travaux seront exécutés à l’entreprise la loi portant code de l’eau au Mali. Les compétences du sous la supervision du Secrétariat permanent de la Réforme Comité de bassin s’exercent sur la portion nationale du domaniale et foncière au Mali.