Plourhan. Comté Du Goëlo (Côtes-D'armor)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Rapporteur : Madame Thérèse JOUSSEAUME, Maire De La Ville De Langueux 1. Rappel Des Enjeux Le 08 Juin 2012, Saint-Brieuc Agglo
COMMUNE DE LANGUEUX Côtes d'Armor EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL Séance du 03 juillet 2017 L'an deux mille dix-sept, le trois juillet à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s'est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Madame Thérèse JOUSSEAUME, Maire de la Ville de Langueux Etaient présents Mesdames Thérèse JOUSSEAUME, Françoise HURSON (excusée pour les rapports n° 2017-58 à 2017-64), Françoise ALLANO, Marie-Hélène BISEUL, Brigitte MERLE, Claudine LE BOUEC, Gwenaëlle TUAL, Laurence LEVEE, Nadège PICOLO Messieurs Alain LE CARROU, Michel BOUGEARD, Jean-Pierre REGNAULT, Patrick BELLEBON, Eric LE BARS, Jean-Louis ROUAULT, Eric TOULGOAT, Olivier LE CORVAISIER, Richard HAAS, Cédric HERNANDEZ, Régis BEELDENS Absents excusés Mesdames Chantal ROUILLE (pouvoir donné à Brigitte MERLE), Isabelle ETIEMBLE (pouvoir donné à Richard HAAS), Caroline BAGOT-SIMON (pouvoir donné à Cédric HERNANDEZ) Messieurs Claude DESANNEAUX (pouvoir donné à Michel BOUGEARD), Daniel LE JOLU (pouvoir donné à Alain LE CARROU), Jean BELLEC (pouvoir donné à Jean-Pierre REGNAULT), Bertrand BAUDET (pouvoir donné à Françoise ALLANO), Adrien ARNAUD (pouvoir donné à Laurence LEVEE) Absente Madame Flavienne MAZARDO-LUBAC Secrétaire Madame Gwénaëlle TUAL Secrétaire Adjoint Monsieur Olivier LE CORVAISIER Secrétaire auxiliaire Monsieur Yannick RAULT, Directeur Général des Services Rapport n° 2017-58 PRISE DE PARTICIPATION DE SAINT-BRANDAN, LANFAINS, LE FOEIL ET PLOURHAN DANS LA SPL BAIE D’ARMOR AMENAGEMENT – RENONCIATION AU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS PAR AUGMENTATION DE CAPITAL Rapporteur : Madame Thérèse JOUSSEAUME, Maire de la Ville de Langueux 1. Rappel des enjeux Le 08 juin 2012, Saint-Brieuc Agglomération et les 14 communes de son territoire ont créé un nouvel outil d’aménagement public sous forme juridique de Société Publique Locale (SPL), dénommé Baie d’Armor Aménagement, au capital social de 450.000 €. -

Février 2012
bulletin d’information municipale n° 18 Février magazine 2012 plourhan.fr Edito contrats d’assurances et des mutuelles, qui augmentent les impôts des classes moyennes et populaires pour diminuer ceux des plus aisées, et qui alourdissent la TVA. Toutes les collectivités, les plus grandes comme les plus petites, sont confrontées à des difficultés pour l’élaboration des budgets locaux : gel, voire baisse des dotations de l’État, diminution de l’autonomie fiscale et financière, problèmes d’accès aux emprunts, etc. Il y a donc nécessité de reconsidérer l’action publique des collectivités. Comme beaucoup d’autres, le département des Côtes-d’Armor est lourdement touché par la crise et les décisions gouvernementales. Il faut prendre en compte cette nouvelle donne, alors que nous savons par ailleurs que l’action du Conseil général est d’une importance capitale pour les 2011 a été une année charnière : dans le les choix exprimés par les Français lors de Costarmoricains. monde, des événements importants se ces scrutins pèseront lourdement sur leur sont produits : le drame de Fukushima est quotidien. Aussi, nous avons conscience d’être entrés venu nous rappeler la fragilité écologique dans une nouvelle ère de l’action publique L’affluence dans notre mairie pour de notre société ; les révolutions départementale, tout en réaffirmant nos s’inscrire sur les listes électorales (135 arabes, porteuses d’espoir mais aussi valeurs, au premier rang desquelles la nouveaux inscrits) témoigne, chez nous, de d’interrogations… solidarité. l’importance accordée à ce moment. En France, nous avons connu les dernières C’est le fil conducteur de l’action Mais 2012 sera aussi une année élections locales sous la forme actuelle : départementale, son cœur de métier : avec exceptionnelle, malheureusement, d’un les élections cantonales en mars, puis les les politiques de l’enfance, de la famille, point de vue économique et social : la sénatoriales en septembre avec le premier des personnes âgées ou en situation de crise que nous traversons va se poursuivre basculement à gauche de cette institution. -

SAINT-QUAY- PORTRIEUX Station D'épuration Conclusions Et Avis
Ref : 18000184 / 35 PREFECTURE DES COTES D’ARMOR Commune de SAINT QUAY PORTRIEUX Mise en conformité de la station d’épuration ___________________________________________ Enquête publique du 20 août 2018 au 14 septembre 2018 II - CONCLUSIONS ET AVIS Maryvonne MARTIN Commissaire enquêteur SAINT QUAY PORTRIEUX : enquête publique concernant les travaux de mise en conformité de la station d’épuration et de son réseau de collecte desservant Saint-Quay-Portrieux, Tréveneuc et le secteur nord-est de Plourhan Conclusions et avis Ref : 18000184 / 35 II – CONCLUSIONS ET AVIS SOMMAIRE 1. RAPPEL DU PROJET ……………………………………………………………………………………………..….. 3 2. BILAN DE L’ENQUETE PUBLIQUE …………………………………………………………………..………… 6 3. APPRECIATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR LE DOSSIER ……………………….. 8 4. APPRECIATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR LES OBSERVATIONS DU PUBLIC ………………………………………………..………………………………………………………………….. 9 5. CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR …………………………………………26 2 SAINT QUAY PORTRIEUX : enquête publique concernant les travaux de mise en conformité de la station d’épuration et de son réseau de collecte desservant Saint-Quay-Portrieux, Tréveneuc et le secteur nord-est de Plourhan Conclusions et avis Ref : 18000184 / 35 II – CONCLUSIONS ET AVIS 1. RAPPEL DU PROJET La commune de Saint-Quay-Portrieux est située dans le département des Côtes d’Armor à 20 km au nord de Saint-Brieuc, à 25 km au sud de Paimpol, et à la même distance à l’est de Guingamp. Saint-Quay-Portrieux est une commune littorale d’une superficie de 387 hectares. Elle fait partie de la communauté d’agglomération Saint Brieuc Armor Agglomération. Le territoire communal est limitrophe des communes de Tréveneuc au nord, de Plourhan à l’ouest et d’Etables-sur-Mer au sud. -

SERVICES TECHNIQUES À La Mairie Sommaire N
MARS 2019 - N° 487 Focus sur les SERVICES TECHNIQUES à la mairie sommaire n INFOS MAIRIE p. 2-5 INFOS AGGLO p. 6-7 VIVRE SA VILLE p. 7-9 DOSSIER p. 10-11 Focus sur les Services Techniques CULTURE p. 12-13 VIE ASSOCIATIVE p. 13-17 EXPRESSION LIBRE p. 18 VIE DES ÉCOLIERS p. 19 LE MOT EN GALLO p. 20 VITRINES/PETITES ANNONCES p. 20 LE PLÉDRANAIS : Diffusion 3 150 exemplaires Directeur de publication : Stéphane BRIEND Membres de la Commission Communication : Olivier COLLIOU, Jean-Marie MOUNIER, Marie-Ange BOURSEUL, Laurence LUCAS, Maryse ECOLAN, Jean-Marc GRABOWSKI, Daniel ETESSE (suppléant), REMISE DES ARTICLES : Daniel TANGUY, Alexandre TAILLARD, Lydie LE GLATIN (référente mairie) en mairie ou par courriel : [email protected] Maquette & Rédaction : n Plédranais d'avril 2019 Mairie de Plédran, service communication - 02 96 64 34 29 au plus tard le mercredi 20 mars dernier délai. Réalisation et Impression : Communicolor - Plédran - 02 96 42 24 85 Distribution à partir du 23 avril Crédits photos : n Mairie de Plédran, Associations, Alphonse LE GLATIN Plédranais de mai 2019 Régie publicitaire : Communicolor Plédran au plus tard le mercredi 24 avril dernier délai. Distribution : Mairie de Plédran - www.pledran.fr Distribution à partir du 21 mai Tél. 02 96 64 34 20 • ISSN 1291-1852 ABONNEMENT pour les non Plédranais : RAPPEL : Tout article remis en mairie après la date indiquée E à chaque numéro du Plédranais ne pourra être publié. 18,90 pour 10 numéros. Contactez la Mairie. Ceci afin de respecter les délais de fabrication et de distribution. 1 n infos mairie Conseil municipal du 26 février 2019 PROGRAMME LOCAL DE SUBVENTIONS 2019 des permanences, ou se structurer dans L’HABITAT 2019-2024 Le conseil municipal, après en avoir un lieu où elles puissent stocker du Le Conseil municipal décide d’émettre un délibéré, décide d’accorder les subven- matériel ou des dossiers. -

Ville Centre : Son Nouveau Visage Se Dessine
n°2 Sep-Oct-Nov17 ÉCONOMIE p. 5 ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR p. 8 La Fnac ouvre L’Agglo fête aux Champs ses étudiants le 5 octobre Dossier p. 15 à 21 Ville centre : son nouveau visage se dessine 2 Binic - Étables-sur-Mer - Hillion - La Harmoye - La Méaugon - Lanfains - Langueux - Lantic - Le Bodéo - Le Fœil - Le Leslay - Le Vieux-Bourg - Plaine-Haute - Plaintel - Plédran - Plérin - Plœuc-L’Hermitage - Ploufragan Poursuivre ensemble la construction intercommunale “au service des communes et du territoire En raison de la loi sur le non- de” la population ; au service d’une dyna- cumul des mandats et suite mique d’aménagement, de développe- à son élection en tant que ment et de rayonnement de l’ensemble Député des Côtes d’Armor, du territoire désormais réuni. Je sais que la constitution de Saint-Brieuc Bruno Joncour, Président Armor Agglomération a représenté pour de Saint-Brieuc Armor lui un véritable défi qu'il a su relever Agglomération depuis avril avec volontarisme et détermination dans l'intérêt commun et dans un réel esprit 2014, a dû démissionner de collectif. ses fonctions le 12 juillet. Saint-Brieuc Armor Agglomération se situe au croisement de plusieurs his- Je tiens à rendre hommage à Bruno toires, de constructions intercommunales Joncour qui a contribué activement patientes et enracinées dans les terri- à façonner l'histoire que nous conti- toires, fruit du travail des élus depuis de nuons d'écrire ensemble, celle qui longues années, regroupant désormais concerne un territoire constitué de l’espace urbain, la réalité rurale et la 32 communes, comportant plus de dimension littorale. -

SAINT-QUAY-PORTRIEUX Rapport D'enquête
Enquête Publique 18000184 / 35 PREFECTURE DES COTES D’ARMOR Commune de SAINT QUAY PORTRIEUX Mise en conformité de la station d’épuration ____________________________________ Enquête publique du 20 août 2018 au 14 septembre 2018 I - RAPPORT D’ENQUÊTE Maryvonne MARTIN Commissaire enquêteur SAINT QUAY PORTRIEUX : enquête publique concernant les travaux de mise en conformité de la station d’épuration et de son réseau de collecte desservant Saint-Quay-Portrieux, Tréveneuc et le secteur nord-est de Plourhan Rapport d’enquête Ref : 18000184 / 35 I – RAPPORT D’ENQUÊTE SOMMAIRE 1 GENERALITES ……………………………………………………………………………………………….…………….. 4 1.1. Objet de l’enquête 1.2. Autorité organisatrice de l’enquête 1.3. Cadre juridique de l’enquête 2 ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE ……………….…………………… 6 2.1. Phase préparatoire de l’enquête 2.2. Déroulement de l’enquête 2.3. Information du public 2.4. Publicité de l’enquête 2.5. Participation du public 2.6. Visites pendant l’enquête publique 2.7. Clôture de l’enquête 3 DESCRIPTION DU PROJET ……………………………………………………………………………………………. 11 3.1. Fonctionnement d’une station à boues activées 3.2. Paramètres de performances d’une station d’épuration 3.3. Description de la structure d’assainissement existante 3.4. Description du nouveau système de collecte et de traitement des eaux usées 3.5. Maîtrise foncière des terrains 4. IMPACS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ………………………………..……………………………..17 4.1. Qualité des eaux 4.2. Qualité de l’environnement humain 4.2.1. Le bruit 4.2.2. Les odeurs 4.2.3. Les Impacts visuels 4.2.4. Les sous-produits : boues et divers 5. -

Mag. - Plourhan - Numéro 31 - 2E Trimestre 2018 ACTIONS 03 La Vie Communale
Plourhan Magazine d’information Numéro 31 Mairie de Plourhan 2e trimestre 2018 le mag> plourhan.fr . 31 8 - 9 > DOSSIER BUDGET 2018 DES INVESTISSEMENTS ATTENDUS 03 > ACTIONS 07 > ACTIONS 10 > ACTIONS Travaux à la Mairie, une Rencontres au cœur Suivi beauté pour la centenaire des quartiers de travaux 31. Edito Voilà l’été, voilà l’été !... “ Nous entrons dans la période des vacances estivales et je souhaite le qu’elles vous soient profitables, SOMMAIRE Plourhan mag reposantes et enrichissantes.” Édito ACTIONS 03 Loïc Raoult Avec ce magazine d’été, vous allez pouvoir faire un Maire de Plourhan Une beauté pour la centenaire bref retour sur les évènements de début d’année tous ACTIONS 04 / 07 marquants pour notre commune. Après votre regard en L’œil dans le rétro arrière, nous vous invitons à vous tourner vers l’avenir, et découvrir tous les Bienvenue sur le réseau TUB projets, programmes et animations qui vous attendent. Rencontres au cœur des cartiers DOSSIER 08 / 09 Cet avenir, nous en échangeons régulièrement avec vous et nous avons Un budget, pour le bien vivre l’occasion d’en débattre vendredi 6 juillet (à 18 h 30 à la salle des fêtes) à Plourhan lors d’une réunion ouverte à tous ou d’en échanger lors des visites organisées ACTIONS 10 dans les quartiers. Suivi de travaux ACTIONS 12 Le dossier de ce magazine est consacré au budget de la commune. Voté La vie communale côté jeunesse fin mars, il nous permet de lancer deux projets de travaux d’envergure pour Plourhan : l’aménagement des entrées de bourg et le réaménagement de la VIE QUOTIDIENNE 13 Changement au Tabac presse mairie, avec notamment son accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. -

Liste Des Communes Et EPCI
Liste alphabétique des communes Etablissement public de coopération intercommunale à Commune Arrondissement fiscalité propre Commune nouvelle Allineuc Saint-Brieuc Loudéac Communauté – Bretagne Centre Andel Saint-Brieuc Lamballe Terre et Mer Aucaleuc Dinan Dinan Agglomération Beaussais sur Mer ( fusion de Trégon, Plessix-Balisson,Ploubalay) Dinan Communauté de communes Côtes d’Emeraude Bégard Guingamp Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération Belle-Isle-en-Terre Guingamp Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération Berhet Lannion Lannion-Trégor Communauté Binic-Etables sur Mer ( fusion de Binic et Etables sur Mer) Saint-Brieuc Saint-Brieuc Armor Agglomération Bobital Dinan Dinan Agglomération Bon repos sur Blavet ( fusion de Saint- Gelven Perret et Laniscat) Guingamp Communauté de communes du Kreiz Breizh Boqueho Guingamp Leff Armor Communauté Bourbriac Guingamp Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération Bourseul Dinan Dinan Agglomération Bréhand Saint-Brieuc Lamballe Terre et Mer Brélidy Guingamp Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération Bringolo Guingamp Leff Armor Communauté Broons Dinan Dinan Agglomération Brusvily Dinan Dinan Agglomération Bulat-Pestivien Guingamp Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération Calanhel Guingamp Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération Callac Guingamp Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération Calorguen Dinan Dinan Agglomération Camlez Lannion Lannion-Trégor Communauté Canihuel Guingamp Communauté de communes du Kreiz Breizh Caouënnec-Lanvézéac Lannion Lannion-Trégor Communauté Carnoët Guingamp -

Printempsdd Programme 2020
credit photos PRINTEMPS DU DD - ÉDITION 2020 BIODIVERSITÉ, ZÉRO-PHYTO, MILIEU VÉGÉTAL... DIMANCHE Randonnées, ateliers, visites... rencontres... De nombreuses 5 AVRIL animations sont proposées Randonnée sur tout le territoire. à la découverte de la biodiversité Cette boucle de randonnée d’environ 6 kms est jalonnée de rencontres avec des spécialistes de la biodiversité. Qu’ils soient botaniste ou ornithologue, ils vous accompagnent découvrir les oiseaux, les insectes et les plantes et vous parlent aussi du cycle de l’eau, des zones humides et du milieu marin. Et ne manquez pas, au retour, la visite chez un producteur de Safran. 4 temps forts La randonnée se fait au départ de la salle des fêtes de Plourhan sur le thème de pour rejoindre, par les chemins, la plage du Moulin à la biodiversité. Étables-sur-Mer. SAM. SAM. DIM. DIM. LIEU Plourhan Départ de la salle des fêtes de Plourhan Ligne de bus → Binic-Étables-sur-Mer, Plourhan XXX → Hillion, Langueux, Trégueux, Yffiniac Sur inscription → Lanfains, Le Fœil, Plaine-Haute, Quintin, Saint-Brandan, Saint-Carreuc HORAIRE : 9h → La Méaugon, Plérin, Ploufragan, Inscriptions obligatoires / Places limitées Saint-Brieuc, Trémuson à 30 personnes. Prévoir des chaussures de marche. CONTACT Mairie de Plourhan : 02 96 71 94 34 - [email protected] Mairie de Binic-Etables-sur-Mer : 02 96 70 64 18 - [email protected] DIMANCHE 26 AVRIL SAMEDI De bric et de bio, végétal 25 AVRIL total, zéro-phyto mon héros SAMEDI Un jardin ressource La journée débutera par une randonnée pédestre au service de la biodiversité d’environ 8 km, organisée par l’association « Un pied 18 AVRIL devant l’autre ». -

Commune De Ploufragan
Département des Côtes d’Armor Arrondissement de Saint-Brieuc COMMUNE DE PLOUFRAGAN EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JUILLET 2017 Convocation du 5 juillet 2017 Compte-rendu affiché le 12 juillet 2017 L'an deux mille dix-sept, le onze juillet, à 19h00, le Conseil Municipal de la commune de PLOUFRAGAN s'est réuni en session ordinaire, à l’hôtel de ville, après convocation légale, sous la présidence de M. Rémy MOULIN, Maire. PRESENTS : Rémy MOULIN, Bruno BEUZIT, Pascale GALLERNE, Jean-Pierre STEPHAN, Marie- Françoise DUPLENNE, Jacques BLANCHARD, Annie LABBE, Gilles LELIONNAIS, Laurence ANDRE, Jean-Paul LE MEE, Michel JUHEL, Annick MOISAN, Yann LE GUEDARD, Anita MELOU, Claire BRASSIER, Anthony DECRETON, Patrick LE HO, Viviane BOULIN, Vincent BOUGOT, Anne-Laure LE BELLEGO, Jean-Pierre HAMON, Marie-Hélène CORDUAN ABSENTS : Christine ORAIN-GROVALET (donne pouvoir à Annie LABBE) Maryse LAURENT (donne pouvoir à Pascale GALLERNE) Patrick COSSON (donne pouvoir à Jean-Paul LE MEE) Annie REY (donne pouvoir à Claire BRASSIER) Evelyne NEJJARI (donne pouvoir à Bruno BEUZIT) Hélène QUEMARD (donne pouvoir à Anne-Laure LE BELLEGO) Paul PERSONNIC (donne pouvoir à Jean-Pierre HAMON) Pierre Jean SALAUN (donne pouvoir à Marie-Françoise DUPLENNE) Jean-Yves BERNARD (donne pouvoir à Marie-Hélène CORDUAN) Gabrielle GOUEDARD (excusée) Martial COLLET (excusé) SECRETAIRE DE SEANCE : Jacques BLANCHARD Membres en exercice : 33 Présents : 22 Votants : 31 1 - ADMINISTRATION GENERALE 2017-576 ACCUEIL MUTUALISÉ : CHARTE D’ADHÉSION AU SERVICE DE GESTION ELECTRONIQUE DE DOCUMENTS (SGED) DU CONSEIL DEPARTEMENTAL M. BEUZIT explique qu’il est prévu de mettre en place un système d’accueil mutualisé entre le Conseil Départemental des Côtes d’Armor, Saint-Brieuc Armor Agglomération et les communes constituant l’agglomération sous la forme d’une information mutualisée et le partage de fiches de connaissance. -

Saint-Brieuc Terre Et Mer
Maison du Département CLIC de Saint-Brieuc Terres et Mer Centre Local d'Information et de Coordination Un service gratuit pour les personnes âgées de plus de 60 ans et leur entourage > “Suis-je assez valide pour > “Quelles sont les aides ? rester en sécurité à mon Combien cela coûte-t-il ?” domicile ?” > “Si les ressources sont insuf- > “Qui peut m’aider chez moi ?” fisantes, quelles sont les > “Le logement de papa n’est obligations familiales ?” plus adapté à son handicap. > « Je suis l’aidant principal de Que puis-je faire ?” mon conjoint, je suis épuisé, > “À qui s’adresse-t-on ?” quelles sont les aides pos- ? sibles ? » > “Maman ne peut rester à la maison… Quelles solutions peuvent lui être offertes sur le Un lieu ressource pour secteur ?” les professionnels Le CLIC, qu’est-ce que c’est ? C’est un Centre Local d’Information et de Coordination. Vous pouvez y rencontrer gratuitement un interlocuteur pour : > vous conseiller et vous aider à trouver des solutions > vous présenter l’offre de service existante Les valeurs du CLIC > vous informer sur • les aides? financières confidentialité • les structures d’hébergement neutralité • les services à domicile • l’adaptation du logement... > vous accompagner dans vos démarches administratives, la prise de contact avec les professionnels, la mise en place des services... Le CLIC est également le relais de la Maison Départementale des Personnes en situation de Handicap (MDPH) pour les + de 55 ans. Le territoire couvert par le CLIC de Saint-Brieuc Terres et Mer Tréveneuc St-Quay-Portrieux Plourhan Binic-Étables -sur-Mer Lantic Coordination personnes âgées CCAS Saint-Brieuc Pordic Tél. -
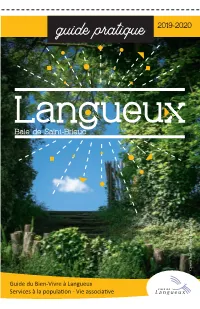
Mairie De Langueux
guide pratique 2019-2020 u u u u Langueux Baie de Saint-Brieuc u u u u Couverture ©Philippe Boulenger Boulenger ©Philippe Couverture Guide du Bien-Vivre à Langueux Services à la population - Vie associative édito Madame, Monsieur, En ce début de saison 2019-2020, le Guide Pratique fait aussi sa rentrée. J’ai ainsi le plaisir de vous présenter sa 20e édition. Ce guide a pour objectif de faciliter le quotidien des Langueusiennes et Langueusiens, chaque jour de l’année. Il sera également très utile à celles et ceux qui, au cours de l’année, choisiront la Ville de Langueux pour s’y installer. Vous y glanerez toutes les informations pratiques sur les services municipaux et la sommaire vie locale, les coordonnées des associations, Langueux, fiche d’identité 4 les numéros utiles, les permanences de vos élus… La Mairie à votre service 10 N’hésitez-pas à nous faire part de vos Déchets, mode d’emploi 14 demandes et suggestions ; les élus et les services de Langueux sont à votre disposition. Enfance-Jeunesse 18 Je vous souhaite à toutes et à tous une Action sociale 24 bonne rentrée ! 28 Vie culturelle Thérèse Jousseaume Maire de Langueux Associations 32 Vice-Présidente de Saint-Brieuc Infos pratiques 38 Armor Agglomération Crédit photos : Philippe Boulenger - Mairie de Langueux 3 fiche d ’identité 7 919 habitants Économie (chiffres INSEE janvier 2019) La commune fut autrefois renommée Territoire de 903 ha pour ses cultures maraîchères et Le canton de Trégueux regroupe particulièrement celle de l’oignon. Le 25 600 habitants avec les communes de travail de la terre perdure mais l’économie Langueux, Hillion et Yffiniac.