« Caen, Ville Héroïque Et Martyre »
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Télécharger Le Dossier Pratique
Contexte historique Historical background Avec l’invasion de la Pologne le 3 septembre 1939, commence It was the invasion of Poland, on September 3rd, 1939, that preci- la seconde guerre mondiale. Rapidement les forces du Reich sub- pitated World War II. The forces of the IIIrd Reich swiftly engulfed mergent toute l’Europe et en l’espace de 2 ans les drapeaux de the whole of mainland Europe and within two years the flags of the l’Axe1 flottent sur tout le continent. Axis Powers5 were floating above the whole of the continent. Britain Seul bastion de défense, la Grande Bretagne, est la première à was the last remaining bastion of defence, the first country to stop stopper les forces du Reich dans une terrible bataille qui se joue the forces of the Reich in their tracks, in a terrible battle fought in dans les airs. the skies. 7 décembre 1941 : les Etats Unis basculent dans la guerre. On December 7th, 1941, the United States also went to war. In 1942 sonne le glas des victoires allemandes avec la défaite infli- 1942, the bell began to toll for the Germans, when the gée au renard du désert2 à El Alamein. “Desert Fox” 6suffered a resounding defeat at El Alamein. Dès 1943, les allemands font retraite sur tous les fronts. Au début By 1943, the Germans were retreating on all fronts. In the early de l’année 1944 la situation semble bloquée : les Russes attendent months of 1944, the war had reached stalemate : the Russians le printemps pour reprendre leur offensive et les Anglo-américains were waiting for spring to resume their offensive, while the British ne progressent que très lentement et avec d’énormes difficultés and Americans were advancing painfully slowly in Italy, encountering en Italie. -

Charles De Gaulle, 1940-1944
DE GAULLE, COUDENHOVE-KALERGI, LES GAULLISTES ET L’EUROPE Comité scientifique Colloque organisé par Jean-Paul Bled, Christine Manigand, Gilles Le Béguec, Frédéric Fogacci la Fondation Charles de Gaulle, le LabEx EHNE (axe 2) Secrétariat du colloque et l’Université Paris III-Sorbonne Nouvelle (ICEE) Sophie Di Folco 01 44 18 66 73 [email protected] Jeudi 28 janvier 2016 Sénat – Palais du Luxembourg Salle Monnerville 15 ter, rue de Vaugirard – 75006 Paris JEUDI 28 JANVIER 2016 JEUDI 28 JANVIER 2016 9h15 : Accueil des participants par Jean Bizet, Président de la commission des Affaires européennes du Sénat 09h25 : Introduction par Jacques Godfrain, ancien ministre, Président de la Fondation III. LE COMITÉ FRANÇAIS DE L’UNION PANEUROPÉENNE, LIEU DE CONTACT ET DE DIALOGUE Charles de Gaulle Présidence : Gilles Le Béguec (Président du Conseil scientifique, Fondation Charles de Gaulle) I. LA PENSÉE EUROPÉENNE DE COUDENHOVE-KALERGI 14h15 : Le groupe Union Démocratique européenne, Cédric Francille (Chargé de Recherche, Présidence : Tristan Lecoq (IGEN, Professeur associé à l’Université Paris-Sorbonne) Association Georges Pompidou) et Christine Manigand (Professeur, Université Paris III, Association Georges Pompidou) 14h40 : Raymond Triboulet, Président du Comité français, Serge Berstein (IEP de Paris) 09h30 : L’idée de Pan-Europe, Jean-Paul Bled (Professeur émérite, Université Paris- Sorbonne) 15h05 : Témoignage d’André Fanton, ancien ministre, ancien membre du Parlement européen, et de Gérard Bokanowski, ancien secrétaire général du groupe UDE. 09h55 : L’Europe de Coudenhove-Kalergi, un projet alternatif à celui de Jean Monnet, Olivier Gohin (Professeur, Université Paris II-Assas) 10h20 : Témoignage de Bernard Dorin, Ambassadeur de France IV. LES RÉSEAUX GAULLISTES EN EUROPE Discussion 15h45 : La Belgique et les réseaux du Président Struye, Baron Francis Delpérée, sénateur II. -
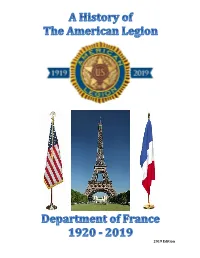
To View Expanded Department of France History
2019 Edition A Message from National Commander Brett P. Reistad The American Legion’s story begins in the Department of France. It was here in the months following the armistice of Nov. 11, 1918, where members of the American Expeditionary Forces waited to re-enter an uncertain future, having fought with their lives to make, as President Woodrow Wilson pledged, the world “safe for democracy.” The cost of fulfilling that pledge can be calculated in many ways, foremost of which is the number of Americans – more than 117,000 – who gave their lives to fulfill it. The enduring benefit of accomplishing such a deadly and difficult mission was a stronger America, a nation that would become revered worldwide as a beacon of hope, liberation and international integrity. When Lt. Col. Theodore Roosevelt, Jr., called three other officers to Paris in January 1919 to discuss the future ahead for America, they did so with the cost of war fresh on their minds. On that occasion, and in a follow-up gathering the next month, they made a commitment that wartime U.S. veterans worldwide would spend the next century fulfilling – to make America stronger, to honor the fallen, to preserve and protect the hard-won peace and to “cement the ties of comradeship” forged in battle. From the Paris Caucus of March 15-17, 1919, through establishment of overseas Memorial Day commemorations and the American Battle Monuments Commission, to the inception of an international coalition of wartime veterans – Federation Interalliee des Anciens Combatants – that laid a foundation later adopted in many ways through NATO, the early American Legion in France built and nurtured respect and understanding of the United States that continues today. -

UN GAULLISTE DE LA Ive
HENRI AMOUROUX UN GAULLISTE DE LA IVe u début de son livre, Un gaulliste de la IVe (1), Ray- xV mond Triboulet écrit : « J'étais fort jeune et absolu. » L'âge est venu. Triboulet n'a pas renoncé à cet absolu du caractère, à cette intrépidité du jugement, à cette confiance en soi, responsables aujourd'hui d'un livre plein de feu et de passion, d'un livre adolescent, mené comme une charge de cavalerie, sans ces précautions qui rendent si ennuyeux à lire les Mémoires de certains hommes politiques, avec leur cortège de faux compli• ments et leur bric-à-brac de poignards dissimulés sous les fleurs. Triboulet aime ou n'aime pas, mais du moins sait-on très vite où vont les préférences de cet homme engagé très tôt dans l'action, qu'un hasard — l'achat, en 1926, d'une ferme dans la plaine de Caen — allait placer au cœur de l'un des plus grands moments du siècle, mais qui, de toute façon, aurait abordé la vie politique pour y faire carrière et y réussir sans renoncer à son ton, son caractère, sa philosophie. « Ma vie politique, qui peut intéresser l'Histoire, note Tri• boulet, s'est nouée à Bayeux en juin 1944. » Seul fonctionnaire préfectoral dans la tête de pont du débarquement, mais fonction• naire de circonstance, né de la Résistance ; recevant tous ceux qui, après tant d'années d'exil, arrivaient pour fouler le sol de France ; ayant à traiter avec des Américains et des Anglais qui ne s'embar• rassaient pas des querelles françaises et désiraient, en face d'eux, des interlocuteurs dont la couleur politique leur importait peu ; devant régler les mille et un problèmes de vie quotidienne qui se 0) Pion, 346 p. -

University Microfilms, Inc., Ann Arbor, Michigan (£) Copyright By
This dissertation has bean microfilmedexactly as r e c e iv e d 68—8882 SMITH, Thomas Alexander, 1936- y L'UNION POUR LA NOUVELLE REPUBLIQUE: GAULLISM IN THE FIFTH REPUBLIC. The Ohio State University, Ph.D.t 1967 Political Science, general University Microfilms, Inc., Ann Arbor, Michigan (£) Copyright by Thomas Alexander Smith 1966 L'UNION POUR LA NOUVELLE REPUBLIQUE: GAULLISM IN THE FIFTH REPUBLIC DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By Thomas Alexander Smith, B.A., A.M. ****** The Ohio State University 1967 Approved by U Adviser Department of Political Science ACKNOWLEDGMENT S At this time I would like to acknowledge a debt to several individuals who have contributed so much to this work. First, to the late Professor Edgar S. Furniss whose deep Insight into the workings of the French polity aided me Immeasurably in my attempts to understand the nature of the UNB. and its role in the Fifth Republic. His encouragement and friendship will never be forgotten. Secondly, to Professor James A. Robinson who agreed to supervise the completion of the dissertation after Professor Furniss*s tragic death, and to Professor Andrew Axllne who painstakingly read the dissertation and whose comments were so helpful 1 am extremely grateful. Thirdly, to my wife, Camille, who never lost faith in the project and who laboriously typed the initial draft of this dissertation, I can never repay in full the debt. It is to her and the memory of Professor Furniss that I humbly dedicate this study. -

Trophies, Awards Ceremonials Manual
TROPHIES, AWARDS & CEREMONIALS MANUAL PUBLISHED FOR THE 2021 SPRING NATIONAL EXECUTIVE COMMITTEE MEETINGS 1 TROPHIES & AWARDS Presented By The NATIONAL ORGANIZATION OF THE AMERICAN LEGION Prepared By: Internal Affairs Commission National Headquarters, The American Legion Indianapolis, Indiana 2021 EDITION The recipients listed in this manual are for member year 2020. The 2021 recipients will be listed in the 2022 edition. 2 TROPHIES AND AWARDS TABLE OF CONTENTS TROPHIES AND AWARDS POLICIES AND PROCEEDURES 05 THE AMERICAN LEGION DISTINGUISHED SERVICE MEDAL 09 AMERICANISM AWARDS American Legion Baseball Graduate of the Year 13 Bob Feller American Legion Pitching Award 15 Commissioner of Baseball Trophy 17 Dr. Irvin L. “Click” Cowger Memorial R.B.I. Award 19 The Ford C. Frick Trophy 21 Frank N. Belgrano, Jr. Trophy 23 George W. Rulon Baseball Player of the Year 25 The Howard P. Savage, Junior Baseball Trophy 27 Jack Williams Memorial Leadership Award 29 James F. Daniel, Jr. Memorial Sportsmanship Award 33 The American Legion Junior Shooting Sports Trophy 35 The American Legion Baseball Slugger Trophy 39 Ralph T. O’Neil Education Trophy 41 The American Legion Baseball “Big Stick” Award 43 Spafford National Trophy 45 Francis M. Redington Sportsmanship Award 47 Daniel J. O’Connor Americanism Trophy 49 The American Legion and Scouting “Square Knot” Award 51 The American Legion Eagle Scout of the Year 57 The American Legion National Education Award 59 INTERNAL AFFAIRS AWARDS The American Legon Canadian Friendship Award 61 The International Amity -

Copyright by Mark Spencer Stephens 2004
Copyright by Mark Spencer Stephens 2004 The Dissertation Committee for Mark Spencer Stephens Certifies that this is the approved version of the following dissertation: A Supranational Elite Theory of Neofunctionalist European Integration Committee: John Higley, Supervisor Zoltan Barany Cynthia Buckley Gary Freeman H.W. Perry A Supranational Elite Theory of Neofunctionalist European Integration by Mark Spencer Stephens, B.A. Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School of The University of Texas at Austin in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy The University of Texas at Austin May, 2004 For my parents, Robert and Sandra Stephens Better folks than anyone deserves Acknowledgements I sincerely thank all who assisted me in this project. Your patience and support were critical to this venture’s completion. In particular, Professor Higley must be thanked for taking the time out of his immensely busy schedule to edit my drafts so helpfully. I apologize for any hand cramps he may have suffered. My good friends, Cathy, MaryJane, and the Schwengs, have helped to maintain my determination to finish. The odysseys of JW and AD have also inspired me to persevere. I also thank the Department of French and Italian for allowing me to audit some courses. Above all, my parents must receive special thanks. Without their generous assistance, this project would have been impossible. v A Supranational Elite Theory of Neofunctionalist European Integration Publication No._____________ Mark Spencer Stephens, PhD The University of Texas at Austin, 2004 Supervisor: John Higley Abstract: The national states of Europe are eliminating themselves. -
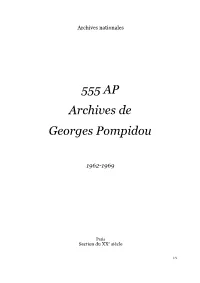
555 AP Archives De Georges Pompidou
Archives nationales 555 AP Archives de Georges Pompidou 1962-1969 Paris Section du XXe siècle 1/9 1996, 2007 2/9 Georges Pompidou, Premier ministre et homme politique Inventaire analytique des archives remises par la famille Pompidou (1962-1969) 555 AP Ce fonds est principalement composé de feuilles sur lesquelles sont inscrits les heures d’audiences et l’emploi du temps de Georges Pompidou, à raison d’une fiche par jour du lundi au samedi, à l’exception de quelques journées pour lesquelles ne figure que l’emploi du temps de la matinée ou de l’après-midi. Sont jointes à ces feuilles des notes de Georges Pompidou, des notes et lettres à lui adressées, des coupures de presse et quelques pièces diverses. On a rattaché aux documents relatifs aux quatre gouvernements Pompidou (avril 1962-juillet 1968) les feuilles d’audiences comprises entre le 10 juin 1968 (démission du quatrième gouvernement Pompidou) et le 19 juin 1969 (proclamation de Georges Pompidou, président de la République). Le présent inventaire adopte un ordre de classement méthodique, tandis que les documents forment matériellement une suite chronologique. Métrage linéaire : 1 ml. Consultation sur autorisation : demande à adresser aux Archives nationales, section du XXe siècle. Reproduction sur autorisation : demande à adresser aux Archives nationales, section du XXe siècle. Sources complémentaires : les archives de Georges Pompidou et de ses collaborateurs versées par la présidence de la République et l’Association Georges-Pompidou sont consultables sur le site internet des Archives nationales (http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/). On y trouvera une bibliographie et un état des sources complémentaires. -

Deportation, Genocide, and Memorial Politics: Remembrance and Memory in Postwar France, 1943-2015
University of Central Florida STARS Electronic Theses and Dissertations, 2020- 2021 Deportation, Genocide, and Memorial Politics: Remembrance and Memory in Postwar France, 1943-2015 Rachel Williams University of Central Florida Part of the Cultural History Commons, Jewish Studies Commons, and the Public History Commons Find similar works at: https://stars.library.ucf.edu/etd2020 University of Central Florida Libraries http://library.ucf.edu This Masters Thesis (Open Access) is brought to you for free and open access by STARS. It has been accepted for inclusion in Electronic Theses and Dissertations, 2020- by an authorized administrator of STARS. For more information, please contact [email protected]. STARS Citation Williams, Rachel, "Deportation, Genocide, and Memorial Politics: Remembrance and Memory in Postwar France, 1943-2015" (2021). Electronic Theses and Dissertations, 2020-. 783. https://stars.library.ucf.edu/etd2020/783 DEPORTATION, GENOCIDE, AND MEMORIAL POLITICS: REMEMBRANCE AND MEMORY IN POSTWAR FRANCE, 1943-2015 by RACHEL L. WILLIAMS B.A. University of Central Florida, 2014 A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in the Department of History in the College of Arts and Humanities at the University of Central Florida Orlando, Florida Summer Term 2021 Major Professor: Amelia H. Lyons © 2021 Rachel L. Williams ii ABSTRACT This thesis examines how the remembrance of deportation from France during the Second World War impacted the creation of two memorials in Paris in the postwar years. The two memorials, located just over 500 meters apart in the center of Paris and inaugurated within seven years of one another, physically embody each of these narratives. -

The Making of Algerian War Veterans in France, 1956-1974
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Carolina Digital Repository HOME FROM THE DJEBEL: THE MAKING OF ALGERIAN WAR VETERANS IN FRANCE, 1956-1974. ANNDAL NARAYANAN A dissertation submitted to the faculty at the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctorate of Philosophy in the History Department. Chapel Hill 2016 Approved by: Donald Reid Konrad Jarausch Lloyd Kramer Wayne Lee Daniel Sherman ©2016 Anndal Narayanan ALL RIGHTS RESERVED ii ABSTRACT Anndal Narayanan: Home from the Djebel: the making of Algerian War veterans in France, 1956-1974. (Under the direction of Donald Reid.) This dissertation examines the return experiences of French veterans of the Algerian War of Independence (1954-1962), focusing on the movement they created and its activism. Service in the Algerian War affected over one million Frenchmen during a period of rapid modernization in France, but these citizens would go unrecognized as veterans by their government for over a decade after the war’s end. Analyzing veterans’ return experiences, memory, and activism helps us understand the political consequences of the Algerian War in postcolonial French society—how the generation of soldiers who fought a “war without a name” brought the war back home. Drawing on state archives, veterans’ association archives, press coverage, and interviews and surveys of veterans, this dissertation finds that long before the French state deigned to recognize them or their war, veterans of Algeria were already politically active, as veterans and as citizens—both to promote their group interests, and to reshape French society based on lessons they drew from the war. -
'Brave Little Israel' To
From ‘Brave Little Israel’ to ‘an Elite and Domineering People’: The Image of Israel in France, 1944-1974 by Robert B. Isaacson B.A. in Jewish Studies, May 2011, The Pennsylvania State University M.A. in History, May 2015, The George Washington University A Dissertation submitted to The Faculty of The Columbian College of Arts and Sciences of The George Washington University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy May 21, 2017 Daniel B. Schwartz Associate Professor of History The Columbian College of Arts and Sciences of The George Washington University certifies that Robert Brant Isaacson has passed the Final Examination for the degree of Doctor of Philosophy as of March 2, 2017. This is the final and approved form of the dissertation. From ‘Brave Little Israel’ to ‘an Elite and Domineering People’: The Image of Israel in France, 1944-1974 Robert B. Isaacson Dissertation Research Committee: Daniel B. Schwartz, Associate Professor of History, Dissertation Director Katrin Schultheiss, Associate Professor of History, Committee Member Jeffrey Herf, Distinguished University Professor, The University of Maryland, Committee Member ii © Copyright 2017 by Robert B. Isaacson All rights reserved iii Dedication This work is dedicated to my family, whose unflagging love, patience, and support made this dissertation possible in a myriad ways. iv Acknowledgments I wish to acknowledge the many individuals and organizations that have helped to make this dissertation possible. I wish to extend my gratitude to the American Academy for Jewish Research for providing an AAJR Graduate Student Travel Grant (2015), and to the Society for French Historical Studies for its Marjorie M. -
The Challenge of Guinean Independence, 1958-1971
THE CHALLENGE OF GUINEAN INDEPENDENCE, 1958-1971 by Mairi Stewart MacDonald A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Graduate Department of History University of Toronto © Copyright by Mairi Stewart MacDonald, 2009 THE CHALLENGE OF GUINEAN INDEPENDENCE, 1958-1971 Doctor of Philosophy, 2009 Mairi Stewart MacDonald Graduate Department of History, University of Toronto Abstract Since the end of French colonial rule in Guinea, “independence” has held a central place in its political culture. Implying both dignity and self-determination for the sovereign people which possesses it, independence is a concept that has meaning only in relation to other nation-states and cultures. Yet the political elite that dominated Guinea’s First Republic constructed a new national culture around this concept. The Challenge of Guinean Independence, 1958-1971 examines Guinea’s assertion of its right to independence and the response of powerful Western players, especially the United States and France, as Guinea challenged their assumptions about the nature of African sovereignty. Considering the history of the international relations of a single African state that enjoyed limited international power and prestige challenges conventions in the historiography of both Africa and international relations. It illuminates and contextualizes expectations concerning the meaning of modernity, African sovereignty as a matter of international law, and the end of formal colonial rule coinciding with the tensions and competitions of the Cold War. The study demonstrates that the international context played a crucial role, both in conditioning the timing and form of decolonization and in shaping the international community’s adaptation of colonial patterns of economic and political interaction to the new reality of African nation-states.