Surveillance Numérique*
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Affaire Kohler: Le Rôle Du N°2 De L’Elysée (Agence Des Participations De L’État – APE –, Direction Générale Du Trésor – DGT)
Directeur de la publication : Edwy Plenel www.mediapart.fr 1 opaque du ministère des finances et de ses épigones Affaire Kohler: le rôle du n°2 de l’Elysée (Agence des participations de l’État – APE –, Direction générale du Trésor – DGT). dévoilé par des courriels de Bercy PAR MARTINE ORANGE ARTICLE PUBLIÉ LE JEUDI 25 JUIN 2020 Alexis Kohler le mercredi 24 juin à l’Élysée. © Ludovic Marin / AFP Le ministère des finances. © Amaury Cornu / AFP Contrairement à ce qu’il a toujours affirmé, Alexis Un ministère où son immensité, ses couloirs sans Kohler a pu, dans toutes les fonctions qu’il a exercées fin, ses recoins ignorés autorisent la constitution de au ministère des finances de 2008 à 2016, garder petits clans autour de personnages puissants mais l’œil et même intervenir sur les dossiers intéressant agissant toujours dans l’ombre, d’une techno-structure l’entreprise MSC, à laquelle il est lié familialement. qui agit en toute impunité, bien loin de l’image de La situation n’a cessé d’intriguer les enquêteurs de la l’intérêt général dont elle aime à se draper, prenant des Brigade de répression de la délinquance économique décisions parfois biaisées. En mettant en avant, quand (BRDE). Au point qu’ils ont fini par l’inscrire en cela est nécessaire pour se couvrir, « le ministre ». gras au détour d’un acte de leur procédure : Alexis Tout prouve combien le dossier STX-MSC a été un Kohler a-t-il été nommé administrateur au conseil dossier à part, faisant l’objet d’une gestion parallèle, de STX France (renommé Chantiers de l’Atlantique) occulte. -

Les Possibles - No
Les Possibles - No. 26 Hiver 2020-2021 Introduction : Le monde est notre commun, à tous les vivants mardi 15 décembre 2020, par Jean-Marie Harribey Pour introduire ce numéro des Possibles, commençons par rouvrir Les structures élémentaires de la parenté de Claude Lévi-Strauss [1], et retrouvons quelques-unes des maximes ou aphorismes qu’il met en exergue de certains des chapitres de ce livre fondateur de l’anthropologie du XXe siècle : « Un parent par alliance est une cuisse d’éléphant » (Rév. A.L. Bishop, cité dans l’introduction) ; « Ta propre mère/ Ta propre sœur/ Tes propres porcs/ Tes propres ignames que tu as empilés/ Tu ne peux les manger/ Les mères des autres/ Les sœurs des autres/ Les porcs des autres/ Les ignames des autres qu’ils ont empilés/ Tu peux les manger (Aphorismes arapesh cités par M. Mead, cité par Lévi-Strauss au début de la première partie). Même si Lévi-Strauss amendera ses premières comme on le dit souvent, ni même à un principe analyses anthropologiques au fil de sa carrière, ce kantien qui réserverait au seul humain le fait d’être qu’il rapporte dans son premier ouvrage reste considéré comme « fin », qu’à une prise de important pour entreprendre une discussion sur les connaissance que certaines sociétés humaines rapports des humains aux non-humains, des humains pratiquent des manières d’être entre les humains et au monde vivant et non vivant, sans oublier les des manières d’entrer en relation avec le monde non rapports des humains entre eux. Lévi-Strauss s’est humain très différentes, voire totalement inversées rendu célèbre en théorisant dans Les structures par rapport à celles de la société moderne élémentaires de la parenté l’universalité de occidentale. -

La Politique Économique De François Hollande (2012-2014)
La politique économique de François Hollande (2012-2014). Trahison électorale, ralliement économique, rupture politique Éléa Pommiers To cite this version: Éléa Pommiers. La politique économique de François Hollande (2012-2014). Trahison électorale, ralliement économique, rupture politique. Science politique. 2016. dumas-01526402 HAL Id: dumas-01526402 https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01526402 Submitted on 23 May 2017 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. ÉLÉA POMMIERS Master 2 Sociologie et institutions du politique. 2015-2016 La politique économique de François Hollande (2012-2014). Trahison électorale, ralliement économique, rupture politique. Sous la direction de Frédéric SAWICKI. Mémoire de recherche Master 2 Université Paris I Panthéon-Sorbonne. UFR de Sciences politiques. !1 Remerciements J’adresse mes remerciements à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce mémoire. Je remercie mon directeur de recherche, M. Frédéric Sawicki, pour m’avoir permis de mener ce travail, et pour ses conseils. Je tiens également à remercier les personnes rencontrées dans le cadre de cette étude, pour m’avoir accordé de leur temps et pour m’avoir livré leurs témoignages. Je remercie enfin tous les membres de mon entourage, famille et amis, qui m’ont soutenue dans cette entreprise de recherche et de rédaction. -

L'affaire Kohler Éclabousse Macron
L’affaire Kohler éclabousse Macron 27 mai 2018 Par Laurent Mauduit et martine orange Selon les documents de la commission de déontologie que nous publions, le secrétaire général de l’Élysée n’a jamais révélé à cette instance ses liens familiaux avec la société MSC. Pour faciliter son pantouflage controversé en 2016, Emmanuel Macron a signé une attestation qui La situation du secrétaire général de l’Élysée devient de plus en plus embarrassante, non seulement pour lui-même, mais aussi pour le chef de l’État. C’est ce que mettent en évidence les documents de la commission de déontologie de la fonction publique que nous publions. Ils apportent la preuve qu’Alexis Kohler n’a jamais révélé à cette instance ses liens familiaux avec les actionnaires de la société Mediterranean Shipping Company (MSC), ni en 2014 quand il a reçu un avis défavorable à sa demande de pantouflage vers le deuxième groupe mondial de transport maritime, ni en 2016 quand l’avis a été favorable. Mais ils placent aussi Emmanuel Macron dans une situation délicate car il a produit en 2016 une attestation, que nous publions, pour faciliter le départ vers le privé de son collaborateur, attestation qui n’évoque pas non plus la situation de conflit d’intérêts de celui qui était peu de temps avant son directeur de cabinet au ministère de l’économie. En résumé, les documents que nous publions soulèvent une rafale de questions graves : l’actuel secrétaire général de l’Élysée n’a-t-il pas commis une faute en ne révélant pas à sa hiérarchie, à Bercy d’abord, puis par deux fois à la -

Une Première Sous La V République : La Démission Du Chef D'état-Major
Une première sous la Ve République : la démission du chef d’état-major des Armées Anatomie de la crise de l’été 2017 Par Martine Cuttier L’armée est l’institution régalienne qui garantit la souveraineté et la sûreté de l’État. Elle le fait par l’usage éventuel de la force, légitime puisque subordonnée à un pouvoir politique légal qui peut faire valoir les intérêts supérieurs de la Nation comme communauté de destin. En cela, l’armée assure, au travers de celle de ses dirigeants du moment, la liberté d’action du pays, voire sa survie, notamment (mais non exclusivement) sur la scène internationale. Elle a longtemps incarné la puissance de la France, structuré l’espace hexagonal et celui de ses dépendances, symbolisé l’unité et l’identité nationales. Sa position au sein de l’appareil d’État républicain a évolué. Si la IIIe République avait isolé l’armée (mais préservé ce faisant son autonomie interne), si par faiblesse institutionnelle et politique la IVe lui avait confié ici et là nombre de pouvoirs civils, sous la Ve République, l’ordre politique s’impose fermement à l’ordre militaire jusque dans le détail.1 Après la tentative de putsch d’avril 1961, le général de Gaulle met au pas les chefs de l’armée, réforme les institutions de façon à la subordonner strictement, et accélère l’obtention d’une arme nucléaire (pour l’essentiel étrangère à sa culture) qui jusqu’à la fin de la Guerre froide lui ravit le premier rôle dans la défense du pays. Le pouvoir politique en place, seul en mesure de synthétiser les intérêts et valeurs à défendre ou promouvoir, est responsable des grandes orientations de la politique étrangère et de la Défense, fait de l’armée un outil, et de ses chefs des auxiliaires chargés d’appliquer sa volonté. -

Une Ministre De La Culture Novice De Forme - Libération
Une ministre de la Culture novice de forme - Libération From www.liberation.fr - April 23, 11:16 PM Par Dominique Albertini et Jérôme Lefilliâtre, (avec Dominique Albertini, Eve Beauvallet et Julien Gester) — Libération du 24 avril 2018 Empathique et brillante pour les uns, trop tendre et manquant de leadership pour les autres. Françoise Nyssen, issue de la société civile, a cumulé les maladresses sur les dossiers dont elle a la charge. Au point de crisper nombre d’acteurs culturels qui s’interrogent sur sa crédibilité. Une ministre de la Culture novice de forme Un silence embarrassé de quelques secondes peut sembler parfois durer des heures. Celui de Françoise Nyssen et de la petite troupe de conseillers et de journalistes qui l’entourent ce 10 avril, dans un couloir du Grand Palais, est interminable. Dans l’auditorium du bâtiment parisien, la ministre de la Culture vient de prononcer un discours sur l’extension des horaires d’ouverture des bibliothèques - l’une des grandes promesses culturelles d’Emmanuel Macron. Une fois de plus, l’ex- patronne d’Actes Sud n’a pas brillé par son souffle oratoire, mais s’en est sortie honorablement, malgré quelques balbutiements au moment d’aborder les détails techniques. A l’arrière de la tribune, une séance informelle de questions-réponses s’engage avec la poignée de journalistes présents (dont Libération). L’une s’approche avec une interrogation apparemment inoffensive : comment faire pour rendre l’accès aux bibliothèques gratuit dans le plus d’endroits possibles ? La réponse de Françoise Nyssen fuse : «Mais toutes les bibliothèques sont gratuites !» Mini-stupeur de l’assemblée. -
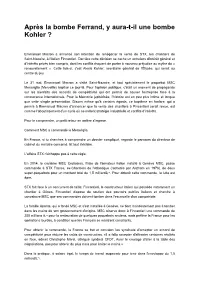
Après La Bombe Ferrand, Y Aura-T-Il Une Bombe Kohler ?
Après la bombe Ferrand, y aura-t-il une bombe Kohler ? Emmanuel Macron a annoncé son intention de renégocier la vente de STX, les chantiers de Saint-Nazaire, à l'italien Fincantieri. Derrière cette décision se cache un entrelacs d'intérêt général et d'intérêts privés bien compris, dont les conflits risquent de porter à nouveau préjudice au mythe du « renouvellement ». Cette fois-ci, c'est Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, qui serait au centre du jeu. Le 31 mai, Emmanuel Macron a visité Saint-Nazaire, et tout spécialement le paquebot MSC Meraviglia (Merveille) baptisé ce jour-là. Pour l'opinion publique, c'était un moment de propagande sur les bienfaits des accords de compétitivité qui ont permis de sauver l'entreprise face à la concurrence internationale. Pour la Macronie jupitérisée, l'histoire est un peu plus intime et longue que cette simple présentation. Disons même qu'à certains égards, ce baptême en fanfare, qui a permis à Emmanuel Macron d'annoncer que la vente des chantiers à Fincantieri serait revue, est comme l'aboutissement d'un cycle où se mêlent stratégie industrielle et conflits d'intérêts. Pour le comprendre, un petit retour en arrière s'impose. Comment MSC a commandé le Meraviglia En France, si tu cherches à comprendre un dossier compliqué, regarde le parcours du directeur de cabinet du ministre concerné. Et tout s'éclaire. L'affaire STX n'échappe pas à cette règle. En 2014, le croisière MSC Croisières, filiale de l'armateur italien installé à Genève MSC, passe commande à STX France, ex-Chantiers de l'Atlantique (rachetés par Alsthom en 1976), de deux super-paquebots pour un montant total de 1,5 milliard€. -
En Voyage Aux Etats-Unis, Pierre Maudet Vante La Stabilité
16 Genève Tribune de Genève | Mardi 9 mai 2017 Diplomatie Le Genevois du jour En voyage aux Etats-Unis, Pierre Maudet Alexis Kohler est vante la stabilité genevoise face à Donald Trump pressenti pour être Promotion économi- découvert une «explo- que Le conseiller d’Etat sion totale de sociétés le bras droit de Macron Pierre Maudet, en charge qui explorent la mutua- du Département de la sé- lisation des données et Elysée C’est la surprise genevoise de l’élection présidentielle curité et de l’économie, a tout ce qui est intelli- française. Alexis Kohler, directeur financier de l’entité Croi- conclu lundi à New York gence artificielle». «En sières de la multinationale Mediterranean Shipping Com- une visite d’une semaine parallèle, nous avons pany (MSC), basée à Genève, est pressenti pour devenir le aux Etats-Unis pour pro- vu qu’il y a des besoins bras droit d’Emmanuel Macron. Rien n’est encore officiel mouvoir les atouts écono- de cadres et d’éléments mais Paris Match et Libération annoncent déjà qu’il sera le miques et diplomatiques éthiques qui permet- nouveau secrétaire général de l’Elysée. C’est l’une des fonc- de Genève. tent de stabiliser les af- tions les plus importantes de la République française. faires», poursuit-il. «Les Né à Strasbourg, le quadragénaire a posé ses valises à Genève 1 Donald Trump, investissements en ma- il y a plusieurs mois, où il vit une partie de la semaine. Au une opportunité tière de cybersécurité siège du numéro 2 mondial du malgré tout sont massifs. Dans ce fret maritime, situé à Champel, Pierre Maudet a quitté les contexte, la neutralité c’est «no comment». -

By JUAN BRANCO
CREPUSCULE By JUAN BRANCO 1 Foreword, by DENIS ROBERT1 It was early November 2018 when the French President completed his remembrance tour with a visit to Pont-à-Mousson, on the Moselle river. He was to close a conference, using English loanwords to “make up” the future world as he saw it: Choose France Grand Est. I have a friend there who is a doctor. I suspect he might have voted for Emmanuel Macron in both rounds of the presidential election. Let’s be perfectly honest, I did the same in the second round, without any qualms whatsoever. This friend of mine, who I suspect always votes for the right wing, sent me a long e-mail message a few days later with ten or so instructive photographs attached. It was as though a lethal gas had wiped out an entire town. Not a single inhabitant of Pont-à-Mousson was in the streets. Place Duroc was completely shut off to the population. The same was true for Prémontrés abbey where the five hundred conference attendees, elected officials and leaders, hand-picked, searched and wearing ties, were penned in. That afternoon, it was as if the town was anaesthetized. The people had been sidelined. There was not a soul around, no free citizen in a radius of approximately 500 meters around Emmanuel Macron. Nothing but metal barriers, rural police forces and anti-riot police waiting in dozens of coaches parked along the river banks. Television that evening, and newspapers the day after, noted the success of the presidential visit, but failed to report the sidelining of the unwelcome common people. -

Comment EDF Tente DE SE Défaire DE L'envahissant
Exemplaire destiné exclusivement à HEBDOMADAIRE PUBLIÉ LE JEUDI DEPUIS 1978 Tous les jours N°1729 sur www.LaLettreA.fr PARIS, LE 12 MAI 2016 Action publique Stratégies d’entreprises Journalistes & médias Le gendarme du rail a les oreilles Afer : quand les millions du fisc Messageries :le bug informatique qui sifflent NP.2 se promènent dans la nature NP.5 de trop NP.8 lant entre digressions psychanalytiques et Administration, grands groupes et X COMMENT EDF psychologie de bazar : aucun contrat ne empêtrés. Le ministère de l'écologie Octave doit plus être signé avec les sociétés en affiche lui-même une position ambigüe. TENTE lien avec David Gutmann. Mais malgré Après avoir confié cet été une enquête sur ce veto, des centaines de cadres ayant le sujet à la Direction générale de l'éner- BONNAUD DE SE DÉfaIRE suivi ces séminaires à l'initiative de ser- gie et du climat (DGEC), le cabinet de DE L'ENvahIssaNT vices RH, dont le coach a su faire sa clé Ségolène Royal reste depuis muet. De d'entrée, sont en activité et perpétuent fait, pas sûr que la DGEC soit la mieux coach GUTMANN son message. Enfin, d'éminents dirigeants placée pour piloter des investigations : de l'énergéticien comptent toujours parmi son patron de 2008 à 2012, Pierre-Franck les formateurs du "conseiller en synthèse", Chevet, maintenant à la tête de l'Autorité - Abonné n°AA031838 EDF a officiellement rompu avec le à l'instar de Bernard Fontana, PDG de sûreté nucléaire, est un fidèle de ces "conseiller en synthèse" David Gutmann d'Areva NP, dont l'avenir est désormais lié séminaires new age ! Au centre d'une mais le coach du CAC 40 ne se démonte à EDF ( LLA nº1727). -

FIG MAG OK Les Hommes Du Président 1934 046
Emmanuel Macron et, de gauche à droite, les deux hommes qui comptent à ses côtés : Alexis Kohler, le secrétaire général, et Ismaël Emelien, conseiller spécial. Ici, dans la salle des fêtes ÉLODIE GRÉGOIRE de l’Elysée, en août 2017. LES HOMMES DU PRÉSIDENT Emmanuel Macron dirige l’Etat avec une poignée de conseillers et de colla borateurs à l’Elysée, qui se surnomment « les Mormons ». Parmi eux : le tandem de choc, Alexis Kohler et Ismaël Emelien. Des hommes secrets aux méthodes commandos assumées. LES HOMMES DU PRÉSIDENT Emmanuel Macron dirige l’Etat avec une poignée de conseillers et de colla borateurs à l’Elysée, qui se surnomment « les Mormons ». Parmi eux : le tandem de choc, Alexis Kohler et Ismaël Emelien. Des hommes secrets aux méthodes commandos assumées. PAR VINCENT NOUZILLE ans leur feu vert, rien n’est possible. Ils relisent tout, dé- cident de tout, bloquent ce qui les dérange, s’immiscent partout… » Cette confi- dence d’un ministre impor- tant en dit long sur le pouvoir actuel d’un cercle très restreint de collaborateurs d’Emmanuel Macron. Depuis son arrivée à l’Elysée le 14 mai, le Président s’est en effet entouré Sd’une garde rapprochée de fidèles, les seuls en qui il a vraiment confiance et avec qui il travaille de manière intensive jour et nuit, généralement dans la bonne humeur, mais souvent jus- qu’à 3 heures du matin, au risque de les épuiser. Certains ont été ses collaborateurs à Bercy. Ils l’ont épaulé dans l’aventure d’En Marche !. Ils ont organisé sa campagne présidentielle. -

Crépuscule C0 Autor
Juan Branco CRÉPUSCULE Vorwort von Denis Robert Nachwort des Autors Aus dem Französischen von ceux qui ne sont rien Juan Branco wurde 1989 in Estepona, Andalusien, geboren. Er war Schüler an der École Alsacien- ne, diplomiert an der Sciences Po Paris, dann an der École normale supérieure in Jura und Philoso- phie. Heute ist er Rechtsanwalt und Rechtsbeistand, insbesondere von WikiLeaks, Julian Assange, sowie von Maxime Nicolle. Er ist ebenfalls Journalist bei der Zeitschrift Le Monde Diplomatique. Als politischer Aktivist war er ausserdem Kandidat der Partei La France Insoumise anlässlich der Parlamentswahlen von 2017 im Departement Seine-Saint-Denis. Dieser Text ist jenen gewidmet, die ihre Würde niemals aufgaben. Jenen die, angesichts der Verlockung der Macht und der Kompromissbereitschaft, der Lügen und der eigenen Interessen, zu widerstehen wussten. Er ist der Idee gewidmet, aus der ich stamme, dieser Republik die die Gleichwertigkeit ihrer Kinder postuliert. Dieser Republik, die die Welt angezogen hat, und die heute in prostituierten Händen versinkt. Vorwort von Denis Robert1 Es war Anfang November 2018. Der Präsident der Republik schloss seine Gedenktour mit einem Besuch in Pont-à-Mousson, einer Stadt an den Ufern der Mosel, ab. Er sollte dort eine Konferenz zum Abschluss bringen, die sich eines Anglizismus bediente, um seine Welt von morgen zu « erfin- den » : Choose France Grand Est. Ich bin dort mit einem Arzt befreundet. Ich verdächtige ihn, in beiden Runden der Präsidentschaftswahlen für Emmanuel Macron gestimmt zu haben. Damit wir uns richtig verstehen: Ich habe in der zweiten Runde dasselbe getan, ohne besondere Gemütslage. Plötzlich schickt mir dieser Freund, den ich verdächtige, immer rechts zu wählen, ein paar Tage später eine lange E-Mail mit einem Dutzend aufschlussreicher Fotos.