These Final B
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

FINAL REPORT Quantitative Instrument to Measure Commune
FINAL REPORT Quantitative Instrument to Measure Commune Effectiveness Prepared for United States Agency for International Development (USAID) Mali Mission, Democracy and Governance (DG) Team Prepared by Dr. Lynette Wood, Team Leader Leslie Fox, Senior Democracy and Governance Specialist ARD, Inc. 159 Bank Street, Third Floor Burlington, VT 05401 USA Telephone: (802) 658-3890 FAX: (802) 658-4247 in cooperation with Bakary Doumbia, Survey and Data Management Specialist InfoStat, Bamako, Mali under the USAID Broadening Access and Strengthening Input Market Systems (BASIS) indefinite quantity contract November 2000 Table of Contents ACRONYMS AND ABBREVIATIONS.......................................................................... i EXECUTIVE SUMMARY............................................................................................... ii 1 INDICATORS OF AN EFFECTIVE COMMUNE............................................... 1 1.1 THE DEMOCRATIC GOVERNANCE STRATEGIC OBJECTIVE..............................................1 1.2 THE EFFECTIVE COMMUNE: A DEVELOPMENT HYPOTHESIS..........................................2 1.2.1 The Development Problem: The Sound of One Hand Clapping ............................ 3 1.3 THE STRATEGIC GOAL – THE COMMUNE AS AN EFFECTIVE ARENA OF DEMOCRATIC LOCAL GOVERNANCE ............................................................................4 1.3.1 The Logic Underlying the Strategic Goal........................................................... 4 1.3.2 Illustrative Indicators: Measuring Performance at the -

Annuaire Statistique 2015 Du Secteur Développement Rural
MINISTERE DE L’AGRICULTURE REPUBLIQUE DU MALI ----------------- Un Peuple - Un But – Une Foi SECRETARIAT GENERAL ----------------- ----------------- CELLULE DE PLANIFICATION ET DE STATISTIQUE / SECTEUR DEVELOPPEMENT RURAL Annuaire Statistique 2015 du Secteur Développement Rural Juin 2016 1 LISTE DES TABLEAUX Tableau 1 : Répartition de la population par région selon le genre en 2015 ............................................................ 10 Tableau 2 : Population agricole par région selon le genre en 2015 ........................................................................ 10 Tableau 3 : Répartition de la Population agricole selon la situation de résidence par région en 2015 .............. 10 Tableau 4 : Répartition de la population agricole par tranche d'âge et par sexe en 2015 ................................. 11 Tableau 5 : Répartition de la population agricole par tranche d'âge et par Région en 2015 ...................................... 11 Tableau 6 : Population agricole par tranche d'âge et selon la situation de résidence en 2015 ............. 12 Tableau 7 : Pluviométrie décadaire enregistrée par station et par mois en 2015 ..................................................... 15 Tableau 8 : Pluviométrie décadaire enregistrée par station et par mois en 2015 (suite) ................................... 16 Tableau 9 : Pluviométrie enregistrée par mois 2015 ........................................................................................ 17 Tableau 10 : Pluviométrie enregistrée par station en 2015 et sa comparaison à -
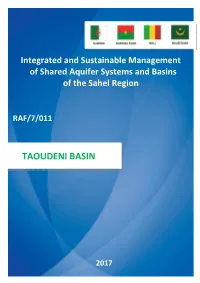
Taoudeni Basin Report
Integrated and Sustainable Management of Shared Aquifer Systems and Basins of the Sahel Region RAF/7/011 TAOUDENI BASIN 2017 INTEGRATED AND SUSTAINABLE MANAGEMENT OF SHARED AQUIFER SYSTEMS AND BASINS OF THE SAHEL REGION EDITORIAL NOTE This is not an official publication of the International Atomic Energy Agency (IAEA). The content has not undergone an official review by the IAEA. The views expressed do not necessarily reflect those of the IAEA or its Member States. The use of particular designations of countries or territories does not imply any judgement by the IAEA as to the legal status of such countries or territories, or their authorities and institutions, or of the delimitation of their boundaries. The mention of names of specific companies or products (whether or not indicated as registered) does not imply any intention to infringe proprietary rights, nor should it be construed as an endorsement or recommendation on the part of the IAEA. INTEGRATED AND SUSTAINABLE MANAGEMENT OF SHARED AQUIFER SYSTEMS AND BASINS OF THE SAHEL REGION REPORT OF THE IAEA-SUPPORTED REGIONAL TECHNICAL COOPERATION PROJECT RAF/7/011 TAOUDENI BASIN COUNTERPARTS: Mr Adnane Souffi MOULLA (Algeria) Mr Abdelwaheb SMATI (Algeria) Ms Ratoussian Aline KABORE KOMI (Burkina Faso) Mr Alphonse GALBANE (Burkina Faso) Mr Sidi KONE (Mali) Mr Aly THIAM (Mali) Mr Brahim Labatt HMEYADE (Mauritania) Mr Sidi Haiba BACAR (Mauritania) EXPERT: Mr Jean Denis TAUPIN (France) Reproduced by the IAEA Vienna, Austria, 2017 INTEGRATED AND SUSTAINABLE MANAGEMENT OF SHARED AQUIFER SYSTEMS AND BASINS OF THE SAHEL REGION INTEGRATED AND SUSTAINABLE MANAGEMENT OF SHARED AQUIFER SYSTEMS AND BASINS OF THE SAHEL REGION Table of Contents 1. -

Districts Sanitaires De Kati Et De Kala
NAME OF PROGRAMME: Programme intégré de lutte contre la mortalité infantile LOCATION: Districts Sanitaires de Kati et de Kalabancoro, Région de Koulikoro, Mali DATE OF INVESTIGATION: From 13st January 2015 to 30st January 2015 AUTHOR: Issiaka Traore, Goita Ousmane, Marie Biotteau TYPE OF INVESTIGATION: SQUEAC TYPE OF PROGRAMME: OTP for SAM IMPLEMENTING ORGANISATION: International Rescue Committee (IRC) 1 SOMMAIRE SOMMAIRE ............................................................................................................................................................................. 2 REMERCIEMENTS ................................................................................................................................................................. 3 ACRONYMES .......................................................................................................................................................................... 4 RESUME .................................................................................................................................................................................. 5 OBJECTIFS .............................................................................................................................................................................. 7 1. INTRODUCTION ............................................................................................................................................................. 8 2. CONTEXTE .................................................................................................................................................................... -

9781464804335.Pdf
Land Delivery Systems in West African Cities Land Delivery Systems in West African Cities The Example of Bamako, Mali Alain Durand-Lasserve, Maÿlis Durand-Lasserve, and Harris Selod A copublication of the Agence Française de Développement and the World Bank © 2015 International Bank for Reconstruction and Development / Th e World Bank 1818 H Street NW, Washington, DC 20433 Telephone: 202-473-1000; Internet: www.worldbank.org Some rights reserved 1 2 3 4 18 17 16 15 Th is work is a product of the staff of Th e World Bank with external contributions. Th e fi ndings, interpretations, and conclusions expressed in this work do not necessarily refl ect the views of Th e World Bank, its Board of Executive Directors, or the governments they represent, or the Agence Française de Développement. Th e World Bank does not guarantee the accuracy of the data included in this work. Th e boundaries, colors, denominations, and other information shown on any map in this work do not imply any judgment on the part of Th e World Bank concerning the legal status of any territory or the endorsement or acceptance of such boundaries. Nothing herein shall constitute or be considered to be a limitation upon or waiver of the privileges and immunities of Th e World Bank, all of which are specifi cally reserved. Rights and Permissions Th is work is available under the Creative Commons Attribution 3.0 IGO license (CC BY 3.0 IGO) http:// creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo. Under the Creative Commons Attribution license, you are free to copy, distribute, transmit, and adapt this work, including for commercial purposes, under the following conditions: Attribution—Please cite the work as follows: Durand-Lasserve, Alain, Maÿlis Durand-Lasserve, and Harris Selod. -

World Bank Document
Document of The World Bank Public Disclosure Authorized FOR OFFICIAL USE ONLY Report No: 39308 - ML PROJECT APPRAISAL DOCUMENT ON A Public Disclosure Authorized PROPOSED CREDIT IN THE AMOUNT OF SDR59.5 MILLION (US$90.0 MILLIONEQUIVALENT) TO THE REPUBLIC OF MALI FOR A Public Disclosure Authorized SECOND TRANSPORT SECTOR PROJECT April 30,2007 This document has a restricted distribution and may be used by recipients only in the Public Disclosure Authorized performance oftheir official duties. Its contents may not otherwise be disclosed without World Bank authorization. CURRENCY EQUIVALENTS (Exchange Rate Effective March 3 1,2007) Currency Unit = Franc CFA CFAF 495 = US$1 US$1.51326 = SDR 1 US$1= SDR 0.660825 FISCAL YEAR January 1-December 3 1 *. 11 - ABBREVIATIONS AND ACRONYMS ACDP Agricultural Competitiveness and Diversification Project AFD Agence Franqaise de Dheloppement (French Agency for Development) AfDB African Development Bank AGEROUTE Agence d’extcution d’Entretien des Travaux Routiers (Road Works Execution Agency) AGETIER Agence d’extcution des Travaux d’hfiastructure et d’Equipements Ruraux (Infrastructure and Rural Equipment Works Execution Agency) ASPEN Africa Safeguards Policy Enhancement BOAD Banque Ouest Afhcaine de DCveloppement CAS Country Assistance Strategy CDD Community Driven Development CETAC Technical Committee of Support to Towns CFAA Country Financial Accountability Assessment CFAF Franc ofthe French Community ofAfhca CMDT Compagnie Malienne pour le Ddveloppement des Textiles (Malian Textile Development Company) -

Building a Decentralization Safo, Based on Socio-Cultural and Artistic Development of the Population ©2018 Konta 404
Journal of Historical Archaeology & Anthropological Sciences Review Article Open Access Building a decentralization Safo, based on socio- cultural and artistic development of the population Abstract Volume 3 Issue 3 - 2018 The quest for new governance is underway in Mali since the national conference in 1992. It implies a redistribution of power in the management of resources and services for Mahamadou Konta communities. Above all, it requires a new behavior of the citizen, who must be mentally Head of Department Study and Research Program, Malian and intellectually prepared to become himself the main architect of his developmental Academy of Languages, Africa development of his locality. In the rural commune of Safo, where we have spent more than three years in need of investigation, the people and their elected officials are looking Correspondence: Mahamadou Konta, Head of Department Study and Research Program, Malian Academy of Languages, for an original way to achieve decentralization. The theme, “Building a decentralization Africa, Tel 7641 1270, Fax 6522 8889, Safo, based on socio-cultural and artistic development of the population” is an attempt Email [email protected] reconciliation of traditional and modern louse Also see around a common purpose, local development, based on the valuation redu socio-cultural heritage and artistic. Received: November 21, 2017 | Published: May 21 2018 Keywords: decentralization, socio-cultural, heritage, Safo, education, population Introduction Problem The socio cultural and artistic values can serve as inspiration to In the rural community of Safo, so development requirements revitalize education, governance and local development in the context necessary to the community, especially the customs and traditions of decentralization. -

Saving for Change Impact Stories Follow-Up Research Report
Saving for Change Impact Stories Follow-Up Research Report Research conducted as a follow-up to the Saving for Change Impact Stories Research published in 2010 January 2013 Photos by: Centre d’Études, de Recherche, de Communication et d’Animation pour le Développement By Megan Gash1, Martha Maxwell, Victor Arredondo, Brittany Brown, JaLeen Farrell, Brittany Guerra, Dr. Tim Heaton, Erik Linton, Renae Morgan, Yukiko Seino and Dr. Benjamin Crookston2 1 Freedom from Hunger 2 The remaining 10 authors are all from the Department of Health Science, Brigham Young University TABLE OF CONTENTS Executive Summary ........................................................................................................................................... 1 I. Introduction .......................................................................................................................................... 3 Saving for Change ..................................................................................................................................... 3 Study Purpose ....................................................................................................................................... 3 II. Methods ................................................................................................................................................. 4 III. Results .................................................................................................................................................... 6 Weekly Contributions, -

Region De Koulikoro
Répartition par commune de la population résidente et des ménages Taux Nombre Nombre Nombre Population Population d'accroissement de de d’hommes en 2009 en 1998 annuel moyen ménages femmes (1998-2009) Cercle de Kati Tiele 2 838 9 220 9 476 18 696 14 871 2,1 Yelekebougou 1 071 3 525 3 732 7 257 10 368 -3,2 Cercle de Kolokani REGION DE KOULIKORO Kolokani 7 891 27 928 29 379 57 307 33 558 5,0 Didieni 4 965 17 073 17 842 34 915 25 421 2,9 En 2009, la région de Koulikoro compte 2 418 305 habitants répartis dans 366 811 ména- ème Guihoyo 2 278 8 041 8 646 16 687 14 917 1,0 ges, ce qui la place au 2 rang national. La population de Koulikoro est composée de Massantola 5 025 17 935 17 630 35 565 29 101 1,8 1 198 841 hommes et de 1 219 464 femmes, soit 98 hommes pour 100 femmes. Les fem- Nonkon 2 548 9 289 9 190 18 479 14 743 2,1 mes représentent 50,4% de la population contre 49,6% pour les hommes. Nossombougou 2 927 10 084 11 028 21 112 17 373 1,8 La population de Koulikoro a été multipliée par près de 1,5 depuis 1998, ce qui représente Ouolodo 1 462 4 935 5 032 9 967 9 328 0,6 un taux de croissance annuel moyen de 4%. Cette croissance est la plus importante jamais Sagabala 2 258 7 623 8 388 16 011 15 258 0,4 constatée depuis 1976. -

2012 Mali Eiti Report Fr.Pdf
REPUBLIQUE DU MALI INITIATIVE POUR LA TRANSPARENCE DANS LES INDUSTRIES EXTRACTIVES ITIE - MALI RECONCILIATION DES FLUX DE PAIEMENT EFFECTUES PAR LES ENTREPRISES EXTRACTIVES ET DES REVENUS PERÇUS PAR L’ETAT POUR L’ANNEE 2012 Rapport Final Décembre 2014 Le présent rapport a été établi à la demande du Comité de Pilotage de mise en œuvre de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives au Mali (ITIE Mali). Les avis qui y sont exprimés sont ceux du Conciliateur Indépendant et ne reflètent en aucun cas l’avis officiel de l’ITIE Mali. Ce rapport a été établi à l’usage exclusif de l’ITIE Mali et il ne doit pas être utilisé par d’autres parties ni à des fins autres que celles auxquelles il est destiné. Réconciliation des flux de paiement effectués par les entreprises extractives et des revenus perçus par l’Etat pour l’exercice 2012 TABLE DES MATIERES 1 INTRODUCTION ................................................................................................................... 5 1.1 Contexte .............................................................................................................................. 5 1.2 Objectif ................................................................................................................................ 5 1.3 Nature et périmètre des travaux ........................................................................................... 5 2 RESUME DES CONSTATATIONS ....................................................................................... 6 2.1 Exhaustivité et -

Thèse De Médecine
REPUBLIQUE DU MALI Un Peuple-Un But-Une Foi MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE UNIVERSITE DES SCIENCES DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO FACULTE DE MEDECINE ET D’ODONTO-STOMATOLOGIE Année universitaire 2019-2020 N0 .. Etude épidémiologique du paludisme en 2019 dans une cohorte de volontaires à Kalifabougou Thèse : Présentée et soutenue publiquement, le 05/11/2020 Devant la Faculté de Médecine et d’Odonto-Stomatologie Par : M. TRAORE Abdoulaye Pour l’obtention du grade de Docteur en Médecine (Diplôme d’Etat). JURY : Président : Pr Boubacar TRAORE Membres : Pr Amagana DOLO Dr Amadou B NIANGALY Directrice de thèse : Pr Safiatou NIARE Epse DOUMBO REPUBLIQUE DU MALI Un Peuple-Un But-Une Foi MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE UNIVERSITE DES SCIENCES DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO FACULTE DE MEDECINE ET D’ODONTO-STOMATOLOGIE Année universitaire 2019-2020 N0 .. Etude épidémiologique du paludisme en 2019 dans une cohorte de volontaires à Kalifabougou Thèse : Présentée et soutenue publiquement, le 05/11/2020 Devant la Faculté de Médecine et d’Odonto-Stomatologie Par : M. TRAORE Abdoulaye Pour l’obtention du grade de Docteur en Médecine (Diplôme d’Etat). JURY : Président : Pr Boubacar TRAORE Membres : Pr Amagana DOLO Dr Amadou B NIANGALY Directrice de thèse : Pr Safiatou NIARE Epse DOUMBO Etude épidémiologique du paludisme dans une cohorte de volontaires à Kalifabougou DEDICACES Je dédie cette thèse… A ma mère feue Assetou Diallo Je te dédie ce travail en témoignage de ce que j’étais pour toi : un fils, un confident. -

IMRAP, Interpeace. Self-Portrait of Mali on the Obstacles to Peace. March 2015
SELF-PORTRAIT OF MALI Malian Institute of Action Research for Peace Tel : +223 20 22 18 48 [email protected] www.imrap-mali.org SELF-PORTRAIT OF MALI on the Obstacles to Peace Regional Office for West Africa Tel : +225 22 42 33 41 [email protected] www.interpeace.org on the Obstacles to Peace United Nations In partnership with United Nations Thanks to the financial support of: ISBN 978 9966 1666 7 8 March 2015 As well as the institutional support of: March 2015 9 789966 166678 Self-Portrait of Mali on the Obstacles to Peace IMRAP 2 A Self-Portrait of Mali on the Obstacles to Peace Institute of Action Research for Peace (IMRAP) Badalabougou Est Av. de l’OUA, rue 27, porte 357 Tel : +223 20 22 18 48 Email : [email protected] Website : www.imrap-mali.org The contents of this report do not reflect the official opinion of the donors. The responsibility and the respective points of view lie exclusively with the persons consulted and the authors. Cover photo : A young adult expressing his point of view during a heterogeneous focus group in Gao town in June 2014. Back cover : From top to bottom: (i) Focus group in the Ségou region, in January 2014, (ii) Focus group of women at the Mberra refugee camp in Mauritania in September 2014, (iii) Individual interview in Sikasso region in March 2014. ISBN: 9 789 9661 6667 8 Copyright: © IMRAP and Interpeace 2015. All rights reserved. Published in March 2015 This document is a translation of the report L’Autoportrait du Mali sur les obstacles à la paix, originally written in French.