7.2 Le Paludisme Grave[28]
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

These Final B
Epidémiologie du paludisme en saison sèche à Kalifabougou, cercle de Kati, Mali Année universitaire 2012-2013 N°……/2013 TITRE EPIDEMIOLOGIE DU PALUDISME EN SAISON THESE SECHE A KALIFABOUGOU, CERCLE DE KATI, Présentée et soutenue publique MALI THESE Présentée et soutenue publiquement le 30-Mars-2013 devant la Faculté de Médecine Et d’Odonto-stomatologie Par Mr Alassane BANGOURA Pour l’obtention du grade de Docteur en Médecine (Diplôme d’Etat) JURY Président : Professeur Seydou DOUMBIA Membres : Docteur Kassoum KAYENTAO Docteur Toumani CONARE Directeur : Professeur Boubacar TRAORE Co-directeur : Docteur Aissata ONGOIBA Thèse Médecine 2013 Alassane BANGOURA 1 Epidémiologie du paludisme en saison sèche à Kalifabougou, cercle de Kati, Mali ~ ,; - ': '" I ; ,, , I >' ); ~ Thèse Médecine 2013 Alassane BANGOURA o2 Epidémiologie du paludisme en saison sèche à Kalifabougou, cercle de Kati, Mali DEDICACES Au nom d’ALLAH le tout puissant le très miséricordieux . Grand merci pour ta grâce et ton assistance de ma naissance à aujourd’hui. Ce travail vient de toi car la réussite de tout projet n’est que ta volonté. Paix et salut sur le Prophète Mohammed, sa noble Famille et ses Compagnons. A feue Nana DIARRA Je te dédie ce travail en témoignage de ce que j’étais pour toi : un fils, un confident. Je ne peux jamais te remercier pour les efforts que tu as consentis pour m’accompagner durant tout mon cycle. Je pleure ton absence à la cérémonie d’aujourd’hui car je suis le fruit de ton éducation et d’une sagesse incomparable de ta part. Tu as pu me supporter et m’entretenir avec un grand amour. -

FINAL REPORT Quantitative Instrument to Measure Commune
FINAL REPORT Quantitative Instrument to Measure Commune Effectiveness Prepared for United States Agency for International Development (USAID) Mali Mission, Democracy and Governance (DG) Team Prepared by Dr. Lynette Wood, Team Leader Leslie Fox, Senior Democracy and Governance Specialist ARD, Inc. 159 Bank Street, Third Floor Burlington, VT 05401 USA Telephone: (802) 658-3890 FAX: (802) 658-4247 in cooperation with Bakary Doumbia, Survey and Data Management Specialist InfoStat, Bamako, Mali under the USAID Broadening Access and Strengthening Input Market Systems (BASIS) indefinite quantity contract November 2000 Table of Contents ACRONYMS AND ABBREVIATIONS.......................................................................... i EXECUTIVE SUMMARY............................................................................................... ii 1 INDICATORS OF AN EFFECTIVE COMMUNE............................................... 1 1.1 THE DEMOCRATIC GOVERNANCE STRATEGIC OBJECTIVE..............................................1 1.2 THE EFFECTIVE COMMUNE: A DEVELOPMENT HYPOTHESIS..........................................2 1.2.1 The Development Problem: The Sound of One Hand Clapping ............................ 3 1.3 THE STRATEGIC GOAL – THE COMMUNE AS AN EFFECTIVE ARENA OF DEMOCRATIC LOCAL GOVERNANCE ............................................................................4 1.3.1 The Logic Underlying the Strategic Goal........................................................... 4 1.3.2 Illustrative Indicators: Measuring Performance at the -

Annuaire Statistique 2015 Du Secteur Développement Rural
MINISTERE DE L’AGRICULTURE REPUBLIQUE DU MALI ----------------- Un Peuple - Un But – Une Foi SECRETARIAT GENERAL ----------------- ----------------- CELLULE DE PLANIFICATION ET DE STATISTIQUE / SECTEUR DEVELOPPEMENT RURAL Annuaire Statistique 2015 du Secteur Développement Rural Juin 2016 1 LISTE DES TABLEAUX Tableau 1 : Répartition de la population par région selon le genre en 2015 ............................................................ 10 Tableau 2 : Population agricole par région selon le genre en 2015 ........................................................................ 10 Tableau 3 : Répartition de la Population agricole selon la situation de résidence par région en 2015 .............. 10 Tableau 4 : Répartition de la population agricole par tranche d'âge et par sexe en 2015 ................................. 11 Tableau 5 : Répartition de la population agricole par tranche d'âge et par Région en 2015 ...................................... 11 Tableau 6 : Population agricole par tranche d'âge et selon la situation de résidence en 2015 ............. 12 Tableau 7 : Pluviométrie décadaire enregistrée par station et par mois en 2015 ..................................................... 15 Tableau 8 : Pluviométrie décadaire enregistrée par station et par mois en 2015 (suite) ................................... 16 Tableau 9 : Pluviométrie enregistrée par mois 2015 ........................................................................................ 17 Tableau 10 : Pluviométrie enregistrée par station en 2015 et sa comparaison à -

Districts Sanitaires De Kati Et De Kala
NAME OF PROGRAMME: Programme intégré de lutte contre la mortalité infantile LOCATION: Districts Sanitaires de Kati et de Kalabancoro, Région de Koulikoro, Mali DATE OF INVESTIGATION: From 13st January 2015 to 30st January 2015 AUTHOR: Issiaka Traore, Goita Ousmane, Marie Biotteau TYPE OF INVESTIGATION: SQUEAC TYPE OF PROGRAMME: OTP for SAM IMPLEMENTING ORGANISATION: International Rescue Committee (IRC) 1 SOMMAIRE SOMMAIRE ............................................................................................................................................................................. 2 REMERCIEMENTS ................................................................................................................................................................. 3 ACRONYMES .......................................................................................................................................................................... 4 RESUME .................................................................................................................................................................................. 5 OBJECTIFS .............................................................................................................................................................................. 7 1. INTRODUCTION ............................................................................................................................................................. 8 2. CONTEXTE .................................................................................................................................................................... -

World Bank Document
Document of The World Bank Public Disclosure Authorized FOR OFFICIAL USE ONLY Report No: 39308 - ML PROJECT APPRAISAL DOCUMENT ON A Public Disclosure Authorized PROPOSED CREDIT IN THE AMOUNT OF SDR59.5 MILLION (US$90.0 MILLIONEQUIVALENT) TO THE REPUBLIC OF MALI FOR A Public Disclosure Authorized SECOND TRANSPORT SECTOR PROJECT April 30,2007 This document has a restricted distribution and may be used by recipients only in the Public Disclosure Authorized performance oftheir official duties. Its contents may not otherwise be disclosed without World Bank authorization. CURRENCY EQUIVALENTS (Exchange Rate Effective March 3 1,2007) Currency Unit = Franc CFA CFAF 495 = US$1 US$1.51326 = SDR 1 US$1= SDR 0.660825 FISCAL YEAR January 1-December 3 1 *. 11 - ABBREVIATIONS AND ACRONYMS ACDP Agricultural Competitiveness and Diversification Project AFD Agence Franqaise de Dheloppement (French Agency for Development) AfDB African Development Bank AGEROUTE Agence d’extcution d’Entretien des Travaux Routiers (Road Works Execution Agency) AGETIER Agence d’extcution des Travaux d’hfiastructure et d’Equipements Ruraux (Infrastructure and Rural Equipment Works Execution Agency) ASPEN Africa Safeguards Policy Enhancement BOAD Banque Ouest Afhcaine de DCveloppement CAS Country Assistance Strategy CDD Community Driven Development CETAC Technical Committee of Support to Towns CFAA Country Financial Accountability Assessment CFAF Franc ofthe French Community ofAfhca CMDT Compagnie Malienne pour le Ddveloppement des Textiles (Malian Textile Development Company) -

Region De Koulikoro
Répartition par commune de la population résidente et des ménages Taux Nombre Nombre Nombre Population Population d'accroissement de de d’hommes en 2009 en 1998 annuel moyen ménages femmes (1998-2009) Cercle de Kati Tiele 2 838 9 220 9 476 18 696 14 871 2,1 Yelekebougou 1 071 3 525 3 732 7 257 10 368 -3,2 Cercle de Kolokani REGION DE KOULIKORO Kolokani 7 891 27 928 29 379 57 307 33 558 5,0 Didieni 4 965 17 073 17 842 34 915 25 421 2,9 En 2009, la région de Koulikoro compte 2 418 305 habitants répartis dans 366 811 ména- ème Guihoyo 2 278 8 041 8 646 16 687 14 917 1,0 ges, ce qui la place au 2 rang national. La population de Koulikoro est composée de Massantola 5 025 17 935 17 630 35 565 29 101 1,8 1 198 841 hommes et de 1 219 464 femmes, soit 98 hommes pour 100 femmes. Les fem- Nonkon 2 548 9 289 9 190 18 479 14 743 2,1 mes représentent 50,4% de la population contre 49,6% pour les hommes. Nossombougou 2 927 10 084 11 028 21 112 17 373 1,8 La population de Koulikoro a été multipliée par près de 1,5 depuis 1998, ce qui représente Ouolodo 1 462 4 935 5 032 9 967 9 328 0,6 un taux de croissance annuel moyen de 4%. Cette croissance est la plus importante jamais Sagabala 2 258 7 623 8 388 16 011 15 258 0,4 constatée depuis 1976. -

Thèse De Médecine
REPUBLIQUE DU MALI Un Peuple-Un But-Une Foi MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE UNIVERSITE DES SCIENCES DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO FACULTE DE MEDECINE ET D’ODONTO-STOMATOLOGIE Année universitaire 2019-2020 N0 .. Etude épidémiologique du paludisme en 2019 dans une cohorte de volontaires à Kalifabougou Thèse : Présentée et soutenue publiquement, le 05/11/2020 Devant la Faculté de Médecine et d’Odonto-Stomatologie Par : M. TRAORE Abdoulaye Pour l’obtention du grade de Docteur en Médecine (Diplôme d’Etat). JURY : Président : Pr Boubacar TRAORE Membres : Pr Amagana DOLO Dr Amadou B NIANGALY Directrice de thèse : Pr Safiatou NIARE Epse DOUMBO REPUBLIQUE DU MALI Un Peuple-Un But-Une Foi MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE UNIVERSITE DES SCIENCES DES TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO FACULTE DE MEDECINE ET D’ODONTO-STOMATOLOGIE Année universitaire 2019-2020 N0 .. Etude épidémiologique du paludisme en 2019 dans une cohorte de volontaires à Kalifabougou Thèse : Présentée et soutenue publiquement, le 05/11/2020 Devant la Faculté de Médecine et d’Odonto-Stomatologie Par : M. TRAORE Abdoulaye Pour l’obtention du grade de Docteur en Médecine (Diplôme d’Etat). JURY : Président : Pr Boubacar TRAORE Membres : Pr Amagana DOLO Dr Amadou B NIANGALY Directrice de thèse : Pr Safiatou NIARE Epse DOUMBO Etude épidémiologique du paludisme dans une cohorte de volontaires à Kalifabougou DEDICACES Je dédie cette thèse… A ma mère feue Assetou Diallo Je te dédie ce travail en témoignage de ce que j’étais pour toi : un fils, un confident. -

Abbreviated Title: Anti-Malaria Mab in Mali FMPOS Protocol #: 2020/32/CE/FMOS/FAPH Version Date: March 2, 2021
Abbreviated Title: Anti-malaria MAb in Mali FMPOS Protocol #: 2020/32/CE/FMOS/FAPH Version Date: March 2, 2021 Title: Safety and Efficacy of VRC-MALMAB0100-00-AB (CIS43LS), a Human Monoclonal Antibody against Plasmodium falciparum, in a Dose-Escalation Trial and a Randomized, Double-Blind Trial of Adults in Mali FMPOS Principal Investigator: Kassoum Kayentao, MD, MPH, PhD Malaria Research and Training Center (MRTC) Faculté de Médecine Pharmacie d’Odontostomatologie (FMPOS) University of Sciences, Techniques, & Technologies of Bamako (USTTB) NIH Principal Investigator: Peter D. Crompton, MD, MPH Laboratory of Immunogenetics (LIG) National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) National Institutes of Health (NIH) Investigational Agent: Drug Name VRC-MALMAB0100-00-AB (CIS43LS) Investigational New 147485 Drug (IND) Number Sponsor Office of Clinical Research Policy and Regulatory Operations (OCRPRO), Division of Clinical Research, NIAID Manufacturer Vaccine Research Center (VRC), NIAID Data and Safety Monitoring Board (DSMB): NIAID Intramural DSMB 2 Abbreviated Title: Anti-malaria MAb in Mali Version Date: March 2, 2021 STUDY STAFF ROSTER FMPOS Investigators: The research activities of the following FMPOS investigators will be reviewed by: FMPOS Ethics Committee BP E302, Point G/FMPOS Bamako, Mali FWA #00001769 FMPOS Principal Investigator: Kassoum Kayentao, MD, MPH, PhD MRTC, FMPOS, USTTB BP E302, Point G/FMPOS Bamako, Mali Phone: +223 7646 0173 Email: [email protected] Role(s): A, B, C, D, E, F FMPOS Associate Investigators: -

Latitudes Longitudes Villages Communes Cercles Regions
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT REPUBLIQUE DU MALI ET DE l’ASSAINISSEMENT UN PEUPLE/UN BUT/UNE FOI DIRECTION NATIONALE DES EAUX ET FORETS(DNEF) SYSTEME D’INFORMATION FORESTIER (SIFOR) SITUATION DES FOYERS DE FEUX DE BROUSSE DU 16 au 18 Mars 2013 SELON LE SATTELITE MODIS. LATITUDES LONGITUDES VILLAGES COMMUNES CERCLES REGIONS 15,1130000000 -4,3140000000 Farayeni Bimberetama Youwarou Mopti 13,1090000000 -7,2740000000 Oulla Tougouni Koulikoro Koulikoro 12,2220000000 -7,5260000000 Gouani Tiélé Kati Koulikoro 12,3130000000 -7,6640000000 Tamala Bougoula Kati Koulikoro 12,3270000000 -7,9290000000 Guelekoro Dialakoroba Kati Koulikoro 12,3840000000 -7,9280000000 Sirakoro Sanankoroba Kati Koulikoro 12,8600000000 -8,0000000000 Sikorobougou Kambila Kati Koulikoro 12,9050000000 -8,1370000000 Kababougou Kalifabougou Kati Koulikoro 13,2840000000 -8,4330000000 Djissoumal Daban Kati Koulikoro 13,7800000000 -8,1380000000 Bandiougou Kolokani Kolokani Koulikoro 14,4030000000 -6,1430000000 Hérébougou Sokolo Niono Ségou 12,4560000000 -8,4080000000 Fraguero Siby Kati Koulikoro 15,8220000000 -2,4580000000 Kelhantas Bambara Maoud G.Rharouss Tombouctou 11,9370000000 -8,5850000000 Mansaya Minidian Kangaba Koulikoro 14,1880000000 -7,5400000000 Kamissara Borron Banamba Koulikoro 12,8630000000 -6,6740000000 Niamana Wé Konobougou Baraoueli Ségou 11,9010000000 -6,4450000000 Kokoun Niantjila Dioila Koulikoro 12,1030000000 -7,8190000000 Kafara Ouéléssébougou Kati Koulikoro 12,1480000000 -7,0690000000 Douma Kemekako Dioila Koulikoro 14,0530000000 -4,5320000000 Kolloye Ouro -

M650kv1906mlia1p-Mliadm22302-Koulikoro.Pdf (French (Français))
RÉGION DE KOULIKORO - MALI Map No: MLIADM22302 9°0'W 8°0'W 7°0'W 6°0'W M A U R I T A N I E ! ! ! Mo!ila Mantionga Hamd!allaye Guirel Bineou Niakate Sam!anko Diakoya ! Kassakare ! Garnen El Hassane ! Mborie ! ! Tint!ane ! Bague Guessery Ballé Mou! nta ! Bou!ras ! Koronga! Diakoya !Palaly Sar!era ! Tedouma Nbordat!i ! Guen!eibé ! Diontessegue Bassaka ! Kolal ! ! ! Our-Barka Liboize Idabouk ! Siramani Peulh Allahina ! ! ! Guimbatti Moneke Baniere Koré ! Chedem 1 ! 7 ! ! Tiap! ato Chegue Dankel Moussaweli Nara ! ! ! Bofo! nde Korera Koré ! Sekelo ! Dally ! Bamb!oyaha N'Dourba N 1 Boulal Hi!rte ! Tanganagaba ! S É G O U ! Djingodji N N ' Reke!rkaye ' To!le 0 Boulambougou Dilly Dembassala 0 ° ! ! ! ° 5 ! ! 5 1 Fogoty Goumbou 1 Boug!oufie Fero!bes ! Mouraka N A R A Fiah ! ! Dabaye Ourdo-Matia G!nigna-Diawara ! ! ! Kaw! ari ! Boudjiguire Ngalabougou ! ! Bourdiadie Groumera Dabaye Dembamare ! Torog! ome ! Tarbakaro ! Magnyambougou Dogofryba K12 ! Louady! Cherif ! Sokolo N'Tjib! ougou ! Warwassi ! Diabaly Guiré Ntomb!ougou ! Boro! dio Benco Moribougou ! ! Fallou ! Bangolo K A Y E S ! Diéma Sanabougou Dioumara ! ! ! Diag! ala Kamalendou!gou ! Guerigabougou ! Naou! lena N'Tomodo Kolo!mina Dianguirdé ! ! ! ! Mourdiah ! N'Tjibougou Kolonkoroba Bekelo Ouolo! koro ! Gomitra ! ! Douabougou ! Mpete Bolib! ana Koira Bougouni N16 ! Sira! do Madina-Kagoro ! ! N'Débougou Toumboula Sirao!uma Sanmana ! ! ! Dessela Djemene ! ! ! Werekéla N8 N'Gai Ntom! ono Diadiekabougou ! ! Dalibougou !Siribila ! ! Barassafe Molodo-Centre Niono Tiemabougou ! Sirado ! Tallan ! ! Begn!inga ! ! Dando! ugou Toukoni Kounako Dossorola ! Salle Siguima ! Keke Magassi ! ! Kon!goy Ou!aro ! Dampha Ma!rela Bal!lala ! Dou!bala ! Segue D.T. -

Annex K List of Schools.Xlsx
Annex K‐ List of schools and number of materials to be distributed per school For Lots 1, 3 and 4, 4626 copies of each of the listed materials are to be delivered to the EDC/SIRA office in Bamako and 147,390 to individual schools listed below. This spreadsheet shows the names of the school, the number of materials to be delivered at the schools and the distance to each school from the CAP. Distance from Number of the District materials to be Education Office Regional District distributed to (CAP) to the Education Education individual schools school No. REGION Office (AE) Office (CAP) Commune Village / Neighborhood Name of School (Grade 2 students) (Kilometers) 1 KOULIKORO DIOILA BELEKO DIEDOUGOU BADIANA BOUGOUDABA BADIANA BOUGOUDABA 19 18 2 KOULIKORO DIOILA BELEKO BENKADI N'TIA N'TIA 17 15 3 KOULIKORO DIOILA BELEKO BENKADI KISSAKORO KISSAKORO 7 17 4 KOULIKORO DIOILA BELEKO JÈKAFO ZAMBOUGOU ZAMBOUGOU 35 22 5 KOULIKORO DIOILA BELEKO BENKADI KOTOULA KOTOULA 1ER C 41 10 6 KOULIKORO DIOILA BELEKO BENKADI WANI WANI 18 10 7 KOULIKORO DIOILA BELEKO BENKADI WO WO 1ER C 24 21 8 KOULIKORO DIOILA BELEKO BENKADI N'TIA N'TIA DOUGOUTIGUILA 55 15 9 KOULIKORO DIOILA BELEKO BENKADI NIANGUÉLA NIANGUÉLA 48 13 10 KOULIKORO DIOILA BELEKO DIÈBÈ DIEBE DIÈBÈ 1ER C 69 57 11 KOULIKORO DIOILA BELEKO DIÈBÈ DIONOGON DIONOGON 47 40 12 KOULIKORO DIOILA BELEKO DIÈBÈ ZANZOUNA ZANZOUNA 24 25 13 KOULIKORO DIOILA BELEKO DIÈBÈ DOUGAZANA DOUGAZANA 30 38 14 KOULIKORO DIOILA BELEKO DOLENDOUGOU DANDOUGOU DANDOUGOU 1ER C 25 15 15 KOULIKORO DIOILA BELEKO DIEDOUGOU BÉLÉKO BÉLÉKO -
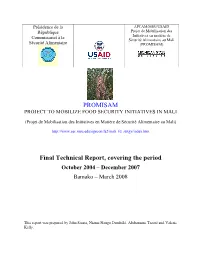
PROMISAM Final Technical Report, Covering the Period
Présidence de la APCAM/MSU/USAID République Projet de Mobilisation des Commissariat à la Initiatives en matière de Sécurité Alimentaire au Mali Sécurité Alimentaire (PROMISAM) PROMISAM PROJECT TO MOBILIZE FOOD SECURITY INITIATIVES IN MALI (Projet de Mobilisation des Initiatives en Matière de Sécurité Alimentaire au Mali) http://www.aec.msu.edu/agecon/fs2/mali_fd_strtgy/index.htm Final Technical Report, covering the period October 2004 – December 2007 Bamako – March 2008 This report was prepared by John Staatz, Niama Nango Dembélé, Abdramane Traoré and Valerie Kelly. PROMISAM Bamako Office ACI 2000, rue 339, porte 158 Hamdallaye Bamako, Mali Tel.: +223 222 34 19 Fax: +223 223 34 82 Name Position Email Nango Dembélé Director, COP [email protected] Abdramane Traore Project Assistant [email protected] Maïmouna Traore Admin. Asst./ Accountant [email protected] Office in the US: Department of Agricultural Economics Michigan State University 202 Agriculture Hall East Lansing, MI 48824-1039 Tel.: +1-517-355-1519 Fax: +1-517-432-1800 Contact Persons Position Email John Staatz Co-Director & Professor [email protected] Valerie Kelly Associate Professor, International Development [email protected] TABLE OF CONTENTS Executive Summary...................................................................................................................... ii 1. Background and Objectives .................................................................................................. 1 1.1 Background and Context ...............................................................................................