La 317E Section
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Johnny Hallyday 1 Johnny Hallyday
Johnny Hallyday 1 Johnny Hallyday Johnny Hallyday Johnny Hallyday au festival de Cannes 2009. Données clés Nom Jean-Philippe Smet Naissance 15 juin 1943 Paris Pays d'origine France Activité principale Chanteur Activités annexes Acteur Genre musical RockBluesBalladeRock 'n' rollVariété françaiseRhythm and bluesPopCountry Instruments Guitare Années d'activité Depuis 1960 Labels Vogue Philips-Phonogram-Mercury-Universal Warner [1] Site officiel www.johnnyhallyday.com Johnny Hallyday 2 Composition du groupe Entourage Læticia Hallyday David Hallyday Laura Smet Eddy Mitchell Sylvie Vartan Nathalie Baye Johnny Hallyday, né Jean-Philippe Smet le 15 juin 1943 à Paris, est un chanteur, compositeur et acteur français. Avec plus de cinquante ans de carrière, Johnny Hallyday est l'un des plus célèbres chanteurs francophones et l'une des personnalités les plus présentes dans le paysage médiatique français, où plus de 2100 couvertures de magazines lui ont été consacrées[2]. Si Johnny Hallyday n'est pas le premier à chanter du rock 'n' roll en France[3], il est le premier à populariser cette musique dans l'Hexagone[4],[5]. Après le rock, il lance le twist en 1961 et l'année suivante le mashed potato (en)[6] et s'il lui fut parfois reproché de céder aux modes musicales[7], il les a toutefois précédées plus souvent que suivies. Les différents courants musicaux auxquels il s'est adonné, rock 'n' roll, rhythm and blues, soul, rock psychédélique, pop puisent tous leurs origines dans le blues. Johnny est également l'interprète de nombreuses chansons de variété, de ballades, de country, mais le rock reste sa principale référence[6]. -

Country Christmas ...2 Rhythm
1 Ho li day se asons and va ca tions Fei er tag und Be triebs fe rien BEAR FAMILY will be on Christmas ho li days from Vom 23. De zem ber bis zum 10. Ja nuar macht De cem ber 23rd to Ja nuary 10th. During that peri od BEAR FAMILY Weihnach tsfe rien. Bestel len Sie in die ser plea se send written orders only. The staff will be back Zeit bitte nur schriftlich. Ab dem 10. Janu ar 2005 sind ser ving you du ring our re gu lar bu si ness hours on Mon- wir wie der für Sie da. day 10th, 2004. We would like to thank all our custo - Bei die ser Ge le gen heit be dan ken wir uns für die gute mers for their co-opera ti on in 2004. It has been a Zu sam men ar beit im ver gan ge nen Jahr. plea su re wor king with you. BEAR FAMILY is wis hing you a Wir wünschen Ihnen ein fro hes Weih nachts- Merry Christmas and a Happy New Year. fest und ein glüc kliches neu es Jahr. COUNTRY CHRISTMAS ..........2 BEAT, 60s/70s ..................86 COUNTRY .........................8 SURF .............................92 AMERICANA/ROOTS/ALT. .............25 REVIVAL/NEO ROCKABILLY ............93 OUTLAWS/SINGER-SONGWRITER .......25 PSYCHOBILLY ......................97 WESTERN..........................31 BRITISH R&R ........................98 WESTERN SWING....................32 SKIFFLE ...........................100 TRUCKS & TRAINS ...................32 INSTRUMENTAL R&R/BEAT .............100 C&W SOUNDTRACKS.................33 C&W SPECIAL COLLECTIONS...........33 POP.............................102 COUNTRY CANADA..................33 POP INSTRUMENTAL .................108 COUNTRY -

Sommaire Catalogue National Octobre 2011
SOMMAIRE CATALOGUE NATIONAL OCTOBRE 2011 Page COMPACT DISCS Répertoire National ............................................................ 01 SUPPORTS VINYLES Répertoire National ............................................................. 89 DVD / HDDVD / BLU-RAY DVD Répertoire National .................................................... 96 L'astérisque * indique les Disques, DVD, CD audio, à paraître à partir de la parution de ce bon de commande, sous réserve des autorisations légales et contractuelles. Certains produits existant dans ce listing peuvent être supprimés en cours d'année, quel qu'en soit le motif. Ces articles apparaîtront de ce fait comme "supprimés" sur nos documents de livraison. NATIONAL 1 ABD AL MALIK Salvatore ADAMO (Suite) Château Rouge Master Serie(MASTER SERIE) 26/11/2010 BARCLAY / BARCLAY 20/08/2009 POLYDOR / POLYDOR (557)CD (899)CD #:GACFCH=ZX]\[V: #:GAAHFD=V^[U[^: Dante Zanzibar + La Part De L'Ange(2 FOR 1) 03/11/2008 BARCLAY / BARCLAY 19/07/2010 POLYDOR / POLYDOR (561)CD (928)2CD #:GAAHFD=VW]\XW: #:GAAHFD=W]ZWYY: Isabelle ADJANI Château Rouge Pull marine(L'ORIGINAL) 14/02/2011 BARCLAY / BARCLAY 08/04/1991 MERCURY / MERCURY (561)CD (949)CD #:GACFCH=[WUZ[Z: #:AECCIE=]Y]ZW\: ADMIRAL T Gibraltar Instinct Admiral 12/06/2006 BARCLAY / BARCLAY 19/04/2010 AZ / AZ (899)CD (557)CD #:GACEJI=X\^UW]: #:GAAHFD=W[ZZW^: Le face à face des coeurs Instinct Admiral(ECOPAK) 02/03/2004 BARCLAY / BARCLAY 20/09/2010 AZ / AZ (606)CD (543)CD #:GACEJI=VX\]^Z: #:GAAHFD=W^XXY]: ADAM & EVE Adam & Eve La Seconde Chance Toucher l'horizon -

TONYPAT... Co,Ltd
Fév 2018 N°12 Journal mensuel gratuit www.pattaya-journal.com TONYPAT... Co,ltd Depuis 2007 NOUVEAU ! Motorbike à louer YAMAHA avec assurance AÉROX 155CC NMAX - PCX & TOUT MODÈLE Des tarifs pour tous Livraison gratuite à partir les budgets d’une semaine de location Ouverture de 10h à 19h30, 7 jours sur 7 Tony Leroy Tonypat... Réservation par internet 085 288 6719 FR - 038 410 598 Thaï www.motorbike-for-rent.com [email protected] | Soi Bongkoch 3 Potage et Salade Bar Compris avec tous les plats - Tous les jours : Moules Frites 269฿ • Air climatisé - Internet • TV Led 32” Cablée ifféren d te • Réfrigérateur 0 s • Coffre-fort 2 b i s èr e es belg Chang RESTAURANT - BAR - GUESTHOUSE Pression Cuisine Thaïe Cuisine Internationale 352/555-557 Moo 12 Phratamnak Rd. Soi 4 Pattaya Tel : 038 250508 email: [email protected] www.lotusbar-pattaya.com Pizzas EDITO LA FÊTE DES AMOUREUX Le petit ange Cupidon armé d’un arc, un carquois et une fleur est de retour ce mois-ci. Il va décocher ses flèches d’argent en pagaille et faire encore des victimes de l’amour. Oui car selon la mythologie, quiconque est touché par les flèches de Cupidon tombe amoureux de la personne qu’il voit à ce moment-là. Moi par exemple... Je m’baladais sur l’avenue, le cœur ouvert à l’inconnu, j’avais envie de dire bonjour à n’importe qui, n’importe qui et ce fut toi, je t’ai dit n’importe quoi, il suffisait de te parler, pour t’apprivoiser.. -

Ce Document Est Extrait De La Base De Données Textuelles Frantext Réalisée Par L'institut National De La Langue Française (Inalf)
Ce document est extrait de la base de données textuelles Frantext réalisée par l'Institut National de la Langue Française (InaLF) [La] tentation de Saint-Antoine [Document électronique] : [version de 1849] / Gustave Flaubert I p205 Messieurs les démons, laissez-moi donc ! Messieurs les démons, laissez-moi donc ! mai 1848. -septembre 1849. G Flaubert. Sur une montagne. à l' horizon, le désert ; à droite, la cabane de saint Antoine, avec un banc devant sa porte ; à gauche, une petite chapelle de forme ovale. Une lampe est accrochée au-dessus d' une image de la sainte vierge ; par terre, devant la cabane, corbeilles en feuilles de palmiers. Dans une crevasse de la roche, le cochon de l' ermite dort à l' ombre. Antoine est seul, assis sur le banc, occupé à faire ses paniers ; il lève la tête et regarde vaguement le soleil qui se couche. Antoine. Assez travaillé comme cela. Prions ! Il se dirige vers la chapelle. Tout à l' heure ces lianes tranchantes m' ont coupé les mains... p206 quand' ombre de la croix aura atteint cette pierre, j' allumerai la lampe et je commencerai mes oraisons. Il se promène de long en large, doucement, les bras pendants. Le cel est rouge, le gypaète tournoie, les palmiers Livros Grátis http://www.livrosgratis.com.br Milhares de livros grátis para download. frissonnent ; sur la crotte de porc voilà les scarabées qui se traînent ; l' ibis a fermé son bec pointu et la cigogne blanche, au sommet des obélisques, commence à s' endormir la tête passée sous son aile ; la lune va se lever. -

Johnny Hallyday-Clémence
« PROF EUROPE EN CHANTANT 92 » Chers Collègues, veuillez trouver ci-joint la quatrième fiche pédagogique élaborée lors de la Formation COFRAN à Bielsko-Biała le samedi 17 septembre 2005, organisée par Renata KLIMEK-KOWALSKA coordinatrice COFRAN pour la Silésie et Beata HONKISZ pour Bielsko-Biała, et moi-même pour le module « CHANSON FRANÇAISE ET FLE ». Bonne lecture ! Richard SORBET [email protected] . Fiche « On a tous besoin d’amour » - Johnny Hallyday-Clémence Auteur : Jean Paul Dréau ; Musique : Saint-Preux (2001). Note : Extrait de la comédie musicale « Jeanne la romantique ». Fiche réalisée par Maria JAROSZ de Katowice, Agata JURASZEK de Milówka, Barbara BISKUP et Magdalena MARSZAŁ de Bielsko-Biała (Pologne) - Niveau-avancé - Temps – 90 minutes Objectifs linguistiques : - Expression orale : exprimer ses sentiments envers les autres (amitié, amour, chagrin). - Lexique : découvrir les expressions liées au besoin d’amour, d’amitié. Thèmes abordés : Le besoin d’amour. Vocabulaire : - Avoir besoin de qch –désirer avoir qch qui est nécessaire. - La détresse – la tristesse. - Faute de mieux – si on a pas la possibilité de qch d’autre. - Se taire – arrêter de parler. 1 Ex.1 Mise en route : À deux : - Quel est le rôle de l’amour et de l’amitié dans votre vie ? - Est-ce que vous pouvez vous imaginer la vie en solitaire, sans amis, sans famille ? Ex.2 Avec les paroles : - Qu’est-ce qui est le plus important dans la vie du narrateur ? - Comment exprime-t-il ses sentiments ? Ex. 3 Expression orale, en petits groupes : - Qu’est-ce que c’est l’amour pour vous ? Quelle est votre définition ? - Est-il possible d’aimer sans responsabilité, sans patience, sans fidélité ? - Quels sont les différents genres d’amour ? (Paternel, filial etc) Ex.4 Exercice à trous. -

SAMEDI 17 MAI 2014 Détail Des Lots 75 Et 77
SAMEDI 17 MAI 2014 Détail des lots 75 et 77 — 2 — VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES JOHNNY HALLYDAY 50 ans de collection Disques Vidéos Livres Revues, magazines, BD & journaux Affiches, publicité & divers Collection particulière Samedi 17 mai 2014 à 10h et à 14h Hôtel des ventes Bordeaux Sainte - Croix SOMMAIRE Ière partie - DISQUES 1) Disques vinyles 45T EP et SP ..... p.7 (Vogue et Philips) 2) Disques vinyles 33T .................. p.10 (25 cm et 30 cm) 3) Disques maxi 45T ..................... p.13 (2 titres) 4) Disques Live / en public ........... p.14 5) Disques vinyles compilations .... p.16 6) Coffrets vinyles et CD .............. p.17 7) Disques étrangers 45T et 33T .... p.19 8) CD ........................................... p.27 9) CD promo et hors commerce ... p.29 IIème partie - DVD 1) DVD concert live ..................... p.32 2) DVD cinéma / TV / série ......... p.33 3) VHS ......................................... p.33 IIIème partie - LIVRES ............. p.34 IVème partie - REVUES ............ p.38 MAGAZINES / BD / JOURNAUX Vème partie - AFFICHES PUBLICITE / VARIA 1) Affiches.................................. p.39 2) Publicité et PLV ...................... p.40 3) Vêtements .............................. p.40 4) Vins ........................................ p.40 5) Varia ....................................... p.40 Concert Alhambra de Bordeaux Avril 1968 Crédit photo : Reporter Photo — 4 — HÔTEL DES VENTES Bordeaux SAINTE - CROIX 12-14, rue Peyronnet - 33800 Bordeaux Société de ventes Volontaires ABB (Agrément 2002 304) Contact -

Monsieur Lecoq Par Émile Gaboriau L'enquête
MONSIEUR LECOQ L’ENQUÊTE « Digitized by Google OUVRAGES du' MÊME AUTEUR Formai crand lo-l8j£sui I L’affairk Lerouce, 5* édition, i vol r)0 Le Crime d’Ohcival, h* édit. 1 voi âc Le Dossier N° 113. 6* édit ;i ;>(i Les Esclaves de Paris, 3* édit., 2 vol 7 > Les Mariages d'avextüues, 2' édil. 1 vol » 5' .' Les CoriLLOtis célèdres, édit. 2 vol. G « Les Comédiën.nes adorées, 2' édil. 1 vol 3 •> Le Treizième uüssard, 16' édit. 1 vol .’> » Les Gens de bureau, 2' édil. 1 vol. » ^ Imprimerie de Ë. Donnaud, rue Cussetlo, Digitized by Google MONSIEUR LECOO PAR é • ÉMILE GABORIAU . I L'ENQUÊTE PARIS K. DENTIJ, EüITEUU MBnAlllK DE LA SOCIETE DES GENS DE LETTRES l.\l.4ls•ltoYAI,, 17 r.T 19, (;ai.fhie d’ürlIays Tous droits r<:servés. Digiiized by Google 1? Am i9C3 5 6 , 5 - 5 ^ I Digitized by Google A M. ALPHONSE MILLAUD DiMcnUH DU PETIT JOURKAL Ce n'est pas à vous, Monsieur le Directeur, que foffre c: volume... Je le dédie à l’ami de tous les jours, à vous, mon cher Alphonse, comm^ un témoignage de la vive et sincère affection De votre dévoué ÉMILE GABOllIAU. Digitized by Google Digitized by Google MONSIEUR LECOQ 4 \ PREMIÈRE PARTIE L’ENQUÊTE 4- 1 Le 20 février 18.., im dimanclie, qui se trouvait être le dimanche gras, sur les onze heures du soir, une ronde d’agents du service de la sûreté sortait du poste de police de l’ancienne barrière d’Italie. La mission de cette ronde était d’explorer ce vaste quartier qui s’étend de la route de Fontainebleau à iu’ ‘ Seine, depuis les boulevards extérieurs jusqu’aux fbrti- fnations. -

Gesture, Affect and Rhythmic Freedom in the Performance of French Tragic Opera from Lully to Rameau Wentz, J.A
The relationship between gesture, affect and rhythmic freedom in the performance of French tragic opera from Lully to Rameau Wentz, J.A. Citation Wentz, J. A. (2010, December 9). The relationship between gesture, affect and rhythmic freedom in the performance of French tragic opera from Lully to Rameau. Retrieved from https://hdl.handle.net/1887/16226 Version: Not Applicable (or Unknown) Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the License: Institutional Repository of the University of Leiden Downloaded from: https://hdl.handle.net/1887/16226 Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable). The Relationship between Gesture, Affect and Rhythmic Freedom in the Performance of French Tragic Opera from Lully to Rameau by Jed Wentz 1 The relationship between gesture, affect and rhythmic freedom in the performance of French tragic opera from Lully to Rameau Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Universiteit Leiden, op gezag van Rector Magnificus prof.mr. P.F. van der Heijden, volgens besluit van het College voor Promoties te verdedigen op donderdag 9 december 2010 klokke 11:15 uur door Jed Wentz, geboren te Beaver Falls, Pa. U. S. A. in 1960 2 Promotiecommissie Promotores Prof. F.C. de Ruiter Prof. Dr. R. Harris-Warrick (Cornell University) Overige Leden Prof. Dr. D.D. Breimer Prof. Dr. A.G.M. Koopman Prof. Dr. L. Rosow (The Ohio State University) Prof. Dr. G. Sadler (University of Hull) Prof. Dr. W.A. Wagenaar 3 TABLE OF CONTENTS Introduction 6 Chapter 1 Utilia non -
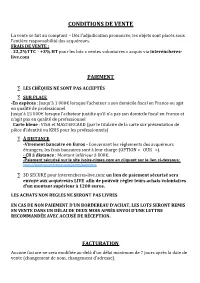
4D Write-Sanstitre
CONDITIONS DE VENTE La vente se fait au comptant - Dès l’adjudication prononcée, les objets sont placés sous l’entière responsabilité des acquéreurs. FRAIS DE VENTE : - 22,2%TTC - +3% HT pour les lots « ventes volontaires » acquis via interencheres- live.com PAIEMENT ∑ LES CHÈQUES NE SONT PAS ACCEPTÉS ∑ SUR PLACE -En espèces : Jusqu’à 1 000€ lorsque l’acheteur a son domicile 8iscal en France ou agit en qualité de professionnel Jusqu’à 15 000€ lorsque l’acheteur justi8ie qu’il n’a pas son domicile 8iscal en France et n’agit pas en qualité de professionnel - Carte bleue : VISA et MASTERCARD (par le titulaire de la carte sur présentation de pièce d’identité ou KBIS pour les professionnels) ∑ À DISTANCE -Virement bancaire en Euros - Concernant les règlements des acquéreurs étrangers, les frais bancaires sont à leur charge (OPTION « OUR »). - CB à distance : Montant inférieur à 800€. -Paiement sécurisé sur le site ivoire-nimes.com en cliquant sur le lien ci-dessous: h"ps://www.ivoire-france.com/nimes/paiement ∑ 3D SECURE pour interencheres-live.com: un lien de paiement sécurisé sera envoyé aux acquéreurs LIVE a9in de pouvoir régler leurs achats volontaires d’un montant supérieur à 1200 euros. LES ACHATS NON REGLES NE SERONT PAS LIVRES EN CAS DE NON PAIEMENT D’UN BORDEREAU D’ACHAT, LES LOTS SERONT REMIS EN VENTE DANS UN DÉLAI DE DEUX MOIS APRÈS ENVOI D’UNE LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION. FACTURATION Aucune facture ne sera modi0iée au-delà d’un délai maximum de 7 jours après la date de vente (changement de nom, changement d’adresse). -
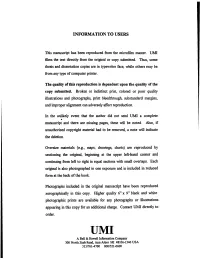
Information to Users
INFORMATION TO USERS This manuscript has been reproduced from the microfilm master. UMI films the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in typewriter face, while others may be from any type of computer printer. The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are reproduced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand comer and continuing from left to right in equal sections with small overlaps. Each original is also photographed in one exposure and is included in reduced form at the back of the book. Photographs included in the original manuscript have been reproduced xerographically in this copy. Ifigher quality 6” x 9” black and white photographic prints are available for any photographs or illustrations appearing in this copy for an additional charge. Contact UMI directly to order. UMI A Bell & Howell Information Company 300 North Zeeb Road, Arm Arbor MI 48106-1346 USA 313/761-4700 800/521-0600 This dissertation has been 64—13,342 microfilmed exactly as received TOLSON, Jr., Melvin Beaunorous, 1923-, THE ROMANS AND RECITS OF RENE MARAN. The University of Oklahoma, Ph.D., 1964 Language and Literature, modem University Microfilms. -

ISBN-0-898535-9 PUB DATE Feb 80 NOTE 30715.; Fbr the -Other Volumes
o DOCUMENT RESUME 1.40-ATc ED 260 001 SO 016 72 0 AUTHOR Mart.in, .Andre, Comp. TITLE I A Franco-American Overview. Volume 2.. Midwest and West. INSTITUTION National Assessment and Dissemination Centee for Bilingual EducStioW, Cambridge, Mass.; National Materiali Development ,Center for)rrench and Portuguese, Bedford, . r SPONS. AGENCY Department ofaEducat:Ion, Washington; DC. REPORT NO ISBN-0-898535-9 PUB DATE Feb 80 NOTE 30715.; Fbr the -other volumes. in this series, see SO. 0i6 725-730. Three chapters are presented in French. PUB TYPE .Historical Materials ow .-- - ,'Viewpoints (420) Collected Works General (020) EDRS PRICE 'MF01/PCI3 Plus Postage.' DESCRIPTORS *Acculturation. Biculturalismi.Colonial History (UnitedStatemir;*Cross Cultural Studies; *Cultural Education; *Cultural'Influences; Cultural Pluralism; Culture; Ethnic Groups; Land Settlement; MigrAtion; Social History; Social Studies; Subcultures; United States History IDENTIFIERS A California; *Franco Americansi.,French (Canadian); French Culture; Fur Trade; Huguenots; Louisiana; Michigan (Detroit); Minnesota;. South Carolina; United States (Midwest; *United States (West); Wisconsin ABSTRACT Intended to help readers develop an.appfeciatidn of the contributions of Franco-Americans to the culturalheritagk,pf the United States, this book( the second of six volumes, presents 15. readings representing many perspectives--from the historical to the b. sociologiCal--illustrating'the thinking and feelings of those in the forefront of Franco-American studies) .ThisivOlume focuses on