L'articulation De L'architecture Et Les Téchnologies Du Numériques
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
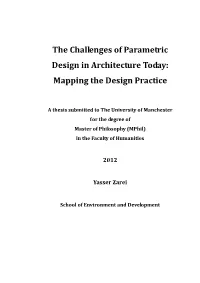
The Challenges of Parametric Design in Architecture Today: Mapping the Design Practice
The Challenges of Parametric Design in Architecture Today: Mapping the Design Practice A thesis submitted to The University of Manchester for the degree of Master of Philosophy (MPhil) in the Faculty of Humanities 2012 Yasser Zarei School of Environment and Development Table ooofof Contents CHAPTER 1: INTRODUCTION Introduction to the Research ....................................................................................................................... 8 CHAPTER 2: THE POSITION OF PARAMETRICS 2.1. The State of Knowledge on Parametrics ............................................................................................. 12 2.2. The Ambivalent Nature of Parametric Design ..................................................................................... 17 2.3. Parametric Design and the Ambiguity of Taxonomy ........................................................................... 24 CHAPTER 3: THE RESEARCH METHODOLOGY 3.1. The Research Methodology ................................................................................................................ 29 3.2. The Strategies of Data Analysis ........................................................................................................... 35 CHAPTER 4: PARAMETRIC DESIGN AND THE STATUS OF PRIMARY DRIVERS The Question of Drivers (Outside to Inside) ............................................................................................... 39 CHAPTER 5: MAPPING THE ROLES IN THE PROCESS OF PARAMETRIC DESIGN 5.1. The Question Of Roles (Inside to Outside) -

Teori Arsitektur 03
•Victorian architecture 1837 and 1901 UK •Neolithic architecture 10,000 BC-3000 BC •Jacobethan 1838 •Sumerian architecture 5300 BC-2000 BC •Carpenter Gothic USA and Canada 1840s on •Soft Portuguese style 1940-1955 Portugal & colonies •Ancient Egyptian architecture 3000 BC-373 AD •Queenslander (architecture) 1840s–1960s •Ranch-style 1940s-1970s USA •Classical architecture 600 BC-323 AD Australian architectural styles •New towns 1946-1968 United Kingdom Ancient Greek architecture 776 BC-265 BC •Romanesque Revival architecture 1840–1900 USA •Mid-century modern 1950s California, etc. Roman architecture 753 BC–663 AD •Neo-Manueline 1840s-1910s Portugal & Brazil •Florida Modern 1950s or Tropical Modern •Architecture of Armenia (IVe s - XVIe s) •Neo-Grec 1848 and 1865 •Googie architecture 1950s USA •Merovingian architecture 400s-700s France and Germany •Adirondack Architecture 1850s New York, USA •Brutalist architecture 1950s–1970s •Anglo-Saxon architecture 450s-1066 England and Wales •Bristol Byzantine 1850-1880 •Structuralism 1950s-1970s •Byzantine architecture 527 (Sofia)-1520 •Second Empire 1865 and 1880 •Metabolist Movement 1959 Japan •Islamic Architecture 691-present •Queen Anne Style architecture 1870–1910s England & USA •Arcology 1970s-present •Carolingian architecture 780s-800s France and Germany Stick Style 1879-1905 New England •Repoblación architecture 880s-1000s Spain •Structural Expressionism 1980s-present Eastlake Style 1879-1905 New England •Ottonian architecture 950s-1050s Germany Shingle Style 1879-1905 New England •Postmodern architecture 1980s •Russian architecture 989-1700s •National Park Service Rustic 1872–present USA •Romanesque architecture 1050-1100 •Deconstructivism 1982–present •Chicago school (architecture) 1880s and 1890 USA •Norman architecture 1074-1250 •Memphis Group 1981-1988 •Neo-Byzantine architecture 1882–1920s American •Blobitecture 2003–present •Gothic architecture •Art Nouveau/Jugendstil c. -

Mapping the Stylistic Affiliations of Le Corbusier's Work 0.1 Prologue
Le Corbusier, 50 years later International Congress Valencia 18th-20lli November 2015 DOI: http://dx.doi.org/10.4995/LC2015.2015.799 Mapping the Stylistic Affiliations of Le Corbusier's Work P. Ilias Panigyrakis TU Delft, School of Architecture and the Built Environment Abstract: The paper deals with Le Corbusier's connection to the term "style". A classification of his work in specific architectural styles is discussed, followed by a description of the procedure through which the style ofthe man Le Corbusier was constructed; in an attempt to search meaning in his continual stylistic shifts and the rationale that kept his lifetime's work and identity strongly compact when we consider him retrospectively. Resiimen: El articulo trata la conexión de Le Corbusier con el lérmino ëstilo'.'Se disciite una clasificación de su obra en estilos arqiiitectónicos especificos, seguido de una descripción de los procedimientos a través del ciial el hombre fiie construido al estilo de Le Corbusier; un intento de büsqueda de sentido en siis camhios estilisticos contimias y las razones que mantuvo el trabajo y la identiclad de su vida fuertemente compacta, cuando lo consideramos retrospectivamente Keywords: Le Corbusier; Style; Stylistic Shifts. Palabras clave: Le Corbusier; Estilo; Cambios Estilisticos. 0.1 Prologue It is said that Le Corbusier used to keep a picture of his 1914 Maison Dom-ino scheme side by side with a picture ofthe Parthenon from his 1911 visit in Athens. It is also known that he viciously fought against the talk of styles m the architectural discourse. How should we interpret then the above mentioned coupling of Dom-mo, the epitome of technique of the 20th century architecture, along with the Parthenon, the most imitated object of any iconographic style prior to Modernism? This research will argue for the stylistic affiliations of Le Corbusier's work in an attempt to map the trajectory of architectural forms applied hi the extensive work ofthe legendary architect. -
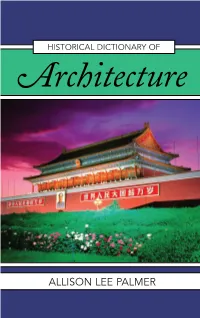
Historical Dictionary of Architecture
ARTS • ARCHITECTURAL HISTORY Historical Dictionaries of Literature and the Arts, No. 29 PALMER HISTORICAL DICTIONARY OF Architecture, which can be understood in its most basic sense as a form of enclosure created with an aesthetic intent, first made its appearance in the Prehistoric Age. From its earliest developments, architecture changed over time and in different cultures in response to changing cultural needs, aesthetic interests, materials, and techniques. Architecture The Historical Dictionary of Architecture provides information on architects HISTORICAL such as Frank Lloyd Wright, Tadao Ando, Leon Battista Alberti, Filippo DICTIONARY Brunelleschi, Michelangelo, and Konstantin Stepanovich Melnikov, as well as OF A on famous structures such as the Acropolis, the Colosseum, the Forbidden City, Machu Pichu, Notre Dame, the Pyramids of Giza, Stonehenge, and the World Trade Center. The dictionary examines the development of architecture rchitecture over the centuries through a chronology, an introductory essay, a bibliography, and hundreds of cross-referenced dictionary entries on the major architects, well-known buildings, time periods, styles, building types, and materials in world architecture. Allison Lee Palmer is professor of art history at the University of Oklahoma. For orders and information please contact the publisher SCARECROW PRESS, INC. A wholly owned subsidiary of The Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc. 4501 Forbes Boulevard, Suite 200 ISBN-13: 978-0-8108-5821-3 Lanham, Maryland 20706 ISBN-10: 0-8108-5821-5 1-800-462-6420 • fax 717-794-3803 ALLISON LEE PALMER www.scarecrowpress.com COVER IMAGE © SCPHOTOS / ALAMY HD Architecture.indd 1 8/11/08 11:16:24 AM Historical Dictionaries of Literature and the Arts Jon Woronoff, Series Editor 1. -

Architectsnewspaper 6.8.2004 Going to Seed
lit ARCHITECTSNEWSPAPER MoMA 049695 6.8.2004 06/16 $3.95 WWW.ARCHPAPER.COM $3.95 00 —I DILLER SCOFIDIO LU + RENFRO: NYC'S NEW URBAN O MASTERMINDS SUMMER READING REM FOR PRESIDENT? EAVESDROP USA 37 CURBSIDE DIARY CLASSIFIEDS ARCHITECTURE AND DESIGN SHOPTALK FEATURED ON NEW BATCH OF STAMPS MODERNIST GARDENS IN THE New York's modernist open spaces, such VILLAGE UNDER THREAT as the plaza of the Seagram Building and the courtyard of the Lever House, are well known, NEW LAW TO REQUIRE Bucky s Dome but the city's legacy of modernist gardens is MANDATORY CERTIFICATION more obscure and potentially under threat. FOR INTERIOR DESIGNERS R. Buckminster Fuller's bald geodesic head In Greenwich Village, two major examples— is about to appear on 96 million first-class GOING the formal garden that I. M. Pei designed in INTERIOR postage stamps. In addition to Bucky's 1965 to accompany his University Village tessellated head, the designs of Isamu towers between Houston, La Guardia and Noguchi, McKim, Mead, and White, Walter Bleecker streets, and the adjacent Washington DESIGNERS Netsch and Skidmore Owings and Merrill Square Village designed in 1959 by land• (SOM), and Rhode Island architect scape architecture firm Sasaki, Walker and GET SERIOUS Friedrich St. Florian will be appear on TO Associates—face uncertain futures. Both stamps this summer. surround New York University housing. The United States Postal Service (USPS) Apart from its value as a leafy respite, the The old turf dispute between New York receives nearly 50,000 requests a year for gardens of University Village are noteworthy. -

Art Deco Complete: the Definitive Guide to the Decorative Arts of the 1920S and 1930S Free Download
ART DECO COMPLETE: THE DEFINITIVE GUIDE TO THE DECORATIVE ARTS OF THE 1920S AND 1930S FREE DOWNLOAD Alastair Duncan | 544 pages | 01 Oct 2009 | Harry N. Abrams | 9780810980464 | English | New York, NY, United States About For Books Art Deco Complete: The Definitive Guide to the Decorative Arts of the 1920s and Ian Allan. De Morant, Henry Raymond Templier designed pieces with highly intricate geometric patterns, including silver earrings that looked like skyscrapers. Late Art Deco wallpaper and textiles sometimes featured stylized industrial scenes, cityscapes, locomotives and other modern themes, as well as stylized female figures, metallic colors and geometric designs. A particular Miami Art Deco feature is the palette of pastel colors, alternating with white stucco. French furniture from until the early s was largely an updating of French traditional furniture styles, and the art nouveau designs of Louis MajorelleCharles Plumet and other manufacturers. Ceres was chosen because the Chicago Board of Trade was one of the largest grain and commodities markets in the world. May Learn how and Art Deco Complete: The Definitive Guide to the Decorative Arts of the 1920s and 1930s to remove this template message. The San Francisco Maritime Museum Radio City Music Halllocated within the skyscraper complex of Rockefeller Center in New York City, was originally a theater for stage shows when it opened inbut it quickly changed to a movie theater, the largest in the United States. While the skyscraper Art Deco style was mostly used for corporate office buildings, it also became popular for government buildings, since all city offices could be contained in one building on a minimal amount of land. -
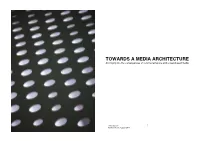
TOWARDS a MEDIA ARCHITECTURE an Inquiry Into the Convergencies of Constructed Space and Screen-Based Media
TOWARDS A MEDIA ARCHITECTURE An inquiry into the convergencies of constructed space and screen-based media Tobias Ebsen 1 Masterʼs thesis, August 2010 CONTENTS CONCLUDING REFLECTIONS ............................................................95! SUMMARY ............................................................................................98! REFERENCES....................................................................................101! NOTES................................................................................................105! INTRODUCTION.....................................................................................4! Scope...................................................................................................5! Background..........................................................................................7! Technology or culture ........................................................................11! Current discourse ..............................................................................12! ARCHITECTURE AND ITS EVOLUTION AS A VISUAL MEDIUM.......15! Form and surface...............................................................................17! Speaking through form ......................................................................18! Speaking through surface..................................................................21! The semiotics of architecture: function and symbolism .....................27! Aesthetic ambiguity ...........................................................................29! -

Architecture Moderne Après Le Moderne
Architecture moderne Après le moderne Cours 6 Omar Hassouni 1 • Timeline et interprétationPlan de l’exposé • Quand l’architecture contemporaine est totalement livrée à elle-même • Critique du courant moderne et du style international • Tendances de l’architecture contemporaine – Néo-corbusianistes – High-tech – Post-modernisme – Déconstructivisme – Néo-classique – Minimalisme – Pop Art – Blobitecture – Autres Timeline et interprétation • D’une manière ou d’une autre, toutes les tendances de la deuxième moitié du XXème siècle continuent de coexister de manière souvent anarchique dans les villes du monde entier • Tout dépend des goûts et des désiratas des promoteurs et des architectes • Le public continue de faire le jeu du choqué- surpris-habitué-compréhensif-admirateur- défenseur- ’en-redemandeur’ • La confusion généralisée semble être la règle ! 500 AD 1000 AD 1500 AD 2000 AD Small Tribal Groups (10.000 BC- 200 AD) Tradingslink India – China (200-600) Tarumanegara (358-669) Sriwijaya (abad ke-7 – ke-13) Majapahit (1293-1500) Mataram (1500-1700) Portugis (1512-1800) VOC (1600 -1800) Belanda (1800-1942) Jepang (1942-1945) Independence (1945-…) http://snpratt.wordpress.com/author/snpratt/ • L’histoire de l’architecture et de l’urbanisme modernes a connu une accélération durant les années après la deuxième guerre mondiale • Plusieurs courants et tendances contradictoires ont vu le jour • Un nouvel éclectisme est apparu Evolution de l’architecture après la deuxième guerre mondiale • Durant les années 1950-1960 : le principal objectif était -

Rebuilding Biophilia
Rebuilding Biophilia Brendan Russell Dillon Master of Architecture Thesis 2007-2008 A Thesis submitted to the Division of Research and Advanced Studies of the University of Cincinnati in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Architecture in the School of Architecture and Interior Design of the College of Design, Architecture, Art, and Planning May 30, 2008 By: Brendan Russell Dillon Bachelor of Fine Arts in Architectural Design, June 2004 Massachusetts College of Artificial Committee Chairs: First Chair: George Thomas Bible Second Chair: Elizabeth Riorden Rebuilding Biophilia: Reconnecting Man with Nature through Architectural Design Biophilic design balances human needs with the value and considerations of natural environments and processes and incorporates aspects and qualities of those elements into architectural design. This serves to reinforce man's instinctual connection and relationship with those systems. There are two basic, symbiotic, motivations for reinforcing this relationship. First, a strong biophilic relationship with the environment has many beneficial effects on human health on the physical, psychological and intellectual levels. The second reason is that a strong relationship with the environment will result in people acting in a manner that is conducive to the environment’s preservation, as a result of having formed a personal relationship with it and having gained an appreciation of its value. Biophilic design nurtures these relationships through the use of five basic principles: affiliation -

Media Matrasain 20 Blobitecture
MEDIA MATRASAIN VOL 9 NO 2 AGUSTUS 2012 BLOBITECTURE Oleh : Sgerlen M. Tunas1, Johanes Van Rate2 (1Mahasiswa Prodi Arsitektur, Fakultas Teknik. Universitas Sam Ratulangi) (2Staf Pengajar Prodi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Sam Ratulangi) ABSTRAK Blobitecture merupakan eksplorasi bentuk dari gaya arsitektur organik yang menjadi salah satu gaya dalam desain arsitektur dengan bentukan yang organik, tampak hidup, berbentuk aneh seperi gumpalan. yang menggunakan alat bantu perangkat lunak komputer dalam penyempurnaan kualitas desain. Blobitecture menjadi salah satu strategi pendekatan perancangan yang dapat menghasilkan sebuah rancangan arsitektur yang representatif dan tereksplorasi dengan baik, yang ditinjau dari segi bentuk maupun fungsinya serta ciri khas tertentu sebagai suatu rancangan arsitektur. Kata Kunci : Blobitecture, eksplorasi bentuk PENDAHULUAN penulisan karya ilmiah dengan Tema : Dalam perkembangan perancangan “Blobitecture” ini. arsitektur telah mengalami pergeseran dalam Tulisan ini bertujuan membahas essensi setiap paradigma-paradigma baru tentang semua hal yang berhubungan dengan dalam arsitektur yang telah mencerminkan “blobitecture” itu sendiri, sebagai salah satu perubahan seiring dengan perkembangan issue tematik, selain itu juga coba dihadirkan teknologi yang kian maju. kajian-kajian tematik yang berlandaskan Hadirnya konsep blobitecture telah oleh beberapa referensi sumber-sumber data menjadi salah satu karya rancangan yang ada untuk digunakan sebagai suatu arsitektur yang mampu menjadi daya tarik konsep -
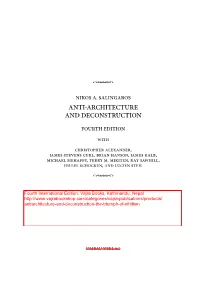
Anti-Architecture and Deconstruction
o Nikos A. SaliNgAros ANTi-ArCHiTECTUrE AND DECoNsTrUCTION FoUrth EDiTioN with christopher alexander, james stevens curl, brian hanson, james kalb, michael mehaffy, terry m. mikiten, Ray Sawhill, hillel schocken, and lucien steil o umbau-verlag ACkNowledgment Grateful acknowledgment is made for permission to reprint the following material, which originally appeared in various journals, both printed and online. “TheChessboard Model of Architectural Styles” was originally published in Italian in Il Covile, No. 320 (April 2006), English translation by the author. “The Danger of Deconstructivism” first appeared in Italian in Temi di Stefano Borselli (February 2003); English version in 2Blowhards (March 2003). A much shortened version of “Charles Jencks and the New Paradigm in Architecture” appeared in Chaos & Complexity Letters Volume 3 (2004); the present full version is previously unpublished. “Deconstructing the Decons” in PLANetizen (January 2003); shorter version in The American Enterprise, Volume 13, No. 2 (March 2003), page 13; Spanish version in AMBIENTE Revista 90 (March 2003). “Death, Life, and Libeskind” published in Architectural Record Online — In the Cause of Architecture (February 2003); shortened version in 2Blowhards (January 2003), reprinted with permission from ArchitecturalRecord. com. Postscripts are hitherto unpublished. Book review of Anthony Vidler’s “Warped Space. Art, Architecture, and Anxiety in Modern Culture” in Journal of Urban Design, Volume 6 (2001), pages 332-334, reprinted with permission from Carfax Publishing, Taylor & Francis Ltd. “Twentieth-Century Architecture as a Cult” in INTBAU Volume 1, Essay Number 3 (November 2002). Postscript is unpublished. “Anti-architecture and Religion” first appeared in Portuguese in Brotéria (Lisbon) Volume 155 (November 2002), pages 381-388; English version in Sacred Architecture, Issue 7 (Fall/Winter 2002), pages 11-13, reprinted with permission from The Institute for Sacred Architecture. -

Anti-Architecture and Deconstruction
o NIKOS A. SALINGAROS ANTI-ARCHITECTURE AND DECONSTRUCTION: THE TRIUMPH OF NIHILISM FOURTH EDITION with christopher alexander, james stevens curl, brian hanson, james kalb, michael mehaffy, terry m. mikiten, Ray Sawhill, hillel schocken, and lucien steil o SUSTASIS PRESS “Anti-Architecture and Deconstruction: The Triumph of Nihilism”, Fourth Edition, by Nikos A. Salingaros Published by: Sustasis Foundation, Portland, Oregon (USA) Formatted by Harald Gottfried, Umbau-Verlag, Solingen (Germany) Printed in Europe (by MijnBestseller.nl) © Author, 2004, 2007, 2008, 2014. All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any means, electronic or mechanical, including photography, recording, or by any information storage or retrieval system or technologies now known or later developed without permission in writing from the author. For a list of the original places of publication of the unrevised texts, see AC- KNOWLEDGMENT, page 4. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Salingaros, Nikos A. Anti-Architecture and Deconstruction: The Triumph of Nihilism ISBN 978-0-9893469-2-4 Fourth (European) Edition “More irritating than someone’s actual stupidity is their mouthing a scien- tific vocabulary... One of the worst intellectual catastrophes is found ni the ap- propriation of scientific concepts and vocabulary by mediocre intelligences.” — Nicolas Gomez-Davila, 1992 “In architectural and art schools, soulless dogma is still being taught; against reason, beauty, nature and man. Man is misused as a guinea pig for perverse, dog- matic, educational, architectural experiments... Young architects who still have dreams of a more beautiful and better world in their heads, these get their dreams taken away from them by force or else they don’t receive their architectural diplo- ma.