Abitation Rurale
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Tunisia Summary Strategic Environmental and Social
PMIR Summary Strategic Environmental and Social Assessment AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP PROJECT: ROAD INFRASTRUCTURE MODERNIZATION PROJECT COUNTRY: TUNISIA SUMMARY STRATEGIC ENVIRONMENTAL AND SOCIAL ASSESSMENT (SESA) Project Team: Mr. P. M. FALL, Transport Engineer, OITC.2 Mr. N. SAMB, Consultant Socio-Economist, OITC.2 Mr. A. KIES, Consultant Economist, OITC 2 Mr. M. KINANE, Principal Environmentalist, ONEC.3 Mr. S. BAIOD, Consultant Environmentalist ONEC.3 Project Team Sector Director: Mr. Amadou OUMAROU Regional Director: Mr. Jacob KOLSTER Division Manager: Mr. Abayomi BABALOLA 1 PMIR Summary Strategic Environmental and Social Assessment Project Name : ROAD INFRASTRUCTURE MODERNIZATION PROJECT Country : TUNISIA Project Number : P-TN-DB0-013 Department : OITC Division: OITC.2 1 Introduction This report is a summary of the Strategic Environmental and Social Assessment (SESA) of the Road Project Modernization Project 1 for improvement works in terms of upgrading and construction of road structures and primary roads of the Tunisian classified road network. This summary has been prepared in compliance with the procedures and operational policies of the African Development Bank through its Integrated Safeguards System (ISS) for Category 1 projects. The project description and rationale are first presented, followed by the legal and institutional framework in the Republic of Tunisia. A brief description of the main environmental conditions is presented, and then the road programme components are presented by their typology and by Governorate. The summary is based on the projected activities and information contained in the 60 EIAs already prepared. It identifies the key issues relating to significant impacts and the types of measures to mitigate them. It is consistent with the Environmental and Social Management Framework (ESMF) developed to that end. -

Les Projets D'assainissement Inscrit S Au Plan De Développement
1 Les Projets d’assainissement inscrit au plan de développement (2016-2020) Arrêtés au 31 octobre 2020 1-LES PRINCIPAUX PROJETS EN CONTINUATION 1-1 Projet d'assainissement des petites et moyennes villes (6 villes : Mornaguia, Sers, Makther, Jerissa, Bouarada et Meknassy) : • Assainissement de la ville de Sers : * Station d’épuration : travaux achevés (mise en eau le 12/08/2016); * Réhabilitation et renforcement du réseau et transfert des eaux usées : travaux achevés. - Assainissement de la ville de Bouarada : * Station d’épuration : travaux achevés en 2016. * Réhabilitation et renforcement du réseau et transfert des eaux usées : les travaux sont achevés. - Assainissement de la ville de Meknassy * Station d’épuration : travaux achevés en 2016. * Réhabilitation et renforcement du réseau et transfert des eaux usées : travaux achevés. • Makther: * Station d’épuration : travaux achevés en 2018. * Travaux complémentaires des réseaux d’assainissement : travaux en cours 85% • Jerissa: * Station d’épuration : travaux achevés et réceptionnés le 12/09/2014 ; * Réseaux d’assainissement : travaux achevés (Réception provisoire le 25/09/2017). • Mornaguia : * Station d’épuration : travaux achevés. * Réhabilitation et renforcement du réseau et transfert des eaux usées : travaux achevés Composantes du Reliquat : * Assainissement de la ville de Borj elamri : • Tranche 1 : marché résilié, un nouvel appel d’offres a été lancé, travaux en cours de démarrage. 1 • Tranche2 : les travaux de pose de conduites sont achevés, reste le génie civil de la SP Taoufik et quelques boites de branchement (problème foncier). * Acquisition de 4 centrifugeuses : Fourniture livrée et réceptionnée en date du 19/10/2018 ; * Matériel d’exploitation: Matériel livré et réceptionné ; * Renforcement et réhabilitation du réseau dans la ville de Meknassy : travaux achevés et réceptionnés le 11/02/2019. -
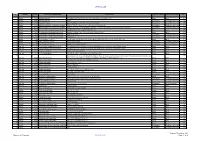
December 2020 Contract Pipeline
OFFICIAL USE No Country DTM Project title and Portfolio Contract title Type of contract Procurement method Year Number 1 2021 Albania 48466 Albanian Railways SupervisionRehabilitation Contract of Tirana-Durres for Rehabilitation line and ofconstruction the Durres of- Tirana a new Railwaylink to TIA Line and construction of a New Railway Line to Tirana International Works Open 2 Albania 48466 Albanian Railways Airport Consultancy Competitive Selection 2021 3 Albania 48466 Albanian Railways Asset Management Plan and Track Access Charges Consultancy Competitive Selection 2021 4 Albania 49351 Albania Infrastructure and tourism enabling Albania: Tourism-led Model For Local Economic Development Consultancy Competitive Selection 2021 5 Albania 49351 Albania Infrastructure and tourism enabling Infrastructure and Tourism Enabling Programme: Gender and Economic Inclusion Programme Manager Consultancy Competitive Selection 2021 6 Albania 50123 Regional and Local Roads Connectivity Rehabilitation of Vlore - Orikum Road (10.6 km) Works Open 2022 7 Albania 50123 Regional and Local Roads Connectivity Upgrade of Zgosth - Ura e Cerenecit road Section (47.1km) Works Open 2022 8 Albania 50123 Regional and Local Roads Connectivity Works supervision Consultancy Competitive Selection 2021 9 Albania 50123 Regional and Local Roads Connectivity PIU support Consultancy Competitive Selection 2021 10 Albania 51908 Kesh Floating PV Project Design, build and operation of the floating photovoltaic plant located on Vau i Dejës HPP Lake Works Open 2021 11 Albania 51908 -

Policy Notes for the Trump Notes Administration the Washington Institute for Near East Policy ■ 2018 ■ Pn55
TRANSITION 2017 POLICYPOLICY NOTES FOR THE TRUMP NOTES ADMINISTRATION THE WASHINGTON INSTITUTE FOR NEAR EAST POLICY ■ 2018 ■ PN55 TUNISIAN FOREIGN FIGHTERS IN IRAQ AND SYRIA AARON Y. ZELIN Tunisia should really open its embassy in Raqqa, not Damascus. That’s where its people are. —ABU KHALED, AN ISLAMIC STATE SPY1 THE PAST FEW YEARS have seen rising interest in foreign fighting as a general phenomenon and in fighters joining jihadist groups in particular. Tunisians figure disproportionately among the foreign jihadist cohort, yet their ubiquity is somewhat confounding. Why Tunisians? This study aims to bring clarity to this question by examining Tunisia’s foreign fighter networks mobilized to Syria and Iraq since 2011, when insurgencies shook those two countries amid the broader Arab Spring uprisings. ©2018 THE WASHINGTON INSTITUTE FOR NEAR EAST POLICY. ALL RIGHTS RESERVED. THE WASHINGTON INSTITUTE FOR NEAR EAST POLICY ■ NO. 30 ■ JANUARY 2017 AARON Y. ZELIN Along with seeking to determine what motivated Evolution of Tunisian Participation these individuals, it endeavors to reconcile estimated in the Iraq Jihad numbers of Tunisians who actually traveled, who were killed in theater, and who returned home. The find- Although the involvement of Tunisians in foreign jihad ings are based on a wide range of sources in multiple campaigns predates the 2003 Iraq war, that conflict languages as well as data sets created by the author inspired a new generation of recruits whose effects since 2011. Another way of framing the discussion will lasted into the aftermath of the Tunisian revolution. center on Tunisians who participated in the jihad fol- These individuals fought in groups such as Abu Musab lowing the 2003 U.S. -

Etat Des Lieux
ETUDE PROSPECTIVE D’AMENAGEMENT DU GRAND SOUSSE Etat des lieux Octobre 2020 • • • • , Mme Sarra KAROUI M. Moez NAIJA M. Aymen GHEDIRA M. Baligh SOUILEM Présidente du PDUI Responsable technique Chef de projet résident Expert énergie Mme Yosra JEMLI M. Ramzi Ben HASSINE M. Noureddine DAGA M. Ali KHÉSSIBI M. Majdi BEN GHZALA Mme Maissa JELASSI M. Tarek BEN HASSINE Mme Kaouther MEHDOUI ETUDE PROSPECTIVE D’AMENAGEMENT DU GRAND SOUSSE Etat des lieux Octobre 2020 Maître d’ouvrage Appui a maîtrise d’ouvrage (AMO) Municipalité de Sousse Groupement URBAPLAN - TRANSITEC Ministère de tutelle URBAPLAN TRANSITEC Avenue de Montchoisi 21 Avenue Auguste-Tissot Gouvernement tunisien 1006 Lausanne, Suisse 1006 Lausanne, Suisse www.urbaplan.ch www.transitec.net Secrétariat d’État à l’économie (SECO) Gouvernement suisse Coordinateur de l'étude Karim Elouardani, Expert en développement local Experts impliqués Chokri Mathlouthi Expert urbaniste Dr. Salwa Trabelsi Expert économiste Dr. Habib Ben Boubakeur Géographe-Environnementaliste Jacques Barbier Expert planification urbaine et Aménagement du Territoire N.B. Les points de vue et idées développées dans ce document n’engagent que leurs auteurs. Table des matières Table des matières ...................................................................................................................... i Index des Tableaux ......................................................................................................................v -

Sociétés, Dynamiques De Peuplement Et Mutations Des Systèmes De Production Traditionnels
Sociétés, dynamiques de peuplement et mutations des systèmes de production traditionnels Henri GUILLAUME et Habiba NOURI Introduction La région de la Jeffara est depuis l'Antiquité le théâtre de mouve ments de populations et de dynamiques complexes d'occupation spatiale marquées par des phases de flux et de reflux de communautés entre les différents types de milieux physiques composant l'espace régional (plaine littorale, massif montagneux, confins désertiques sahariens). De par sa situation géographique et la configuration de sa plaine côtière, la Jeffara est la seule voie de passage naturelle facile entre la Tunisie et la Tripolitaine, et plus largement entre le Maghreb et le Machrek (Lissir, 1993). Mais l'histoire de cette région ne tient pas au seul fait qu'elle constitue un « passage obligé », Elle a aussi été le théâtre de dynamiques d'occupation humaine et d'exploitation du milieu dont l'article de Ben Ouezdou, dans cet ouvrage (partie 1), révèle l'ancienneté à travers de nou veaux éclairages et hypothèses. C'est dire toute la puissance de cet ancrage historique qui porte fortement la « signature » des hommes sur leur environnement et leurs capacités d'adaptation à des milieux contraignants. Dans le prolongement de cette mise en perspective, cet article a pour objet d'analyser les grandes lignes du processus de peuplement et des principales mutations connues par la Jeffara tunisienne, au cours des derniers siècles, dans les modes d'occupation de l'espace et d'usage des ressources naturelles. Cette approche est indispensable pour appréhender les évolutions croisées et les interactions entre les dynamiques environne mentales et les dynamiques humaines. -

Arrêté2017 0057.Pdf
MINISTERE DE L’INDUSTRIE Les directions régionales du commerce sont chargées ET DU COMMERCE des opérations de vérification soit dans leurs bureaux permanents, soit dans les bureaux temporaires établis en dehors des chefs lieux des gouvernorats dans les localités Arrêté du ministre de l’industrie et du indiquées au tableau « A » annexé au présent arrêté, et commerce du 6 janvier 2017, relatif aux ce, conformément aux dates arrêtées en coordination opérations de vérification et de poinçonnage avec les autorités locales et régionales. des instruments de mesure au cours de Les opérations de vérification effectuées dans les l’année 2017. établissements où sont détenus les instruments de mesure se dérouleront aux dates convenues entre l’agence Le ministre de l’industrie et du commerce, nationale de métrologie et les établissements concernés, Vu la constitution, à l’exception des distributeurs de carburant fixes dont Vu le décret du 29 juillet 1909, relatif à la les dates de vérification sont indiquées dans le tableau « B » annexé au présent arrêté. vérification et la construction des poids et mesures, Art. 3 - Les détenteurs d’instruments de remplissage, instruments de pesage et de mesurage, tel que modifié de distribution ou de pesage à fonctionnement par le décret du 10 mars 1920 et le décret du 23 automatique doivent surveiller l’exactitude et le bon octobre 1952, notamment son article 13, fonctionnement de leurs instruments, et ce, en effectuant Vu la loi n° 99-40 du 10 mai 1999, relative à la périodiquement un contrôle statistique pondéral ou métrologie légale, telle que modifiée et complétée par volumétrique sur les produits mesurés. -

Genève, Le 9 Avril 1942. Geneva, April 9Th, 1942. Renseignements Reçus
R . EL. 841. SECTION D’HYGIÈNE DU SECRÉTARIAT DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS HEALTH SECTION OF THE SECRETARIAT OF THE LEAGUE OF NATIONS RELEVE EPIDEMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE WEEKLY EPIDEMIOLOGICAL RECORD 17me année, N° 15 — 17th Year, No. 15 Genève, le 9 avril 1942. Geneva, April 9th, 1942. COMMUNIQUÉ DE L’OFFICE INTERNATIONAL D’HYGIÈNE PUBLIQUE N ° 697 Renseignements reçus du 27 mars au 2 avril 1942. Ce Communiqué contient les informations reçues par l’Office This Communiqué incorporates information supplied to the International d'Hygiène publique en exécution de la Convention Office International d’Hygiène publique under the terms of sanitaire internationale de 1926, directement ou par l’inter the International Sanitary Convention, 1926, directly or through médiaire des Bureaux suivants, agissant comme Bureaux the folloWing organisations, Which act as regional Bureaux for régionaux pour l’application de cette Convention: the purposes of that Convention: Bureau d’Extrême-Orient de l’Organisation d'hygiène de la League of Nations, Health Organisation, Far- Eastern Société des Nations, Singapour. Bureau, Singapore. Bureau Sanitaire Panaméricain, Washington. The Pan-American Sanitary Bureau, Washington. Bureau Régional d'informations sanitaires pour le Proche- The Regional Bureau for Sanitary Information in the Orient, Alexandrie. Near East, Alexandria. Explication des signes: signifie seulement que le chiffre Explanation of signs : f merely indicates that the reported des cas et décès est supérieur à celui de la période précédente; figure of cases and deaths is higher than that for the previous \ que ce chiffre est en baisse; —► qu'il n’a pas sensiblement period; 'n* that the figure is loWer; —*■ that it has not changed varié. -
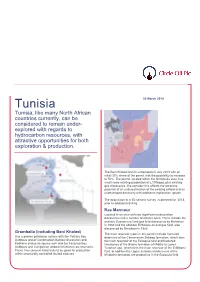
Factsheet-Tunisia-March202014.Pdf
Operations: 20 March 2014 Tunisia Tunisia, like many North African countries currently, can be considered to remain under- explored with regards to hydrocarbon resources, with attractive opportunities for both exploration & production. The Beni Khaled farm in undertaken in July 2013 with an initial 30% share of the permit with the possibility to increase to 50%. The permit, located within the Grombalia area, has small scale existing production at c.100bopd, plus existing gas discoveries. We consider this affords the attractive potential of an underestimation of the existing oilfield and an undeveloped discovery with additional exploration upside. The acquisition of a 3D seismic survey is planned for 2014, prior to additional drilling. Ras Marmour Located in an area with two significant hydrocarbon discoveries and a number of smaller ones. These include the onshore Ezzaouia oil and gas field discovered by Marathon in 1986 and the offshore El Bibane oil and gas field, also discovered by Marathon in 1982. Grombalia (including Beni Khaled) The main reservoir types in this permit include fractured Has a proven petroleum system with the Tertiary Bou dolomites of the Cenomanian Zebbag formation, which form Dabbous and/or Cenomanian Bahloul limestones and the main reservoir of the Ezzaouia field and fractured Fadhene shales as source rock and the fractured Bou limestones of the Bireno formation of Middle to Lower Dabbous and Campanian Abboid limestones as reservoirs. Turonian age, which form the main reservoir of the El Bibane These have proven historically to be good for production field. In addition the Upper Jurassic sands levels of the within structurally controlled faulted closures. -

Quelques Aspects Problematiques Dans La Transcription Des Toponymes Tunisiens
QUELQUES ASPECTS PROBLEMATIQUES DANS LA TRANSCRIPTION DES TOPONYMES TUNISIENS Mohsen DHIEB Professeur de géographie (cartographie) Laboratoire SYFACTE FLSH de Sfax TUNISIE [email protected] Introduction Quelle que soit le pays ou la langue d’usage, la transcription toponymique des noms de lieux géographiques sur un atlas ou un autre document cartographique en particulier ou tout autre document d’une façon générale pose problème notamment dans des pays où il n’y a pas de tradition ou de « politique » toponymique. Il en est de même pour les contrées « ouvertes » à l’extérieur et par conséquent ayant subi ou subissant encore les influences linguistiques étrangères ou alors dans des régions caractérisées par la complexité de leur situation linguistique. C’est particulièrement le cas de la Tunisie, pays méditerranéen bien « ancré » dans l’histoire, mais aussi bien ouvert à l’étranger et subissant les soubresauts de la mondialisation, et manquant par ailleurs cruellement de politique toponymique. Tout ceci malgré l’intérêt que certains acteurs aux profils différents y prêtent depuis peu, intérêt matérialisé, entre autres manifestations scientifiques, par l’organisation de deux rencontres scientifiques par la Commission du GENUING en 2005 et d’une autre août 2008 à Tunis, lors du 35ème Congrès de l’UGI. Aussi, il s’agit dans le cadre de cette présentation générale de la situation de la transcription toponymique en Tunisie, dans un premier temps, de dresser l’état des lieux, de mettre en valeur les principales difficultés rencontrées en manipulant les noms géographiques dans leurs différentes transcriptions dans un second temps. En troisième lieu, il s’agit de proposer à l’officialisation, une liste-type de toponymes (exonymes et endonymes) que l’on est en droit d’avoir par exemple sur une carte générale de Tunisie à moyenne échelle. -

Communiqué De L'office International D'hygiène
R. H. 827. SECTION D’HYGIÈNE DU SECRÉTARIAT DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS HEALTH SECTION OF THE SECRETARIAT OF THE LEAGUE OF NATIONS RELEVE EPIDEMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE WEEKLY EPIDEMIOLOGICAL RECORD 17m® année, N° 1 — 17th Year, No. 1 Genève, le 1er janvier 1942. Geneva, January 1st, 1942. COMMUNIQUÉ DE L’OFFICE INTERNATIONAL D’HYGIÈNE PUBLIQUE N" 682 Renseignements reçus du 12 au 18 décembre 1941. Ce Communiqué contient les informations reçues par l’Office This Communiqué incorporates information supplied to the International d’Hyglène publique en exécution de la Convention Office International d’Hygiène publique under the terms of sanitaire internationale de 1926, directement ou par l’inter the International Sanitary Convention, 1926, directly or through médiaire des Bureaux suivants, agissant comme Bureaux the following organisations, which act as regional Bureaux for régionaux pour l’application de cette Convention: the purposes of that Convention: Bureau d’Extrême-Orient de l’Organisation d’hygiène de la League of Nations, Health Organisation, Far- Eastern Société des Nations, Singapour. Bureau, Singapore. Bureau Sanitaire Panaméricain, Washington. The Pan-American Sanitary Bureau, Washington. Bureau Régional d’informations sanitaires pour le Proche- The Regional Bureau for Sanitary Information in the Orient, Alexandrie. Near East, Alexandria. Explication des signes: f signifie seulement que le chiffre Explanation of signs: merely indicates that the reported des cas et décès est supérieur à celui de la période précédente; figure of cases and deaths is higher than that for the previous que ce chiffre est en baisse; —► qu’il n’a pas sensiblement period ; N* that the figure is lower; —*- that it has not changed varié. -

Minorités Religieuses Et Dynamiques Identitaires En Tunisie: Ibadites Et Juifs À L'épreuve Du Tourisme Et De La Révolution
Minorités religieuses et dynamiques identitaires en Tunisie: Ibadites et Juifs à l'épreuve du tourisme et de la révolution Thèse Mourad Boussetta Doctorat en ethnologie et patrimoine Philosophiæ doctor (Ph. D.) Québec, Canada © Mourad Boussetta, 2020 Minorités religieuses et dynamiques identitaires en Tunisie : Ibadites et Juifs à l’épreuve du tourisme et de la révolution Thèse Mourad Boussetta Sous la direction de : Habib Saidi, directeur de recherche Résumé Dans cette recherche, j’étudie les dynamiques identitaires des minorités ibadite/berbère et juive de l’île de Djerba (Tunisie) à travers le prisme du tourisme et de la révolution. Je démontre que l’agencéité de ces deux minorités ethnico- religieuses se base sur la force mobilisatrice de leur patrimoine immatériel. Je déconstruis le double discours colonial et national les dotant d’un statut historique et juridique subalterne en me basant sur l’apport critique des études postcoloniales et sur une ethnographie multi-située. J’inscris ce faisant cette agencéité dans une dynamique de relations de pouvoir. J’analyse les adaptations, les négociations et les résistances des acteurs ibadites/berbères et juifs sous le régime colonial puis sous l’État-nation pour aboutir à une meilleure connaissance de leurs stratégies dans l’hyperprésent, soit la révolution de 2011. J’explique qu’en contribuant activement au jumelage de leur patrimoine immatériel à l’industrie touristique et qu’en s’engageant dans la mouvance politique postrévolutionnaire, ces acteurs se réapproprient une citoyenneté entière en Tunisie. Cet examen critique met en évidence les stratégies adoptées par les acteurs des minorités étudiées pour se repositionner par rapport aux structures, non pas dans le sens d’une rupture, mais plutôt dans celui de s’insérer dans les relations de pouvoir avec un statut avantageux.