EIES-R-Seau-Kinshasa-PEMU-FA.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Country Sheet Democratic Republic of Congo (Drc)
The Country of Return Information Project functions as a network of NGOs for the collection and transfer of specific information on reintegration possibilities for potential returnees and their counsellor. All questions you may have on reintegration possibilities and on which you don’t find the answer in this country sheet can be directed to the helpdesk: “Country of Return Information and Vulnerable Groups”. E-mail: [email protected] COUNTRY SHEET DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO (DRC) The Country of Return Information Project and Vulnerable Groups runs until June 2009 and is funded by the European Community. The European Commission is not responsible for any use that JUNE 09 may be made of the information provided. Sole responsibility for its content lies with the author. 1 DISCLAIMER This Country Sheet is for informational purposes only and no rights can be derived from its contents. The CRI-partners will do their utmost to include accurate, corroborated, transparent and up-to-date information, but make no warrants as to its accuracy or completeness. Consequently, the CRI-partners do not accept responsibility in any way for the information in this Country Sheet and accept no liability for damages of any kind arising from using the information in this Country Sheet. The information in this Country Sheet has been retrieved in collaboration with local partners. This Country Sheet contains links to websites that are created and maintained by other organizations. The CRI-project does not take any responsibility for the content of these websites. The CRI-partners are the partners who participate fully in the CRI-project: Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Asociación Comissión Católica Española de Migración, Caritas International Belgium, Consiglio Italiano Per I Rifugiati, Coordination et Initiatives pour les Réfugiés et Étrangers and Dansk Flygtningehjælp. -

Liste Des Contribuables Déclarés Introuvables Par Le CDI KIN Et Transférés Dans Les CIS
Liste des contribuables déclarés introuvables par le CDI KIN et transférés dans les CIS FORME N° NIF Raison Sociale Sigle Adresse SECTEUR ACTIVITE ETAT SOCIETE SERVICE GESTIONNAIRE JURIDIQUE AV. COL Télécom. et nouvelles 1 A1418699R PM 2ÈME OEIL YA COMMUNICATION SARL INTROUVABLE CIS / NGALIEMA MONDJIBA technologies d'information 2ID CONSULTING ( INGENIERIE DE L'INFORMATION ET DU 2ID AV.N°157 DE LA Prestation de services et travaux 2 A1611866R PM INTROUVABLE CIS / GOMBE DECISIONNEL ) SARL CONSULTING VALLEE N°72 immobiliers SARL BLVD.C/GOMBE DU 30 Commerce Général et Import- 3 A1515021U PM 3RD YES SARL INTROUVABLE CIS / GOMBE JUIN N°10 IMM. Export AV.GALERIE LOKOLELA Commerce Général et Import- 4 A1302545G PM 7 SARL INTROUVABLE CIS / KINSHASA N°112 Export AV.C/KINSHASA EQUATEUR Commerce Général et Import- 5 A0708987C PM A.M. YOZMA SPRL A.M.YO. INTROUVABLE CIS / GOMBE N°749 Export AV.C/GOMBE SERGENT Prestation de services et travaux 6 A1401591W PM A.S.B GROUP S.A.R.L INTROUVABLE CIS / NGALIEMA MOKE N°14 immobiliers ETS CONGO 4C/NGALIEMA EME N°230/B 7 A1007700G PP ABBAS BACHROUCH "ETS CONGO BRIQUES" Industie INTROUVABLE CIS / LIMETE BRIQUES Q/INDUSTRIEL AV.KINGABUAC/LIMETE 8 A1301215L PP ABBAS GHANEM Autres INTROUVABLE CIS / LIMETE N° 3717 AV.C/LIMETE Commerce Général et Import- 9 A1504836Z PM ABD GROUP CONGO SARL A.G.C SARL INTROUVABLE CIS / MASINA AMBASSADEUR Export BLVDN°06 Q/SANS Commerce Général et Import- 10 A0714176S PP ABDOUL HASSAN ''ETS FISH & MEAT'' * INTROUVABLE CIS / LIMETE LUMUMBA N° Export AV.198605 TSHUAPA 1ère Agriculture et exploitation 11 A0905544M PP ABDOULAY ABASA INTROUVABLE CIS / KINSHASA Q/MADIMBA forestière AV.C/KINSHASA AVENIR Commerce Général et Import- 12 A1520272C PM ABIKIZ SARL INTROUVABLE CIS / KINTAMBO N°12 Export AV.CONCESSION EQUATEUR Commerce Général et Import- 13 A0803244L PM ABNER CONGO DIAMOND SPRL A.C.D SPRL INTROUVABLE CIS / GOMBE N° 24 C/ Export AV.GOMBE COL V/KINEBEYA Prestation de services et travaux 14 A1214486K PP ACHRAF ALI ALACHKAR INTROUVABLE CIS / GOMBE N°76 C/GOMBE immobiliers BLVD. -
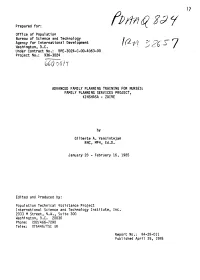
Washington, D.C.C- Under Contract No.: DPE-3024-C-O0-4063-OO Project No.: 936-3024
Prepared for: Office of Population Bureau of Science and Technology Agency for International Development Washington, D.C.c- Under Contract No.: DPE-3024-C-O0-4063-OO Project No.: 936-3024 ADVANCED FAMILY PLANNING TRAINING FOR NURSES: FAMILY PLANNING SERVICES PROJECT, KINSHASA - ZAIRE by Gilberte A. Vansintejan RNC, MPH, Ed.D. January 28 - February 16, 1985 Edited and Produced by: Population Technical Assistance Project International Science and Technology Institute, Inc. 2033 M Street, N.W., Suite 300 Washington, D.C. 20036 Phone: 202/466-7290 Telex: 275445/TSI UR Report No.: 84-28-011 Published April 25, 1985 -i- TABLE OF CONTENTS LIST OF ABBREVIATIONS . * * * * . * e. * * ii ACKNOWLEDGEMENTS . * * * * * a e e a . * a a e iii EXECUTIVE SUMMARY . .. a.. .a **.. iv I. INTRODUCTION . .. .. .. .. 1 II. OBSERVATIONS AND FINDINGS . 2 III. RECOMMENDATIONS . .. .. .. 4 APPENDICES Appendix A. List of Participants Appendix B. Characteristics of the Participants Appendix C. Schedule (Emploi du Temps-PSND) Appendix D. Schedule for Clinical Practice (Seminaire/Recyclage des Infirnieres: Calendrier des Stages Pratiques) Appendix E. Final Evaluation of Seminar (Evaluation du Seminaire/Atelier) Appendix F. List of Handouts, Books and Publications Distributed to the Participants Appendix G. Scope of Work LIST OF ABBREVIATIONS ENGLISH FPSP Family Planning Services Project IEC Information, Education and Communication ISTI International Science and Technology Institute 100 Intrauterine Device MCH Maternal and Child Health WIM Women in Management (Center -

Witchcraft, Violence and Everyday Life: an Ethnographic Study of Kinshasa
WITCHCRAFT, VIOLENCE AND EVERYDAY LIFE: AN ETHNOGRAPHIC STUDY OF KINSHASA A THESIS SUBMITTED FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY BY SILVIA DE FAVERI COLLEGE OF BUSINESS, ARTS AND SOCIAL SCIENCES DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES, MEDIA AND COMMUNICATIONS DIVISION OF ANTHROPOLOGY BRUNEL UNIVERSITY OCTOBER 2014 Abstract The inhabitants of Kinshasa, who call themselves Kinois, deal with insecurity and violence on a daily basis. Cheating and thefts are commonplace, and pillaging by street gangs and robberies by armed thieves are everyday occurrences. The state infrastructure is so poorly regulated that deaths by accident or medical negligence are also common. This, and much more, contributes to a challenging social milieu within which the Kinois’ best hope is simply to ‘make do’. This thesis, based on extensive fieldwork in Kinshasa, analyses different forms of violence which affect the Kinois on a daily basis. I argue that the Kinois’ concept of violence, mobulu, differs from Western definitions, which define violence as an intrinsically negative and destructive force. Mobulu is for the Kinois a potentially constructive phenomenon, which allows them to build relationships, coping strategies and new social phenomena. Violence is perceived as a transformative force, through which people build meaningful lives in the face of the hardship of everyday life. Broadly speaking, this thesis contributes to the Anthropology of violence which has too often focused on how violence is imposed upon a population, often from a structural level of a state and its institutions. Such an approach fails to account for the nuances of alternate perspectives of what ‘violence’ is, as evidenced in this thesis through the prism of the Kinois term mobulu. -

Reseau De Soins Rdc
RESEAU DE SOINS RDC Classement par Ville et par Type de prestations Centre Téléphone Adresse BENI CENTRES PLURIDISCIPLINAIRES CENTRE MÉDICAL LA BRECHE 06, AVENUE KIKWIT, QUARTIER MATONGE, COMMUNE DE MULEKERA BOMA CENTRES PLURIDISCIPLINAIRES CLINIQUE DES ANGES 02, AVENUE DU 4 JANVIER, COMMUNE DE NZADI HOPITAL SCPT SA (EX ONATRA) COMMUNE DE KABONDO BUKAVU CENTRES PLURIDISCIPLINAIRES SKYBONE HOSPITAL 77, AVENUE MANIEMA, COMMUNE D'IBANDA PHARMACIES PHARMACIE NOBLESSE 210, AVENUE P.E. LUMUMBA, COMMUNE D’IBANDA BUNIA CENTRES PLURIDISCIPLINAIRES CLINIQUE SALAMA 1, AVENUE SALAMA/SQ POLICE DE FRONTIÈRE, BUNIA BUTEMBO CENTRES PLURIDISCIPLINAIRES CENTRE MÉDICAL UMOJA 02, QUARTIER VUNGI, COMMUNE DE MUSUSA GYNECO-OBSTETRICIENS POLYCLINIQUE PAX CHRISTI 06, CEL. KYAVUHIRI, QUARTIER MUTURI, COMMUNE DE BULENGERA PHARMACIES PHARMACIE LA NOBLESSE 28, AVENUE BAYE, COMMUNE DE KIMEMI GOMA CENTRES PLURIDISCIPLINAIRES CE.DI.GO. 255, AVENUE DE LA PAIX, QUARTIER HIMBI, COMMUNE DE GOMA CENTRE MÉDICAL CAMELIAS AVENUE BUNANGANA, QUARTIER KATINDO GAUCHE PHARMACIE LA NOBLESSE AVENUE TOURISTES, N° 6 QUARTIER LES VOLCANS HEAL AFRICA SIS RUE LYN LUSI Nº 111 CENTRE PARTAGE ATTITUDE 11, AVENUE KILIMANDJARO, QUARTIER KATOY, COMMUNE DE KARISIMBI, GOMA mardi 2 octobre 2018 Page 1 sur 6 RESEAU DE SOINS RDC Classement par Ville et par Type de prestations Centre Téléphone Adresse GOMA PHARMACIES PHARMACIE LA NOBLESSE AVENUE TOURISTES, N° 6 QUARTIER LES VOLCANS KALEMIE CENTRES PLURIDISCIPLINAIRES HÔPITAL CAMP MARIN VILLE DE KALEMIE KINSHASA CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL CENTRE MÉDICO-CHIRUGICAL -

Republique Democratique Du Congo Ministere Des
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS DIRECTION DE L'ASSIETTE FISCALE REPERTOIRE DES CONTRIBUABLES ASSUJETTIS A LA TVA, ARRETE AU 28 FEVRIER 2019 FORME SIEGE OU ANCIEN SERVICE NOUVEAU SERVICE N NIF NOMS OU RAISON SOCIALE SIGLE ADRESSE SECTEUR DACTIVITE ETAT SOCIETE JURIDIQUE SUCCURSALE GESTIONNAIRE GESTIONNAIRE Commerce Général et 1 A1200188T PM 3 G SERVICES SPRL SIEGE SOCIAL Q/MAINDOMBE N°35/C MATETE Import-Export EN ACTIVITE CDI / KINSHASA CDI / KINSHASA AV. NZOBE N°128 Q/BISENGO Commerce Général et 2 A1300881Y PM 3 rd YES SPRL SIEGE SOCIAL C/BANDALUNGWA Import-Export EN ACTIVITE CDI / KINSHASA CDI / KINSHASA Prestation de services 3 A1610526K PM 360° COMMUNICATIONS SARL SIEGE SOCIAL AV. DE LA JUSTICE N°44 C/GOMBE et travaux immobiliers EN ACTIVITE CDI / KINSHASA CDI / KINSHASA Commerce Général et 4 A1505996K PM 3MC SARL SIEGE SOCIAL AV.DEAV. LUKUSA LA VALLEE N°2 Q/GOLF N°4B APP. C/GOMBE RESIDENCE Import-Export EN ACTIVITE CDI / KINSHASA CDI / KINSHASA PRESTIGE C/GOMBE D/LUKUNGA Prestation de services 5 A1419266H PM 4CIT SOFTWARE SOLUTIONS LIMITED SIEGE SOCIAL V/KINSHASA et travaux immobiliers EN ACTIVITE CDI / KINSHASA CDI / KINSHASA 4K PYRAMIDE DE CONSTRUCTIONS ET Prestation de services 6 A1515786B PM TRAVAUX SARL SIEGE SOCIAL AV. KABAYIDI N°68 Q/NDANU C/LIMETE Télécom.et travaux et immobiliers nouvelles EN ACTIVITE CDI / KINSHASA CDI / KINSHASA AV.BAKONGO N°644 C/GOMBE technologies 7 A1408818B PM 7 SUR 7.CD SIEGE SOCIAL D/LUKUNGA V/KINSHASA d'information EN ACTIVITE CDI / KINSHASA CDI / KINSHASA Commerce Général et 8 A1515519L PM A CASA MIA SARL SIEGE SOCIAL AV. -

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO Kinshasa, Le Ministère De L’Environnement Et Développement Durable
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO Kinshasa, le Ministère de l’Environnement et Développement Durable N° /SG-EDD/BTB/GBK/2018 Secrétariat Général à l’Environnement et Développement Durable Direction Règlementation et Contentieux Environnementaux LES AVIS FAVORABLES DE FONCTIONNEMENT OCTROYES AUX ONG DE MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE (ANNEE 2018- 2019) N° DENOMINATION LIEU DU SIEGE DOMAINE N°AVIS FAVORABLE RAYON D D’INTERVENTION ACTION 01 PLAIDOYER DEBOUT N°366, AV. DE LA PROTECTION DE N°1139/CAB/NIN/EDD/AAN/WF/05 RDC/KINSHAS < ASBL> MISSION,Q/HIMBI.II.C/GOMBE L’ENVIRONNEMENT ET /2017 A DANS LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 02 ASSOCIATION D’ N°28,AV.KATAMBI,Q/MBAMU- PROTECTION DE N°1303/CAB/MIN/EDD/AAN/WF/05 RDC/KINSHAS ASSAINISSEMENT KINGABWA.C/LIMETE L’ENVIRONNEMENT ET /2017 A <A.A/ONG-ASBL> DE L’ASSAISSEMENT 03 SUNAMITE EN MISSION N°123, AV. DE LUTSHATSHA, Q/DE LA PROTECTION DE N°1302/CAB/MIN/EDD/AAN/WF/05 RDC/KINSHSA ASSOCIATION FOIRE.C/LEMBA L’ENVIRONNEMENT ET /2017 SA D’ASSAINISSEMENT DU REBOISEMENT. <SUN.E.M> 04 CONSERV CONGO N°21/694,4EMERUE,CITE PROTECTION DE N°1285/CAB/MIN/EDD/AAN/WF/05 RDC/KINSHAS VERTE.C/SELEMBAO L’ENVIRONNEMENT /2017 A 05 NEW VISION FOR CITE DE BUNAGANA, PROTECTION DE N°1188/CAB/MIN/EDD/AAN/TNT/0 RDC/NORD- WOMEN TERRITOIRE/RUTSHURU.NORD-KIVU L’ENVIRONNEMENT 2/2017 KIVU DEVELOPMENT<N.V.W.D .> 06 CADRE DE N°157, AV. COLONEL MONDJIBA, PROTECTION DE N°1293/CAB/MIN/EDD/AAN/WF/05 RDC/KINSHAS CONCERTATION IMMEUBLE GALERIE L’ENVIRONNEMENT ET /2017 A NATIONALE DE LA LAPEPITHO.C/NGALIEMA DU DEVELOPPEMENT SOCIETE CIVILE EN DURABLE. -

Republique Democratique Du Congo Ministere Des Finances Direction Generale Des Impôts Direction De L'assiette Fiscale
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS DIRECTION DE L'ASSIETTE FISCALE LISTE DES CONTRIBUABLES RELEVANT DES SERVICES REFORMES NON PUBLIES ET NON EN REGLE AVEC LA DGI FORME SERVICE GEST N° NIF NOMS OU RAISON SOCIALE SIGLE ADRESSE JURIDIQUE DGIREP 1 A1215262D ASBL VILLE DE KINSHASA H V K AV. EBEYA N°150 C/GOMBE CDI / KINSHASA 2 A1200429F ASBL TODA CORPORATION INSTITUT MEDICAL DE KASA-VUBU CDI / KINSHASA 3 A0905945Y ASBL FONDS MEDICAL TROPICAL AVJUSTICE N°123 Q.FAC HT COMMDT C/GOMBE CDI / KINSHASA 4 A1204215W ASBL AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT- A.F.D KINSHASA / GOMBE CDI / KINSHASA 5 A0905944X ASBL FONDATION LAURENT DESIRE KABILA AV 30 JUIN N°183 C/GOMBE CDI / KINSHASA INTERNATIONAL CENTER FOR RESEARCH AND 6 A1215574S ASBL I.C.R.T.S AV. DU MARCHE N°03 C/GOMBE CDI / KINSHASA SOLUTION DYNAMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT 7 A1215565H ASBL AV. MARCHE N°11 C/NDJILI CDI / KINSHASA INTERNATIONAL FONDS COMMUNAUTAIRE DE PROMOTION ET DE COOPEC- 8 A1200219C ASBL AV. DU COMMERCE N° 34 C/ GOMBE CDI / KINSHASA CREDIT AGRICOLES FONDS ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA 9 A1214184G ASBL A.D.E.G.I AV. KINGABWA N°10 C/NGIR NGIRI CDI / KINSHASA GESTION DES INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES ET FILLES DE MARIE AUXILIATRICE SALESIENNES DON 10 A0901830A ASBL F.M.A. AV. ANUARITE Q/LUKALENGE C/KATANDA CDI / KINSHASA BOSCO 11 A1315373A ASBL DEFENSE ET PROMOTION DES DROITS DES FEMMES AV. DES CLINIQUES N°3979 C/GOMBE CDI / KINSHASA AV. 7eme RUE REVOLUTION N°402 Q.RESIDENTIEL 12 A0907983N ASBL ASBL TRIAS RDC CDI / KINSHASA C/LIME 13 A0907442A ASBL AFRICARE AFRICARE AV. -

Democratic Republic of Congo Media and Telecoms Landscape Guide December 2012
1 Democratic Republic of Congo Media and telecoms landscape guide December 2012 2 Index Page Introduction...............................................................................................3 Media overview.......................................................................................14 Media groups...........................................................................................24 Radio overview........................................................................................27 Radio stations..........……………..……….................................................35 List of community and religious radio stations.......…………………….....66 Television overview.................................................................................78 Television stations………………………………………………………......83 Print overview........................................................................................110 Newspapers…………………………………………………………......…..112 News agencies.......................................................................................117 Online media……...................................................................................119 Traditional and informal channels of communication.............................123 Media resources.....................................................................................136 Telecoms companies..............................................................................141 Introduction 3 The Democratic Republic of Congo (DRC) has been plagued by conflict, corruption -

De La République Démocratique Du Congo Cabinet Du Président De La République
Journal Officiel - Banque des Données Juriques - 2013 Première partie 54e année n° 2 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Kinshasa – 15 janvier 2013 l’Asbl, Communauté Pentecôtiste au Nord Katanga du SOMMAIRE 18 juillet 2012, col. 17. 18 janvier 2013 - Arrêté ministériel n°021/CAB/ GOUVERNEMENT MIN/J&DH/2013 accordant la personnalité juridique à Ministère de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et l’Association sans but lucratif confessionnelle Affaires Coutumières dénommée « Ministère Evangélique, Prophétique et de 29 octobre 2012 - Arrêté ministériel n°25/CAB/ Délivrance », en sigle « M.E.P.D. », col. 19. MININTERSEDAC/033/2012 portant reconnaissance du statut de réfugié, col. 6. Ministère de la Culture et des Arts 08 novembre 2012 - Arrêté ministériel n° 036/2012 03 mars 2012 - Arrêté ministériel n°016 /CAB/MIN/ portant reconnaissance d’un Chef de Chefferie dans le CA/2012 modifiant et complétant l'Arrêté ministériel Territoire d’Uvira, Province du Sud-Kivu, col. 8. n°018/CAB/MIN/CA/2011 du 04 août 2011 fixant le 08 novembre 2012 - Arrêté ministériel n° 037/2012 cadre organique d'un Etablissement public dénommé « portant reconnaissance d’un Chef de Chefferie dans le Fonds de Promotion Culturelle », col. 21. Territoire d’Uvira, Province du Sud-Kivu, col. 9. Ministère de la Jeunesse, Sports, Culture et Arts 08 janvier 2013 - Arrêté ministériel n°044/2013 12 juillet 2012 - Arrêté ministériel n°105 /CAB/ portant suspension des activités d’un parti politique MIN/JSCA/2012 portant nomination des membres des dénommé « Rassemblement des Congolais Démocrates Comités de Direction des Complexes Omnisports Stade et Nationalistes », en sigle « R.C.D.N », col. -
Revue De Presse JEUX DE LA FRANCOPHONIE Juin 2021
Revue de presse JEUX DE LA FRANCOPHONIE Juin 2021 Réalisée par le Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF) SYNTHESE Ce document fait la synthèse de la presse parue sur internet portant sur les Jeux de la Francophonie au cours du mois de juin 2021. à partir du site internet des Jeux de la Francophonie ww.jeux.francophonie.org La fréquentation du site du 1er au 31 juin 2021 Sessions : 3913 *Il s'agit du nombre total de sessions sur la période. Une session est la période pendant laquelle un utilisateur est actif sur son site Web, ses applications, etc. Toutes les données d'utilisation (visionnage de l'écran, événements, e-commerce, etc.) sont associées à une session. Utilisateurs : 2957 *Utilisateurs qui ont initié au moins une session dans la plage de dates sélectionnée. Pages vues : 10 408 *Il s'agit du nombre total de pages consultées. Les visites répétées d'un internaute sur une même page sont prises en compte. Au niveau de l’Internet : 33 articles de presse ou brèves recensés publiées sur divers sites internet o 26 concernant les IXes Jeux de la Francophonie o 1 sur les Jeux de la Francophonie en général o 6 articles sur les lauréats des Jeux de la Francophonie 2 SOMMAIRE I. Articles sur les IXes Jeux de la Francophonie .................................................................... 5 RVA : Bienvenu Liyoya déclaré persona non grata ! ................................................................... 5 Football-RD Congo : menace sur l’organisation de la Coupe du Congo ..................................... 6 La ministre de la Culture, arts et patrimoine salue l’état de conservation de la Place des artistes ........................................................................................................................................ -

Annual Report Reflects Activities Implemented Over a One-Year Period; They Form Part Of, and Are Based On, Longer-Term, Multi-Year Planning
DEMOCRATIC REPUBLIC OF 31 May 2006 CONGO In Brief Appeal No. 05AA035; Appeal target: CHF 1,586,382 (USD 1,258,533 or EUR 1,004,475); Appeal coverage: 84.2%. Click here to go directly to the attached Financial Report. Annual Appeal: http://www.ifrc.org/docs/appeals/annual05/05AA035.pdf Programme Update no. 1: http://www.ifrc.org/docs/appeals/annual05/05AA03501.pdf Programme Update no. 2: http://www.ifrc.org/docs/appeals/annual05/05AA03502.pdf This Annual Report reflects activities implemented over a one-year period; they form part of, and are based on, longer-term, multi-year planning. All International Federation assistance seeks to adhere to the Code of Conduct and is committed to the Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response in delivering assistance to the most vulnerable. For support to or for further information concerning Federation programmes or operations in this or other countries, please access the Federation’s website at http://www.ifrc.org For further information specifically related to this Annual Appeal please contact: · In DRC: Matthieu Musepulu, Secretary General, Red Cross of the Democratic Republic of Congo, Kinshasa, Email: [email protected]; Phone: +243.998.225.214 or +243.998.481.624 · In DRC: Zibi Zibi Constantin, Head of Federation delegation, Kinshasa, Email: [email protected]; Phone +243.818.801.400 , +243.998.011.801 · In Cameroon: Moulaye Camara, Federation acting Head of Central Africa Sub-Regional Office, Yaoundé; Email: [email protected]; Phone +237.221.74.37; Fax +237.221.74.39