Rapport Saint-Rémy-Lès-Chevreuse
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

N° 104 Juillet 2017
LE TRAIT D’UNION N° 104 JUILLET 2017 Association des Retraités de Technip [email protected] www.artechnip.org JUILLET 2017 N°104 SOMMAIRE ÉDITORIAL – page 1 ARTS & CULTURE – page 11 . de l’ARTP . Le Coin des Artistes. Homographes – Homophones NOUVELLES DE LA FNAR-UFR – page 2 . La naissance du marbre automobile . Lettre de la CFR au Président de la République . Les 40 ans du RER . Le MS61 est entré dans l’histoire . Au Fil des Jours ACTIVITÉS DE TECHNIP – page 26 REVUE DE PRESSE – page 7 . « Intérêts privés » du mois de mars 2017 . La flotte - Livraison du Skandi Búzios . Nouveaux contrats CHRONIQUES du CHAOS AMBIANT – page 9 LOISIRS – page 29 . de Corindon . Expositions Communiqués ARTP – page 10 NÉCROLOGIE – page 31 . Senior expérience . Hommage à ceux qui nous ont quittés . Site www.artp.org NOUVEAUX ADHÉRENTS 0~0~0~0~0 La réalisation de ce numéro a été effectuée avec la participation de : Daniel Bailly - Joseph Caer - Bernard Chavand - Jean-Pierre Cohen Natalia Diaith - Jean-Michel Gay - Jean-Louis Gérard - Huguette Livernault Jacques Massol - Michel Pinaz - Philippe Robin - Jean Roy - Jean Marie Ternisien Qu’ils soient tous chaleureusement remerciés ainsi que les ateliers de reprographie de TECHNIP ÉDITORIAL Les retraités ont fait l’objet d’une attention particulière lors des récentes élections. Dans cette période de « promesses » on aurait pu s’attendre à un projet de revalorisation des pensions - gelées depuis des années - ou à d’autres mesures en leur faveur. Et bien non il est envisagé principalement d’augmenter la CSG applicable aux pensions. La Confédération Française des Retraités, à laquelle nous sommes affiliés, a immédiatement réagi. -

Saint-Rémy-Lès-Chevreuse Renouvellement De La Signalisation Et Fiabilisation Des Garages Et Dégarages
Version du 11 juin 2015 Juin 2015 SCHEMADIRECTEURRERB Premières opérations d’amélioration du RER B Etudes d’AVP Saint-Rémy-lès-Chevreuse Renouvellement de la signalisation et fiabilisation des garages et dégarages Avant-projet Saint-Rémy-lès-Chevreuse – Renouvellement de la signalisation et création d’itinéraires. 1 / 46 S OMMAIRE A. Préambule................................................................................................................................4 1. Présentation du document...............................................................................................4 2. Description du secteur concerné par le projet..................................................................4 2.1 La ligne B ........................................................................................................................4 2.2 Historique de la ligne B ...................................................................................................4 2.3 Infrastructures ferroviaires...............................................................................................5 2.4 Le schéma Directeur du RER B au Sud............................................................................7 B. Définition du projet..................................................................................................................9 1. Rappel du contexte..........................................................................................................9 1.1. Un projet de maintenance patrimoniale..........................................................................9 -

RER B a La Conquête De L'excellence !
Comité de ligne B Novembre 2010 Les travaux B Nord + Un conducteur RATP à Roissy CDG Nouveau MI 79 rénové Sommaire 2 Présentation de la ligne 1. La régularité de la ligne B interopérée 2. L’offre et le projet RER B Nord + 3. L’intermodalité Présentation de la ligne La ligne B, c’est une ligne avec une histoire 4 À l’origine, 2 réseaux différents : –La ligne de Sceaux avec pour terminus Denfert (1846), puis Luxembourg (1895) –La ligne de la Compagnie des Chemins de Fer du Nord - Paris Gare du Nord – Mitry – Laon (1860) et la ligne Aulnay – Roissy CDG (1976) 1983 : un RER B interconnecté à Gare du Nord (SDAURIF 1976) –La création des gares de Châtelet Les Halles (1977), Gare du Nord souterraine (1981), et St Michel (1988) –Correspondance de quai à quai en Gare du Nord (1981), il faut changer de train –Interconnexion en juin 1983 de la ligne de Sceaux et du réseau Paris Nord 2009 : un RER B interopéré, on ne change plus de conducteur –après un travail juridique, technique et managérial majeur, et une mobilisation de tous les acteurs 2013 ? Denfert-Rochereau : terminus de la ligne de Sceaux La construction de la Gare du Nord souterraine La relève à Gare du Nord Un conducteur RATP à Roissy CDG Aujourd’hui, la ligne B, c’est… 5 8 départements 33 communes 47 gares TGV, Eurostar, Thalys 31 RATP et 16 SNCF 2 lignes Transilien 4 lignes de RER 3 9 lignes de métro b 2 lignes de tramway aéroports 77,5 km 2 opérateurs ferroviaires : RATP & Transilien SNCF 2 gestionnaires d’infrastructures : RATP & RFF Aujourd’hui, la ligne B, c’est aussi… 6 Marseille -
Dossier D'émergence Du Schéma Directeur RER B
Dossier d’émergence du schéma directeur RER B Version du 16 novembre 2011 Préambule Origine de la démarche Le projet de SDRIF adopté par le Conseil Régional d’Ile-de-France en septembre 2008 prévoit (page 137) « (l’)étude et (la) mise en œuvre des schémas directeurs de lignes ferroviaires, notamment en renforçant les RER B, D, C et A, tout particulièrement dans leurs sections les moins fluides », ces projets devant être menés au cours des phases 1 et 2, c’est-à-dire avant 2014 pour la première et entre 2014 et 2020 pour la suivante. Un premier exercice, antérieur à l’élaboration du SDRIF, a été mené à l’occasion du projet « RER B Nord+ » dont le schéma directeur a été pris en considération par le STIF en 2003, puis le schéma de principe (modificatif) adopté en septembre 2006. Le projet RER B Nord+, qui doit être achevé fin 2012, consiste en une modernisation lourde de la section nord, permettant une nouvelle offre cadencée sur deux voies en principe dédiées au seul RER B, ainsi que des améliorations concernant l’accessibilité des gares, l’information des voyageurs et l’intermodalité. Le présent schéma directeur de la ligne B, doit permettre de mettre en œuvre au sud une modernisation comparable au projet RER B Nord+ tout en portant un regard d’ensemble sur les performances ferroviaires de la ligne. Objectifs du schéma directeur Les objectifs poursuivis par le STIF dans ce schéma directeur sont de : - satisfaire au mieux et au plus vite les attentes des usagers par l’amélioration de la régularité et de la qualité de service, - préparer les évolutions de l’offre, - satisfaire la logique de performance globale et d’unicité de service. -

La Ponctualité De La Ligne B Du RER
n°- 009609-01 30 avril 2014 La ponctualité de la ligne B du RER Efficacité des investissements et réformes en cours CONSEIL GÉNÉRAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE Rapport n° : 009609-01 La ponctualité de la ligne B du RER Efficacité des investissements et réformes en cours établi par Bernard Simon Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts Hervé de Tréglodé Ingénieur en chef des mines 30 avril 2014 Fiche qualité La mission du CGEDD qui a donné lieu à la rédaction du présent rapport a été conduite conformément au dispositif qualité du Conseil(1). Rapport CGEDD n° 009609-01 Date du rapport : 30 avril 2014 Titre : La ponctualité de la ligne B du RER Sous-titre du rapport : Efficacité des investissements et réformes en cours Commanditaire(s) : ministre délégué chargé des transports, de Date de la commande : 19 février 2014 la mer et de la pêche Auteurs du rapport (CGEDD) : Bernard Simon et Hervé de Tréglodé Coordonnateur : Hervé de Tréglodé Superviseur : Jean-Paul Ourliac Relecteur : Laurent Winter Membres du comité des pairs : Jean-Paul Ourliac (président du comité des pairs), Marc d’Aubreby, Marie- Anne Bacot, Patrick Labia, Isabelle Massin et François-Régis Orizet Nombre de pages du rapport (sans les annexes) : 41 8 48 (1) Guide méthodologique s'appliquant aux missions confiées au CGEDD http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/007204- 02_guide_methodologique_cgedd_2012_05_04_cle2e6cae.pdf Les rapporteurs attestent que l'impartialité d'aucun d'entre eux n'a été mise en cause par des intérêts particuliers ou par des éléments de ses activités passées ou présentes. -

Schémas Directeurs Des RER a Et RER B
[ . Juillet 2015 Schémas directeurs des RER A et RER B - RER A - Création d’installations de retournement à Etoile - RER A - Création d’infrastructures à Chessy (phase 1) - RER B - Renouvellement de la signalisation et fiabilisation des garages et dégarages de Saint Rémy - RER B - Adaptation de la signalisation de la ligne B Sud (phase1) - RER B - Création d’un Tiroir en arrière-gare d’Orsay CONVENTION 15DPI000 – SGP2015CONV059 Schémas Directeurs des RER Convention de financement n°2 relative aux études Projet et travaux du RER A et RER B (Périmètre RATP) 2/38 SOMMAIRE CONTEXTE GENERAL DE L’OPERATION 7 Article 1. Objet de la convention 8 Article 2. PERIMETRE ET CALENDRIER DE REALISATION DES ETUDES PROJET ET TRAVAUX 9 Article 3. ROLES ET ENGAGEMENTs DES PARTIES 14 3.1. L’Autorité organisatrice ................................................................................................................... 14 3.2. La maîtrise d’ouvrage des opérations .......................................................................................... 14 3.3. Les financeurs ................................................................................................................................ 15 Article 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 16 4.1. Estimation du coût des études de Projet,des travaux des projets et des « moyens de substitution » objet de la présente convention est : ........................................................................................................... 16 4.2. Coût global des études Projet et des travaux -
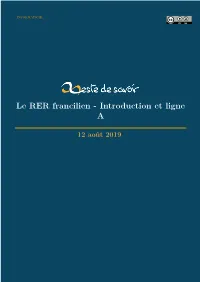
Le RER Francilien - Introduction Et Ligne A
informaticie... Le RER francilien - Introduction et ligne A 12 août 2019 0 Table des matières 1. Présentation générale ................................. 2 1.1. Les problèmes de l’Île-de-France avant le RER ............... 2 1.2. Un embryon dans les années 1930 ...................... 2 1.3. Le schéma directeur du futur RER ..................... 3 1.4. Un mot sur les exploitants .......................... 4 2. RER A : la liaison Est-Ouest ............................ 5 2.1. Début des travaux Défense - Étoile ..................... 6 2.2. La ligne de Vincennes et son renouveau .................. 6 2.3. Ligne de Saint-Germain-en-Laye et travaux à l’Ouest ........... 7 2.4. La jonction, l’ouverture et Marne-la-Vallée ................. 8 2.5. La jonction .................................. 8 2.6. L’aventure continue ............................. 9 2.7. Deuxième prolongement à l’Est ....................... 9 2.8. La ligne A en résumé ............................. 11 2.9. La surcharge et le SACEM .......................... 13 2.10. Problèmes et solutions envisagées ...................... 14 2.11. La co-direction de la ligne .......................... 14 Le Réseau Express Régional est un des symboles de l’Île-de-France. Composé de 5 lignes, il relie les différents départements en passant par Paris, d’où son nom. Mais le connais-tu vraiment ? À travers une série d’articles, dont celui-ci est le premier, nous allons en apprendre plus sur les origines de ce fameux RER, sur les motivations de ses concepteurs, sa progression, ses défauts, ses qualités. En bref, tu seras incollable sur le sujet. i Cet article est la première partie d’une série d’articles sur le RER de la région Île-de-France (RER B , RER C et RER D ). -

Monographie Du Quartier De Gare : Palaiseau • Ligne 18
Observatoire des quartiers de gare du Grand Paris Monographie du quartier de gare Palaiseau Ligne ⓲ !" AVRIL 2017 Directrice de la publication : Dominique Alba Étude réalisée par : Stéphanie Jankel, Clément Mariotte Avec le concours de : Camille Bourguignon, Julien Gicquel, Sandra Roger Cartographie : Marie-Thérèse Besse, Christine Delahaye, Laurent Planchot, Anne Servais, Pascale Sorlin Photos et illustrations : Apur sauf mention contraire Mise en page : Apur www.apur.org 2016V2.7.1. Sommaire Introduction ....................................................................................1 1. Aujourd’hui peu d’habitations autour de l’École Polytechnique et des centres de recherche et entreprises voisines .........................3 2. Un quartier en profonde mutation .................................................4 3. Le cadre urbain et paysager du quartier de gare ..............................5 3.1. Un quartier spécialisé dans l’enseignement supérieur et la recherche ..................5 3.2. Des hauteurs de bâti faibles .............................................................................6 3.3. Un quartier en cours de densification ...............................................................6 3.4. Un tissu urbain contrasté ................................................................................7 3.5. L’urbanisation récente du plateau de Saclay .....................................................8 3.6. Un cadre végétal remarquable .........................................................................9 3.7. Des -

Le RER Francilien - La Ligne B
informaticie... Le RER francilien - La ligne B 12 août 2019 0 Table des matières 1. RER B : la liaison Nord - Sud ............................ 2 1.1. Les travaux préparatoires sur la ligne de Sceaux .............. 2 1.2. Les travaux au nord ............................. 2 1.3. L’inauguration ................................ 3 1.4. Le matériel bi-courant, Gare du Nord, le bout du tunnel ......... 3 1.5. Toujours plus de gares ! ........................... 4 1.6. RER B Nord ................................. 4 1.7. La ligne B en résumé ............................. 5 1.8. B comme beaucoup (de problèmes) ..................... 6 1.9. Un centre de commandement unique .................... 6 i Cet article fait partie d’une série d’articles sur le RER de la région Île-de-France (RER A , RER C et RER D ). Je tiens à remercier Franklin Jarrier et son site carto.metro.free.fr pour m’avoir autorisé à utiliser sa carte consacrée au RER . N’hésite pas à consulter son site, il y a plein d’autres cartes intéressantes, notamment le métro de Paris. Un grand merci également à zeqL , lama en chef, pour la validation de ce deuxième article. En 1977, alors que les tronçons est et ouest de la ligne A sont enfin réunis, est prolongée la fameuse Ligne de Sceaux jusqu’à Châtelet-les-Halles, maintenant connue sous le nom de RER B. — Prévue au schéma d’exploitation du futur RER, cette ligne doit traverser la région du Nord au Sud, tout en étant en correspondance avec la ligne Est - Ouest. — Elle doit permettre de décharger la ligne 4, qui devient progressivement la plus chargée du métro, ainsi que Gare du Nord, qui prend la tête du classement devant Saint-Lazare.