EI Tescou Chapitre4 Impacts
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Official Journal C 3 of the European Union
Official Journal C 3 of the European Union Volume 62 English edition Information and Notices 7 January 2019 Contents IV Notices NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2019/C 3/01 Euro exchange rates .............................................................................................................. 1 NOTICES FROM MEMBER STATES 2019/C 3/02 Notice inviting proposals for the transfer of an extraction area for hydrocarbon extraction ................ 2 2019/C 3/03 Communication from the Minister for Economic Affairs and Climate Policy of the Kingdom of the Netherlands pursuant to Article 3(2) of Directive 94/22/EC of the European Parliament and of the Council on the conditions for granting and using authorisations for the prospection, exploration and production of hydrocarbons ................................................................................................... 4 V Announcements PROCEDURES RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF COMPETITION POLICY European Commission 2019/C 3/04 Prior notification of a concentration (Case M.9148 — Univar/Nexeo) — Candidate case for simplified procedure (1) ........................................................................................................................ 6 EN (1) Text with EEA relevance. OTHER ACTS European Commission 2019/C 3/05 Publication of the amended single document following the approval of a minor amendment pursuant to the second subparagraph of Article 53(2) of Regulation (EU) No 1151/2012 ............................. -

Arrêté Cadre Interdépartemental Du Portant Définition D'un Plan D'action Sécheresse Pour Le Sous-Bassin Du Tarn
PRÉFET DU TARN DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES Service eau, environnement et urbanisme Pôle eau et biodiversité Bureau ressources en eau Arrêté cadre interdépartemental du portant définition d'un plan d'action sécheresse pour le sous-bassin du Tarn Les préfets des départements de l’Aveyron, du Gard, de la Haute-Garonne, de l’Hérault, du Lot, de Lozère, du Tarn, de Tarn-et-Garonne, Vu le code civil et notamment les articles 640 à 645, Vu le code de la santé publique, livre III, Vu le code de l’environnement et notamment les articles L.211-3, L.215-7 à L.215-13, L.432- 5 et R.211-66 à R.211-74, Vu le code pénal et notamment son livre Ier – titre III, Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1, Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, Vu le décret n° 2004-0374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements, Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 2010-2015 du bassin Adour- Garonne approuvé le 1er décembre 2009, Vu l'arrêté cadre interdépartemental du 29 juin 2004 de définition d'un plan d'action sécheresse pour le sous-bassin du Tarn, Vu le plan de gestion des étiages (PGE) du bassin versant du Tarn approuvé le 8 février 2010, Considérant la nécessité d'une cohérence de la gestion des situations de crise au niveau de l'ensemble du bassin Tarn, conformément aux principes de l'article L 211-3 du code de l'environnement. -

Dourgne Sacré Champion Du Tarn
Numéro 33 – Mai 2012 Dourgne sacré Champion du Tarn Magazine d’information édité par le District du Tarn de Football Responsable de la publication : Commission Communication Rédacteur : Franck FERNANDEZ Crédit photo : DTF – Louis GOULESQUE Collaborateurs: Sébastien Bosc, David Welferinger, Sonia Lagasse, Romain Bortolotto. 1 SOMMAIRE AGENDA Page 2 : Agenda Samedi 26 mai à Rigaud Finale du Challenge Trouche à 14h Page 3-4 : Actualité Lescure 3 – Fréjeville Les distinctions individuelles en Excellence Finale du Challenge Manens à 17h Albi Mahorais – Sorèze Page 5 : Tournoi Le Trophée Alain Bénédet – Valence OF Finale de la Coupe du Tarn à 20h Marssac 2 - Dourgne Page 6 : Portrait Laurie et Romain Cabanel - Lacaune Dimanche 3 juin Finale de la Coupe du Midi féminines Page 7 : Football féminin Asptt Albi 2 – TFC2 Les classements Finale du Challenge Souchon Page 8 : Football d’animation Gaillac – St Jean SO St Amans Samedi 16 juin Page 9 : l’ITW décalé Assemblée Générale d’été - Lavaur Mathieu Baudoui – ES Viviers Pages 10-11 : Technique Perfectionnement aux techniques de conduites, dribbles et contrôles pour éliminer un adversaire. CHALLENGE DU JEUNE EDUCATEUR Le District du Tarn de Football organise pour la 5e année consécutive le Challenge du Jeune Educateur. Vous Le soualais Dauer (en-haut) termine meilleur buteur en pouvez télécharger le dossier de Excellence pour la seconde fois consécutive devant le candidature ainsi que le règlement du marssacois André (ci-dessous). Challenge sur le site Internet du DTF. Cette opération a pour but de donner un coup de projecteur sur des jeunes (filles ou garçons) âgés entre 15 et 20 ans qui ont fait le choix de donner de leur temps libre au football en encadrant des équipes lors des entraînements et/ou des rencontres du samedi. -

Restauration Du Tescou Et Tescounet
Restauration du Tescou et Tescounet Le mot du Président Créé en 2007, notre syndicat est enfin entré dans sa phase active avec une première tranche de travaux réalisée en 2009/2010 sur les départements du Tarn et du Tarn et Garonne. Ces premiers travaux, un baptême pour notre syndicat, se sont bien passés et ont donnés de bons résultats, cela grâce aux entreprises mais aussi à vous propriétaires. Il s’agit maintenant d’entretenir ces zones déboisées afin d’éviter des repousses importantes et indésirables. Je compte sur votre civilité et votre amour de la nature pour cela. La deuxième tranche de travaux s’est déroulée en début 2011 (janvier-mars) sur les deux départements et nous conti- nuerons tous les ans jusqu’à l’accomplissement final de notre mission. Je remercie une nouvelle fois les Conseils Généraux des trois départements Tarn, Tarn et Garonne et Haute-Garonne ainsi que l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et le Conseil Régional Midi-Pyrénées de nous suivre et de nous aider dans ces travaux. J.C. BOURGEADE, Président du Syndicat Mixte du Tescou et Tescou- La réalisation des travaux de restauration du Tescou et du Tescounet Réalisés dans le cadre d'un programme pluriannuel, les travaux de restauration intègrent un ordre de priorité et les spécificités des différents tronçons pour faire face aux besoins les plus pressants. Chaque année, ils sont confiés à des entreprises spécialisées dans le cadre d’un marché public de travaux et visent à une amélioration de l’état général de la rivière. Ils consistent en un rattrapage du cours d’eau après des années d’abandon et font appel à des techniques forestières et de génie végétal (coupe sélective, recépage, élagage, gestion des embâcles…). -

Sivens: the Removal of the French Territory by Means of Planning and Development
7/2015 Sivens: The removal of the French territory by means of planning and development. Philippe Pelletier -Université Lyon 2 What has been going on for the last two years in the Tescou valley over the Sivens (Tarn) dam project, and which has suddenly gathered sped with the death of a young opponent on October 26, 2014 following a nocturnal charge by the police, again dramatically illustrates the removal of territory by means of planning and development that is currently taking place in France. At the same time – and this is no coincidence – the highest authorities are finalizing two major worksites with extreme geographic implications. On the one hand, we have Prime Minister Manuel Valls’ commitment of €1.4 billion of government money for the Greater Paris transit system. On the other, we have territorial land reform concerning the regrouping of the Regions, also confirmed by Valls, which was approved by France’s National Assembly on December 9, 2014. Brutal top-down process The top-down process, by way of local political bosses, characterizes what is going on in Sivens just as it did for the Notre-Dame-des-Landes airport project (see the article by A.L. Pailloux also in this issue). After having convinced their general council, a handful of local elected officials supported by a lobbying group – manufacturing companies supported by a major ruthless national developer on the one hand, and a few farmers declaring that they have no water on the other – forced through a project and a dam. Their opponents, often well informed, well equipped and knowing the right questions to ask, are looked down on. -

Le Nouveau Plan De Gestion Du Tescou Et Du Tescounet : 2019-2024
Travaux envisagés Le nouveau Plan de Gestion du Tescou Actions sur les zones humides Recensement et du Tescounet : 2019-2024 Gestion/Restauration Sensibilisation Zones humides fonctionnelles présentes sur le bassin versant du Tescou Autres actions sur les cours d’eau Le mot du Président Chantiers pilotes de restitution de débit sur 2 retenues J.C. BOURGEADE, Contrôle des points d’accès du bétail : mise en défens, points d’abreuve Président du Syndicat Mixte du Tescou et Tescounet. ment stabilisés ou en retrait du cours d’eau Mise en défens et point d’abreuvement Un nouveau petit journal pour notre syndicat. hors cours d’eau (bassin Cérou-Vère) Nous avons accueilli un nouveau technicien, M Yann LAURENT depuis presque 3 ans maintenant. A ce jour, nous Sensibilisation et communication autour de nos actions avons pratiquement travaillé sur la totalité des rivières Tescou et Tescounet et je dois remercier les propriétai- res riverains, les agriculteurs car ces travaux se sont déroulés dans de bonnes conditions. Le mot du riverain J’ai pu apprécier tout au long de ces travaux la participation des riverains avec les entreprises et le Syndicat. Propriétaires d'un moulin qui enjambe le Tescou sur la commune de LISLE SUR TARN , nous jouissons d'un cadre de vie agréable qui nous impose, à juste titre, des responsabilités quant à la vie de la rivière. Lancés Nous engageons un nouveau Plan Pluriannuel de Gestion, très ambitieux, se conformant aux nouvelle normes et lois depuis peu dans la restauration de notre ancien moulin nous nous devons de respecter les règles environne- sur le domaine des milieux aquatiques. -

Comparison of El Hierro Island Hydro Wind Project and Sivens Dam Project
Open Archive TOULOUSE Archive Ouverte ( OATAO ) OATAO is an open access repository that collects the work of Toulouse researchers and makes it freely available over the web where possible. This is an author-deposited version published in : http://oatao.univ-toulouse.fr/ Eprints ID : 17496 To link to this article : DOI: 10.1016/j.compchemeng.2017.02.002 URL : http://dx.doi.org/10.1016/j.compchemeng.2017.02.002 To cite this version : Roth, Anastasia and Gerbaud, Vincent and Boix, Marianne and Montastruc, Ludovic Holistic framework for land settlement development project sustainability assessment: comparison of El Hierro Island hydro wind project and Sivens dam project. (2017) Computers & Chemical Engineering, vol. 100, pp. 153-176. ISSN 0098-1354 Any correspondence concerning this service should be sent to the repository administrator: [email protected] Holistic framework for land settlement development project sustainability assessment: Comparison of El Hierro Island hydro wind project and Sivens dam project A. Roth, V. Gerbaud ∗, M. Boix, L. Montastruc Laboratoire de Génie Chimique, Université de Toulouse, CNRS, INPT, UPS, Toulouse, France abstract Project developer in the domain of land settlement project are involved with many stakeholders and are Keywords: usually overflown by data relative to technical, economic and social issues. This paper contributes to the Framework Eco-energy system necessary multi-scale approach challenge and we propose a holistic framework that enables to describe Multi-stakeholders the development process of land settlement project and assess its sustainability. It would help developers Multiperspective design to take decisions compliant with the project complexity. In the model driven engineering perspective, the metamodel framework is described with the ISO 19440 four views to represent complex systems: architectural, structural, functional and behavioural. -

Liste Des Personnes Auditées NOM Prénom Organisme ANDRIEU
Liste des personnes auditées NOM Prénom Organisme ANDRIEU Rémy Directeur de l'Epi Salvagnacois ANGLADE Bruno Agriculteur du Tarn ARLANDES Régis Adjoint au maire de Monclar de Quercy ARLANDES Arnaud Agriculteur de Tarn-et-Garonne ASTRUC Christian Président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne BAREGES Brigitte Maire de Montauban BELOT Florian Agriculteur du Tarn BESNARD Pierre Préfet de Tarn-et-Garonne BLANDEL Françoise UPNET du Tarn BOU Alain SAFALT du Tarn BOULOUS Alexandre Agriculteur du Tarn BOURGEADE Jean-Claude Président du SMIX Tescou-Tescounet CARCENAC Thierry Président du conseil départemental du Tarn CATALA Richard Gérant de l'abattoir de Beauvais-sur-Tescou CONRAD Christian APIFERA DA ROS Yves Agriculteur du Tarn DEJEAN Claude Président de la fédération départementale de la pêche de Tarn-et-Garonne DEMETZ Joffrey Président de l'association des habitants de Sivens DOUMAYROU Jean-Paul Agriculteur de Tarn-et-Garonne DOUREL Bernard Association Bio consom'acteurs ESCANDE David Agriculteur du Tarn FITA Claire Conseil régional de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées FLOUR Patrick Agence de l'eau FORESTIE Edouard Agriculteur de Tarn-et-Garonne GARRIGUES Géraldine Directrice de la Société Nutribio GENTILHOMME Thierry Préfet du Tarn GODIN Philippe Directeur de la RAGT d'Albi HAYA Pierre Agriculteur du Tarn HELIN Brigitte Gîte et chambres d'hôte à Salvagnac HUC Jean-Claude Président de la chambre d'agriculture du Tarn LABARTHE Vincent Conseil régional de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées LACOSTE Pierre et Nadine Agriculteurs du Tarn -

Montauban and Middle Ages Villages
Montauban and Middle Ages villages Ref : : 18JG-044 Tarn-and-Garonne is one of the wildest departments of Occitania region where food, gastronomy and traditions are part of daily life. Admire beautiful medieval heritage such as Montauban city or the villages of Bruniquel and Saint Antonin Noble val. In the morning, meet your guide and visit the charming city of Montauban, main city of Tarn-and –Garonne. The city was built during the 12th century in between three rivers: Tarn, Tescou and Garrigue. Middle Ages used to be its most important period during which the city extended and monuments were built: the Old Bridge, The St Jacques church or its sumptuous cathedral. Tempted by Catharism, it would finally become one of the high places of Protestantism. Lunch: traditional lunch in a nearby restaurant. In the afternoon, Drive along the Aveyron valley to reach two beautiful medieval villages, Bruniquel and Saint Antoine Noble Val. Bruniquel was built over a hill and its castle still overlooks the Aveyron River. The village keeps its medieval center, the medieval gate, its cobbled streets, its lovely squares. A perfect place for a stroll or to let your mind dreams. Saint Antonin Noble Val was a village that developed thanks to the presence of an abbey already known in the 9th century. Through the medieval streets, you can admire the façades of medieval houses and private mansions. Our day tour prices are Our day tour includes: all inclusive, without transport - tour guide services during the entire day - entrance fees to the listed monuments - lunch (3 courses meal, 1/4l wine and coffee) - driver cost Rate per Person For 25 persons minimum For 30 persons minimum For 35 persons minimum For 40 persons minimum For 45 persons minimum 46,00 € 44,00 € 42,00 € 41,00 € 40,00 € Agence GuideSud Occréa 3 Place du jeu de Boules F - 34440 Colombiers http://www.guidesud.com [email protected] http://www.facebook.com/GuidesudOccrea Tel : 00 33 (0) 434 53 57 66 - Mobile : 00 33 (0) 689 57 41 31 Guidesud Garantie APST RC Hiscox Immatriculation 034120010 . -

Concerning the Community List of Less-Favoured Farming Areas Within the Meaning of Directive the Requirements for Less-Favoured
15 . 11 . 89 Official Journal of the European Communities No L 330 / 31 COUNCIL DIRECTIVE of 23 October 1989 concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75 / 268 / EEC ( France ) ( 89 / 587 /EEC ) THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES , Whereas the three types of areas communicated to the Commission satisfy the conditions laid down in Article 3 ( 3 ), Having regard to the Treaty establishing the European ( 4 ) and ( 5 ) of Directive 75 / 268 /EEC ; whereas the first meets Economic Community , the requirements for mountain areas, the second meets the requirements for less-favoured areas in danger of Having regard to Council Directive 75 /268 /EEC of 28 April depopulation where the conservation of the countryside is 1975 on mountain and hill farming and farming in certain necessary and which are made up of farming areas which are less-favoured areas (*), as last amended by Regulation ( EEC ) homogeneous from the point of view of natural production No 797/ 85 ( 2 ), and in particular Article 2 ( 2 ) thereof, conditions , and the third meets the requirements for areas affected by specific handicaps ; Having regard to the proposal from the Commission , Whereas, according to the information provided by the Member State concerned , these areas have adequate Having regard to the opinion of the European infrastructure , Parliament ( 3 ), Whereas Council Directive 75 / 271 /EEC of 28 April 1975 HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE : concerning the Community list of less-favoured areas within the meaning of Directive 75 / 268 / EEC ( 4 ), supplemented Article 1 by Directives 76 /401 / EEC ( 5 ), 76 / 631 / EEC ( 6 ), 77 /178 /EEC ( 7 ) and 86-/ 655 /EEC ( 8 ) indicates the areas of The areas situated in the French Republic which appear in the the French Republic which are less-favoured within the Annex form part ofthe Community list ofless-favoured areas meaning of Article 3 ( 3 ), ( 4 ) and ( 5 ) of Directive within the meaning of Article 3 ( 3 ), ( 4 ) and ( 5 ) of Directive 75 /268 /EEC ; 75 /268 / EEC . -

Focus Berges Du Tarn.Pdf
1 4 5 1 6 3 4 Cours Foucault Pont de l'avenir 2 25 Tel. 05 63 22 12 00 12 22 63 05 Tel. 7 82013 Montauban cedex Montauban 82013 9 rue de l’Hôtel de Ville de l’Hôtel de rue 9 25 Service Développement Durable Durable Développement Service 3 TARN 5 Villenouvelle ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. à 14h de et 12h30 à 10h de samedi au lundi du ouvert Le Centre du patrimoine est est patrimoine du Centre Le www.centredupatrimoine.montauban.com [email protected] 24 6 Tél. 05 63 63 03 50 03 63 63 05 Tél. 82013 Montauban Cedex Montauban 82013 Ancien Collège, 2 rue du Collège du rue 2 Collège, Ancien Direction du développement culturel développement du Direction 5 Place 23 Centre du patrimoine du Centre 8 Renseignements 24 Nationale 22 7 bénéficient de l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire. et d’art Pays et Villes l’appellation de bénéficient Pont vieux 8 d’Aure et du Louron, le grand Rodez le Pays des Pyrénées cathares et Gaillac Gaillac et cathares Pyrénées des Pays le Rodez grand le Louron, du et d’Aure Rouergue, le Pays de la Vallée de la Dordogne Lotoise, le Pays des vallées vallées des Pays le Lotoise, Dordogne la de Vallée la de Pays le Rouergue, Cahors, Figeac, le Grand Auch, Millau, Moissac, le Pays des Bastides du du Bastides des Pays le Moissac, Millau, Auch, Grand le Figeac, Cahors, A proximité A Villebourbon 22 toute la France. -
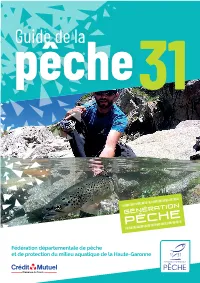
Guide-Peche-2021.Pdf
Fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique de la Haute-Garonne Plaisance du Touch SOMMAIRE RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE 4 Quelle carte pour 2021 6 Périodes d’ouverture et tailles légales 8 Comment mesurer un poisson 8 Limitation du nombre de captures 9 Nombre de cannes autorisées 9 Appâts 9 Classement piscicole 10 Heures légales de pêche 11 Modes de pêche prohibés 11 Procès verbaux 12 Réserves et pêches interdites 16 Les écrevisses PARCOURS SPÉCIAUX 18 Parcours spécifiques Μ22 Parcours animations pêche pour enfants 23 Parcours touristique et initiation 24 Parcours détente et initiation AGIR POUR LA PÊCHE 26 Calendriers des lâchers de truites 2021 28 Pêche en barque et float tube 28 Mises à l’eau 29 Pêche en embarcation en Haute-Garonne 30 Les associations de pêche 32 Les Ateliers Pêche Nature (APN) 33 Le pôle animation 31 34 Les dépositaires 38 Les pontons 40 Au service de la pêche 42 La garderie fédérale 44 Guide de pêche 44 Pêches spécialisées 46 Les hébergements pêche A L’INTÉRIEUR CARTE DÉTACHABLE > Réseau départemental > Lacs et plans d’eau > Lacs de montagne > Poster poissons LE MOT DU PRÉSIDENT L’année 2020 avait bien commencé et laissait présager une bonne année halieutique. La crise sanitaire et son train de mesures restrictives, est hélas venue perturber la pratique de notre loisir. Pour faire face à cette situation inédite, nous avons dû nous organiser pour assurer la continuité de gestion de la Fédération tout en respectant les consignes du confinement. Nous avons eu recours au télétravail pour le service administratif et à l’arrêt provisoire du service développement.