L'église De Heux À Larroque-Sur-L'osse: Un Édifice Du
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
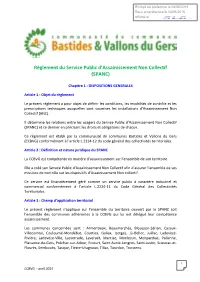
Règlement Du Service Public D'assainissement Non Collectif (SPANC)
Envoyé en préfecture le 04/05/2015 Reçu en préfecture le 04/05/2015 Affiché le Règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) Chapitre 1 : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Objet du règlement Le présent règlement a pour objet de définir les conditions, les modalités de contrôle et les prescriptions techniques auxquelles sont soumises les installations d’Assainissement Non Collectif (ANC). Il détermine les relations entre les usagers du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) et ce dernier en précisant les droits et obligations de chacun. Ce règlement est établi par la communauté de communes Bastides et Vallons du Gers (CCBVG) conformément à l’article L.2224-12 du code général des collectivités territoriales. Article 2 : Définition et nature juridique du SPANC La CCBVG est compétente en matière d’assainissement sur l’ensemble de son territoire. Elle a créé son Service Public d’Assainissement Non Collectif afin d’assurer l’ensemble de ses missions de contrôle sur les dispositifs d’Assainissement Non collectif. Ce service est financièrement géré comme un service public à caractère industriel et commercial conformément à l’article L.2224-11 du Code Général des Collectivités Territoriales. Article 3 : Champ d’application territorial Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire couvert par le SPANC soit l’ensemble des communes adhérentes à la CCBVG qui lui ont délégué leur compétence assainissement. Les communes concernées sont : Armentieux, Beaumarchès, Blousson-Sérian, Cazaux- Villecomtal, Couloumé-Mondébat, Courties, Galiax, Izotges, Jû-Belloc, Juillac, Ladevèze- Rivière, Ladevèze-Ville, Lasserrade, Laveraët, Marciac, Monlezun, Monpardiac, Pallanne, Plaisance-du-Gers, Préchac-sur-Adour, Ricourt, Saint Aunix-Lengros, Saint-Justin, Scieurac-et- Flourès, Sembouès, Tasque, Tieste-Uragnoux, Tillac, Tourdun, Troncens. -

Publication of an Application for Approval of Amendments, Which Are
20.1.2020 EN Offi cial Jour nal of the European Union C 18/39 Publication of an application for approval of amendments, which are not minor, to a product specification pursuant to Article 50(2)(a) of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council on quality schemes for agricultural products and foodstuffs (2020/C 18/09) This publication confers the right to oppose the amendment application pursuant to Article 51 of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council (1) within three months from the date of this publication. APPLICATION FOR APPROVAL OF NON-MINOR AMENDMENTS TO THE PRODUCT SPECIFICATION FOR A PROTECTED DESIGNATION OF ORIGIN OR PROTECTED GEOGRAPHICAL INDICATION Application for approval of amendments in accordance with the first subparagraph of Article 53(2) of Regulation (EU) No 1151/2012 ‘JAMBON DE BAYONNE’ EU No: PGI-FR-00031-AM01 — 11.9.2018 PDO ( ) PGI (X) 1. Applicant group and legitimate interest Consortium du Jambon de Bayonne Route de Samadet 64 410 Arzacq FRANCE Tel. +33 559044935 Fax +33 559044939 Email: [email protected] Membership: Producers/processors 2. Member State or third country France 3. Heading in the product specification affected by the amendment(s) Name of product Description of product Geographical area Proof of origin Method of production Link Labelling Other: data update, inspection bodies, national requirements, annexes 4. Type of amendment(s) Amendments to the product specification of a registered PDO or PGI not to be qualified as minor within the meaning of the third subparagraph of Article 53(2) of Regulation (EU) No 1151/2012 Amendments to the product specification of a registered PDO or PGI for which a Single Document (or equivalent) has not been published and which cannot be qualified as minor within the meaning of the third subparagraph of Article 53(2) of Regulation (EU) No 1151/2012 (1) OJ L 343, 14.12.2012, p. -

C24 Official Journal
Official Journal C 24 of the European Union Volume 64 English edition Information and Notices 22 January 2021 Contents I Resolutions, recommendations and opinions RECOMMENDATIONS Council 2021/C 24/01 Council Recommendation on a common framework for the use and validation of rapid antigen tests and the mutual recognition of COVID-19 test results in the EU . 1 II Information INFORMATION FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2021/C 24/02 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9984 — CIMIC/Elliott/Thiess) (1) . 6 2021/C 24/03 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9911 — Voith/PCSH/TSA) (1) . 7 2021/C 24/04 Non-opposition to a notified concentration (Case M.10034 — Pizarreño/Maderas Arauco/E2E JV) (1) . 8 2021/C 24/05 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9892 — Leonardo/Thales/VSB) (1) . 9 EN (1) Text with EEA relevance. IV Notices NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2021/C 24/06 Euro exchange rates — 21 January 2021 . 10 2021/C 24/07 Opinion of the Advisory Committee on restrictive agreements and dominant positions at its meeting on 10 July 2020 concerning a draft decision relating to Case AT.40410 – Ethylene – Rapporteur: Czech Republic . 11 2021/C 24/08 Final Report of the Hearing Officer (Case AT.40410 – Ethylene) . 13 2021/C 24/09 Summary of Commission Decision of 14 July 2020 relating to a proceeding under Article 101 of the Treaty on the functioning of the European Union (Case AT.40410 – Ethylene) (notified under document number C(2020) 4817 final) . -

Volume 2 Sources Écrites
--------------------------------------------------------------------------------------------- STÉPHANE ABADIE Le 9 janvier 2016 ' : ' , . V II : S --------------------------------------------------------------------------------------------- ED TESC : Histoire FRAMESPA (UMR 5136) J-L A, P, U T-J J, L B, P, U C/B-, E G, P, U V, É L, P, U T N P-D, P, U T-J J, X R, P , U T-J J UN TEMPOREL MONASTIQUE DANS L’ESPACE MÉDIÉVAL GASCON : L’ABBAYE PRÉMONTRÉE DE LA CASEDIEU (XIIE-XVIE S.) STÉPHANE ABADIE, 2015 Volume II Sources écrites Sommaire général Sommaire général du volume................................................................................................................…........... 3 Présentation............................................................................................................................................................. 5 Première partie : Index chronologique du chartrier de la Casedieu.…........................................................................................ 9 Deuxième partie : Transcription de pièces inédites concernant l'abbaye de la Casedieu.…..................................................... 15 Troisième partie : Description et transcription intégrale du volume H5 aux archives départementales du Gers : inventaire de 1749 réalisé par Jean-Baptiste Larcher........................................................................................................169 Table des matières...............................................................................................................................................403 -

Flavescence Dorée, 321 Communes À 0 Traitement Obligatoire VP 1181
Cultures viticulture Cultures viticulture Flavescence dorée : 321 communes à 0 traitement obligatoire ! Tableau 2 : Liste des communes Aménagements des traitements Dispositions réglementaires Tableau 1 : Liste des communes à 0 traitement obligatoire à 2 traitements obligatoires contre la cicadelle de la flavescence Lutte contre la cicadelle de la flavescence dorée en viticulture conventionnelle Canton Communes Canton Communes dorée pour la campagne 2010 Dates des traitements obligatoires en viticulture conventionnelle Canton Communes La lutte est réalisée à l’aide d’un Ayzieu, Campagne d’Armagnac, Bourouillan, Cravencères, Espas, insecticide autorisé pour la lutte Castex d’Armagnac, Cazaubon, Estang, Magnan, Manciet, CAZAUBON Panjas Dans l’attente de l’arrêté préfectoral qui devrait sortir pro- DATES Eclosion Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 contre la cicadelle de la flavescence des oeufs CAZAUBON Lannemaignan, Larée, Lias d’Armagnac, NOGARO Perchède, Saint Griède, dorée. NOGARO Arblade-le-Haut, Laujuzan, Luppé-Violles, chainement, nous communiquons la liste des communes dont Marguestau, Mauléon d’Armagnac, Salles d’Armagnac Nogaro, Urgosse les obligations réglementaires ont été aménagées par la DRAAF. Communes à 3 Maupas, Monclar, Réans Vous trouverez la liste des spécia- traitements obligatoires 7-13 juin 21-28 juin Fin juillet VIC FEZENSAC Belmont, Caillavet, Castillon-Debats, Marambat, lités commerciales et leurs doses ho- et vignes mères 4-7 mai Attente de Castelnau d’Auzan, Cazeneuve, Fourcès, Bretagne d’Armagnac, Dému, Mirannes, Préneron, Tudelle, Vic-Fezensac Grâce à la mise en place d’un dis- les administrations locales et régio- mologuées sur le site internet e-phy : 2010 confirmation MONTREAL Gondrin, Labarrère, Lagraulet du Gers, EAUZE Lannepax, Ramouzens positif de prospection à l’initiative nales pour faire évoluer les arrêtés http://e-phy.agriculture.gouv.fr/ Communes à 2 par le SRAL Larroque sur L’osse, Lauraët, Montréal EAUZE Bascous, Courrensan, Eauze, Mourède, Noulens des GDON dans le vignoble gersois préfectoraux. -

CC Bastides Et Vallons Du Gers (Siren : 243200508)
Groupement Mise à jour le 01/07/2021 CC Bastides et Vallons du Gers (Siren : 243200508) FICHE SIGNALETIQUE BANATIC Données générales Nature juridique Communauté de communes (CC) Commune siège Marciac Arrondissement Mirande Département Gers Interdépartemental non Date de création Date de création 08/11/2000 Date d'effet 08/11/2000 Organe délibérant Mode de répartition des sièges Répartition de droit commun Nom du président M. Jean-Louis GUILHAUMON Coordonnées du siège Complément d'adresse du siège Route du Lac Numéro et libellé dans la voie Distribution spéciale Code postal - Ville 32230 MARCIAC Téléphone 05 62 09 30 68 Fax 05 62 09 34 99 Courriel [email protected] Site internet Profil financier Mode de financement Fiscalité professionnelle unique Bonification de la DGF non Dotation de solidarité communautaire (DSC) non Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) non Autre taxe non Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) non Autre redevance non Population Population totale regroupée 7 377 1/5 Groupement Mise à jour le 01/07/2021 Densité moyenne 24,60 Périmètre Nombre total de communes membres : 30 Dept Commune (N° SIREN) Population 32 Armentieux (213200082) 75 32 Beaumarchés (213200363) 705 32 Blousson-Sérian (213200587) 43 32 Cazaux-Villecomtal (213200991) 74 32 Couloumé-Mondebat (213201098) 201 32 Courties (213201114) 53 32 Galiax (213201361) 173 32 Izotges (213201619) 102 32 Jû-Belloc (213201635) 305 32 Juillac (213201643) 120 32 Ladevèze-Rivière (213201742) 222 32 Ladevèze-Ville (213201759) 230 32 Lasserrade -

LA BASTIDE DE PLAISANCE DU GERS AU XIXE SIECLE CROISSANCE ET APOGEE DU BOURG-MARCHE Vers 1780-1880
LA BASTIDE DE PLAISANCE DU GERS AU XIXE SIECLE CROISSANCE ET APOGEE DU BOURG-MARCHE Vers 1780-1880 Par Alain LAGORS Professeur d'histoire, membre de la Société Archéologique et historique du Gers et Plaisantin La confrontation des plans de la commune de Plaisance de l'An XI et de 1883 fait apparaître la forte extension urbaine de ce chef-lieu de canton gersois au cours du XIXe siècle. Cette ré-urbanisation de la bastide qui a gardé jusqu'à la fin de l'Ancien Régime les traces topographiques du semi-échec de sa fondation s'est accompagnée, pendant la plus grande partie du XIX siècle, d'un renforcement de ses fonctions de bourg-marché dans les campagnes de Rivière-Basse. De plus, elle a donné naissance à un espace urbain original, se structurant le long des routes nouvellement construites, mais s'organisant surtout autour de deux places à arcades. Plaisance devient vers 1850 l'une des très rares bastides de la Gascogne gersoise à deux places à embans : la place Vieille, pivot du noyau ancien, la place Nouvelle, autour de laquelle s'organise le nouveau faubourg en construction. Peu de bastides ont connu au cours du XIX siècle de tels aménagements et une telle mutation de leur espace urbain. Notre étude nous conduira à aborder, en premier lieu, le problème des origines de cette croissance, puis nous détaillerons les principales étapes de l'évolution urbaine que connaît notre bastide au cours du XIX siècle. A. - AUX ORIGINES DE LA CROISSANCE URBAINE L'EXPANSION DÉMOGRAPHIQUE ET LA PROSPÉRITÉ DE PLAISANCE En 1861, F-J Bourdeau écrit au sujet de Plaisance : " elle a cessé de se ressentir de ses cruels désastres et s'est placée même au rang de nos cités secondaires les plus belles et les plus florissantes ". -

C99 Official Journal
Official Journal C 99 of the European Union Volume 63 English edition Information and Notices 26 March 2020 Contents II Information INFORMATION FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2020/C 99/01 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9701 — Infravia/Iliad/Iliad 73) (1) . 1 2020/C 99/02 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9646 — Macquarie/Aberdeen/Pentacom/JV) (1) . 2 2020/C 99/03 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9680 — La Voix du Nord/SIM/Mediacontact/Roof Media) (1) . 3 2020/C 99/04 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9749 — Glencore Energy UK/Ørsted LNG Business) (1) . 4 IV Notices NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2020/C 99/05 Euro exchange rates — 25 March 2020 . 5 2020/C 99/06 Summary of European Commission Decisions on authorisations for the placing on the market for the use and/or for use of substances listed in Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) (Published pursuant to Article 64(9) of Regulation (EC) No 1907/2006) (1) . 6 EN (1) Text with EEA relevance. V Announcements PROCEDURES RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF COMPETITION POLICY European Commission 2020/C 99/07 Prior notification of a concentration (Case M.9769 — VW Group/Munich RE Group/JV) Candidate case for simplified procedure (1) . 7 OTHER ACTS European Commission 2020/C 99/08 Publication of a communication of approval of a standard amendment to a product specification for a name in the wine sector referred to in Article 17(2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 . -

(EU) 2021/335 of 23 February 2021 Amending the Annex To
25.2.2021 EN Offi cial Jour nal of the European Uni on L 66/5 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2021/335 of 23 February 2021 amending the Annex to Implementing Decision (EU) 2020/1809 concerning certain protective measures in relation to outbreaks of highly pathogenic avian influenza in certain Member States (notified under document C(2021) 1386) (Text with EEA relevance) THE EUROPEAN COMMISSION, Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, Having regard to Council Directive 89/662/EEC of 11 December 1989 concerning veterinary checks in intra-Community trade with a view to the completion of the internal market (1), and in particular Article 9(4) thereof, Having regard to Council Directive 90/425/EEC of 26 June 1990 concerning veterinary checks applicable in intra-Union trade in certain live animals and products with a view to the completion of the internal market (2), and in particular Article 10(4) thereof, Having regard to Council Directive 2005/94/EC of 20 December 2005 on Community measures for the control of avian influenza and repealing Directive 92/40/EEC (3), and in particular Article 63(4) thereof, Whereas: (1) Commission Implementing Decision (EU) 2020/1809 (4) was adopted following outbreaks of highly pathogenic avian influenza (HPAI) in holdings where poultry or other captive birds were kept in certain Member States and the establishment of protection and surveillance zones by those Member States in accordance with Council Directive 2005/94/EC. (2) Implementing Decision (EU) 2020/1809 provides that the protection and surveillance zones established by the Member States listed in the Annex to that Implementing Decision, in accordance with Directive 2005/94/EC, are to comprise at least the areas listed as protection and surveillance zones in that Annex. -

Site Natura 2000 Coteaux Du Lizet Et De L’Osse Vers Montesquiou FR7300893
Comité de pilotage local Site Natura 2000 Coteaux du Lizet et de l’Osse vers Montesquiou FR7300893 Saint-Arailles, le 30 janvier 2020, 14h-16h 1 Ordre du jour Préalable : contexte et objectifs sur le site - 10 min 1 – Bilan d’activité de l’animation Natura 2000 en cours - 50 min § Contractualisation / Animation générale / Communication § Questions / discussions 2- Perspectives 2020-2021 et priorisation budgétaire - 30 min § Questions /discussions 3 – Prairies de fauche ciblées par Natura 2000 - 30 min § Quelles sont-elles? Mieux les connaître § Questions /discussions 2 Ordre du jour Préalable : contexte et objectifs sur le site - 10 min 1 – Bilan d’activité de l’animation Natura 2000 en cours - 50 min § Contractualisation / Animation générale / Communication § Questions / discussions 2 - Perspectives 2020-2021 et priorisation budgétaire - 30 min § Questions /discussions 3 – Prairies de fauche ciblées par Natura 2000 - 30 min § Quelles sont-elles? Mieux les connaître § Questions /discussions 3 Le site Natura 2000 2 communes 1865 ha 2 Communautés de communes : D’Artagnan en Fezensac Et Cœur d’Astarac en Gascogne 61% du site Natura 2000 en surface agricole 31/01/2020 4 Le habitats d’intérêt communautaire Saint-Arailles Montesquiou 5 Enjeux de conservation et objectifs Pelouses et landes sèches à Orchidées & Orchis parfumé Lutte contre la déprise agropastorale : ® enjeu de soutien des pratiques liées à l’élevage extensif Préserver le bocage : ® haies, arbres isolés, alignements, bois de chênes ® favoriser le maintien de vieux arbres feuillus +++ Insectes et chauve-souris liés au bocage 31/01/2020 Prairie naturelle de fauche 6 Enjeux de conservation et objectifs Sofie dans les 2 rivières Préserver le réseau de Cistude dans les mares des pâturages mares, la qualité de l’eau et des milieux, de l’environnement. -

Les Seniors Donnent De La Voix Création D’Archives Sonores En Bastides Et Vallons Du Gers
Les Seniors donnent de la voix Création d’archives sonores en Bastides et Vallons du Gers Novembre 2020 Mai 2021 Les Seniors donnent de la voix, qu’es aquò ? Et si l’histoire et le patrimoine de notre territoire étaient une richesse à partager ? Le CIAS Marciac-Plaisance, la médiathèque de la Communauté de communes Bastides et Vallons du Gers et les guides-conférencières de Pass’enGers vous invitent à contribuer à la création d’archives sonores représentatives de votre bassin de vie. Après avoir sélectionné ensemble les sujets à aborder, nous réaliserons collectivement de petites émissions radiophoniques qui témoigneront de l’histoire locale. Une écrivaine et une créatrice de podcast viendront vous apporter leur aide en cours de projet. Les émissions seront ensuite diffusées sur les radios locales et les sites internet des partenaires. Ça se passe quand et où ? Le projet se compose de 11 séances, qui auront lieu de 14h30 à 16h aux dates suivantes : • Jeudi 26 novembre 2020 à Juillac • Jeudi 10 décembre 2020 à Juillac • Jeudi 7 janvier 2021 à Juillac • Jeudi 21 janvier 2021 à Marciac • Jeudi 11 février 2021 à Marciac • Jeudi 4 mars 2021 à Plaisance • Jeudi 18 mars 2021 à Marciac • Jeudi 1er avril 2021 à Marciac • Jeudi 15 avril 2021 à Marciac • Jeudi 6 mai 2021 à Marciac • Jeudi 27 mai 2021 à Plaisance Chaque atelier sera clôturé par un goûter. Pour faciliter les échanges, le groupe sera limité à 10 personnes maximum, qui se retrouveront tout au long du projet. Compte tenu du contexte épidémique, les consignes sanitaires seront respectées avec vigilance. -

Prélèvements En Eau Superficielle En Période D'étiage ANNEXE 1 À L
ANNEXE 1 à l’arrêté inter préfectoral n° du délivrant l’autorisation unique pluriannuelle à l’Organisme Unique de Gestion Collective Neste et rivières de Gascogne sur le périmètre Neste et rivières de Gascogne au titre du code de l’environnement Prélèvements en eau superficielle en période d’étiage Départ Type de Commune Débit demandé Volume Débit réservé UG Demandeur Raison Sociale Adresse C.P. Commune Siret ID PPT Milieu Prélevé X en lambert 93 Y en Lambert 93 usage Alternatif Num Compteur ement ressource Prélèvement (l/s) demandé (m3) (l/s) cours d'eau rte de 32 96 ABADIE Christian 32300 MIRANDE ### 1622 GRANDE BAISE MIRANDE 490 499 6 272 832 IRR 1/1 11,00 44 000 09AEI502530 316,6 réalimenté Montesquiou cours d'eau QUARTIER 65 96 ABADIE Francis 65190 BEGOLE ### 2912 GRANDE BAISE MONTASTRUC 484 037 6 238 952 IRR 1/3 10,00 40 000 05WLI43924 320 réalimenté LAPOUTGE cours d'eau QUARTIER 65 96 ABADIE Francis 65190 BEGOLE ### 23096 GRANDE BAISE BONNEFONT 484 426 6 241 288 IRR 2/3 10,00 40 000 47,4 réalimenté LAPOUTGE cours d'eau QUARTIER 65 96 ABADIE Francis 65190 BEGOLE ### 6692 GRANDE BAISE MONTASTRUC 484 119 6 238 526 IRR 3/3 10,00 40 000 60,6 réalimenté LAPOUTGE cours d'eau non 47 97 ABADIE Francis Montfaucon 47170 MEZIN ### 2795 gélise MEZIN 478 815 6 331 950 IRR 1/1 8,33 11 000 47,4 réalimenté cours d'eau 32 96 ABADIE Guy Aux Aussats 32170 MIELAN 388461881 1921 BOUES AUX AUSSAT 480 577 6 262 936 IRR 1/2 13,00 52 000 12ACI102451 68,7 réalimenté cours d'eau 32 96 ABADIE Guy Aux Aussats 32170 MIELAN 388461881 23567 BOUES MIELAN 480 386