Diaspora Et Terrorisme
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Epidemiological Week 45 (Week Ending 12Th November, 2017)
Early Warning Disease Surveillance and Response Bulletin, Somalia 2017 Epidemiological week 45 (Week ending 12th November, 2017) Highlights Cumulative figures as of week 45 Reports were received from 226 out of 265 reporting 1,363,590 total facilities (85.2%) in week 45, a decrease in the reporting consultations completeness compared to 251 (94.7%) in week 44. 78,596 cumulative cases of Total number of consultations increased from 69091 in week 44 to 71206 in week 45 AWD/cholera in 2017 The highest number of consultations in week 44were for 1,159 cumulative deaths other acute diarrhoeas (2,229 cases), influenza like illness of AWD/Cholera in 2017 (21,00 cases) followed by severe acute respiratory illness 55 districts in 19 regions (834 cases) reported AWD/Cholera AWD cases increased from 77 in week 44 to 170 in week 45 cases No AWD/cholera deaths reported in all districts in the past 7 20794 weeks cumulative cases of The number of measles cases increased from in 323 in week suspected measles cases 44 to 358 in week 45 Disease Week 44 Week 45 Cumulative cases (Wk 1 – 45) Total consultations 69367 71206 1363590 Influenza Like Illness 2287 1801 50517 Other Acute Diarrhoeas 2240 2234 60798 Severe Acute Respiratory Illness 890 911 16581 suspected measles [1] 323 358 20436 Confirmed Malaria 269 289 11581 Acute Watery Diarrhoea [2] 77 170 78596 Bloody diarrhea 73 32 1983 Whooping Cough 56 60 687 Diphtheria 8 11 221 Suspected Meningitis 2 2 225 Acute Jaundice 0 4 166 Neonatal Tetanus 0 2 173 Viral Haemorrhagic Fever 0 0 130 [1] Source of data is CSR, [2] Source of data is Somalia Weekly Epi/POL Updates The number of EWARN sites reporting decrease from 251 in week 44 to 226 in week 45. -
Calula Calula Calula Calula BOSSASO BOSSASO !
Progression of Nutrition Situation (Gu 2011 - Deyr 2015/16) SOMALIA - ESTIMATED NUTRITION SITUATION (IPC PHASES) SOMALIA - ESTIMATED NUTRITION SITUATION (IPC PHASES) SOMALIA - ESTIMATED NUTRITION SITUATION (IPC PHASES) August , 2012 (Based on June/July, 2012 surveys) -IPC Ver 2 December , 2012 (Based on October-December, 2012 surveys) -IPC Ver 2 August 16th , 2011 (Based on June/July surveys) - IPC Ver 2 SOMALIA - ESTIMATED NUTRITION SITUATION (IPC PHASES) SOMALIA - ESTIMATED NUTRITION SITUATION (IPC PHASES) Gu 2011 January , 20Deyr12 (Based on N o2011/12vember/December, 2011 surveys) -IPC Ver 2 Gu 2012 Deyr 2012/13 August , 2013 (BGuased on A2013pril-June, 2013 surveys) -IPC Ver 2 Calula Calula Calula Calula BOSSASO BOSSASO !. !. BOSSASO Calula BOSSASO !. Qandala !. Qandala Qandala Las Qoray/ Qandala Las Qoray/ BOSSASO Zeylac Bossaaso Zeylac Bossaaso Las Qoray/ !. Badhan Las Qoray/ Badhan Zeylac Bossaaso Qandala Lughaye ERIGABO Zeylac Lughaye ERIGABO Badhan !. Badhan Bossaaso !. Lughaye ERIGABO Las Qoray/ AWDAL Lughaye ERIGABO !. Zeylac Bossaaso Iskushuban AWDAL AWDAL Badhan Baki !. Baki Iskushuban Iskushuban Lughaye ERIGABO Berbera AWDAL Baki !. Borama SANAG Iskushuban Borama Berbera SANAG Berbera AWDAL Baki Borama SANAG Iskushuban BORAMA Ceel Afweyne BARI Berbera BORAMA Ceel Afweyne BARI Baki !. Sheikh Borama SANAG Sheikh BORAMA Ceel Afweyne BARI Berbera Ceerigaabo !. Ceerigaabo !. Sheikh Borama SANAG W. GALBEED BORAMA Ceel Afweyne BARI W. GALBEED W. GALBEED Ceerigaabo Gebiley Sheikh Gebiley BORAMA Ceel Afweyne BARI HARGEYSA BURAO -

TRANSITTING THROUGH DJIBOUTI Trip Oferitrea Orethiopia,Thisistheplace
© Lonely Planet Publications 284 www.lonelyplanet.com DJIBOUTI CITY •• Information 285 TRANSITTING THROUGH DJIBOUTI Internet Access Transitting Through PRACTICALITIES There’s a slew of Internet outlets in the Djibouti uses the metric system and centre. The following ones offer the best DJIBOUTI distances are in kilometres. connections. Cyber Cafe Filga Informatique (rue de Paris; per hr Djibouti Electricity in Djibouti is 220V. European DFr300; h7am-12.30pm & 4-10pm Sat-Thu, 4-10pm Fri) two-prong plugs are mainly used. TRANSITTING THROUGH Easy Internet (rue de Londres; per hr DFr400; Local newspapers are published weekly h7.30am-1pm & 4-11pm Sat-Thu, 4-11pm Fri) Djibouti might be one of the tiniest, youngest and least-known nations in Africa; it could in French. They include La Nation and also well be the most talented or, depending on your perspective, the most opportunistic. Réalité. Medical Services While Eritrea and Ethiopia, its larger and more powerful neighbours, are embroiled in what TV programmes are in Somali, Afar, CHA Bouffard (%351351; Boulaos district) The best seems to be a never-ending border dispute, Djibouti stands out as a haven of stability and Arab and French. equipped hospital, south of the city. Pôle Médical (%352724; hSat-Thu) A well-equipped neutrality. The country’s leaders cleverly maintain good relations with their unruly neigh- clinic run by French doctors who can speak English. It’s off bours. Djibouti’s port is now Ethiopia’s main hub for imports and exports. Place du 27 Juin 1977. As long as the border between Ethiopia and Eritrea remains closed, Djibouti is the obvi- DJIBOUTI CITY Money ous transit point for those travellers who want to visit the two countries in a single trip. -

Decentralization and Service Delivery in Somaliland A
DECENTRALIZATION AND SERVICE DELIVERY IN SOMALILAND A Thesis Presented to the School of Postgraduate Studies and Research of Kampala International University Kampala, Uganda In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts in Public Administration and Management By: Ahmed Abdillahi Dualeh M PA/40296/9 1/DF August, 2011 DECLARATION A “This thesis is my origina’ work and has never been presented for a Degree or any other academic award in any University or Institution of Learning”. u2A~ ~tQL Name and Signature of Candidate Date DECLARATION B TTJ confirm that the work reported in this thesis was carried out by the candidate under my supervision”. Ben’amin Bella Oluka PHD Candidate Name and Signature of Supervisor ~ Date APPROVAL SHEET This thesis entitled Decentralization and service delivery in Somaliland, prepared and submitted by Ahmed Abdillahi Dualeh in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in Public Administration and Management has been examined and approved by the panel on oral examination with a grade of: PASSED Dr ~ i2~~ ~ Name and Sig. of Chairman ~ _________ Name and Sig. of Supervisor Name and Sig. of Panelist ‘ ç~~3—i- M—1 ~ Name and Sig. of Panelist Name and Sig. of Panelist Date of Comprehensive Examination: Grade: Name and Sig. of Director, SPGSR Name and Sig. of DVC, SPGS DEDICATION I dedicated this thesis to my old brother Abdirahman Abdillahi Dualeh, My wonderful parents, mum Milgo Daud Egal and Dad Abdillahi Dualeh Ajab and my beloved wife Hamda Mohmed Hussein. 1~ ACKNOWLEDGMENT Foremost, I am grateful to Allah for seeing me through my years of university education. -

Understanding Household Responses to Food Insecurity and Famine Conditions in Rural Somaliland
Understanding Household Responses to Food Insecurity and Famine Conditions in Rural Somaliland By Ismail Ibrahim Ahmed A Thesis Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy of the University of London Wye College University of London December 1994 ProQuest Number: 11010333 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a com plete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. uest ProQuest 11010333 Published by ProQuest LLC(2018). Copyright of the Dissertation is held by the Author. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States C ode Microform Edition © ProQuest LLC. ProQuest LLC. 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106- 1346 / ' " V ' .• •‘W^> / a - ; "n ^T.k:, raj V£\ aK ^ 's a ABSTRACT This thesis examines the responses adopted by rural households in Somaliland to changes in their resource endowments and market exchange during the 1988- 1992 food crisis. It tests whether there is a predictable sequence of responses adopted by rural households when faced with food insecurity and famine conditions and examines the implications of this for famine early warning and famine response. The research is based on fieldwork conducted in rural Somaliland in 1992. A sample of 100 households interviewed just before the outbreak of the war in 1987 were re-sampled, allowing comparisons to be made before and after the crisis. -

519 Ethiopia Report With
Minority Rights Group International R E P O R Ethiopia: A New Start? T • ETHIOPIA: A NEW START? AN MRG INTERNATIONAL REPORT AN MRG INTERNATIONAL BY KJETIL TRONVOLL ETHIOPIA: A NEW START? Acknowledgements Minority Rights Group International (MRG) gratefully © Minority Rights Group 2000 acknowledges the support of Bilance, Community Aid All rights reserved Abroad, Dan Church Aid, Government of Norway, ICCO Material from this publication may be reproduced for teaching or other non- and all other organizations and individuals who gave commercial purposes. No part of it may be reproduced in any form for com- financial and other assistance for this Report. mercial purposes without the prior express permission of the copyright holders. For further information please contact MRG. This Report has been commissioned and is published by A CIP catalogue record for this publication is available from the British Library. MRG as a contribution to public understanding of the ISBN 1 897 693 33 8 issue which forms its subject. The text and views of the ISSN 0305 6252 author do not necessarily represent, in every detail and in Published April 2000 all its aspects, the collective view of MRG. Typset by Texture Printed in the UK on bleach-free paper. MRG is grateful to all the staff and independent expert readers who contributed to this Report, in particular Tadesse Tafesse (Programme Coordinator) and Katrina Payne (Reports Editor). THE AUTHOR KJETIL TRONVOLL is a Research Fellow and Horn of Ethiopian elections for the Constituent Assembly in 1994, Africa Programme Director at the Norwegian Institute of and the Federal and Regional Assemblies in 1995. -

Electronic Communication and an Oral Culture: the Dynamics of Somali Websites and Mailing Lists
ELECTRONIC COMMUNICATION AND AN ORAL CULTURE: THE DYNAMICS OF SOMALI WEBSITES AND MAILING LISTS BY ABDISALAM M. ISSA-SALWE A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS OF THAMES VALLEY UNIVERSITY FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY CENTRE FOR INFORMATION MANAGEMENT SCHOOL OF COMPUTING AND TECHNOLOGY THAMES VALLEY UNIVERSITY SUPERVISORS: DR. ANTHONY OLDEN, THAMES VALLEY UNIVERSITY EMERITUS PROFESSOR I M LEWIS, LSE, UNIVERSITY OF LONDON EXAMINERS: PROFESSOR CHRISTINE MCCOURT, THAMES VALLEY UNIVERSITY DR. MARTIN ORWIN, SOAS, UNIVERSITY OF LONDON NOVEMBER 2006 TO MY WIFE HAWO, MY CHILDREN MOHAMED-NASIR, MOHAMUD, ALI, HAFSA-YALAH, HAMDA, SHARMARKE AND YUSUF-HANAD ACKNOWLEDGMENT Foremost, I would like to thank to the Council for Assisting Refugee Academics (CARA) who helped in funding my studies. I would like to thank my thesis advisors, Dr. Tony Olden (Thames Valley University) and Emeritus Professor I M Lewis (London School of Economics) for their continuous encouragement, optimism and confidence in me to make it possible to write this dissertation. Both Dr. Olden and Emeritus Professor Lewis put an enormous amount of time and effort into supervision. Likewise, this study has been enhanced through the incisive comments of Dr Stephen Roberts (Thames Valley University). I also appreciate the advice of Dr Mohamed D. Afrax and Abdullahi Salah Osman who read and commented on the manuscript of this dissertation. I am also thankful to Ahmed Mohamud H Jama (Nero) who allowed me to have useful material relevant to my research; Dr. Ebyan Salah who solicited female correspondents to reply to the research questionnaires. I am also grateful to Said Mohamed Ali (Korsiyagaab) and Ismail Said Aw-Muse (PuntlandState.com) who gave me permission to use their websites statistics. -

Vegetable Trade Between Self-Governance and Ethnic Entitlement in Jigjiga, Ethiopia
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics Gebresenbet, Fana Working Paper Perishable state-making: Vegetable trade between self-governance and ethnic entitlement in Jigjiga, Ethiopia DIIS Working Paper, No. 2018:1 Provided in Cooperation with: Danish Institute for International Studies (DIIS), Copenhagen Suggested Citation: Gebresenbet, Fana (2018) : Perishable state-making: Vegetable trade between self-governance and ethnic entitlement in Jigjiga, Ethiopia, DIIS Working Paper, No. 2018:1, ISBN 978-87-7605-911-8, Danish Institute for International Studies (DIIS), Copenhagen This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/179454 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under -

United Nations Assistance Mission in Somalia Unsom
UNITED NATIONS NATIONS UNIES UNITED NATIONS ASSISTANCE MISSION IN SOMALIA UNSOM Briefing to the Security Council by Ambassador Nicholas Kay, Special Representative of the Secretary-General (SRSG) for Somalia 11 March 2014 [AS DELIVERED] Madam President, Members of the Council, Thank you for giving me the opportunity to brief the Council from Mogadishu today and for your continued support to Somalia’s peace-building and state-building. I am on the ground in Mogadishu and not with you in New York due to the intensity of events at this moment. I hope you understand. Madam President The best hope for peace and stability in Somalia, the Horn of Africa and beyond remains a united, secure and federal Somalia. This is achievable. Somalia can reach its goal of an agreed constitution, a nation-wide electoral process and increased security by 2016. But times are tough, and in the short term may get tougher. Insecurity in Mogadishu poses challenges for Somalis, the UN and the international community. 2014 is a crucial year. It is marked, I would say, by security and political challenges, which will be overcome if the Federal Government of Somalia and international partners remain united and if both accelerate delivery of their mutual commitments. Madam President As I speak, an expanded AMISOM and the Somali National Army (SNA) are prosecuting a renewed offensive against Al Shabaab, made possible by UN Security Council Resolution 2124. It will be the most significant and geographically extensive military advance since AMISOM started, and there have already been notable successes. I pay tribute to the commitment and sacrifices made by AMISOM and its police and troop contributing states. -

Anticipating Violence Intelligently Functional Impacts of Integrating Intelligence Products Into Regional Conflict Early Warning Systems
ANTICIPATING VIOLENCE INTELLIGENTLY FUNCTIONAL IMPACTS OF INTEGRATING INTELLIGENCE PRODUCTS INTO REGIONAL CONFLICT EARLY WARNING SYSTEMS AARON ELI VILLARRUEL MORA MASTER THESIS IN PEACE AND CONFLICT STUDIES DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE UNIVERSITY OF OSLO AUTUMN 2009 i To my family. The original and new members (You know who you are). ii Acknowledgements Ideas spawn projects that eventually become research. This case is not the exception. Even though the original idea and aims resulted from personal interests and wonder, this final product has been benefited from the worthy and constructing contributions of fellow scholars, institutional supports and personal belief in the endeavour. Without following an order of importance since any input has been instrumental in the stage it was received, I want to express my recognition and gratitude to those who deserve it. Thanks to Martin Austvoll Nome, to his patience, sincere involvement and methodological support in the early phase of this enquiry, the idea took shape and gained analytical precision for further development. My deep gratitude to Karin Dokken, whose sound, devoted and pleasant supervision, encouragement and time allowed the proper fulfilment of this thesis. Thank you for reminding me that in research the art of communication is equally as important as systematic investigation. I am grateful to the Conflict Early Warning and Response Mechanism of the Intergovernmental Authority on Development, for providing excellent working conditions and facilitating this study and my stay in Addis Ababa. Without the willingness and time of each of the key informants this analysis would have never been substantiated, thence I gratefully appreciate it. Thanks to fellow colleagues and friends Rasmus Christian Bering, Jakob Aasland Ravndal and Sébastien Miraglia-Yossen for your rhizomatic feedback and comments on early ideas and drafts. -
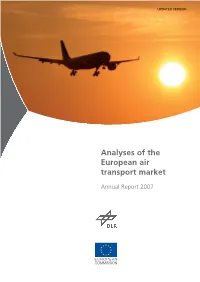
Annual Report 2007
EU_ENTWURF_08:00_ENTWURF_01 01.04.2026 13:07 Uhr Seite 1 Analyses of the European air transport market Annual Report 2007 EUROPEAN COMMISSION EU_ENTWURF_08:00_ENTWURF_01 01.04.2026 13:07 Uhr Seite 2 Air Transport and Airport Research Annual analyses of the European air transport market Annual Report 2007 German Aerospace Center Deutsches Zentrum German Aerospace für Luft- und Raumfahrt e.V. Center in the Helmholtz-Association Air Transport and Airport Research December 2008 Linder Hoehe 51147 Cologne Germany Head: Prof. Dr. Johannes Reichmuth Authors: Erik Grunewald, Amir Ayazkhani, Dr. Peter Berster, Gregor Bischoff, Prof. Dr. Hansjochen Ehmer, Dr. Marc Gelhausen, Wolfgang Grimme, Michael Hepting, Hermann Keimel, Petra Kokus, Dr. Peter Meincke, Holger Pabst, Dr. Janina Scheelhaase web: http://www.dlr.de/fw Annual Report 2007 2008-12-02 Release: 2.2 Page 1 Annual analyses of the European air transport market Annual Report 2007 Document Control Information Responsible project manager: DG Energy and Transport Project task: Annual analyses of the European air transport market 2007 EC contract number: TREN/05/MD/S07.74176 Release: 2.2 Save date: 2008-12-02 Total pages: 222 Change Log Release Date Changed Pages or Chapters Comments 1.2 2008-06-20 Final Report 2.0 2008-10-10 chapters 1,2,3 Final Report - full year 2007 draft 2.1 2008-11-20 chapters 1,2,3,5 Final updated Report 2.2 2008-12-02 all Layout items Disclaimer and copyright: This report has been carried out for the Directorate-General for Energy and Transport in the European Commission and expresses the opinion of the organisation undertaking the contract TREN/05/MD/S07.74176. -

Tahir, Abdifatah I.Pdf
A University of Sussex PhD thesis Available online via Sussex Research Online: http://sro.sussex.ac.uk/ This thesis is protected by copyright which belongs to the author. This thesis cannot be reproduced or quoted extensively from without first obtaining permission in writing from the Author The content must not be changed in any way or sold commercially in any format or medium without the formal permission of the Author When referring to this work, full bibliographic details including the author, title, awarding institution and date of the thesis must be given Please visit Sussex Research Online for more information and further details URBAN GOVERNANCE, LAND CONFLICTS AND SEGREGATION IN HARGEISA, SOMALILAND: HISTORICAL PERSPECTIVES AND CONTEMPORARY DYNAMICS ABDIFATAH I TAHIR This thesis is submitted to the Department of Geography, School of Global Studies, University of Sussex, in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) OCTOBER 1, 2016 DEPARTMENT OF GEOGRAPHY SCHOOL OF GLOBAL STUDIES UNIVERSITY OF SUSSEX 1 | Page ORIGINALITY STATEMENT I hereby declare that this thesis has not been and will not be submitted in whole or in part to another University for the award of any other degree. Signature 2 | Page I. ABSTRACT This thesis offers an explanation for why urban settlement in Somaliland’s capital city of Hargeisa is segregated along clan lines. The topic of urban segregation has been neglected in both classic Somali studies, and recent studies of post-war state-building and governance in Somaliland. Such negligence of urban governance in debates over state-making stems from a predominant focus on national and regional levels, which overlooks the institutions governing cities.