Poisson Carole 2016 These.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Bulletin Est Publié Par L’Amicale Des Anciens Parlementaires Du Québec Avec La Collaboration Des Services De L’Assemblée Nationale
Le Bulletin est publié par l’Amicale des anciens parlementaires du Québec avec la collaboration des services de l’Assemblée nationale. Comité de rédaction Volume 12, Numéro 2, Automne 2011 Serge Geoffrion BULLETIN Marie Tanguay de l’ Responsable de l’édition Serge Geoffrion Collaboration Christian Chevalier François Cloutier Laurie Comtois micale Isabelle Côté A Rita Dionne-Marsolais Ce livre se veut un éloge, fait des images Antoine Drolet du photographe Christian Chevalier et habillé de Marise Falardeau Gisèle Gallichan la poésie de l’écrivain Stanley Péan. Il présente, de façon André Gaulin singulière, l’environnement dans lequel se tisse, depuis 125 ans, Serge Geoffrion l’histoire politique québécoise. Réalisé en collaboration avec la Commission Stéphanie Giroux André Harvey de la capitale nationale du Québec et les Publications du Québec, il fait partie Claude Lachance des activités organisées pour commémorer le 125e anniversaire de l’hôtel du Diane Leblanc Parlement. Michel Leduc Frédéric Lemieux Christian Chevalier amorce sa carrière en 1972 à Québec, comme camé- Suzanne Lévesque Marcel Masse raman. Se consacrera ensuite à la réalisation pour le Canal de l’Assemblée Richard Merlini nationale pendant 30 ans avant de devenir le photographe officiel de l’insti- Martin Pichette tution. Stanley Péan est né à Port-au-Prince, en Haïti, et a grandi à Jonquière. Stéfany Ranger Jocelyn Saint-Pierre Écrivain, mélomane, traducteur, scénariste et journaliste, il a été président de Pierre-Paul Sénéchal l’Union des écrivaines et des écrivains québécois de 2004 à 2010. Carole Théberge Cécile Vermette Conception et réalisation Catherine Houle Marie Tanguay Révision linguistique SALON DES ANCIENS Caroline Saint-Michel Veuillez prendre note que le Salon des anciens est maintenant Impression situé au local 3.30 de l’hôtel du Parlement. -

Impacts De La Loi 101 Sur La Culture Politique Au Québec De 1977 À 1997
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL IMPACTS DE LA LOI 101 SUR LA CULTURE POLITIQUE AU QUÉBEC DE 1977 À 1997 MÉMOIRE PRÉSENTÉ COMME EXIGENCE PARTIELLE DE LA MAÎTRISE EN HISTOIRE PAR PIERRE-LUC BILODEAU AVRIL 2016 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL Service des bibliothèques Avertissement La diffusion de ce mémoire se fait dans le respect des droits de son auteur, qui a signé le formulaire Autorisation de reproduire et de diffuser un travail de recherche de cycles supérieurs (SDU-522- Rév.07-2011). Cette autorisation stipule que «conformément à l'article 11 du Règlement no 8 des études de cycles supérieurs, [l'auteur] concède à l'Université du Québec à Montréal une licence non exclusive d'utilisation et de publication de la totalité ou d'une partie importante de [son] travail de recherche pour des fins pédagogiques et noh commerciales. Plus précisément, [l'auteur] autorise l'Université du Québec à Montréal à reproduire, diffuser, prêter, distribuer ou vendre des copies de [son] travail de recherche à des fins non commerciales sur quelque support que ce soit, y compris l'Internet. Cette licence et cette autorisation n'entraînent pas une renonciation de [la] part [de l'auteur] à [ses] droits moraux ni à [ses] droits de propriété intellectuelle. Sauf entente contraire, [l'auteur] conserve la liberté de diffuser et de commercialiser ou non ce travail dont [il] possède un exemplaire.» RÉSUMÉ La Charte de la langue française, également connue sous le nom de loi 101, survient à la suite de plusieurs années de tensions sur le plan linguistique. Celle-ci fait basculer les francophones québécois du statut de groupe minoritaire à celui de majoritaire. -

The Globe's Representation of the Armenian Genocide and Canada's Acknowledgement
University of Windsor Scholarship at UWindsor Electronic Theses and Dissertations Theses, Dissertations, and Major Papers 2012 The globe's representation of the Armenian genocide and Canada's acknowledgement Karen Ashford University of Windsor Follow this and additional works at: https://scholar.uwindsor.ca/etd Recommended Citation Ashford, Karen, "The globe's representation of the Armenian genocide and Canada's acknowledgement" (2012). Electronic Theses and Dissertations. 8. https://scholar.uwindsor.ca/etd/8 This online database contains the full-text of PhD dissertations and Masters’ theses of University of Windsor students from 1954 forward. These documents are made available for personal study and research purposes only, in accordance with the Canadian Copyright Act and the Creative Commons license—CC BY-NC-ND (Attribution, Non-Commercial, No Derivative Works). Under this license, works must always be attributed to the copyright holder (original author), cannot be used for any commercial purposes, and may not be altered. Any other use would require the permission of the copyright holder. Students may inquire about withdrawing their dissertation and/or thesis from this database. For additional inquiries, please contact the repository administrator via email ([email protected]) or by telephone at 519-253-3000ext. 3208. THE GLOBE’S REPRESENTATION OF THE ARMENIAN GENOCIDE AND CANADA’S ACKNOWLEDGEMENT by Karen Ashford A Thesis Submitted to the Faculty of Graduate Studies through the Department of Communication Studies in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts at the University of Windsor Windsor, Ontario, Canada 2012 © 2012 Karen Ashford THE GLOBE’S REPRESENTATION OF THE ARMENIAN GENOCIDE AND CANADA’S ACKNOWLEDGEMENT by Karen Ashford APPROVED BY: ______________________________________________ Dr. -

Bulletin De L'amicale, Volume 17, Numéro 2, Juin 2016
VOLUME 17, NUMÉRO 2, JUIN 2016 BULLETIN D E L’A M I C A L E Hommage à Robert Bourassa L'assemblée générale du 18 mai 2016 Marie-Claire Kirkland, 1924-2016 TABLE DES MATIÈRES 3 Mot du rédacteur EN COUVERTURE 4 Conseil d’administration 2016-2017 Robert Bourassa est né à Montréal, le 14 juillet 1933. 5 Rapport du président Il a étudié au collège Brébeuf à Montréal et à l’Université de Montréal, où il a reçu 9 Rapports des comités la médaille du gouverneur général, en 1956. Admis au Barreau du Québec en 13 Prix de l’Amicale juin 1957. A obtenu une maîtrise en sciences économiques et politiques 21 Sous l’œil des photographes d’Oxford, en Angleterre, en 1959, et une Photo : BAnQ, fonds Ministère des Communications, photographe : Jean-Yves Bruel maîtrise en fiscalité et droit financier de 26 Robert Bourassa : de chef de parti à chef d’État l’Université Harvard en 1960. 29 Robert Bourassa tel que je l’ai connu Conseiller fiscal au ministère du Revenu national, à Ottawa, de 1960 à 1963. Professeur de sciences économiques et de fiscalité à l’Université d’Ottawa, de 1961 à 1963. Secrétaire et directeur 32 La relation Ryan-Bourassa des recherches de la Commission royale d’enquête Bélanger sur la fiscalité, de 1963 à 1965. Conseiller spécial sur les questions économiques et fis- 34 Robert Bourassa : le courage tranquille cales au ministère fédéral des Finances. Professeur de finances publiques d’un bâtisseur à l’Université de Montréal et à l’Université Laval, de 1966 à 1969. -

Amicale Des Anciens Parlementaires D’Ici En Collaboration Avec Les Publications Du Québec
Le nom de lieu, signature du temps et de l’espace BULLETIN Volume 14 numéro 1, Janvier 2013 Fière de ses 100 ans, la Commission de toponymie du Québec a lancé récemment l’ouvrage Parlers et de l’ paysages du Québec : randonnée à travers les mots Le Bulletin est publié par l’Amicale des anciens parlementaires d’ici en collaboration avec Les Publications du Québec. du Québec Elle a aussi inauguré l’exposition Le nom de lieu, avec la collaboration des services signature du temps et de l’espace, présentée au Musée de l’Assemblée nationale. de la civilisation de Québec. micale Comité de rédaction Serge Geoffrion A me La présidente de la Commission de toponymie, M Louise Marchand, Marie Tanguay a précisé que « ce magnifique ouvrage prend la forme d’un carnet Responsable de l’édition de randonnée où la rigueur scientifique se mêle à la poésie. C’est un Serge Geoffrion véritable cadeau rempli de photos, de mots et de noms de lieux parfois Collaboration surprenants qui évoquent la grande richesse de notre patrimoine culturel ». Par Robert Comeau exemple, on y apprend l’histoire du mot rigolet qui se retrouve dans 31 noms Rita Dionne-Marsolais de lieux du Québec, dont Rigolet des Abîmes, dans les îles de Berthier. Destiné Yves L. Duhaime Gisèle Gallichan au grand public, Parlers et paysages du Québec est en vente sur le site Web des André Gaulin Publications du Québec ainsi que dans les librairies. Stéphanie Giroux Carole Théberge À l’aube de ses 100 ans, la Commission de toponymie du Québec est toujours aussi dynamique et elle demeure prête à relever encore beaucoup de Conception et réalisation Catherine Houle défis, durant le prochain siècle. -
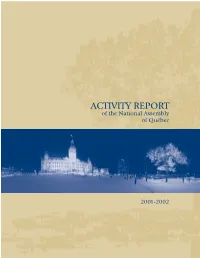
ACTIVITY REPORT of the National Assembly of Québec
ACTIVITY REPORT of the National Assembly of Québec 2001-2002 1 This publication was accomplished with the collaboration of the executive personnel and staff from all administrative branches of the National Assembly. Unless otherwise indicated, the data provided in this report concerns the activities of the National Assembly from 1 April 2001 to 31 March 2002. Director: Patricia Rousseau Coordinator: Richard-Gilles Guilbault Supervisory and editorial committee: Jean Bédard Guy Bergeron Joan Deraîche Frédéric Fortin Yves Girouard Richard-Gilles Guilbault André Lavoie Denise Léonard Gilles Pageau Translation: Sylvia Ford Revision: Nancy Ford Design and page layout: Nathalie Cazeau Printing: National Assembly Press Photographs: Front cover: Denis Tremblay Members of the 36th Legislature: Daniel Lessard Éric Lajeunesse Jacques Pontbriand Legal deposit - 2nd Quarter 2002 Bibliothèque nationale du Québec Bibliothèque nationale du Canada ISBN 2-550-39309-0 ISSN 1492-9023 2 TABLE OF CONTENTS Preface .......................................................................................... 5 Foreword ............................................................................................. 6 The National Assembly ......................................................................... 8 its mission .................................................................................................. 9 the Members ............................................................................................ 10 The National Assembly and Parliamentary -

Court of Appeal of Québec Montréal
500-09-027501-188 Court of Appeal of Québec Montréal On appeal fram a Judgment of the Superior Court, District of Montréal, rendered on April 18, 2018 by the Honourable Claude Dallaire, J.S.C. No. 500-05-065031-013 S.C.M. KEITH OWEN HENDERSON APPELLANT - Petitioner v. ATTORNEY GENERAL OF QUEBEC RESPONDENT - Respondent -and- ATTORNEY GENERAL OF CANADA MIS EN CAUSE - Intervener -and- SOCIÉTÉ SANT-JEAN-BAPTISTE DE MONTRÉAL MISE EN CAUSE -Intervener APPELLANT'S BRIEF Volume 2 : pages 43 to 395 Dated October 9, 2018 Me Brent D. Tyler Me Stephen A. Scott 83 Saint-Paul Street West 3644 Peel Street Montréal, Québec Montréal, Québec H2Y 1Z1 H3A 1W9 Tel. : 514 966-2977 Tel. : 514398-6617 Fax: 514842-8055 Fax: 514398-4659 [email protected] [email protected] Attorney for Appellant Counsel for Appellant THÉMIS MULTIFACTUM INC. ~.,~ 4, rue Notre-Dame Est, bur. 100, Montréal (Québec) H2Y 188 • Téléphone: 514866-3565 Télécopieur: 514 866-4861 'il": • 1.:.1. • [email protected] www.multifactum.com 500-09-027501-188 Court of Appeal of Québec Montréal Me Jean-Yves Bernard, Ad. E. Me Claude Joyal, Ad. E. BERNARD, Roy (JUSTICE-QUÉBEC) DEPARTMENT OF JUSTICE 1 Notre-Dame Street East Complexe Guy-Favreau, East Tower Suite 8.00 200 René-Lévesque Blvd. West Montréal, Québec 9th Floor H2Y 1B6 Montréal, Québec H2Z 1X4 Tel. : 514393-2336, ext. 51467 Tel. : 514283-8768 Fax: 514873-7074 Fax: 514283-3856 [email protected] [email protected] Attorney for Respondent Attorney for Mis en cause Attorney General of Canada Me Marc Michaud MICHAUD SANTORIELLO AVOCATS 5365 Jean-Talon Street East Suite 602 Saint-Léonard, Québec H1S 3G2 Tel.: 514 374-8777 Fax: 514 374-6698 [email protected] Attorney for Mise en cause Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal THÉMIS MULTIFACTUM INC. -
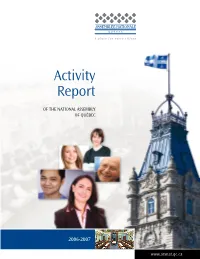
Activity Report
Activity Report OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF QUÉBEC NATIONAL ASSEMBLY OF QUÉBEC PARLIAMENT BUILDING Québec (Québec) G1A 1A3 www.assnat.qc.ca 2006-2007 [email protected] 1 866 DÉPUTÉS www.assnat.qc.ca On the cover: The new institutional signature, adopted by the authorities of the National Assembly in November 2006, has been used on the cover page of this Activity Report. Additional information on the logo is provided on page 41. Activity Report OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF QUÉBEC 2006-2007 www.assnat.qc.ca This publication was accomplished with the collaboration of the executive personnel and staff from all administrative branches of the National Assembly. Unless otherwise indicated, the data provided in this report concerns the activities of the National Assembly from 1 April 2006 to 31 March 2007. Director: Dominic Toupin Coordinator: Noémie Cimon-Mattar Supervisory and editorial committee: Noémie Cimon-Mattar Maude Daoust Joan Deraîche Dominique Drouin Robert Jolicoeur Marie-France Lapointe Georges Rousseau Christina Turcot Revision: Francine Boivin Lamarche Nancy Ford Sylvia Ford Marie-Jeanne Gagné Suzie Gauvin Translation: Sylvia Ford Graphic design: Myriam Landry Manon Paré Photographs: Clément Allard, pages 32, 34 Christian Chevalier, page 53 Robert Jolicoeur, page 4 Francis Leduc, page 59 Daniel Lessard, pages 4, 5, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 56 Claude Mathieu, page 59 François Nadeau, pages 4, 5, 33 Yannick Vachon, page 4 Claudie Vézina, page 5 This publication is available on the Internet site of the National Assembly at the -

Core 1..160 Hansard (PRISM::Advent3b2 6.50.00)
CANADA House of Commons Debates VOLUME 139 Ï NUMBER 037 Ï 3rd SESSION Ï 37th PARLIAMENT OFFICIAL REPORT (HANSARD) Tuesday, April 20, 2004 (Part A) Speaker: The Honourable Peter Milliken CONTENTS (Table of Contents appears at back of this issue.) All parliamentary publications are available on the ``Parliamentary Internet Parlementaire´´ at the following address: http://www.parl.gc.ca 2107 HOUSE OF COMMONS Tuesday, April 20, 2004 The House met at 10 a.m. The Speaker: The House has heard the motion. Is it the pleasure of the House to adopt the motion? Prayers Some hon. members: Agreed. (Motion agreed to) ROUTINE PROCEEDINGS Ï (1005) GOVERNMENT ORDERS [English] WESTBANK FIRST NATION SELF-GOVERNMENT ACT PETITIONS The House proceeded to the consideration of Bill C-11, an act to MARRIAGE give effect to the Westbank First Nation Self-Government Agree- Mr. Darrel Stinson (Okanagan—Shuswap, CPC): Mr. Speaker, ment, as reported (with amendment) from the committee. I am pleased to present a petition with signatures collected in my [English] riding by the Broadview Evangelical Free Church addressing the issue of marriage. SPEAKER'S RULING The petitioners state that the best foundation for families and the The Speaker: There are three motions in amendment standing on raising of children is that the institution of marriage be recognized in the Notice Paper for the report stage of Bill C-11. federal law as being the lifelong union of one man and one woman to [Translation] the exclusion of all others. *** Motion No. 2 will not be selected by the Chair as it could have been presented in committee. -
Visit to Vietnam Regional Meetings in Newfoundland and Labrador and Quebec Serving Independently YOUR ORGANIZATION Vietnamese Study Tour Feb
Visit to Vietnam Regional meetings in Newfoundland and Labrador and Quebec Serving independently YOUR ORGANIZATION Vietnamese study tour Feb. 4th until the 18th, 2020. Hon. Eleni Bakopanos. Dorothy Dobbie and Ian Waddell. A fountain in the courtyard of Sophie’s Art. Warren Redman and Dr. Hélène Bertrand. Charlette Duguay gets her temperature taken as she enters a restaurant. Danielle and Massimo Pacetti pose with the server Léo Duguay luxuriates in one of the VERY comfortable Ken Hughes. at the restaurant where we made our own dinners. National Assembly chairs. Page 2 Beyond the Hill • Spring 2020 Beyond the Hill • Spring 2020 Page 3 Beyond the Hill Canadian Association of Former Parliamentarians Volume 16, Issue No. 1 Spring 2020 CONTENTS Lynn McDonald’s private member’s bill ............25 By Matt Reekie Vietnamese study tour ........................................2 How it works ....................................................26 Canadian Association of Former Parliamentarians By Hon. John Reid – who we are and what we stand for .............4 Election Observation: Social media and China’s treatment of the Uyghurs rings alarms ....28 accessibility on the agenda .................................5 Reworded by Gina Hartmann from By Gina Hartmann Hon. David Kilgour’s text and notes Update from the President: Oh what a year! ......6 Do Canadian elections meet the accessibility By Dorothy Dobbie challenge? .....................................................29 By Wade Morris CAFP Delegation tours Vietnam .........................7 By