Contes Et Nouvelles Corses
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Projet Arrete Nuisibles 2020
PRÉFÈTE DE LA CORSE-DU-SUD DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER Service Risques Eau Forêt Affaire suivie par : Carole BOURCIER Arrêté n° du fixant la liste des espèces d’animaux classés susceptibles d’occasionner des dégâts et les modalités de leur destruction dans le département de la Corse-du-Sud pour l’année 2020. La préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud, Officier de la Légion d’Honneur, Officier de l’Ordre National du Mérite, Chevalier du Mérite Agricole, Chevalier des Palmes Académiques, VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.427-8, R.421-31, R.427-6 à R.427-28 et R.428-19 ; VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ; VU le décret du Président de la République du 27 avril 2018 nommant madame Josiane CHEVALIER, préfète hors classe, en qualité de préfète de Corse, préfète de Corse-du-Sud ; VU le décret du Président de la République du 3 août 2018 nommant M. Alain CHARRIER, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud ; VU l’arrêté préfectoral du 27 août 2018 portant délégation de signature à M. Alain CHARRIER, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud ; VU l’arrêté ministériel du 29 janvier 2007, modifié par l’arrêté du 18 septembre 2009, fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l’article L 427-8 du code de l’environnement ; VU l’arrêté ministériel du 3 avril 2012 pris pour l’application de l’article -

3B2 to Ps Tmp 1..96
1975L0271 — EN — 14.04.1998 — 014.001 — 1 This document is meant purely as a documentation tool and the institutions do not assume any liability for its contents ►B COUNCIL DIRECTIVE of 28 April 1975 concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive No 75/268/EEC (France) (75/271/EEC) (OJ L 128, 19.5.1975, p. 33) Amended by: Official Journal No page date ►M1 Council Directive 76/401/EEC of 6 April 1976 L 108 22 26.4.1976 ►M2 Council Directive 77/178/EEC of 14 February 1977 L 58 22 3.3.1977 ►M3 Commission Decision 77/3/EEC of 13 December 1976 L 3 12 5.1.1977 ►M4 Commission Decision 78/863/EEC of 9 October 1978 L 297 19 24.10.1978 ►M5 Commission Decision 81/408/EEC of 22 April 1981 L 156 56 15.6.1981 ►M6 Commission Decision 83/121/EEC of 16 March 1983 L 79 42 25.3.1983 ►M7 Commission Decision 84/266/EEC of 8 May 1984 L 131 46 17.5.1984 ►M8 Commission Decision 85/138/EEC of 29 January 1985 L 51 43 21.2.1985 ►M9 Commission Decision 85/599/EEC of 12 December 1985 L 373 46 31.12.1985 ►M10 Commission Decision 86/129/EEC of 11 March 1986 L 101 32 17.4.1986 ►M11 Commission Decision 87/348/EEC of 11 June 1987 L 189 35 9.7.1987 ►M12 Commission Decision 89/565/EEC of 16 October 1989 L 308 17 25.10.1989 ►M13 Commission Decision 93/238/EEC of 7 April 1993 L 108 134 1.5.1993 ►M14 Commission Decision 97/158/EC of 13 February 1997 L 60 64 1.3.1997 ►M15 Commission Decision 98/280/EC of 8 April 1998 L 127 29 29.4.1998 Corrected by: ►C1 Corrigendum, OJ L 288, 20.10.1976, p. -

Sartene Propriano
Territoire du Les Incontournables Sartenais Valinco Taravo Les sites préhistoriques : La Corse compte actuellement plus Légendes de 900 menhirs situés principalement en Corse du Sud et plus particulièrement Édifices classés sur notre territoire. - Filitosa : ce site classé monument his- Site préhistorique torique est l’une des aventures archéolo- giques les plus riches de Corse. Tour Génoise - Cauria : sur ce site se situent l’aligne- Palneca ment I Stantari, l’alignement de Rinaiu Site préhistorique et le dolmen de Funtanaccia. aménagé - Paddaghu est la concentration de 258 Bastelica Point de vue D69 monolithes regroupés en 7 alignements. Ciamannacce construites entre le XVIe et le début du Bains d'eau chaude Les tours génoises : XVIIe siècle pour freiner les incursions barbaresques Sampolo Cozzano Site protégé - La Tour de Campomoro, la plus massive de Corse, entourée Conservatoire Tasso du Littoral d’un rempart en étoile, est ouverte au public d’ Avril à début Territoire D757 du Sartenais Octobre ( entrée 3.50€) Valinco Taravo D69 - La Tour de Roccapina - 8 m de haut Zicavo - partiellement en ruine, surplombe la Plages plage de Roccapina et n’est visible que D757a Sentiers de balades Guitera-les-bains du point de vue, sur la RN 196. schématisés - La tour de Capanella, renovée en 2010. (Consultation d'une carte I.G.N. conseillée) Accès à pied au départ de Porto Pollo. - Les tours de Micalona et de la Calanca Domaines viticoles D83 Corrano sont privées. Office de Tourisme - La tour de Senetosa - 11 m de haut - Zévaco est accessible à pied par le sentier du D27 littoral entre Tizzano et Campomoro, ou par la mer à partir de la Cala di Conca ( 1h de marche). -

La FRESC Fédération De Reconquête Économique, Sociale Et Culturelle
Fiche initiative La FRESC Fédération de Reconquête Économique, Sociale et Culturelle La FRESC, association loi 1901, a pour volonté de proposer des moyens de nouer des liens sociaux, de participer à une dynamique de développement local et de promouvoir l’animation rurale, basée notamment sur une transmission de savoirs, de savoir-faire et de valeurs. Elle intervient principalement sur le canton de Petreto- Bicchisano, regroupant 1700 habitants répartis sur 6 communes au Sud du Parc naturel régional de la Corse. > Paul-Joseph Caïtucoli, président > Dominique Faux, animatrice Objectifs Quartier Gaci, Depuis sa création fin 2008, la FRESC favorise le partage d’expériences dans l’objectif de donner à 20410 Petreto-Bicchisano chacun la possibilité de « faire et construire ensemble ». [email protected] L’association a pour objet : 04 95 25 46 49 www.vaddi-e-paesi.com • La promotion et le développement économique, social, culturel et sportif • L’animation du territoire et l’organisation de manifestations • La formation et l’information des différents publics • La préservation et la valorisation du patrimoine (environnemental, bâti, culturel, etc…) • La vente de produits et de prestations de services pour que l’association puisse étendre ses activités. La FRESC est un lieu de : • Représentation des partenaires • Concertation • Réflexion, analyse et étude • Définition des priorités du développement micro régional global • Soutien et coordination des projets • Mise en synergie des moyens (humains, techniques et financiers). Partenaires Pour porter -

Liste Des Sites Natura 2000 Et Des Contacts
Liste des sites Natura 2000 et des contacts Lien Fiche du Site Code du Autre Contact (cliquer sur le Nom du site Communes (cliquer sur le Structure animatrice Animateur Coordonnées animateur (cliquer sur le lien) site lien) symbole) Porto / Scandola Cargèse, Ota, Piana, FR9400574 Revellata / Calvi Calanches de Piana Serriera, Partinello, [email protected] (zone terrestre et marine) Osani (+2B) 8 FR9400576 Massif montagneux du Cinto Evisa (+2B) 8 [email protected] Plateau du Coscione et massif de Quenza, Serra di Communauté de communes de l’Alta FR9400582 Véronique SANGES [email protected] l'Incudine Scopamene, Zicavo 8 Rocca Carbini, Porto-vecchio, FR9400583 Forêt de l'Ospedale [email protected] San Gavino di Carbini 8 Marais de Lavu Santu et littoral de FR9400584 Zonza Conseil départemental 2A Vanina CASTOLA [email protected] Fautea 8 FR9400585 Iles Pinarellu et Roscana Zonza 8 Conseil départemental 2A Vanina CASTOLA [email protected] Embouchure du Stabiaccu, Domaine FR9400586 Porto-Vecchio [email protected] public maritime et îlot Ziglione 8 Iles Cerbicale FR9400587 Porto-Vecchio [email protected] et frange littorale 8 FR9400588 Suberaie de Ceccia / Porto-Vecchio Porto-Vecchio 8 Mairie de Porto-Vecchio [email protected] Tre Padule de Suartone, Rondinara et FR9400590 Bonifacio [email protected] Balistra 8 Plateau de Pertusato Bonifacio et îles FR9400591 Bonifacio [email protected] Lavezzi 8 -

Recueil Des Actes Administratifs De La Prefecture De La Corse-Du-Sud
PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD FEVRIER 2008 Tome 2 Edité le 04 mars 2008 Le contenu intégral des textes/ou les documents et plans annexés peuvent être consultés auprès du service sous le timbre duquel la publication est réalisée. Recueil du mois de Février 2008 – Tome 2 – Edité le 04 mars 2008 SOMMAIRE PAGES DIVERS 5 Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle 6 - Arrêté du 28 décembre 2007 reconnaissant la qualité de Société Coopérative 7 Ouvrière de Production (S.C.O.P.)……………………………………………… - Arrêté N° 04/02/08-A-02A-Q-001 du 04 février 2008 portant agrément qualité 9 d'un organisme de services aux personnes (insertion sud corse)……………… - Arrêté N° 28/02/08-F-02A-S-001 du 28 février 2008 portant agrément simple d'un organisme de services aux personnes (Rossi Mathieu – Enseigne Rossi 11 Services)………………………………………………………………………… Direction Régionale des Affaires Maritimes de Corse 13 - Décision N° 25/2008/DRAM du 1er février 2008 désignant les examinateurs de l’extension « hauturière » du permis mer dans le département de la Corse du 14 Sud …………………………………………………………………………….. Direction Régionale et Départementale de l'Equipement 16 - Arrêté N° 2008–0076 du 29 janvier 2008 déterminant le délai prévu à l’article 17 L 441-1-4 du Code de la construction et de l’habitation……………………….. - Arrêté N° 08-0127 du 8 février 2008 approuvant le tracé des lignes et notifiant l’approbation du projet à M. le Président du Syndicat Intercommunal 18 d’Electrification du Sud de la Corse………………………………………… Direction Régionale de l'Environnement 20 - Arrêté N° 08-0080 du 29 janvier 2008 portant création et composition du Comité de Pilotage Local du Site Natura 2000 FR 9400608 « Mares 21 temporaires du terrain militaire de FRASSELLI »……………………………… - Arrêté n 08 -0097 en date du 04 02 2008 portant création et composition du Comité de Pilotage du Site Natura 2000 FR 9402008 « Lac de Creno » 23 (directive habitats)………………………………………………………………. -

FORETS D'altitude DU HAUT TARAVO (Identifiant National : 940004158)
Date d'édition : 27/10/2020 https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004158 FORETS D'ALTITUDE DU HAUT TARAVO (Identifiant national : 940004158) (ZNIEFF Continentale de type 2) (Identifiant régional : 2AHTTARA) La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DREAL Corse, .- 940004158, FORETS D'ALTITUDE DU HAUT TARAVO. - INPN, SPN-MNHN Paris, 18P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004158.pdf Région en charge de la zone : Corse Rédacteur(s) :DREAL Corse Centroïde calculé : 1168913°-1687649° Dates de validation régionale et nationale Date de premier avis CSRPN : 05/05/2010 Date actuelle d'avis CSRPN : 05/05/2010 Date de première diffusion INPN : 23/10/2020 Date de dernière diffusion INPN : 23/10/2020 1. DESCRIPTION ............................................................................................................................... 2 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 3 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .............................................................................. 3 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ............................................................. 4 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ........................................... 4 6. HABITATS ...................................................................................................................................... 4 7. ESPECES ...................................................................................................................................... -
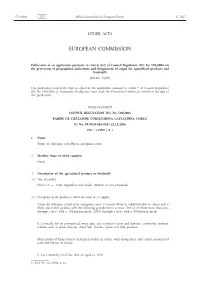
Of Council Regulation (EC)
27.3.2010 EN Official Journal of the European Union C 78/7 OTHER ACTS EUROPEAN COMMISSION Publication of an application pursuant to Article 6(2) of Council Regulation (EC) No 510/2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs (2010/C 78/07) This publication confers the right to object to the application pursuant to Article 7 of Council Regulation (EC) No 510/2006 ( 1 ). Statements of objection must reach the Commission within six months of the date of this publication. SINGLE DOCUMENT COUNCIL REGULATION (EC) No 510/2006 ‘FARINE DE CHÂTAIGNE CORSE/FARINA CASTAGNINA CORSA’ EC No: FR-PDO-005-0581-22.12.2006 PGI ( ) PDO ( X ) 1. Name: ‘Farine de châtaigne corse/Farina castagnina corsa’ 2. Member State or third country: France 3. Description of the agricultural product or foodstuff: 3.1. Type of product: Class 1.6 — Fruit, vegetables and cereals, whether or not processed 3.2. Description of the product to which the name in (1) applies: ‘Farine de châtaigne corse/Farina castagnina corsa’ is creamy white to reddish-brown in colour and is finely and evenly ground, with the following granulometry: at least 70 % of the flour mass must pass through a sieve with a 106-micron mesh, 100 % through a sieve with a 450-micron mesh. It is notable for its pronounced sweet taste and complex scents and flavours, combining aromatic families such as dried chestnut, dried fruit, biscuits, spices and milk products. Flour produced from roasted chestnuts is darker in colour, with strong hues, and a more pronounced taste and flavour of biscuit. -

Commune Nom Du Maire AFA Ange Pascal MINICONI AJACCIO
Maires de Corse du Sud - municipales 2020 Commune Nom du maire Arrondissement Ange Pascal AFA AJACCIO MINICONI Laurent AJACCIO AJACCIO MARCANGELI ALATA Etienne FERRANDI AJACCIO Pierre Paul ALBITRECCIA AJACCIO LUCIANI Toussaint ALTAGENE François SARTENE SIMONPIETRI Jean Toussaint AMBIEGNA AJACCIO POLI François APPIETTO AJACCIO FAGGIANELLI Marie-Antoinette ARBELLARA SARTENE CARRIER ARBORI Paul CHIAPPELLA AJACCIO Paul Joseph ARGIUSTA MORICCIO SARTENE CAÏTUCOLI Christian ARRO AJACCIO ANGELINI Pierre AULLENE SARTENE CASTELLANI Marie-Dominique AZILONE AMPAZA AJACCIO CHIARISOLI AZZANA Thierry LECA AJACCIO Dominique BALOGNA AJACCIO GRISONI Jean-Baptiste BASTELICA AJACCIO GIFFON BASTELICACCIA Antoine OTTAVI AJACCIO Joseph BELVEDERE CAMPOMORO SARTENE SIMONPIETRI BILIA Michel TRAMONI SARTENE Achille BOCOGNANO AJACCIO MARTINETTI Jean-Charles BONIFACIO SARTENE ORSUCCI CALCATOGGIO Charles CHIAPPINI AJACCIO CAMPO Joseph QUILICI AJACCIO François-Joseph CANNELLE AJACCIO PARAVISINI Jean Jacques CARBINI SARTENE NICOLAI Pierre-François CARBUCCIA AJACCIO BELLINI CARDO-TORGIA Nora ETTORI AJACCIO François CARGESE AJACCIO GARIDACCI Don Jacques de CARGIACA SARTENE ROCCA SERRA Ours-Pierre CASAGLIONE AJACCIO ALFONSI Vincent CASALABRIVA SARTENE MICHELETTI CAURO Pascal LECCIA AJACCIO Charles Ange CIAMANNACCE AJACCIO VENTURELLI François COGGIA AJACCIO COGGIA Ange-Marie COGNOCOLI-MONTICCHI AJACCIO ALIOTTI François Antoine CONCA SARTENE MOSCONI Antoine Joseph CORRANO AJACCIO PERALDI Henri-Jules COTI-CHIAVARI AJACCIO ANTONA Jean-Jacques COZZANO AJACCIO CICCOLINI Antoine -

Brigade Territoriale De Pila Canale GD 20 E 188-191 Brigade Territoriale 1946-1947 De Vico 1941-1947
ARCHIVES DE LA DEFENSE UNITES DE LA COMPAGNIE AUTONOME DE LA CORSE (1897-1946) REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE SOUS-SERIE GD 20 E (mis à jour en 2015) SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE Couverture : SHDGN_GN_2007_PA_206_388R ARCHIVES DE LA DEFENSE UNITES DE LA COMPAGNIE AUTONOME DE LA CORSE (1897-1946) REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE SOUS-SERIE GD 20 E dressé par Claudie BELLEAU diplômées d’études supérieures spécialisées sous la direction des lieutenantes Sandra SERIS et Karine PERRISSIN-FABER diplômées d’études supérieures spécialisées SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE Château de Vincennes 2008 (mise à jour 2015) 3 INTRODUCTION Les archives des unités de gendarmerie ont subi d’importantes destructions liées, soit aux vicissitudes de l’histoire (essentiellement en raison des conflits successifs du XXe siècle), soit aux règlements internes imposant la destruction des documents. Un bref historique de la politique archivistique en gendarmerie est nécessaire à la compréhension de ces destructions entraînant aujourd’hui l’absence de nombreux documents dans les collections du Service historique de la Gendarmerie nationale1. La première mention de conservation des archives de la gendarmerie apparaît dans l’ordonnance royale du 29 octobre 1820 portant règlement sur le service : il y est question d’inventaire et de transmission des écrits des officiers à leurs remplaçants. Malgré plusieurs tentatives de conservation définitive ou périodique, une grande partie des documents fut détruite de différentes manières (l’exemple des documents donnés à l’artillerie pour la confection des gargousses et des cartouches est régulièrement cité). Il fut toutefois prévu des délais en fonction de la spécificité de certains documents (10, 15 ou 20 ans). -
Projet De Loi
N * 102 PROJET M LOI adopté SÉNAT t I» avril 1975. SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1974-1978 PROJET DE LOI portant réorganisation de la Corse. (Texte définitif.) Le Sénat a adopté sans modification, en pre mière lecture, le projet de loi adopté par l'As semblée Nationale, en première lecture, dont la teneur suit : Article premier. Il est créé sur le territoire de la Corse deux départements qui prennent respectivement les noms de département de la Corse-du-Sud et de département de la Haute-Corse. Le département de la Corse-du -Sud comprend les communes appartenant actuellement aux arron dissements d'Ajaccio et de Sartène. Voir m numéro» : Assemblée Nationale ( 5e législ.) : 1413, 1493 et in-8° 225. Sénat : 220 et 262 (1974-1975). — 2 — Le département de la Haute-Corse comprend les communes appartenant aux arrondissements de Bastia , de Calvi et de Corte . Ces communes sont énumérées dans le tableau annexé à la présente loi, avec leur répartition actuelle par canton et par arrondissement. Le département de la Corse est supprimé. Art. 2. Sauf disposition contraire de la présente loi, les immeubles faisant partie du domaine public ou du domaine privé du département de la Corse , les meubles corporels de ce département, ainsi que les droits et obligations se rattachant à ces immeubles ou à ces meubles sont transférés, de plein droit, au département sur le territoire duquel ils sont situés . Les nouveaux départements peuvent, par accord amiable , modifier la répartition résultant de l'ali néa premier du présent article. Art. 3. Lorsque les biens mentionnés à l'article 2 ci- dessus sont situés hors du territoire de la Corse, ces biens , ainsi que les droits et obligations qui s'y rattachent , sont transférés, par accord amiable, entre les nouvelles collectivités, à l'une d'entre elles ou à une institution interdépartementale . -
Mercredi 30 Avril '1975
** Aue 1975. — N° 22 S. Le Numéro : 0,50 F Jeudi l ee et Vendredi 2 Mai 1975 ** JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DÉBATS PARLEMENTAIRES SÉNAT COMPTE RENDU INTEGRAL DES SEANCES Abonnements à rEdition des DEBATS DU SENAT : FRANCE ET OUTRE-MER : 16 F ; ETRANGER : 24 F (Compte chèque postal : 9063.13, Paris.) DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION Renseignements: 579-01-95 Téléphone 26, Rue Desaix, 75732 Paris CEDEX 15. Administration: 578-61-39 Le bureau de vente est ouvert tous les jours, sauf le dimanche et les jours fériés, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h. SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1974-1975 COMPTE RENDU INTEGRAL - 11 0 SEANCE Séance du Mercredi 30 Avril '1975. 5. — Permis de chasser. — Adoption des conclusions d'une commis- SOMMAIRE sion mixte paritaire (p. 735). PRÉSIDENCE DE M. Louis GROS Discussion générale : MM. Alfred Kieffer, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; André Jarrot, ministre 1. — Procès-verbal (p. 724). de la qualité de la vie. 2. — Décès de M. Louis Talamoni, sénateur du Val-de-Marne (p. 724). Art. 2, 3 et amendement du Gouvernement, 6 et 8 bis. 3. — Dépôt d'une question orale avec débat (p. 724). Art. 8 ter : MM. Marcel Champeix, Ladislas du Luart, le ministre. 4. — Réorganisation de la Corse (p. 724). Art. 9, 10, 11, 14 et 16. Adoption de trois projets de loi et d'un projet de loi organique. Adoption du projet de loi. Discussion générale commune : MM. Jacques Pelletier, rappor- teur de la commission de législation ; Michel Poniatowski, ministre 6.