Projet De Plan De Gestion 2014-2018
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Révision Taxinomique Et Nomenclaturale Des Rhopalocera Et Des Zygaenidae De France Métropolitaine
Direction de la Recherche, de l’Expertise et de la Valorisation Direction Déléguée au Développement Durable, à la Conservation de la Nature et à l’Expertise Service du Patrimoine Naturel Dupont P, Luquet G. Chr., Demerges D., Drouet E. Révision taxinomique et nomenclaturale des Rhopalocera et des Zygaenidae de France métropolitaine. Conséquences sur l’acquisition et la gestion des données d’inventaire. Rapport SPN 2013 - 19 (Septembre 2013) Dupont (Pascal), Demerges (David), Drouet (Eric) et Luquet (Gérard Chr.). 2013. Révision systématique, taxinomique et nomenclaturale des Rhopalocera et des Zygaenidae de France métropolitaine. Conséquences sur l’acquisition et la gestion des données d’inventaire. Rapport MMNHN-SPN 2013 - 19, 201 p. Résumé : Les études de phylogénie moléculaire sur les Lépidoptères Rhopalocères et Zygènes sont de plus en plus nombreuses ces dernières années modifiant la systématique et la taxinomie de ces deux groupes. Une mise à jour complète est réalisée dans ce travail. Un cadre décisionnel a été élaboré pour les niveaux spécifiques et infra-spécifique avec une approche intégrative de la taxinomie. Ce cadre intégre notamment un aspect biogéographique en tenant compte des zones-refuges potentielles pour les espèces au cours du dernier maximum glaciaire. Cette démarche permet d’avoir une approche homogène pour le classement des taxa aux niveaux spécifiques et infra-spécifiques. Les conséquences pour l’acquisition des données dans le cadre d’un inventaire national sont développées. Summary : Studies on molecular phylogenies of Butterflies and Burnets have been increasingly frequent in the recent years, changing the systematics and taxonomy of these two groups. A full update has been performed in this work. -

Alpe Giarasson (Val Chisone)
Alpe Giarasson (Val Chisone) Lunghezza: 13,29 Km Tempo percorrenza: 2h 30' Cartografia: ISTITUTO GEOGRAFICO CENTRALE Carta dei sentieri e dei rifugi 1:50.000 n. 1 Valli di Susa Chisone e Germanasca Periodo consigliato: giugno - settembre Tipo: asfalto 3,81 km (29%) - sterrato 9,48 km (71%) Dislivello: 650 metri Difficolta': B.C.A. (medio alpinistico) Effettuato il: 27 giugno 2004 Località di partenza: La Rua' (Pragelato) Accesso: da Pinerolo con la SS23 si risale la val Chisone sino alla Rua', capoluogo di Pragelato. Si parte nei pressi dell'edificio delle scuole comunali, quasi al termine della borgata. Si puo' parcheggiare la vettura lungo il Chisone. Descrizione: l'itinerario sfrutta i percorsi segnalati numero 1 e 2 che si snodano sul versante che discende dai monti Genevris e Blegier e che, durante la stagione invernale, vengono effettuati con l'ausilio delle racchette da neve (ciaspole). Dalle scuole comunali (0 Km) seguiamo la SS23 in direzione Sestriere per poche decine di metri e quindi imbocchiamo la via Rio Pomerol (0,07). Procedendo sempre in salita si guadagna dolcemente quota mentre la vista inizia ad aprirsi sul fondovalle e sulle cime che lo delimitano: citiamo tra le tante il Monte Albergian e la Punta Rognosa. Dopo una serie di tornanti, giriamo sulla pista forestale chiusa da sbarra (2,99) che transita nei pressi della Fontana Clot. Dopo un'altra serie di tornanti si prende la deviazione segnalata (sulla sinistra) per l'Alpe Giarasson (5,26). La pendenza risulta ora piu' marcata e una volta arrivati alle costruzioni dell'alpeggio (6,78) una pausa e' d'obbligo. -

Relazione Finale
STUDIO INTEGRATO PER LA CONSERVAZIONE DELLE POPOLAZIONI DI SALAMANDRA LANZAI DELL’ALTA VAL GERMANASCA E DELL’ALTA VAL PO RELAZIONE CONCLUSIVA Luglio 2005 1 Studio Integrato per la Conservazione delle Popolazioni di Salamandra lanzai dell’Alta Val Germanasca e dell’Alta Val Po * Redazione a cura di Franco Andreone, Paolo Eusebio Bergò & Vincenzo Mercurio † * Questa è la relazione conclusiva del progetto di studio su Salamandra lanzai, svolto nel biennio 2003-2004. Per la realizzazione dello stesso hanno collaborato diverse persone, come segue: Franco Andreone (coordinamento scientifico, attività sul campo, elaborazione dei dati e redazione dei testi), Stefano Bovero (attività sul campo), Stefano Camanni (coordinamento amministrativo), Stefano Doglio (attività sul campo), Paolo Eusebio Bergò (attività sul campo, elaborazione dei dati, cartografia e redazione dei testi), Marco Favelli (attività sul campo, archiviazione dei dati, rilettura dei testi), Enrico Gazzaniga (attività sul campo), Vincenzo Mercurio (attività sul campo, elaborazione e redazione dei testi), Patrick Stocco (attività sul campo). Nel corso della realizzazione di questo progetto diverse persone hanno contribuito con suggerimenti, aiuto sul campo e altro. Ci teniamo particolarmente a ringraziare: Claude Miaud, Chiara Minuzzo, Carlotta Giordano, Elena Gavetti, Rafael M. Repetto, Giulia Tessa, Roberta Pala e Gianni Valente. L’Ospedale di Ivrea, Reparto di Radiologia, ci ha considerevolmente aiutati per la realizzazione delle radiografie. La Regione Piemonte e il Servizio Aree Protette, in particolare nelle persone di Ermanno de Biaggi e Marina Cerra, in quanto particolarmente sensibili alle sorti della salamandra permettendo uno studio di grande interesse conservazionistico e naturalistico. Ringraziamo infine il Parco del Po – Sezione Cuneese che ha favorito lo studio. -

Alta Val Susa & Chisone
ALTA VAL SUSA & CHISONE SKI ITALIA/PIEMONTE/ALPI WELCOME PIACERE DI CONOSCERVI! Le montagne di Torino hanno una delle più estese aree sciistiche di tutte le Alpi, conosciuta in tutto il mondo per la qualità e la quantità dei servizi offerti. In una parola: emozioni. AltaL’ Val Susa e Chisone, teatro degli eventi montani delle Olimpiadi Torino 2006, offre vaste e moderne aree per lo sci e lo snowboard, come Vialattea e Bardonecchia Ski, terreno ideale sia per i principianti che per i più esperti. Gli impianti moderni regalano piste tecniche ai praticanti dello sci alpino ed anche agli amanti dello sci di fondo. I numerosi snowpark offrono salti e trick per sciatori e snowboarder amanti delle acrobazie e del divertimento puro. Maestri e guide alpine possono accompagnarvi su meravigliosi itinerari fuori pista, tra pinete e plateau, in completa sicurezza. Gli amanti della montagna al naturale potranno anche praticare sci alpinismo ed escursionismo con le racchette da neve, sulle vette più selvagge, per godere di panorami mozzafiato. Non potrete mai più fare a meno della neve sotto i piedi! Tutto servito nel migliore stile italiano, per quello che riguarda ospitalità, cucina e cultura, a solo un’ora di treno o di auto dalla città di Torino, una vera meraviglia per monumenti, storia, cultura e stile di vita. Le stesse montagne, quando indossano l’abito estivo, si trasformano in un paradiso per gli appassionati delle due ruote, con e senza motore, su asfalto e sui sentieri. Bike park, single-track, strade militari sterrate e colli che fanno la storia del Giro d’Italia e del Tour de France ed una ricettività pronta ad accogliervi con tutti i servizi e la flessibilità richiesti da chi si diverte in bici o in moto, dagli atleti alle famiglie. -

Trekking "Il Giro Dell'orsiera"
Il Giro dell’Orsiera è l’anello di congiunzione tra pianura e montagna: dall’alto delle cime e dei valichi si possono osservare Superga e Torino, la Rocca di Cavour e il Monviso, la pianura padana fino a Chivasso e Saluggia, e la vista corre anche verso ovest, alle cime cristalline degli Écrins, della Vanoise, al lago del Moncenisio. Da Torino, lo sguardo volto ad occidente si ferma proprio qui, a questo gruppo di montagne aguzze che divide bassa Val Susa e Val Chisone, stringendo in mezzo la Val Sangone: le tre valli del Parco Naturale Orsiera Rocciavrè. Il trekking del Giro dell’Orsiera contorna infatti l’area del massiccio Orsiera-Rocciavrè e offre ambienti straordinari, in un’alternanza di pascoli, pietraie, lariceti, faggete, oltre a paesaggi in cui i grandi ghiacciai quaternari sembrano essersi sciolti solo pochi giorni fa, lasciandosi dietro la bellezza grezza e seducente delle rocce. Un itinerario che porta alla scoperta della natura incontaminata a due passi da Torino, ma che, allo stesso tempo, soddisfa sia i collezionisti di vette, sia coloro che in vacanza amano anche imparare qualcosa della storia del luogo che attraversano: durante il percorso del Giro dell’Orsiera si trovano le testimonianze della Storia più nota, quella fatta dai Re e dal potente clero medioevale (forte di Fenestrelle, Certosa di Montebenedetto, ecc.), ma anche gli aspetti meno conosciuti, quella “piccola” Storia di tutti i giorni, vissuta dai pastori e dai montanari che fino a cinquant’anni fa popolavano numerosi queste vallate (incisioni rupestri, mulattiere -
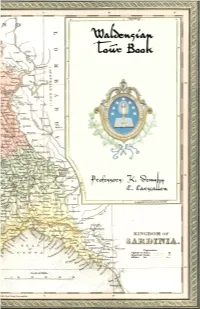
Waldensian Tour Guide
1 ii LUX LUCET EN TENEBRIS The words surrounding the lighted candle symbolize Christ’s message in Matthew 5:16, “Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your father who is in heaven.” The dark blue background represents the night sky and the spiritual dark- ness of the world. The seven gold stars represent the seven churches mentioned in the book of Revelation and suggest the apostolic origin of the Waldensian church. One oak tree branch and one laurel tree branch are tied together with a light blue ribbon to symbolize strength, hope, and the glory of God. The laurel wreath is “The Church Triumphant.” iii Fifth Edition: Copyright © 2017 Original Content: Kathleen M. Demsky Layout Redesign:Luis Rios First Edition Copyright © 2011 Published by: School or Architecture Andrews University, Berrien Springs, MI 49104 Compiled and written: Kathleen M. Demsky Layout and Design: Kathleen Demsky & David Otieno Credits: Concepts and ideas are derived from my extensive research on this history, having been adapted for this work. Special credit goes to “The Burning Bush” (Captain R. M. Stephens) and “Guide to the Trail of Faith” (Maxine McCall). Where there are direct quotes I have given credit. Web Sources: the information on the subjects of; Fortress Fenestrelle, Arch of Augustus, Fortress of Exhilles and La Reggia Veneria Reale ( Royal Palace of the Dukes of Savoy) have been adapted from GOOGLE searches. Please note that some years the venue will change. iv WALDENSIAN TOUR GUIDE Fifth EDITION BY KATHLEEN M. DEMSKY v Castelluzzo April 1655 Massacre and Surrounding Events, elevation 4450 ft The mighty Castelluzzo, Castle of Light, stands like a sentinel in the Waldensian Valleys, a sacred monument to the faith and sacrifice of a people who were willing to pay the ultimate price for their Lord and Savior. -

For Over 150 Years, Talc Exploration and Extraction in the Chisone And
or over 150 years, talc exploration and extraction in the workers at hydroelectric stations, electricians and drivers. At its Chisone and Germanasca Valleys offered the greatest num- peak of expansion, the company employed over 600 people Fber of job opportunities as an alternative to migration. from the valley area. Until the mid-1800s, talc extraction was limited to exploitating The activity of “Talco e Grafite Val Chisone” continued until the small outcrops of the deposit at high altitudes. It was used in the late 1980s when it was taken over by the “Luzenac Val Chisone” form of soapstone to make everyday tools and utensils such as Company, a world leader in talc production.. In February 2006, irons, pans for the tourtèl (large ravio- the Luzenac Val Chisone Company li), inkpots, bed warmers, and drinking GRUPPO DI MINATORI © PRO LOCO SALZA became part of the “Rio Tinto troughs for farm animals... Minerals” Group, a leading interna- In the second half of the 19th century, tional producer of industrial minerals. numerous businessmen undertook the Mining continues inside the only exist- mining adventure with varying ing mine, Rodoretto. degrees of success, opening sites at Maniglia and Malzas (Perrero), at To celebrate 100 years of mining the Sapatlé, Pleinet, Envie and Crosetto famed “Bianco delle Alpi” (the White of (Prali) and at Fontane (Salza di the Alps), the Ecomuseo Regionale delle Pinerolo). Miniere e della Val Germanasca This period was characterised by the (Regional Ecomuseum of Mines and the extreme contiguity of the sites, by Germanasca Valley) and the “Rio Tinto controversies concerning the conces- Minerals - Luzenac Val Chisone” sions and by a lack of clarity in mining Company, in collaboration with the legislation. -

Sestriere - Perosa A
ORARIO IN VIGORE dal 12 Aprile 2021 Linea 275/282 edizione Aprile 2021 Contact center Arriva Italia 035 289000 ANDATA torino.arriva.it | extrato.it SESTRIERE - PEROSA A. - PINEROLO - TORINO Stagionalità corsa FER FER FER FER FER FER FER FER FER FER FER FER FER FER FER FER FER FER FER FER FER FER FER FER FER FER SCO FER Giorni di effettuazione 12345 12345 12345 12345 12345 123456 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 123456 12345 123456 12345 12345 12345 12345 78 6 123456 12345 NOTE: A A A A F A A A A A A A A F A A A A A A A A A A J A # Scol A OULX - Stazione FS OULX - Liceo D OULX - p.zza Garambois A CESANA TORINESE SESTRIERE T 6.10 PRAGELATO O 6.30 FENESTRELLE - via Nazionale R 6.10 6.10 6.50 7.10 PEROSA ARG.-pzza Terzo Alpini (Arrivo) 6.40 6.40 7.20 Possibile interscambio a Perosa Argentina - ATTENZIONE! Ritardi di carattere eccezionale potrebbero pregiudicare l'interscambio PEROSA ARG.-pzza Terzo Alpini (Partenza) 4.20 4.50 5.40 5.50 5.50 6.00 R 6.20 6.40 6.40 6.50 7.00 7.10 7.24 7.40 7.40 7.40 PINASCA 4.24 4.54 5.44 5.54 5.54 6.04 E 6.24 6.44 6.44 6.54 7.04 7.14 7.28 7.44 7.44 7.44 DUBBIONE - via Nazionale 4.25 4.55 5.45 5.55 5.55 6.05 6.25 6.45 6.45 6.55 7.05 7.15 7.29 7.45 7.45 7.45 VILLAR PEROSA - via Nazionale 4.30 5.00 5.50 6.00 6.00 6.10 F 6.30 6.50 6.50 7.00 7.10 7.20 7.30 7.34 7.50 7.49 7.49 S. -

L'alpe Selleries
VALLE CHISONE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - L’ALPE SELLERIES Località di partenza: Fenestrelle: Fontana del Ponte Rosso-Forte delle Valli Epoca consigliata: giugno-ottobre Tipo di itinerario: escursionistico/cicloturistico Quota di partenza/arrivo: 1700 m – 2365 m (arrivo 1° e 2° itinerario) La quota massima lungo il percorso è 2077 m. Durata del percorso di salita: 1° itinerario: 1 h circa. 2° Itinerario: 2/3 h Per saperne di più: www.rifugioselleries.it; www.chisone- germanasca.torino.it; www.parco-orsiera.it Cartografia: carta turistica del Parco Orsiera Rocciavrè scala 1:25.000 oppure carta n°1 dell'Istituto Geografico Centrale "Valli di Susa, Chisone e Germanasca"scala 1:50.000 Ricettività locale: Rifugio Selleries, 0121 842664 - 347 3182113, Alpeggi in loco: Alpe di Selleries, Alpe Juglard, Pian dell’Alpe Eventi: Tutti gli anni si festeggia S. Anna il 26 luglio a Puy e la Madonna delle Nevi la prima domenica di agosto a Pequerel. L’ultimo fine settimana di settembre: Festa del Plaisentif, organizzata dal Rifugio Selleries e dal Parco Orsiera Rocciavrè presso l'Alpe Selleries. Alpe Selleries 58 VALLE CHISONE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - ACCESSO Da Torino si raggiunge Pinerolo, con l’autostrada A 55 e da qui si prosegue sulla SR 23 fino a Depot, frazione di Fenestrelle. Prima di entrare nell’abitato svoltare a destra per il Colle delle Finestre. Dopo circa 6 km si giunge al centro di Pracatinat, che riutilizza i fabbricati del cosiddetto Sanatorio Agnelli, realizzato negli anni 1926-28 per ospitare pazienti affetti da malattie polmonari grazie a un ambiente con clima asciutto e boschi di conifere molto soleggiato. Oggi i fabbricati sono destinati ad attività culturali, educative, formative, turistico- sociali ed ospitano anche la sede del museo del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè. -

Sovraccoperta Fauna Inglese Giusta, Page 1 @ Normalize
Comitato Scientifico per la Fauna d’Italia CHECKLIST AND DISTRIBUTION OF THE ITALIAN FAUNA FAUNA THE ITALIAN AND DISTRIBUTION OF CHECKLIST 10,000 terrestrial and inland water species and inland water 10,000 terrestrial CHECKLIST AND DISTRIBUTION OF THE ITALIAN FAUNA 10,000 terrestrial and inland water species ISBNISBN 88-89230-09-688-89230- 09- 6 Ministero dell’Ambiente 9 778888988889 230091230091 e della Tutela del Territorio e del Mare CH © Copyright 2006 - Comune di Verona ISSN 0392-0097 ISBN 88-89230-09-6 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, without the prior permission in writing of the publishers and of the Authors. Direttore Responsabile Alessandra Aspes CHECKLIST AND DISTRIBUTION OF THE ITALIAN FAUNA 10,000 terrestrial and inland water species Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona - 2. Serie Sezione Scienze della Vita 17 - 2006 PROMOTING AGENCIES Italian Ministry for Environment and Territory and Sea, Nature Protection Directorate Civic Museum of Natural History of Verona Scientifi c Committee for the Fauna of Italy Calabria University, Department of Ecology EDITORIAL BOARD Aldo Cosentino Alessandro La Posta Augusto Vigna Taglianti Alessandra Aspes Leonardo Latella SCIENTIFIC BOARD Marco Bologna Pietro Brandmayr Eugenio Dupré Alessandro La Posta Leonardo Latella Alessandro Minelli Sandro Ruffo Fabio Stoch Augusto Vigna Taglianti Marzio Zapparoli EDITORS Sandro Ruffo Fabio Stoch DESIGN Riccardo Ricci LAYOUT Riccardo Ricci Zeno Guarienti EDITORIAL ASSISTANT Elisa Giacometti TRANSLATORS Maria Cristina Bruno (1-72, 239-307) Daniel Whitmore (73-238) VOLUME CITATION: Ruffo S., Stoch F. -

SESS 2 16022011 TPR3.Pub
Il Quaternario Congresso AIQUA Italian Journal of Quaternary Sciences Il Quaternario Italiano: conoscenze e prospettive 24, (Abstract AIQUA, Roma 02/2011), 104 - 106 Roma 24 e 25 febbraio 2011 POST-GLACIAL EVOLUTION OF GRAVITATIONAL SLOPE DEFORMATIONS IN THE UPPER SUSA AND CHISONE VALLEYS (ITALIAN WESTERN ALPS) Gianfranco Fioraso1, Paolo Baggio2, Livio Bonadeo3 & Fabio Brunamonte2, 3 1 CNR - Istituto di Geoscienze e Georisorse - Torino 2 IG - Ingegneria Geotecnica - Torino 3 Dipartimento di Scienze Chimiche e Ambientali - Università dell’Insubria Corresponding author: G. Fioraso <[email protected]> ABSTRACT: Fioraso G. et al., Post-glacial evolution of gravitational slope deformations in the upper Susa and Chisone Valleys (Italian Western Alps). (IT ISSN 0394-3356, 2011) The upper Susa and Chisone valleys host the largest concentration of deep-seated gravitational slope deformations (DSGSD) and large landslides of the whole Alpine chain. This is due i) to the lithostructural characteristics of bedrock and ii) to the intense and the prolonged glacial scouring during the upper Pleistocene. Deep drill holes carried out on seven large landslides show that the evolution of gravitational phenomena has completely re-shaped the original post- glacial morphology of valley bottoms. RIASSUNTO: Fioraso G. et al., Evoluzione post-glaciale dei fenomeni gravitativi nelle alte valli di Susa e Chisone (Alpi Occidentali). (IT ISSN 0394-3356, 2011) In alta Valle di Susa e in alta Val Chisone è ospitata la maggiore concentrazione di deformazioni gravitative profonde di versante (DGPV) e grandi frane dell'intero arco alpino. Questa particolarità è dovuta i) alle caratteristiche litostrutturali del substrato roccioso e ii) all'intenso approfondimento erosivo dei solchi vallivi operato dai ghiacciai nel corso del Pleistocene superiore. -

How Much Biodiversity Is in Natura 2000?
Alterra Wageningen UR Alterra Wageningen UR is the research institute for our green living environment. P.O. Box 47 We off er a combination of practical and scientifi c research in a multitude of How much Biodiversity is in Natura 2000? 6700 AA Wageningen disciplines related to the green world around us and the sustainable use of our living The Netherlands environment, such as fl ora and fauna, soil, water, the environment, geo-information The “Umbrella Eff ect” of the European Natura 2000 protected area network T +31 (0) 317 48 07 00 and remote sensing, landscape and spatial planning, man and society. www.wageningenUR.nl/en/alterra The mission of Wageningen UR (University & Research centre) is ‘To explore Technical report Alterra Report 2730B the potential of nature to improve the quality of life’. Within Wageningen UR, ISSN 1566-7197 nine specialised research institutes of the DLO Foundation have joined forces with Wageningen University to help answer the most important questions in the Theo van der Sluis, Ruud Foppen, Simon Gillings, Thomas Groen, René Henkens, Stephan Hennekens, domain of healthy food and living environment. With approximately 30 locations, 6,000 members of staff and 9,000 students, Wageningen UR is one of the leading Kim Huskens, David Noble, Fabrice Ottburg, Luca Santini, Henk Sierdsema, Andre van Kleunen, organisations in its domain worldwide. The integral approach to problems and Joop Schaminee, Chris van Swaay, Bert Toxopeus, Michiel Wallis de Vries and Lawrence Jones-Walters the cooperation between the various disciplines