Partis Et Systèmes De Partis En Belgique En Perspective
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

30Years 1953-1983
30Years 1953-1983 Group of the European People's Party (Christian -Demoeratie Group) 30Years 1953-1983 Group of the European People's Party (Christian -Demoeratie Group) Foreword . 3 Constitution declaration of the Christian-Democratic Group (1953 and 1958) . 4 The beginnings ............ ·~:.................................................. 9 From the Common Assembly to the European Parliament ........................... 12 The Community takes shape; consolidation within, recognition without . 15 A new impetus: consolidation, expansion, political cooperation ........................................................... 19 On the road to European Union .................................................. 23 On the threshold of direct elections and of a second enlargement .................................................... 26 The elected Parliament - Symbol of the sovereignty of the European people .......... 31 List of members of the Christian-Democratic Group ................................ 49 2 Foreword On 23 June 1953 the Christian-Democratic Political Group officially came into being within the then Common Assembly of the European Coal and Steel Community. The Christian Democrats in the original six Community countries thus expressed their conscious and firm resolve to rise above a blinkered vision of egoistically determined national interests and forge a common, supranational consciousness in the service of all our peoples. From that moment our Group, whose tMrtieth anniversary we are now celebrating together with thirty years of political -

Module 3 Verkiezingen En Partijen Le Du 3
Module 3 Verkiezingen en partijen le du 3 o M 92 Module 3 Verkiezingen en partijen le du 3 o M Inhoudstafel Module 3 A Democratie en verkiezingen . 94 B Het stemrecht . .96 . Wie mag stemmen? 96 Het algemeen stemrecht 97 Stemrecht of opkomstplicht 99 De evolutie van het stemrecht, een tijdlijn 101 C Kiesstelsels . 103 . Het Belgische kiesstelsel 103 Andere kiesstelsels 105 D Onze parlementsverkiezingen in de praktijk . 111 . Kandidatenlijsten 111 Een kandidatenlijst opstellen 111 De verkiezingscampagne 112 In het stembureau 113 Zetelverdeling 114 E Politieke partijen . 117 Democratie en debat 117 Ideologieën 118 De politieke partijen in Vlaanderen 122 Andere politieke partijen 129 De kritiek op politieke partijen 130 93 Democratie A en verkiezingen In het oude Athene werd door lottrekking bepaald wie zou gaan besturen Elke Atheense bur- ger (niet de vrouwen, de slaven en de niet-Atheners) had dus evenveel kans om geselecteerd te worden In ons democratisch systeem wijzen we onze politici en bestuurders aan door ver- kiezingen Verkiezingen zijn met andere woorden een methode om te selecteren wie een rol zal spelen bij het besturen van de samenleving We organiseren verkiezingen omdat we het belangrijk vinden om legitieme afgevaardigden te kunnen aanwijzen die in onze naam zullen spreken, handelen, wetten maken en opleggen Door de afgevaardigden te verkiezen, geven we hun met andere woorden de toestemming om dwingende regels te maken 1 Verkiezingen zijn niet de enige methode om invloed uit te oefenen op het bestuur van de samenleving Als burger -

François Koulischer
François Koulischer https://sites.google.com/site/francoiskoulischer/ University of Luxembourg Department of Finance Kirchberg campus, building F Luxembourg, L-1359 Tel: +352 466644 5618 E-mail: [email protected] Education Université Libre de Bruxelles Ph.D. in Economics (ECARES), 2016 M.Sc. in Economics and Statistics (Faculty of Sciences), 2012 B.Sc. and M.Sc. in Business Economics (Solvay Brussels School), 2009 Resarch Interests Sustainable Finance, Financial Intermediation, Monetary Policy Employment University of Luxembourg Research Associate, Department of Finance, 2018 – Present Banque centrale du Luxembourg Economist, Financial Stability Division, 2016 – 2018 Banque de France Economist, Financial Economics Research Division, 2014 – 2016 Other Affiliations LuxFLAG Finance Labeling Agency External advisor, 2020 – Present National Bank of Belgium Research consultant, Economics Department, 2019 – Present Visiting researcher, Financial Stability Division, 2013 Page 1 François Koulischer https://sites.google.com/site/francoiskoulischer/ Stanford University Visiting scholar, Economics Department, 2013 University of Oxford Visiting scholar, Nuffield College, 2011 European Central Bank Research consultant, Directorate General Market Operations (DG-M), 2011 Intern, DG-M, 2009-2010 Publications Inspecting the Mechanism of Quantitative Easing in the Euro Area (with Ralph Koijen, Benoît Nguyen and Motohiro Yogo). Journal of Financial Economics, Forthcoming. The Collateral Channel of Open Market Operations (with Nuno Cassola). Journal of Financial Stability, April 2019, 41, 73-90. Euro-Area Quantitative Easing and Portfolio Rebalancing (with Ralph Koijen, Benoit Nguyen, and Motohiro Yogo). American Economic Review (P&P), 107(5), 2017. Central Bank Liquidity Provision and Collateral Quality (with Daan Struyven). Journal of Banking and Finance, December 2014, 49(0), 113-130. Work in Progress Assessing the Carbon Footprint of Investor Portfolios. -
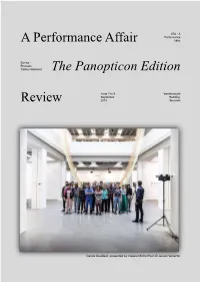
A Performance Affair the Panopticon Edition Review
APA • A Performance A Performance Affair Affair During • Brussels Gallery Weekend The Panopticon Edition From 7 to 9 Vanderborght September Building, Review 2018 Brussels Carole Douillard presented by Galerie Michel Rein © Jeroen Verrecht APA • INTRODUCTION This inaugural edition was a resounding success with 23 artist activated performances and 1500 visitors, including world-class collectors, curators, representatives from cultural institutions, luminaries and performance aficionados. We are thankful we could partner with Brussels Gallery Weekend for our first edition. The Panopticon, A Performance Affair’s first edition, transformed the second floor of the Vanderborght Building into an immersive space for three days of performances in collaboration with the Brussels Gallery Weekend (7—9 September 2018). Inspired by the notion of the Panopticon and the building’s unique architecture, continuous and overlapping performance works by international artists were presented throughout the dynamic venue. Presenting a myriad of performances for sale by emerging and mid-career artists selected by a high-level committee, and featuring Violent Incident, an historic performance video by Bruce Nauman, an interactive performance installation by Greg Finger, A Performance Affair put the whole spectrum of the economies of performance art on display and for discussion. Watch the replay on Youtube Joris Van de Moortel presented by Galerie Nathalie Obadia © Jeroen Verrecht Thanks to the Vanderborght’s unique architecture, The Panopticon transformed each visitor from witness to voyeur to performer, while the Bureau broadcasted live the whole duration of the weekend, enabling visitors from around the world to surveil the affair through our two YouTube channels. APA youtube LIVE © Jeroen Verrecht APA • CONCEPT A Performance Affair is a new Brussels based association with international outreach dedicated to performance art. -

Sammlung Minke, Alfred
BE-A0531_705474_702105_FRE Inventar Archivbestand Sammlung Alfred Minke (1684-2010) Het Rijksarchief in België Archives de l'État en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This finding aid is written in French. 2 Sammlung Minke, Alfred DESCRIPTION DU FONDS D'ARCHIVES:................................................................5 DESCRIPTION DES SÉRIES ET DES ÉLÉMENTS.........................................................7 Sammlung Minke (1914-2011).........................................................................7 I. Unterlagen 1989-2010.........................................................................................7 A. Hospital Eupen...............................................................................................7 B. Stadt Eupen....................................................................................................7 C. Presse............................................................................................................. 9 D. Dokumentation Deutschsprachige Gemeinschaft..........................................9 35 - 37 Dokumente aus der Periode 1914-1946 zur Geschichte Ostbelgiens aus belgischen Archiven. O.D.........................................................................9 E. Tod S.M. König Baudouin..............................................................................10 41 - 52 Grenz-Echo, 66. Jahrgang. August 1993...........................................10 58 - 60 "Het Laatste Nieuws", 106de jaargang. August 1993.......................11 -

The Lion, the Rooster, and the Union: National Identity in the Belgian Clandestine Press, 1914-1918
THE LION, THE ROOSTER, AND THE UNION: NATIONAL IDENTITY IN THE BELGIAN CLANDESTINE PRESS, 1914-1918 by MATTHEW R. DUNN Submitted to the Department of History of the University of Kansas in partial fulfillment of the requirements for departmental honors Approved by: _________________________ Dr. Andrew Denning _________________________ Dr. Nathan Wood _________________________ Dr. Erik Scott _________________________ Date Abstract Significant research has been conducted on the trials and tribulations of Belgium during the First World War. While amateur historians can often summarize the “Rape of Belgium” and cite nationalism as a cause of the war, few people are aware of the substantial contributions of the Belgian people to the war effort and their significance, especially in the historical context of Belgian nationalism. Relatively few works have been written about the underground press in Belgium during the war, and even fewer of those works are scholarly. The Belgian underground press attempted to unite the country's two major national identities, Flemings and Walloons, using the German occupation as the catalyst to do so. Belgian nationalists were able to momentarily unite the Belgian people to resist their German occupiers by publishing pro-Belgian newspapers and articles. They relied on three pillars of identity—Catholic heritage, loyalty to the Belgian Crown, and anti-German sentiment. While this expansion of Belgian identity dissipated to an extent after WWI, the efforts of the clandestine press still serve as an important framework for the development of national identity today. By examining how the clandestine press convinced members of two separate nations, Flanders and Wallonia, to re-imagine their community to the nation of Belgium, historians can analyze the successful expansion of a nation in a war-time context. -

European Parliament Made Simple
THE EUROPEAN PARLIAMENT MADE SIMPLE 2014-2019 The European Parliament Made Simple is produced by the American Chamber of Commerce to the European Union (AmCham EU) as a introduction to the workings of the European Parliament for amateurs and experts alike. Production Team Editor and project manager Giovanni Mastrobuono Senior Communications Officer Editorial assistance Alexandrine Gauvin Communications Officer Eli Corso-Phinney Communications Intern The information contained in this publication has been compiled in good faith and is accurate according to the most recent sources available at the time of going to press. Photographs used with the kind permission of the Audiovisual Libraries of the European Commission, Council of the European Union and the European Parliament. First edition, 2014 ISBN: 978-2-9146856-7-2 Printed in Belgium American Chamber of Commerce to the European Union (AmCham EU) Avenue des Arts 53, B-1000 Brussels Telephone: +32 (0)2 513 68 92 Fax: +32 (0)2 513 79 28 [email protected] www.amchameu.eu Foreword Susan Danger Managing Director American Chamber of Commerce to the European Union t is with great pleasure that I present AmCham EU’s newest guide, The European Parliament Made Simple. The Lisbon Treaty, signed in 2009, gave the European Parliament greater power in EU Idecision-making and an increased role in selecting and approving the European Commission. As a result, this year’s European election has a greater democratic influence than ever before. With this in mind, AmCham EU has published The European Parliament Made Simple to explain the Parliament’s expanded powers and roles, for both the Brussels policy community and public affairs professionals in the EU and US. -

"The Times They Are Changing"1
1/1 "The times they are changing"1 Belgien - Ein Staat im Wandel Referat2: G. Modard-Girretz, Juristin im Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens Erste Fassung - Stand 21.09.08 Struktur des Referats 1. Einleitung 2. Die bisherigen Staatsstrukturen und -reformen a. Belgien vor Beginn des Föderalisierungsprozesses b. 1968-1971: Die erste große Staatsreform Die Wiege einer neuen institutionellen Ära c. 1980-1983: Die zweite große Staatsreform Ausbau und Stärkung der Errungenschaften von 1970 d. 1988-1989: Die dritte große Staatsreform Klärung der „Brüssel-Frage“ und weiterer Autonomieausbau e. 1993: Die vierte große Staatsreform Der Wandel ist vollzogen - Belgien ist ein Föderalstaat f. 2001: Die fünfte große Staatsreform Weitere Stärkung der Gliedstaaten 3. Vorbereitung einer sechsten großen Staatsreform a. Technische Umsetzungsmöglichkeiten einer Staatsreform b. Forderungen 2001-2007 c. Die 2007 zur Revision freigegebenen Verfassungsartikel d. Was ist seit den Föderalwahlen von Juni 2007 geschehen? 4. Zukunftsaussichten 5. Schlusswort 6. Quellenverzeichnis 1 Titel eines Bob-Dylan-Songs aus dem Jahre 1964; in der Übersetzung „Die Zeiten ändern sich“ 2 Vorliegender Text ist die schriftliche Fassung des Referats, das am 22. September 2008 im Rahmen des Aktualitätsunterrichts des VHS-Bildungskurses gehalten wurde. 2/2 1. Einleitung „Kommt Abgeordnete, bitte achtet auf den Ruf. Steht nicht in der Türe und blockiert nicht die Halle. Denn, wer zu Schaden gekommen ist, der hat auch Zeit geschunden. Draußen wütet eine Schlacht. Er wird schon bald an euren Fenstern rütteln und eure Wände erschüttern, denn die Zeiten ändern sich.3“ frei übersetzter Auszug aus dem Bob-Dylan-Song The times they are changing Die Zeiten ändern sich. -

Réalités Et Représentations 1918-1940
LES FEMMES D'UNE GUERRE À L'AUTRE Réalités et représentations 1918-1940 ELIANE GUBIN* L’ENTRE-DEUX-GUERRES EST GÉNÉRALEMENT PRÉSENTÉ COMME UNE “PÉRIODE DE TRANSITION ENTRE DEUX ORDRES SOCIO-ÉCONOMIQUES DISTINCTS” 1. POUR LES FEMMES, IL S’AGIT D’UNE PÉRIODE DÉCISIVE DANS L’HISTOIRE DE LEUR ÉMANCIPATION. CETTE AFFIRMATION VA RÉSOLUMENT À CONTRE-COURANT D’UNE HISTORIOGRAPHIE QUI, APRÈS AVOIR CRU DÉCELER DANS LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE L’AMORCE DE LA LIBÉRATION DES FEMMES 2, MET AUJOURD’HUI SURTOUT L’ACCENT SUR LEUR ‘REMISE AU PAS’ DÈS LES ANNÉES VINGT. DE RÉVISION EN RÉVISION, LES CONCLUSIONS OPTIMISTES SE SONT TARIES ET BEAUCOUP N’HÉSITENT PAS À CONSIDÉRER QUE LA GUERRE A MÊME RETARDÉ LA REDISTRIBUTION DES RÔLES SEXUÉS QUI S’AMORÇAIT AVANT LE CONFLIT 3. POURTANT, APRÈS 1918, PLUS RIEN N’EST PAREIL POUR LES FEMMES. ELLES MARQUENT SANS CONTESTE DES POINTS, MÊME SI L’ÉVOLUTION N’EST PAS LINÉAIRE : À LA VEILLE DE LA DEUXIÈME GUERRE, “ON VOIT BIEN QUE PRESQUE TOUT A CHANGÉ... MAIS ON NE SAIT FINALE MENT PAS DU TOUT POURQUOI ET LE COMMENT LUI-MÊME RESTE ASSEZ EMBROUILLÉ” 4. L’ARTICLE BROSSE ICI À GRANDS TRAITS CES ANNÉES; PRENANT POUR PRINCIPAL EXEMPLE LE _ TRAVAIL DES FEMMES, IL MONTRE COMMENT LES PARADOXES DES RÉALITÉS QUOTIDIENNES ET LA • PERSISTANCE DES DISCOURS TRADITIONNELS ONT OCCULTÉ D’IMPORTANTS CHANGEMENTS DANS LA CONDITION FÉMININE. I. Le temps des paradoxes e prime abord, les pessimistes semblent avoir raison : après la guerre, tous les Dindicateurs ‘objectifs’ de l’émancipation des femmes sont en baisse. Leur taux d’activité enregistrée -

Sur L'identité Francophone En Belgique
THÈME Sur l’identité francophone en Belgique La conscience de soi, des autres et du monde est tributaire du contexte historique: les mentalités, qui en Sommaire sont la nébuleuse de référence, dépendent d’une multitude de paramètres, qui configurent les instances de Francophone, et peu fier de l’être ? la conscience individuelle, de la conscience collective et de Michel Francard, D.R. la conscience universelle, dont nul homme vraiment libre Valérie Provost 12 ne peut se passer. La situation linguistique de la Belgique Le passage d’un Royaume de Belgique uni et patriotique, avant la ne laisse personne indifférent. Qu’en est-il, dans le dédale linguistico- Première Guerre mondiale, à une Belgique, aujourd’hui fédérale et siège de institutionnel de notre pays, de la la Commission de l’Union Européenne, fondée sur une conscience collective Communauté Wallonie-Bruxelles? transformée, est un fait historique. Nouvelle réalité, principalement Modèles littéraires, fictions focalisée sur et par la conscience linguistique, elle repense et examine les identitaires fondements de ses nouvelles cohérences, des nouvelles cohésions qui Pierre Piret 15 peuvent la structurer. Depuis une bonne vingtaine d’années, L’identité francophone en est une, si importante qu’au-delà comme en- l’idée d’une littérature belge distincte deçà des questions de sol elle a justifié un pouvoir, un gouvernement, un de sa grande sœur française a refait surface et s’est rapidement affirmée. parlement et qu’elle en appelle à la conscience individuelle de chaque francophone et à la conscience universelle des droits de l’Homme. Une presse en manque d'identités Le propos de ce dossier n’est certes pas de tout examiner et de tout dire à Vincent Rocour 20 ce sujet. -

Priester Daens in Ninove
de pijn daensist te zijn te daensist pijn de Joris De Kegel Kerksken 8 augustus 1943 Joris is daensist van de vierde generatie. Zijn overgroot- vader Jozef Callebaut was roelander en spilfiguur van De Christene Volkspartij. Diens archief bleef bewaard en samen met persoonlijke getuigenissen vormt het de kern van de pijn daensist te zijn. Hij studeerde aan het Koninklijk Atheneum en de Rijks Hogere Handelsschool te Aalst. Gedurende meer dan 30 jaar werkte hij in een Zwitsers bedrijf in Ninove, vervolgens als boekhouder, personeelsverantwoordelijke en procuratie- houder. In zijn functie werd hij geconfronteerd met de cyclische economische crisissen. Medeonderhandelaar in 1998 bij de sluiting van de Belgische productie- de afdeling van het bedrijf. Hij was actief in de jeugdbeweging als lid van het A.D.V.J. en VBV en behoor- de tot de leiding van het Blauwvoetvendel Priester Daens in Ninove. Hij werd politiek actief in de Volksunie, zetelde in de arrondissementsraad en was tijdelijk pijn voorzitter van de afdeling Kerksken en verantwoordelijke uitgever van het infor- matieblad Wij, Vlaams Nationaal Kerksken. Hij zetelde voor de VU van 1970 tot 1976 in de toenmalige C.O.O. De auteur is medewerker van de Heemkundige Kring Haaltert. Hij publiceerde in 1999 samen met Willy De Loose, Kerksken de wereld in een dorp, bijdrage tot daensist de geschiedenis van Kerksken. Hij publiceert regelmatig bijdragen in het tijd- schrift van de Heemkundige Kring. Hij werkte mee − door het aanreiken van plaatselijk historisch onderzoek − met auteur Dirk Musschoot en is verder actief in het onderzoek naar de Vlaamse-Nationalistische jeugdbewegingen voor en na WO II. -

Le Conseiller Du Roi
Armel Job Le Conseiller du roi DOSSIER PÉDAGOGIQUE Pour s’assurer de la qualité du dossier, tant au niveau du contenu que de la langue, chaque texte est relu par des pro- fessionnels de l’enseignement qui sont, par ailleurs, membres du comité éditorial Espace Nord : Françoise Chatelain, Rossano Rosi, Valériane Wiot. Ces derniers vérifient aussi sa conformité à l’approche par compétences en vigueur dans les écoles francophones de Belgique. Le dossier est richement illustré de documents iconogra- phiques soigneusement choisis en collaboration avec Laurence Boudart, directrice adjointe des Archives & Musée de la Littérature. Ces images sont téléchargeables sur la page dédiée du site www.espacenord.com. Elles sont soumises à des droits d’auteur ; leur usage en dehors du cadre privé engage la seule responsabilité de l’utilisateur. © 2015 Communauté française de Belgique Illustration de couverture : © Rohit Seth – Fotolia.com Mise en page : Charlotte Heymans Armel Job Le Conseiller du roi (roman, n° 303, 2012) DOSSIER PÉDAGOGIQUE réalisé par Charlotte Van Asbroeck Table des matières 1. L’auteur ............................................................................................................................................ 5 2. Le résumé du livre ........................................................................................................................ 6 2.1. L’intrigue ................................................................................................................................................. 6 2.2.