Dossier-Pedagogique-GAUGUIN.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

2020) Gauguin and Van Gogh Meet the Ninth Art. Euro- Pean Comic Art, 13 (1
Screech, Matthew (2020) Gauguin and Van Gogh Meet the Ninth Art. Euro- pean Comic Art, 13 (1). pp. 21-44. ISSN 1754-3797 Downloaded from: https://e-space.mmu.ac.uk/625715/ Version: Accepted Version Publisher: Berghahn Books DOI: https://doi.org/10.3167/eca.2020.130103 Please cite the published version https://e-space.mmu.ac.uk Gauguin and Van Gogh Meet the Ninth Art Postmodernism and Myths about Great Artists Matthew Screech Abstract This article analyses how a late twentieth-century/early twenty-first- century development in bandes dessinées, which combines historical novels with bi- ographies, expresses paradoxical attitudes towards mythologies surround- ing Paul Gauguin and Vincent Van Gogh. Firstly, I demonstrate that the paradox stems from a simultaneous desire for and suspicion of master narratives, identified as intrinsic to postmodernism by Linda Hutcheon. Then I establish how eight graphic novels perpetuate pre-existing mytho- logical master narratives about Gauguin and Van Gogh. Nevertheless, those mythologies simultaneously arouse scepticism: myths do not express ex- emplary uni versal truths; myths are artificial and fictionalised constructs whose status in reality is dubious. The albums convey tension between desire and suspicion regarding myths by a variety of devices. These include sequenced panels, circular plots, unreliable witnesses, fictional insertions, parodies and mock realism. Keywords: Gauguin, graphic novels, great artists, Linda Hutcheon, mythology, postmodernism, Van Gogh Over the period spanning 1990 to 2016 -

Paul Gauguin 8 February to 28 June 2015
Media Release Paul Gauguin 8 February to 28 June 2015 With Paul Gauguin (1848-1903), the Fondation Beyeler presents one of the most important and fascinating artists in history. As one of the great European cultural highlights in the year 2015, the exhibition at the Fondation Beyeler brings together over fifty masterpieces by Gauguin from leading international museums and private collections. This is the most dazzling exhibition of masterpieces by this exceptional, groundbreaking French artist that has been held in Switzerland for sixty years; the last major retrospective in neighbouring countries dates back around ten years. Over six years in the making, the show is the most elaborate exhibition project in the Fondation Beyeler’s history. The museum is consequently expecting a record number of visitors. The exhibition features Gauguin’s multifaceted self-portraits as well as the visionary, spiritual paintings from his time in Brittany, but it mainly focuses on the world-famous paintings he created in Tahiti. In them, the artist celebrates his ideal of an unspoilt exotic world, harmoniously combining nature and culture, mysticism and eroticism, dream and reality. In addition to paintings, the exhibition includes a selection of Gauguin’s enigmatic sculptures that evoke the art of the South Seas that had by then already largely vanished. There is no art museum in the world exclusively devoted to Gauguin’s work, so the precious loans come from 13 countries: Switzerland, Germany, France, Spain, Belgium, Great Britain (England and Scotland), -

Belonging Beyond Borders: Cosmopolitan Affiliations in Contemporary Spanish American Literature
University of Calgary PRISM: University of Calgary's Digital Repository University of Calgary Press University of Calgary Press Open Access Books 2021-01 Belonging Beyond Borders: Cosmopolitan Affiliations in Contemporary Spanish American Literature Bilodeau, Annik University of Calgary Press Bilodeau, A. (2021). Belonging Beyond Borders: Cosmopolitan Affiliations in Contemporary Spanish American Literature. University of Calgary Press, Calgary, AB. pp. 1-267. http://hdl.handle.net/1880/113029 book https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 Downloaded from PRISM: https://prism.ucalgary.ca BELONGING BEYOND BORDERS: Cosmopolitan Affiliations in Contemporary Spanish American Literature Annik Bilodeau ISBN 978-1-77385-159-4 THIS BOOK IS AN OPEN ACCESS E-BOOK. It is an electronic version of a book that can be purchased in physical form through any bookseller or on-line retailer, or from our distributors. Please support this open access publication by requesting that your university purchase a print copy of this book, or by purchasing a copy yourself. If you have any questions, please contact us at [email protected] Cover Art: The artwork on the cover of this book is not open access and falls under traditional copyright provisions; it cannot be reproduced in any way without written permission of the artists and their agents. The cover can be displayed as a complete cover image for the purposes of publicizing this work, but the artwork cannot be extracted from the context of the cover of this specific work without breaching the artist’s copyright. COPYRIGHT NOTICE: This open-access work is published under a Creative Commons licence. -

Paul Gauguin L'aventurier Des Arts
PAUL GAUGUIN L’Aventurier des arts Texte Géraldine PUIREUX lu par Julien ALLOUF translated by Marguerite STORM read by Stephanie MATARD © Éditions Thélème, Paris, 2020 CONTENTS SOMMAIRE 6 6 1848-1903 L’apostrophe du maître de la pose et de la prose 1848-1903 The master of pose and prose salute 1848-1864 Une mythologie familiale fondatrice d’un charisme personnel 1848-1864 Family mythology generating personal charisma 1865-1871 Un jeune marin du bout du monde 1865-1871 A far-flung young sailor 1872-1874 L’agent de change donnant le change en société devient très artiste 1872-1874 The stockbroker becomes a code-broker artist 8 8 1874-1886 Tirer son épingle du jeu avec les Impressionnistes 1874-1886 Playing ball with the Impressionists 1886-1887 Le chef de file de l’École de Pont-Aven 1886-1887 The leader of the Pont-Aven School 1887-1888 L’aventure au Panama et la révélation de la Martinique 1887-1888 Adventure in Panama and a revelation in Martinique 1888-1889 L’atelier du Midi à Arles chez van Gogh : un séjour à pinceaux tirés 1888-1889 Van Gogh’s atelier du Midi in Arles: a stay hammered with paintbrushes 1889-1890 Vivre et s’exposer, avec ou sans étiquette, avec ou sans les autres 1889-1890 Living and exhibiting, with or without label, with or without others 46 46 1891-1892 Un dandy tiré à quatre épingles, itinérant et sauvage 1891-1892 A wild, dressed-to-the-teeth travelling dandy 1893-1894 En peignant la Javanaise : Coup de Jarnac à Concarneau 1893-1894 Painting Javanaise Woman: Jarnac blow in Concarneau 1895 Le retour à Pont-Aven -

Gentse · Bijdragen ·- Tot De Kunstgeschiedenis En Oudheidkunde
GENTSE · BIJDRAGEN ·- TOT DE KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE XXVII (1988) UITGEGEVEN DOOR DE SECTIE KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN DE RIJKSUNIVERSITEIT T E GENT MET DE STEUN VAN HET UN IVERSITEITSVERMOGEN GENT 1988 F GENTSE BIJDRAGEN TOT DE KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE EDITORlAL ADDRESS e.o. Joost Vander Auwera Secretary of the Editorial Board St.-Hubertusstraat 2, B-9000 Gent DISTRIBUTION up to vol. 26: idem from vol. 27 onwards: PEETERS PRESS- P.B. 41 - B-3000 LOUVAIN All rights reserved. No part of this pub/ication may be reproduced, slored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, e/ectronic, mechanica/ photocopying, recording, or otherwise, without the prior permission of the Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Sectie Kunst geschiedenis en Oudheidkunde. Copyright: © Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Sectie Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde Wettelijk depot: D. 1989/0634/8 ISSN: 0772-7151 GENTSE BIJDRAGEN TOT DE KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE . 4 XXVII (1988) UITGEGEVEN DOOR DE SECTIE KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN DE RIJKSUNIVERSITEIT TE GENT MET DE STEUN VAN HET UNIVERSITEITSVERMOGEN GENT 1988 INHOUDSTAFEL H. F. MusscHE, Holzwege im Laureion Patriek MoNSIEUR, Het Herakteion van Thasos: Een evaluatie van het onderzoek . 8 F.J. DE HEN, Tohu Ubohu en Genesis van de muziekinstrumenten tijdens de middeleeuwen . 21 Juliaan H.A. DE RIDDER, Villard de Honnecourt en de Kabbala . 31 Frieda VAN TYGHEM - Jean VAN CLEVEN, Het kasteel van Moregem bij Oudenaarde ( 1792-1798). Een merkwaardig ensemble uit de 'Direc- toire '-tijd . 39 Sibylle VALCKE, François-Joseph Navez et les peintres primitifs 79 Anthony DEMEY, Een blik in het archief van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen: Henri Geirnaerf en de kerk van Eksaarde 88 Francisca VANDEPITTE, Het exotisme bij Gauguin . -

The Marquesas
© Lonely Planet Publications 199 The Marquesas Grand, brooding, powerful and charismatic. That pretty much sums up the Marquesas. Here, nature’s fingers have dug deep grooves and fluted sharp edges, sculpting intricate jewels that jut up dramatically from the cobalt blue ocean. Waterfalls taller than skyscrapers trickle down vertical canyons; the ocean thrashes towering sea cliffs; sharp basalt pinnacles project from emerald forests; amphitheatre-like valleys cloaked in greenery are reminiscent of the Raiders of the Lost Ark; and scalloped bays are blanketed with desert arcs of white or black sand. This art gallery is all outdoors. Some of the most inspirational hikes and rides in French Polynesia are found here, allowing walkers and horseback riders the opportunity to explore Nuku Hiva’s convoluted hinterland. Those who want to get wet can snorkel with melon- headed whales or dive along the craggy shores of Hiva Oa and Tahuata. Bird-watchers can be kept occupied for days, too. Don’t expect sweeping bone-white beaches, tranquil turquoise lagoons, swanky resorts and THE MARQUESAS Cancun-style nightlife – the Marquesas are not a beach holiday destination. With only a smat- tering of pensions (guesthouses) and just two hotels, they’re rather an ecotourism dream. In everything from cuisine and dances to language and crafts, the Marquesas do feel different from the rest of French Polynesia, and that’s part of their appeal. Despite the trap- pings of Western influence (read: mobile phones), their cultural uniqueness is overwhelming. They also make for a mind-boggling open-air museum, with plenty of sites dating from pre-European times, all shrouded with a palpable historical aura. -

PAUL GAUGUIN (Paris 1848 - 1903 Hiva Oa)
PAUL GAUGUIN (Paris 1848 - 1903 Hiva Oa) Mask of a Savage Patinated plaster 9 7/8 x 7 3/4 inches (250 x 195 mm) Executed between 1893-1897 PROVENANCE: Vollard Collection, Paris, France John Rewald 1957-58 The Phillips Family Collection Dr. Joachim Theye, Zurich Private Collection, Switzerland EXHIBITED: Washington, D.C., National Gallery of Art, The Art of Paul Gauguin, 1 May – 31 July 1988; Chicago, Art Institute of Chicago, 17 September – 11 December 1988; Paris, Grand Palais, 10 January – 10 April 1989, illustrated catalogue no. 210 Dallas, Dallas Museum of Art, on extended loan, 1991 – 1994 Baltimore, The Walters Art Gallery, Gauguin and the School of Pont-Aven, 20 November 1994 – 15 January 1995, illustrated in addendum Boston, Museum of Fine Arts, 1995 Williamston, Massachusetts, Sterling and Francine Clark Art Institute, on extended loan 1997 – 1998 Martigny, Switzerland, Fondation Pierre Gianadda, Gauguin, 10 June – 22 November 1998, illustrated, catalogue no. 117 London, England, Ordovas, Tales of Paradise Gauguin, 4 February – 18 April 2014, illustrated p. 60 Riehen/Basel, Switzerland, Fondation Beyeler, Paul Gauguin, 8 February – 28 June 2015 As were many symbolist artists, Gauguin was fascinated by the idea of a disembodied face or mask.1 In 1893, at the very end of his first trip to Tahiti, Gauguin developed the essential characteristics of our mask in Hina Te Fatou (Fig. 1), now in the Museum of Modern Art, New York. It is interesting to note that Degas purchased this painting from the Paris exhibition of Gauguin’s work held at the Galerie Durand-Ruel in the autumn of 1893. -

Paula Soriano Solana Grau En Disseny Curs: 2019/2020 Tutora: Mireia Feliu Fabra
ZEITGEIST Paula Soriano Solana Grau en Disseny Curs: 2019/2020 Tutora: Mireia Feliu Fabra 1 Als meus pares, per l’amor, confiança, esforç i dedicació; al Rubén per ser el meu company; a la tata, per estar sempre; i a l’Oriol, per la constància i talent. 2 3 Paula Soriano Solana Zeitgeist ABSTRACT 00 6 INTRODUCCIÓ 01 8 MOTIVACIÓ 01.1 9 59 OBJECTIUS 01.2 10 CONCLUSIONS 03 METODOLOGIA 01.3 11 FORMALITZACIÓ 04 61 RECERCA CONCEPTUAL 02 14 EL MITE D’EKHÓ 04.1 62 INTRODUCCIÓ AL POST IMPRESSIONISME 02.1 15 ESCENOGRAFIA I ATREZZO 04.2 63 AUTORS POST IMPRESSIONISTES 02.2 16 MAKING OF 04.3 64 Paul Gauguin 02.2.1 17 66 Paul Cézzane 02.2.2 BIBLIOGRAFIA 05 25 Vincent Van Gogh 02.2.3 28 Conclusions 02.2.4 DIRECCIÓ D’ART 02.3 34 ANÀLISI DE REFERENTS 02.4 48 4 5 Grau en Disseny 2019-2020 Paula Soriano Solana Zeitgeist Paula Soriano Solana Zeitgeist 00.1 Abstract (es) Con la intención de intención de investigar qué función tiene la dirección de arte en el cine y qué posibilidades tiene, se ha 00 Abstract creado el proyecto Zeitgeist, una obra autobiográfica que explica la situación de una persona con inquietudes creativas que se tiene que adaptar a una situación totalmente nueva para él; un confinamiento en casa. Zeitgeist extrae el proceso creativo propio de los artistas que se los engloba dentro del postimpresionismo, el cual se tra- Amb la intenció d’investigar quina funció té la direcció d’art en el cinema i quines possibilitats engloba, s’ha creat el projecte duce finalmente en un cortometraje con gran interés simbólico y estético. -
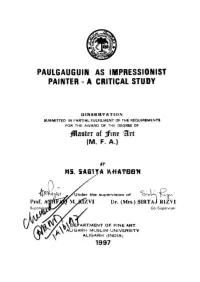
Mnittv of Fmt ^Rt (M
PAULGAUGUIN AS IMPRESSIONIST PAINTER - A CRITICAL STUDY DISSERTATION SUBMITTED IN PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUIRIMENTS FOR THE AWARD OF THE DEGREE OF Mnittv of fmt ^rt (M. F. A.) BT MS. SAB1YA K4iATQQTI Under the supervision of 0^v\o-vO^V\CM ' r^^'JfJCA'-I ^ M.JtfzVl Dr. (Mrs.) SIRTAJ RIZVl Co-Supervisor PARTMENT OF FINE ART IGARH MUSLIM UNIVERSITY ALIGARH (INDIA) 1997 DS2890 ^^ -2-S^ 0 % ^eAtcMed to ^ff ^urents CHAIRMAN ALiGARH MUSLIM UNIVERSITY DEPARTMENT OF FINE ARTS ALIGARH—202 002 (U.P.). INDIA Dated. TO WHOM IT BIAY CONCERN This is to certify that Miss Sabiya Khatoon of Master of Fine Arts (M.F.A.) has completed her dissertation entitled "PAOL GAUGUIN AS IMPRESSIONIST PAINTER - A CRITICAL STUDY", under the supervision of Prof. Ashfaq M. Rizvi and Co-Supervision Dr. (Mrs.) Sirtaj Rizvi, Reader, Department of Fine Arts. To the best of my knowledge and belief, the work is based on the investigations made, data collected and analysed by her and it has not been submitted in any other University or Institution for any Degree. 15th MAY, 1997 ( B4RS. SEEMA JAVED ) ALIGARH CHAIRMAN PHONES—OFF. : 400920,400921,400937 Extn. 368 RES. : (0571) 402399 TELEX : 564—230 AMU IN FAX ; 91—0571—400528 CONTENTS PAGE ND. ACKNOWLEDGEMENT 1. INTRODUCTION 1-19 2. LIFE SKETCH OF PAUL 20-27 GAUGUIN 3. WORK AND STYLE 28-40 4. INFLUENCE OF PAUL 41-57 GAUGUIN OWN MY WORK 5. CONCLUSION ss-eo INDEX OF PHOTOGRAPHS BIBLIOGRAPHY ACKNOWLEDGEMENT I immensely obliged to my Supervisor Prof. Ashfaq Rizvi whose able guidance and esteemed patronage the dissertation would be given final finishing. -

Paul GAUGUIN IA ORANA MARIA
Paul GAUGUIN IA ORANA MARIA Gauguin traite un thème religieux à la mode tahitienne dans cette scène qui rappelle les estampes japonaises... · En février l 891, avant le départ de Gauguin Paul GAUGUIN 1848-1903 pour Tahiti, une vente de ses œuvres est orga • Ja Orana Maria nisée à l'hôtel Drouot. Les trente tableaux ven • Huile sur toile 113,5 cm x 87,5 cm dus rapportent trois mille six cents francs. • Signé «P. Gauguin 91 » Parmi les acquéreurs figurent Degas, Mon • Peint en 1891 freid, de Bellio, Manzi ~t les Natanson. • Localisation : New York, Metropolitan A la même éP<?que, L'Echo de Paris salue en Museum of Art Gauguin « un des artistes les plus personnels ·et les plus troublants notre ». , de époq~e ~n~ verte de fruits symbolise l'opulence de la na semaine plus tard, dans Le Moderniste, 1ecn ture. Au second plan, deux jeunes ~illes_ v_êtues _ vain et critique Albert Aurier met en évidence d'un paréo semblent prier, les marns 1orntes. le rôle joué par le peintre dans la création du La végétation à l'arrière-plan est restituée dans symbolisme. , un style décoratif qui rappelle l'art j a~nais : Trois mois après un banquet donne en son des arbres fleuris alternent avec un palmier se honneur au café Voltaire, Gauguin embarque détachant.sur les contours d'une montagne. pour Tahiti. Dès son arrivée, il attire l'attention Gauguin utilise des couleurs vives, qui âon avec ses cheveux sur les épaules et son cha nent un éclat indéniable à cette œuvre. Plus peau de cow-boy. -

L-G-0000349753-0002315416.Pdf
Gauguin Page 4: Self-Portrait with a Palette, c.1894 oil on canvas, 92 x 73 cm Private Collection Designed by: Baseline Co. Ltd, 61A-63A Vo Van Tan Street 4th Floor District 3, Ho Chi Minh City Vietnam ISBN 978-1-78042-211-4 © Parkstone International © Confidential Concepts, worldwide, New York, USA All rights reserved No part of this publication may be reproduced or adapted without the permission of the copyright holder, throughout the world. Unless otherwise specified, copyrights on the works reproduced lies with the respective photographers. Despite intensive research, it has not always been possible to establish copyright ownership. Where this is the case we would appreciate notification 2 “In art, one idea is as good as another. If one takes the idea of trembling, for instance, all of a sudden most art starts to tremble. Michelangelo starts to tremble. El Greco starts to tremble. All the Impressionists start to tremble.” – Paul Gauguin 3 Biography 1848 Paul Gauguin born in Paris, on June 7. 1849 The family left France for Peru; his father died at sea. 1855–1861 Returned to France after a five-year stay in Lima. Lived in Orleans, his father’s native town. Studied at the Petit Seminaire. 1861(?)–1865 Moved with his mother to Paris. Attended high school. 1865 Entered the merchant marine as a cabin-boy. 1868–1871 Served in the navy after the disbandment of the French army and navy settled in Paris. 1871–1873 Worked as a stockbrocker in the banking office of Bertin. In the house of his sister’s guardian, Gustave Arosa, began to take interest in art. -

La Vie Prodigieuse De Gauguin
LA VIE PRODIGIEUSE DE GAUGUIN Paul Gauguin, Autoportrait à Charles Morice, 1891, toile. DU MÊME AUTEUR (Chez d'autres Éditeurs) LES PRIMITIFS NIÇOIS, 129 Reproductions. LA PEINTURE AU PALAIS DE MONACO, sous le Patronage de D.A.S. le PRINCE LOUIS II. INGRES. CLAUDE MONET, avec la collaboration de Blanche Monet. VINCENT VAN GOGH. GAUGUIN, les Documents d'Art, Monaco. MAURICE HENSEL, Tahiti et Montmartre, 12 aquarelles. GAUGUIN, LE PEINTRE ET SON ŒUVRE, avant-propos de Pola Gauguin, Presses de la Cité, édition anglaise James Replay. CLOÎTRES ET ABBAYES DE FRANCE, éditions du Louvre. LETTRES DE GAUGUIN A SA FEMME ET A SES AMIS, Bernard Grasset. Traductions : anglaise, américaine, suédoise, allemande, italienne et japonaise. MATISSE. DESSINS, avec la collaboration de l'artiste. GAUGUIN, Génies et Réalités, Hachette, 1961. (Chapitre IV, L'Homme qui a réinventé la Peinture); réédition, Chêne- Hachette, 1986. AUX ÉDITIONS BUCHET/CHASTEL Dans la Collection « Grandes Biographies » MALCOLM LOWRY, Douglas Day. HENRY MILLER, Jay Martin. CÉLINE, Erika Ostrovsky. MALRAUX, Robert Payne. HITLER, Robert Payne. COCTEAU, Francis Steegmuller. HENRY MILLER, Norman Mailer. Hors collection PICASSO, Joseph Chiari CRÉSUS, Claude Kevers-Pascalis LE DUC DE LAUZUN, Clément Velay D.H. LAWRENCE, Henry Miller MAURICE MALINGUE LA VIE PRODIGIEUSE DE GAUGUIN ÉDITIONS BUCHET/CHASTEL 18, rue de Condé - 75006 PARIS Si cet ouvrage vous a intéressé, il vous suffira d'adresser votre carte de visite aux ÉDITIONS BUCHET/CHASTEL, 18, rue de Condé, 75006 PARIS, pour rece- voir gratuitement nos bulletins illustrés par lesquels vous serez informé de nos dernières publications. © 1987 ÉDITIONS BUCHET/CHASTEL, Paris. Tous droits de reproduction, de traduction et d'adaptation réservés pour tous pays, l'U.R.S.S.