La Conquete De La Lune
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

China's Human Spaceflight Program : Achievemenfs And
China's Human Spaceflight Program : Achievemenfs and The Newest Member of the EVA Club z Milestones in Space Capability China Russia United States Satell¡te Launch 1 970 1 957 1 958 Human Launch 2003 1 961 1 962 2-man crew 2005 N/A 1 965 3-man crew 2008 1 964 1 968 Space walldEVA 2008 (14 min.) 1965 (24 min.) 1965 (20 min.) Space Laboratory ? 1971 (Salyut 1) 1s73 (Skylab) Circum-lunar flight ? ? 1968 (Apollo 8) Orion-Shenzhou-Soyuz Comparison Shenzhou is an upgraded version of the proven design of the Russian Soyuz vehicle - Shffzhd is -95+o/. ind¡gênously developed ild produced - Shszhd ¡s '13% lagêr than Soyuz - Mod¡fications to land¡ng, abort, and rænty systems Future Shenzhou missions influenced by or will utilize evolved Russ¡an designs & products - Spæe suits (EVA) - KUFS & APAS (rsndezvous arìd dock¡ng system) lmplication: Shenzhou likely compatiblø with ISS Tolål l¡¿æ - kg 6.8{Xt75m 7,840 -f6,8{þ Lenglh . m 7.ß 925 -10.m D¡amtq - m 2.t2 2,AO -5.(x) Swi€ lrodul€ M¡c- kg 2dxF2,950 3,(x)O -0,3û) Prcpêllânt ll¡æ - kg 9(X) 1,000 -3.6(x) Sdi@ lrodule L.ngth - kg 2,5 2.94 -6.m Cw Modulè M¡æ- kg 42004,300 4,760 -8,5ü) Shenzhou: Larger Cr{ Module Lênglh - m 4.50 4.86 -3.60 13'" 2 Preliminary NASA-CNSA Discussions NASA Administrator Sean O'Keefe meets with CNSA delegation in December 2004 - Sun Laiyan, Administrator of China National Space Administrator - Space applications, Earth science and space science NASA Administrator Mike Griffin Visits China in September 2006 - Discussion of regular exchanges NASA team visits CNSA in July 2008 - Formation of two working groups on Earth and space science Dependent on the broader U.S.- China relationship Ð- I - Missile sanctions on Great Wall lndustry lifted by Treasury in 2008 Chinese Human Spaceflight Capabilities . -
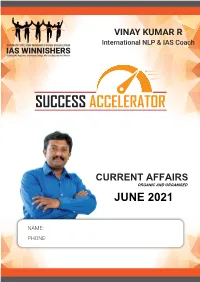
June 2021 2019
CURRENT AFFAIRS ORGANIC AND ORGANISED DECEMBERJUNE 2021 2019 A LETTER FROM MY HEART Dear IAS Aspirant Friends, It gives me immense pleasure to present to you the 360º Current Affairs Magazine for the month of June 2021. The dedicated team that compiles and edits Current Affairs at IAS WINNISHERS has made sincere efforts to provide to you the most relevant and important news from the point of view of Interview, Mains and especially the soon approaching Prelims. Our mission is to build IAS aspirants into human beings who can become IAS officers. In that direction, we strive to facilitate the current affairs knowledge that is ORGANIC and ORGANISED. Due to the ongoing unfortunate situation, we fully empathize with your anxiety related to the exam. This compilation aids you in your preparation, especially the soon approaching Prelims exam. This issue also carries information on INTERVIEW GUIDANCE PROGRAM conducted by IAS WINNISHERS, which has produced amazing results in the past. Get more information on our website and benefit immensely from it. Wishing You Success Vinay Kumar R Founder & CEO, IAS WINNISHERS Vinay Kumar R International NLP & IAS Coach 9036113902 | 9886273325 www.iaswinnishers.com © Winnishers Educational Services Pvt Ltd © Winnishers Educational Services Pvt Ltd 1 Contents 1. POLITY & CONSTITUTION ............................................................................................................ 8 1.1.LAST ‘D-VOTER’ WALKS OUT OF ASSAM DETENTION CENTRE ................................................................ -

China on Track with Its Extraterrestrial Mission
OPINION: GIST OF PEOPLE’S DEMOCRACY P.24 | FEATURES: GREATER IPR PROTECTION P.36 VOL.64 NO.19 MAY 13, 2021 WWW.BJREVIEW.COM SPACE TREK RMB6.00 China on track with its USD1.70 AUD3.00 GBP1.20 extraterrestrial mission CAD2.60 CHF2.60 )/$ЮፑʶѮՁὙڍJPY188 ᥪԦ̼Ձe COVER STORY $127+(5 *,$17/($3 A new chapter in extraterrestrial exploration opens with the launch of the ‘control room’ of China’s space station By Li Qing 12 BEIJING REVIEW MAY 13, 2021 http://www.bjreview.com t 11:23 a.m. on April 29, The second stage was to test key tech- a rocket blasted off from nologies needed for a permanent space the Wenchang Spacecraft station, including extra-vehicular activities Launch Site in Hainan and orbital docking. In 2008, fighter pilot Province, carrying the core Zhai Zhigang ventured out of the Earth- $section of China’s space station. orbiting Shenzhou-7 spacecraft and walked After traveling a little over eight minutes LQVSDFHEHFRPLQJ&KLQD·VÀUVWWDLNRQDXWWR on the domestically developed Long March- leave a “footprint in the universe.” 5B Y2 rocket, the module, named Tianhe, To amass more experience for develop- which means harmony of the heavens, sepa- ing a space station, an experimental space rated from the rocket and entered into orbit. lab, Tiangong-1, was lifted up in 2011 to A key step in the construction of the space test the technologies for rendezvous and station that is expected to be completed next docking between spacecraft. A month later, year, Tianhe will act as the management and Shenzhou-8 entered into orbit and accom- control hub of the station as well as a node plished the first automatic rendezvous and for docking with other spacecraft, up to docking with Tiangong-1. -

Nº De Aluna: 26055 CHINA's SPACE PROGRAM: a NEW TOOL FOR
Nº de Aluna: 26055 CHINA’S SPACE PROGRAM: A NEW TOOL FOR PRC “SOFT POWER” IN INTERNATIONAL RELATIONS? MARA IMRAN ___________________________________________________ MASTER DISSERTATION Supervisor: Dr. Tiago Moreira de Sá SEPTEMBER 2010 DECLARATION I declare that this thesis is the result of my independent and personal research. Its content is original and all sources consulted are duly mentioned in the text, notes and bibliography. The candidate, ____________________ Lisbon, .... of ............... of ............... I declare that this thesis is able to be submitted to public examination. The supervisor, ____________________ Lisbon, .... of ............... of .............. i Personal Dedication In the name of God Almighty, most gracious and most merciful, who blessed me with the wisdom and knowledge to accomplish my goal. I dedicate this work to my dear husband, Dr. Tayyab Imran who encouraged me in my desire and determination to enhance my knowledge. I could not have completed this journey without him. He inspired, motivated, and challenged me in every step of life since I married, especially for believing in me. Also, I would like to dedicate my work to my baby who is soon to arrive in this world. ii ACKNOWLEDGMENTS It is with great pleasure that I thank the many people who made my education and this thesis possible. It has been a fantastic experience for me, as a person from Romania, to study and live for two years in Portugal. My life has become much more enriched by this experience. I have established friendship with many nice people and as a student I got the chance to learn a lot about Portuguese culture and history. -

Afghan Advertisements
MONDAY-JUNE 28, 2021 Miscellaneous 07 China is readying Shenzhou 13 spacecraft Afghan Advertisements in case of space station emergency AA 887 INVITATION FOR BIDS (IFB) INTERNATIONAL COMPETITIVE BIDDING (ICB) China may have successfully "Shenzhou 12 is docked on orbit. foot-long (10 meters) robotic arm sent its first astronauts to its new the space station. Because of Tianhe provides living quar- and test new regenerative life sup- Procurement Entities NPA on behalf of Afghanistan Nuclear Energy Agency, Islamic Republic space station module this month, space debris or various reasons, ters for the crew and propulsion port systems. of Afghanistan. but back on the ground authori- the Shenzhou 12 spacecraft may for the space station. It has a rear If there are no emergencies, ties are still readying a new rocket be at risk when it returns. Then docking port and a forward dock- Shenzhou 13 will launch as Funded By Government of Islamic Republic of Afghanistan in case of emergency. we could launch Shenzhou 13 in ing hub that will allow two more planned around October. Tian- Three Chinese astronauts the shortest time," Shao Limin, modules to connect and other zhou 3, a supply mission, is ex- Item Description Procurement of chemical and biological materials launched to Tianhe, the country's deputy technological manager of spacecraft to visit. pected to fly in September in Lab Equipment for AENA first space station module, on the the Shenzhou 12 spacecraft, told That means, unlike China's preparation for the arrival of the Shenzhou 12 mission on June 17. China's CCTV media. -

Rad-Bio-App: a Discovery Environment for Biologists to Explore Spaceflight-Related Radiation Exposures ✉ ✉ Richard Barker 1 , Sylvain V
www.nature.com/npjmgrav COMMENT OPEN Rad-Bio-App: a discovery environment for biologists to explore spaceflight-related radiation exposures ✉ ✉ Richard Barker 1 , Sylvain V. Costes 2, Jack Miller3,4, Samrawit G. Gebre4, Jonathan Lombardino5 and Simon Gilroy 1 In addition to microgravity, spaceflight simultaneously exposes biology to a suite of other stimuli. For example, in space, organisms experience ionizing radiation environments that significantly differ in both quality and quantity from those normally experienced on Earth. However, data on radiation exposure during space missions is often complex to access and to understand, limiting progress towards defining how radiation affects organisms against the unique background of spaceflight. To help address this challenge, we have developed the Rad-Bio-App. This web-accessible database imports radiation metadata from experiments archived in NASA’s GeneLab data repository, and then allows the user to explore these experiments both in the context of their radiation exposure and through their other metadata and results. Rad-Bio-App provides an easy-to-use, graphically-driven environment to enable both radiation biologists and non-specialist researchers to visualize, and understand the impact of ionizing radiation on various biological systems in the context of spaceflight. npj Microgravity (2021) 7:15 ; https://doi.org/10.1038/s41526-021-00143-x 1234567890():,; INTRODUCTION receive ~360 mGy absorbed dose, much of it from highly ionizing 4,5 The space environment introduces organisms to a unique range of galactic cosmic ray (GCR) ions . This is similar to several decades challenges. For example, for humans the closed environment of of absorbed background dose on Earth, but as noted, from a very space vehicles alongside enforced confinement, and the isolation different spectrum of radiation and delivered at a very different inherent in the vast distances traveled all have important impacts dose rate. -

The Taikonaut As Icon: the Cultural and Political Significance of Yang Liwei, China’S First Space Traveler
The TAIKONAUT as Icon: The Cultural and Political 103 Significance of Yang Liwei, China’s First Space Traveler CHAPTER 7 The TAIKONAUT as Icon: the Cultural and Political Significance of Yang Liwei, China’s First Space Traveler James R. Hansen n 2005 the government of the People’s Republic of China (PRC) sponsored the Idevelopment of a new video game featuring heroes from Chinese history.The plan was to wean Chinese young people off their growing addiction to Western video games and replace it with something appropriate to Chinese values. Unlike American video games in which players slay dragons, fight aliens, beat up bad guys (or, more likely, be the bad guys themselves), in the new game “chinese Heroes” players click on icons of select Chinese heroes to learn about their noble experiences and carry out healthy and constructive tasks like moving bricks and darning socks. An official with china’s General Administration of Press and Publication, which sponsored the game’s development by a Shanghai gaming company,hoped the game “will teach players about Chinese ethics.”1 Five heroes are featured in the video game: • Bao Zheng: an eleventh century statesman renowned for his battle against government corruption, strong sense of fair play, ability to tell truth from falsehood, and determination to mete out justice without fear or favor; • Yue Fei, a twelfth century general who, with only 800 soldiers, defeated an invading army 500,000-strong.Before he left home to join the army at age 18, his mother allegedly tattooed four characters on his back which meant “Serve the country loyally,” a constant reminder to protect China at all costs; • Zheng He, the eunuch admiral of the Ming dynasty whose “treasure ships” sailed across the Indian Ocean to Africa in the early fifteenth century; 1. -

China's Navigation in Space
copyright © 2012, Proceedings, u.S. naval institute, Annapolis, Maryland (410) 268-6110 www.usni.org China’s Navigation in SpaceBy Andrew Erickson and Amy Chang What new approaches will China’s space tracking take? he People’s Republic of China’s dencies and liabilities. The program appears “Long View” space-tracking and at a crossroads, with the development of ad- telemetry system enhances space ditional overseas ground stations a tempting situational awareness and operations alternative. How Beijing proceeds will shape Twhile offering military potential. Yet this sea- its capabilities critically; the United States based approach suffers from inherent depen- should monitor related developments closely. AP Photo (Vincent Yu) A fundamental element of the Chinese space program, space-tracking Yuanwang vessels provide ship-based C4ISR and can also track infor- mation and guidance for foreign satellite data. Here, the Yuanwang 6 docks in Hong Kong after tracking and remotely controlling the Shen- zhou 7 spacecraft in 2008. 42 • April 2012 www.usni.org China relies on space-event support ships far Russia today operates only the Akademik Sergei more than does any other power today—its fleet Korolev, and France the Monge. No other country is rivaled only by that of the United States. But maintains a significant presence in this field. in contrast to the United States, Russia, and other modern global military powers, a regionally fo- Birth of a Space-Tracking Program cused China has no overseas military bases and First conceived in 1965 by Premier Zhou Enlai, only limited space and domestic ground-based Beijing’s concept for space-tracking ships was assets on which to rely. -

Spacewatchafrica March 2021 Edition 3
Giraffe GPS satellite tracking project in Africa VVVolVolVolVol o6 o6 66l l. .No. NoNo. No79 N N 55 oo5.. 3 March 2018 2021 AFRICA SPECIAL EDITION The space industry in Nigeria 2021 2021 Africa leaps into A new leader and player i5Gn the ecosystemaerospace industry C O N T E N T S Vol.9 No. 3 The era of 5G network in Africa Giraffe GPS satellite tracking project in Africa Editor in-chief Aliyu Bello Expanding the boundaries of space insurance Executive Manager Tonia Gerrald Satellite based solutions fighting COVID-19 SA to the editor in-Chief Ngozi Okey Space against youth unemployment Head, Application Services M. Yakubu CONAE's leading women share experiences Editorial/ICT Services John Daniel working in the space industry Usman Bello Still on healthcare networks Alozie Nwankwo Singapore initiative makes progress in encouraging more young women Juliet Nnamdi to learn about engineering Client Relations Sunday Tache Industry players brace up as NCC Lookman Bello opens up Virtual Network market Safiya Thani Why digital inclusion matters Marketing Offy Pat Aiming for the stars with Europe's Tunde Nathaniel Ariane 6 launch vehicles Wasiu Olatunde 2021: Africa leaps into 5G ecosystem Media Relations Favour Madu Big data in the shipping industry Khadijat Yakubu What to do when GPS is compromised Zacheous Felicia The story of Chinese lunar mission Finance Folarin Tunde Defence industry 'must rise to the challenge' in 2021 The future progression of Space Watch Magazine is a publication of in-flight Wi-Fi market Communication Science, Inc. All correspondence should be addressed to editor, space Watch Magazine. -

Orbital-Hub DLR Vision 2025
DLR, July 2015 Orbital-Hub DLR Vision 2025 DLR Institute of Space Systems System Analysis Space Segment Bremen, July 2015 International Context Motivation for For decades the International Space Station ISS has demonstrated not only long-term New LEO-Platform Considerations international cooperation between 14 partner governments but also a significant engineering and programmatic achievement mostly as a compromise of budget, pol- All Space Station partners agree to utilise the orbital research facility until at least itics, administration and technological feasibility. Most ISS technologies are based on 2020. NASA, Roscosmos and CSA announced a desire to support the extension of the Mir and other previous experience. Due to high safety standards required for human ISS until 2024. Whether this is politically, technologically and financially feasible for spaceflight activities, these technologies are often conservative and new developments all partners is unknown. But still, there is a common understanding that a platform require patience and waiving ‘state-of-the-art’ technologies. A paradigm shift to more in LEO is a basic requirement for science, Earth observation and monitoring and even innovation and risk acceptance can be observed in the development of new markets potentially for the next steps to the Moon or Mars. If the current ISS seems to be too by shifting responsibilities to private entities and broadening research disciplines, expensive we have to think about ways to make it cheaper. In general, a transition demanding faster access by users and including new launcher1 and experiment facili- to a new concept without a critical loss of know-how amounts to 10 to 15 years. -
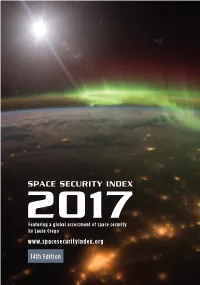
SPACE SECURITY INDEX 2017 Featuring a Global Assessment of Space Security by Laura Grego
SPACE SECURITY INDEX 2017 Featuring a global assessment of space security by Laura Grego www.spacesecurityindex.org 14th Edition SPACE SECURITY INDEX 2017 WWW.SPACESECURITYINDEX.ORG iii Library and Archives Canada Cataloguing in Publications Data Space Security Index 2017 ISBN: 978-1-927802-19-9 © 2017 SPACESECURITYINDEX.ORG Edited by Jessica West Design and layout by Creative Services, University of Waterloo, Waterloo, Ontario, Canada Cover image: NASA Astronaut Scott Kelly took this majestic image of the Earth at night, highlighting the green and red hues of the Aurora, 20 January 2016. Credit: NASA Printed in Canada Printer: Pandora Print Shop, Kitchener, Ontario First published September 2017 Please direct enquiries to: Project Ploughshares 140 Westmount Road North Waterloo, Ontario N2L 3G6 Canada Telephone: 519-888-6541 Email: [email protected] Governance Group Melissa de Zwart Research Unit for Military Law and Ethics The University of Adelaide Peter Hays Space Policy Institute, The George Washington University Ram Jakhu Institute of Air and Space Law, McGill University Cesar Jaramillo Project Ploughshares Paul Meyer The Simons Foundation Dale Stephens Research Unit for Military Law and Ethics The University of Adelaide Jinyuan Su School of Law, Xi’an Jiaotong University Project Manager Jessica West Project Ploughshares Table of Contents TABLE OF CONTENTS TABLE PAGE 1 Acronyms and Abbreviations PAGE 5 Introduction PAGE 9 Acknowledgements PAGE 11 Executive Summary PAGE 19 Theme 1: Condition and knowledge of the space environment: This theme examines the security and sustainability of the space environment, with an emphasis on space debris; the allocation of scarce space resources; the potential threats posed by near-Earth objects and space weather; and the ability to detect, track, identify, and catalog objects in outer space. -
![[Paper Number]](https://docslib.b-cdn.net/cover/5345/paper-number-5495345.webp)
[Paper Number]
SSC20-WP2-32 BAMMsat-on-BEXUS: A technology and operation demonstration of a bioCubeSat platform on a stratospheric balloon flight educational program A. Shamsul, G. Sinclair, A. Bolliand, A. Chabi, M. Martinez de Bujo, M. Zalasiewicz, D. C. Cullen Centre for Autonomous and Cyberphysical Systems Cranfield University College Road, Cranfield, Bedford, MK43 0AL, United Kingdom [email protected] M. Cooke, T. Etheridge Department of Sport and Health Science University of Exeter St. Lukes Campus, Exeter, EX1 2LU, United Kingdom [email protected] ABSTRACT This paper reports the current use of the REXUS/BEXUS educational program. The program allows university students across Europe to carry out scientific and technology experiments on research sounding rockets and balloons. BAMMsat-on-BEXUS (BoB) is an experiment from Cranfield University and University of Exeter performing a technology and operation demonstration of a bioCubeSat on a stratospheric balloon at an altitude of ~30km above the ground. BEXUS stands for Balloon Experiments for University Students and is realized under an agreement between the German Aerospace Centre (DLR), Swedish National Space Agency (SNSA), European Space Agency (ESA), and EuroLaunch. The term bioCubeSat could be used to refer to a nanosatellite in a CubeSat format with a biological experiment on-board. Over the last decade, a series of six bioCubeSats have been launched into orbit by NASA and a private company, SpacePharma, i.e., GeneSat, PharmaSat, O/OREOS, SporeSat, Dido-2, and EcAMSat. The BAMMsat concept (Bioscience, Astrobiology, Medicine and Material science on CubeSat) is a bioscience hardware platform which aims to advance the current state of the art technology, under development at Cranfield University, for application in LEO and beyond LEO.