Levin Kipnis
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
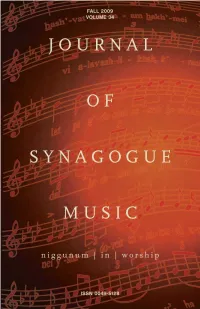
Transdenominational MA in Jewish Music Program, Preparing
THIS IS THE INSIDE FRONT COVER EDITOR: Joseph A. Levine ASSOCIATE EDITOR: Richard Berlin EDITORIAL BOARD Rona Black, Shoshana Brown, Geoffrey Goldberg, Charles Heller, Kimberly Komrad, Sheldon Levin, Laurence Loeb, Judy Meyersberg, Ruth Ross, Neil Schwartz, Anita Schubert, Sam Weiss, Yossi Zucker TheJournal of Synagogue Music is published annually by the Cantors As- sembly. It offers articles and music of broad interest to theh azzan and other Jewish professionals. Submissions of any length from 1,000 to 10,000 words will be consid ered. GUIDELINES FOR SUBMITTING MATERIAL All contributions and communications should be sent to the Editor, Dr. Joseph A. Levine—[email protected]—as a Word docu- ment, with a brief biography of the author appended. Musical and/or graphic material should be formatted and inserted within the Word document. Footnotes are used rather than endnotes, and should conform to the fol- lowing style: A - Abraham Idelsohn, Jewish Liturgy (New York: Henry Holt), 1932: 244. B - Samuel Rosenbaum, “Congregational Singing”; Proceedings of the Cantors Assembly Convention (New York: Jewish Theological Seminary), February 22, 1949: 9-11. Layout by Prose & Con Spirito, Inc., Cover design and Printing by Replica. © Copyright 2009 by the Cantors Assembly. ISSN 0449-5128 ii FROM THE EDITOR: The Issue of Niggunim in Worship: Too Much of a Good Thing? ..................................................4 THE NEO-HASIDIC REVIVAL AT 50 Music as a Spiritual Process in the Teachings of Rav Nahman of Bratslav Chani Haran Smith. 8 The Hasidic Niggun: Ethos and Melos of a Folk Liturgy Hanoch Avenary . 48 Carlebach, Neo-Hasidic Music and Liturgical Practice Sam Weiss. -

Honour List 2018 © International Board on Books for Young People (IBBY), 2018
HONOUR LIST 2018 © International Board on Books for Young People (IBBY), 2018 IBBY Secretariat Nonnenweg 12, Postfach CH-4009 Basel, Switzerland Tel. [int. +4161] 272 29 17 Fax [int. +4161] 272 27 57 E-mail: [email protected] http://www.ibby.org Book selection and documentation: IBBY National Sections Editors: Susan Dewhirst, Liz Page and Luzmaria Stauffenegger Design and Cover: Vischer Vettiger Hartmann, Basel Lithography: VVH, Basel Printing: China Children’s Press and Publication Group (CCPPG) Cover illustration: Motifs from nominated books (Nos. 16, 36, 54, 57, 73, 77, 81, 86, 102, www.ijb.de 104, 108, 109, 125 ) We wish to kindly thank the International Youth Library, Munich for their help with the Bibliographic data and subject headings, and the China Children’s Press and Publication Group for their generous sponsoring of the printing of this catalogue. IBBY Honour List 2018 IBBY Honour List 2018 The IBBY Honour List is a biennial selection of This activity is one of the most effective ways of We use standard British English for the spelling outstanding, recently published children’s books, furthering IBBY’s objective of encouraging inter- foreign names of people and places. Furthermore, honouring writers, illustrators and translators national understanding and cooperation through we have respected the way in which the nomi- from IBBY member countries. children’s literature. nees themselves spell their names in Latin letters. As a general rule, we have written published The 2018 Honour List comprises 191 nomina- An IBBY Honour List has been published every book titles in italics and, whenever possible, tions in 50 different languages from 61 countries. -

Mikan, Journal for Hebrew and Israeli Literature and Culture Studies
Mikan, Journal for Hebrew and Israeli Literature and Culture Studies Vol. 16, March 2016 מכון והמחלקה לספרות עברית, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב Editor: Hanna Soker-Schwager Editorial board: Tamar Alexander, Yitzhak Ben-Mordechai, Yigal Schwartz (Second Editor), Zahava Caspi (Third Editor) Junior editors: Chen Bar-Itzhak, Rina Jean Baroukh, Omer Bar Oz, Yael Ben- Zvi Morad, Tahel Frosh, Maayan Gelbard, Tami Israeli, Yaara Keren, Shachar Levanon, Itay Marienberg-Milikowsky,Rachel Mizrachi-Adam, Yonit Naaman, Yotam Popliker, Efrat Rabinovitz, Yoav Ronel, Tamar Setter. Editorial advisors: Robert Alter, Arnold J. Band, Dan Ben-Amos, Daniel Boyarin, Menachem Brinker, Nissim Calderon, Tova Cohen, Michael Gluzman (First Editor), Nili Scharf Gold, Benjamin Harshav, Galit Hasan-Rokem, Hannan Hever, Ariel Hirschfeld, Avraham Holtz, Avner Holtzman, Matti Huss, Zipporah Kagan, Ruth Kartun-Blum, Chana Kronfeld, Louis Landa, Dan Laor, Avidov Lipsker, Dan Miron, Gilead Morahg, Hannah Nave, Ilana Pardes, Iris Parush, Ilana Rosen, Tova Rosen, Yigal Schwartz, Uzi Shavit, Raymond Sheindlin, Eli Yassif, Gabriel Zoran Editorial coordinator: Irit Ronen, Maayn Gelbard Language editors: Liora Herzig (Hebrew); Daniella Blau (English) Graphic editor: Tamir Lahav-Radlmesser Layout and composition: Srit Rozenberg Cover photo: Disjointed Voices of Birds Behind the Water, 1994, Watercolor on Paper 16x25.4 Jumping FROM One Assuciation to Another, 2008, Black ink and Col on brown cardboard. 28.5x30.5 Hedva Harechavi IBSN: 978-965-566-000-0 All rights reserved © 2016 Heksherim Institute for Jewish and Israeli Literature and Culture, Ben Gurion University, Beer Sheva, and Kinneret, Zmora-Bitan, Dvir - Publishing House Ltd., Or Yehuda Printed in Israel www.kinbooks.co.il Contents Articles Avidov Lipsker and Lilah Nethanel - The Writing of Space in the Novels Circles and The Closed Gate by David Maletz Tamar Merin - The Purloined Poem: Lea Goldberg Corresponds with U. -

Odessa Soundscapes Одесса Мама Еврейская Музыка Mama of Odessa Одессы
Center for the Study of Cultures of Place in the מרכז לחקר המוסיקה היהודית Modern Jewish World JEWISH MUSIC RESEARCH CENTRE Supported by the I-CORE Program of the Planning and Budgeting Committee and The Israel Science Foundation (grant No 1798/12) אימא אודסה המוסיקה של אודסה Jewish היהודית Odessa Soundscapes Одесса Мама Еврейская Музыка Mama of Odessa Одессы Music of the Synagogue and the Jewish Street in Odessa at the Beginning of the 20th Century Sunday, 25 March 2018 Cantor Azi Schwartz (Park Avenue Synagogue, New York) Vira Lozinski - Yiddish and Russian songs The Chamber Choir of the Jerusalem Academy of Music and Dance Conductor: Stanley Sperber Piano and organ: Raymond Goldstein Da'at Hamakom - Center for the Study of Cultures of Place in the Modern Jewish World Jewish Music Research Centre - Faculty of the Humanities - The Hebrew University of Jerusalem In collaboration with Park Avenue Synagogue, New York Idea and production: Anat Rubinstein, Eliyahu Schleifer, Edwin Seroussi (Jewish Music Research Centre) Technical support and production coordination: Anat Reches (Da'at Hamakom), Sari Salis, Tali Schach (Jewish Music Research Centre) Production coordination for the Jerusalem Academy of Music and Dance: Chana Englard The Chamber Choir of the Jerusalem Academy of Music and Dance Conductor and musical manager: Stanley Sperber Assistant conductor: Taum Karni Musical adviser: Tami Kleinhaus Choir pianist: Irina Lunkevitch Choir manager: Maya Politzer Acting choir manager: Yif'at Shachar Choir members: Soprano Alto Tenor Bass Maria -

Download Liner Notes
Cover Art Helfman Helfman_LinerNts 9440.indd 1 12/5/05 1:03:47 PM A MESSAGE FROM THE MILKEN ARCHIVE FOUNDER Dispersed over the centuries to all corners of the earth, the Jewish people absorbed elements of its host cultures while, miraculously, maintaining its own. As many Jews reconnected in America, escaping persecution and seeking to take part in a visionary democratic society, their experiences found voice in their music. The sacred and secular body of work that has developed over the three centuries since Jews fi rst arrived on these shores provides a powerful means of expressing the multilayered saga of American Jewry. While much of this music had become a vital force in American and world culture, even more music of specifi cally Jewish content had been created, perhaps performed, and then lost to current and future generations. Believing that there was a unique opportunity to rediscover, preserve and transmit the collective memory contained within this music, I founded the Milken Archive of American Jewish Music in 1990. The passionate collaboration of many distinguished artists, ensembles and recording producers over the past fourteen years has created a vast repository of musical resources to educate, entertain and inspire people of all faiths and cultures. The Milken Archive of American Jewish Music is a living project; one that we hope will cultivate and nourish musicians and enthusiasts of this richly varied musical repertoire. Lowell Milken A MESSAGE FROM THE ARTISTIC DIRECTOR The quality, quantity, and amazing diversity of sacred as well as secular music written for or inspired by Jewish life in America is one of the least acknowledged achievements of modern Western culture. -
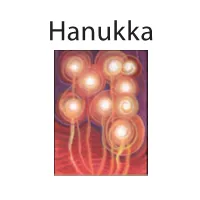
Hanukka a MESSAGE from the MILKEN ARCHIVE FOUNDER
Hanukka A MESSAGE FROM THE MILKEN ARCHIVE FOUNDER Dispersed over the centuries to all corners of the earth, the Jewish people absorbed elements of its host cultures while, miraculously, maintaining its own. As many Jews reconnected in America, escaping persecution and seeking to take part in a visionary democratic society, their experiences found voice in their music. The sacred and secular body of work that has developed over the three centuries since Jews first arrived on these shores provides a powerful means of expressing the multilayered saga of American Jewry. My personal interest in music and deep abiding commitment to synagogue life and the Jewish people united as I developed an increasing appreciation for the quality and tremendous diversity of music written for or inspired by the American Jewish experience. Through discussions with contemporary Jewish composers and performers during the 1980s, I realized that while much of this music had become a vital force in American and world culture, even more music of specifically Jewish content had been created, perhaps performed, and then lost to current and future generations. Believing that there was a unique opportunity to rediscover, preserve, and transmit the collective memory contained within this music, the Milken Archive of American Jewish Music was founded in 1990. This project would unite the Jewish people’s eternal love of music with their commitment to education, a commitment shared by the Milken Family Foundation since our founding in 1982. The passionate collaboration of many distinguished artists, ensembles, and recording producers has created a vast repository of musical resources to educate, entertain, and inspire people of all faiths and cultures. -

®Fficial <Sa3ette
®fficial <Sa3ette OF THE (Government of Palestine. PUBLISHED FORTNIGHTLY BY AUTHORITY. Noi 268 JERUSALEM 1st October, 1930. CONTENTS Page I. GOVERNMENT NOTICES. 1930׳ ----- a\ Enactment of the Contempt of Court Ordinance, No. 25 of 782) (b) Confirmation of Ordinances Nos. 14 and 18 of 1930 ------- 782 ־ ־ ־ ־ ־ - ־ ־ ־ ־ ־ ־ c) Appointments, etc. 782-783) {d) Certificate under the Expropriation of Land Ordinance, 1926, regarding the ־ - ־ ־ - - - - - widening of roads in the Jaffa Port Area 783 ־ e) Proclamation under the Forests Ordinance, 1926, defining a closed forest area - 784-785) ־ ־ Order under the Police Ordinance, 1926, appointing a Superior Police Officer 785 (/) (g) Orders applying the Urban Property Tax Ordinances, 1928-1929, to and appointing ־ an Appeal Commission and Assessment Committees in Safad 785-786 (h) Orders applying tl e Urban Property Tax Ordinances, 1928-1929, to and appointing ־ an Appeal Commission and Assessment Committees in Nazareth 787-788 (/) Orders revoking the application of the Urban Property Tax Ordinance, 1928, to Haifa and Acre ----- - - 788-789 ־ - ij) Pegulations under the Customs Ordinance, 1929, regarding Customs flag, etc. 789 {k) Regulation under the Plant Protection Ordinance, 1924, to check the spread of Black Scale -------------- 789-790 (/) Revocation of Rules under the Diseases of Animals Ordinance, 1926, prohibiting and regulating the movement of cattle, etc. in the vicinity of the northern and north-easief n frontiers of Palestine - • - -- -- -- 790 (m) Advocates (Professional Conduct) Rules of Court, 1930 ------- 790 (n) Notices under the Diseases of Animals Ordinance, 1926, declaring certain ־ - ־ - - ־" - ־ - - - villages to be infected areas 791 (6) Notice under the Expropriation of Land Ordinance, 1926, regarding the construction ־־ ־ ־ ־ ־ . -

Purim Spiel (A Purim Play) by Levin Kipnis Illustrated by Nachum Gutman
Purim Spiel (A Purim Play) By Levin Kipnis Illustrated by Nachum Gutman Come see the show! The song Purim Spiel or Purim Play is written as a humorous script based on the Book of Esther. It is an invitation to watch a children's play with a big cast, all dressed up as Megillah characters: Mordechai, Queen Esther, King Achashverosh and Haman. Humor-filled performances have been staged in various Jewish communities on Purim since the 16th century. In Yiddish they were called Purim Spiel, in Arabic – Kal'aat Purim. Levin Kipnis perpetuated this Purim tradition in a song which is in fact a script for a children's play, to be performed by them. His words were put to music by Nahum Nardi as part of a children's Purim play, and later illustrated by Nachum Gutman. The book in its current format was first published in 1933, and the songs in it have been an integral part of many a Purim among Israeli children. Happy Purim! Ideas for Family Activities You may enjoy looking together at Nachum Gutman's special, 80-year-old illustrations. Did you notice that all the characters in the book, even the horse, are actually children in costume? You could make simple animal costumes at home using paper or foam sheets to create ears, belts for tails, or any other similar idea. Now the kids can crawl on all fours and turn into neighing horses, barking dogs, bleating sheep and so on. Do you know the tune to Purim Play? You may want to listen to the song, clap along to the music, or accompany it with your own instrument, and dance together. -

Razumny Family Tree Artifact Card Artifact Card
INTERARTIFACTVIEW GUI CARDDELINES ADDRESS BOOK AND PENCIL CASE 4 x 8 inches, Leather, metal, pencils, ruler, British postage stamp, British coins, paper Brought from Germany to England in 1939 Gift of Erika Tichauer Rosenthal Erika took this address book and pencil case with her when she and her younger brother Horst were sent to England as part of the Kindertransport. The Kindertransport was a rescue effort that helped approximately 10,000 children leave Nazi Germany for England. When Erika and Horst’s parents entrusted them to the Kindertransport they did not know if they would ever see their children again. These artifacts are a reminder of the difficult decisions that parents had to make to protect their children during the Nazis’ rise to power. INTERARTIFACTVIEW GUI CARDDELINES RAZUMNY FAMILY TREE 26 x 22-1/2 inches, Paper Possibly the United States, 1983 Gift of Janice and Marvin Epstein The Razumny family is originally from Latvia but members of this family now live in over a dozen countries including Denmark, England, France, Spain, Germany, Israel, Norway, Scotland, Sweden, the former Soviet Union, and the United States. Many members of the family have a copy of the family tree just like this one. This family tree illustrates the presence of the Jewish people all over the world. It also shows us how names were passed down through the generations and how names were changed based on where different parts of the family were located. INTERARTIFACTVIEW GUI CARDDELINES PHOTOGRAPH OF NACHUM AND RITA KAHN IN AN ORCHARD Photograph Herzliya, Palestine, 1928 Collection of Efrat Carmon Nachum Kahn is a descendent of the Razumny family. -

Let My People Know Limmud FSU: the Story of Its First Decade
Let My People Know Limmud FSU: The Story of its First Decade LET MY PEOPLE KNOW Limmud FSU: The Story of its First Decade Mordechai Haimovitch Translated and Edited by Asher Weill Limmud FSU New York/Jerusalem Copyright@Limmud FSU International Foundation, New York, 2019 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form without the prior permission of the copyright holder Editor’s Notes. Many place names in this book are interchangeable because of the various stages of historical or political control. We have usually chosen to use the spellings associated with Jewish history: eg. Kiev not Kviv; Lvov not Lviv; Kishinev not Chișinău; Vilna not Vilnius, etc. Every attempt had been made to trace the source of the photographs in the book. Any corrections received will be made in future editions. Limmud FSU International Foundation 80, Central Park West New York, NY 10023 www.Limmudfsu.org This book has been published and produced by Weill Publishers, Jerusalem, on behalf of Limmud FSU International Foundation. ISBN 978-965-7405-03-1 Designed and printed by Yuval Tal, Ltd., Jerusalem Printed in Israel, 2019 CONTENTS Foreword - Natan Sharansky 9 Introduction 13 PART ONE: BACK IN THE USSR 1. A Spark is Kindled 21 2. Moscow: Eight Years On 43 3. The Volunteering Spirit 48 4. The Russians Jews Take Off 56 5. Keeping Faith in the Gulag 62 6. Cosmonauts Over the Skies of Beersheba 66 7. The Tsarina of a Cosmetics Empire 70 PART TWO: PART ONE: BACK IN THE USSR 8. -

Jewish Folksongs in the Palestinian Period: Building a Nation
JEWISH FOLKSONGS IN THE PALESTINIAN PERIOD: BUILDING A NATION by ESTHER RUTSTEIN submitted in accordance with the requirements for the degree of MASTER OF ARTS in the subject MODERN HEBREW atthe UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA SUPERVISOR: MRS N. KOLBER JOINT SUPERVISOR: DR D.W. LLOYD JANUARY 1997 ****************** This study is lovingly dedicated to my father Morris, to the memory of my late mother, Yetta and to my children - Loni and Tali. \\lHl\11~111\1 0001700961 SUMMARY The psyche of an entire people underwent a paradigm shift during the Palestinian Period (1920-1948). Jews took a spiritual quantum leap; they left the despair of the 'wastelands' of the Diaspora and journeyed towards the Promised Land. The quest of these pioneers was to rebuild their ancestral homeland. When the pioneering Halutzim encountered the ancestral soil of their Motherland, deep impulses were revealed. Their folksongs - an important component of folklore and mythology - reflected this inner dimension of their being and of their experiences in Eretz Israel by means of archetypal transformations. Initially, an idealistic devotion to reconstruction and intimate reverence for the Land was reflected. However, in the 1930s and 1940s, opposition to Jewish settlement transformed folksongs so they became increasingly militant, reflecting a movement towards extroversion in the Jewish psyche which was consolidated in 1948. Keywords Israel Jews Diaspora Palestinian Period Pioneers Mythology Archetypes Folklore Folksongs Student number: 566-427-6 I declare that Jewish Folksongs In The Palestinian Period: Building A Nation is my own work and that all the sources that I have used or quoted have been indicated and acknowledged by means of complete references. -

Theater for Kindergarten Children in the Yishuv: Toward the Formation of an Eretz-Israeli Childhood
SHELLY ZER-ZION THEATER FOR KINDERGARTEN CHILDREN IN THE YISHUV: TOWARD THE FORMATION OF AN ERETZ-ISRAELI CHILDHOOD Abstract which became known as “The Children’s Theater near “The Children’s Theatre by the Kindergarten Teachers Cen- the Kindergarten Teachers’ Center.”3 This institution, ter,” that was founded in 1928, was the first Hebrew repertory which operated continuously until 1955, was the first theatre exclusively addressing the audience of children attend- Hebrew repertory theater that exclusively addressed ing kindergarten and the first grades of elementary school. the audience of children attending kindergarten and This article explores how The Children’s Theater conveyed a the first grades of elementary school. Moshe Gorali, set of performative practices that consolidated a habitus of who documented the activity of this theater, stressed Eretz-Israeli childhood. The theater articulated the embodied its significance in the context of the culture of the repertoire of Eretz-Israeli childhood and established it on two Yishuv—the Jewish-Zionist settlement in Mandatory pillars. First, it epitomized the concept of an innocent and Palestine:4 secure childhood. The world performed on the stage created a utopian notion of childhood. Second, it encouraged the children A special feature distinguishes the theater audience to participate in the world of adults, but in a way suited to attending children’s theater from that of adults and their age and psychological needs. The ability of this theatre that is its frequent change. Namely, this audience, upon to create an enriching and a secure environment for children growing up and leaving the age of childhood, leaves the was deeply needed in the Jewish settlement of Palestine of the (children’s theater) institutions for good.