Glières Et Vercors
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Revue De La Fondation De La France Libre
COUV 52_cor_- 08/07/14 16:54 Page1 COUV 52_cor_- 08/07/14 16:54 Page2 SoSmommmaiarie re La Vie de la Fondation Revue d’information Le mot du président 1 trimestrielle de la e Fondation de la 70 anniversaire de la Libération 1 France Libre Réunion des délégués de la Fondation de la France Libre 2 Parution : Juin 2014 Numéro 52 Hommage national aux « dissidents » antillais et guyanais 2 Le 18 juin à Paris 3 En couverture : 5 juin 1944, à Rome, le drapeau tricolore flotte au balcon du palais Farnèse, hissé par le 2 e classe Paul Histoire Poggionovo, Corse de vingt ans Le corps expéditionnaire français en Italie engagé dans le bataillon d’infan- 4 terie de marine et du Pacifique (BIMP), au sein de la 1 re division Félix Éboué, de l’engagement colonial au combat pour la France Libre 9 française libre (1 re DFL), tué dans la forêt de Ronchamp, dans les La querelle des Glières : Une certaine « réalité » contre le « mythe » ? 15 Vosges, le 29 septembre 1944 (photo de l’Office français Le débarquement de Normandie 18 d’information cinématographique, coll. Bongrand Saint Hillier). Hommage à Émile Bouétard 22 En bas, de gauche à droite : un détachement de la 13 e demi- brigade de Légion étrangère (13 e DBLE) sous les ordres du commandant Paul Arnault (à droite) présente les honneurs au général de Gaulle, accompagné du Livres 24 général Juin, commandant du corps expéditionnaire français en Italie, à la villa Médicis, à Rome, le 28 juin 1944 (ECPAD) ; Charles de In memoriam 26 Gaulle accueilli par le gouverneur général Félix Éboué, sans date (Office of War Information Photograph Collection, Library of Congress) ; le général de Gaulle Carnet 28 dans les rues de Bayeux, avec le général Antoine Béthouart (1889- 1982), chef d’état-major de la défense nationale, et Pierre Viénot 29 (1897-1944), ambassadeur du Dans les délégations Gouvernement provisoire de la République française (GPRF) auprès du gouvernement britan - e nique (DR). -
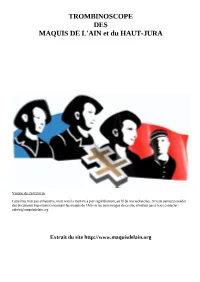
Trombinoscope.Pdf
TROMBINOSCOPE DES MAQUIS DE L'AIN et du HAUTJURA Version du 25/03/2016 Cette liste n'est pas exhaustive, mais nous la mettons à jour régulièrement, au fil de nos recherches. Si vous pensez posséder des documents importants concernant les maquis de l'Ain ou les personnages de ce site, n'hésitez pas à nous contacter : [email protected] Extrait du site http://www.maquisdelain.org #### Claude Claude Groupe franc FUJ Coup de main sur le réseau ferroviaire et parachutages à la veille du débarquement du 6 juin 1944. http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=122 ADAM Jean De Chavannes sur Suran. Fusillé le 17 juillet 1944 http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=178 ADHEMAR Henri dit J3 Du mouvement «Franctireur» chargé de la propagande et de la diffusion des journaux clandestins. A conduit Pierre MARCAULT au camp du Gros Turc en juillet 1943 pour récupérer les 43 réfractaires conduits à la ferme de Morez sur Hôtonnes en Valromey. Un élément de Franc tireur qui a conduit une importante activité au profit de la presse clandestine. http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=62 ADOBATI Lucien Compagnie Chouchou. Tué à Ponthieu, le 15 juin 1944. http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=220 ALLOIN Jean Sergent, Compagnie Chouchou. Tué au combat à PonthieuThézillieu, le 15 juin 1944 http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=221 ANDRE Robert Pseudo Porthos Maquis du HautJura Service Périclès camp Cyrus Annuaire Périclès_1714_P. Cyrus Né en 1921 à Nancy Réfractaire au STO. -

Chronologie Mars 1944 Pour
CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS MARS 1944 1er MARS 4 MARS Max Knipping, envoyé spécial de Darnand L’équipe des ravitailleurs de la vallée du Borne s’installe à Annecy pour suivre les opérations de dirigée par Roger Broizat fait monter un Haute-Savoie. troupeau de 35 vaches pour nourrir le Plateau. Les G.M.R. arrêtent Michel Fournier, l’assistant du médecin du Plateau, descendu chercher des médicaments au Grand-Bornand comme l’accord passé l’avant-veille devait le lui permettre. 2 MARS En réaction, la compagnie Humbert va investir le poste G.M.R. de Saint-Jean-de-Sixt (à quinze kilomètres du Plateau) et, sans un coup de feu, fait prisonniers la trentaine d’hommes qui s’y trouvent. Par téléphone Humbert obtient du colonel Lelong la promesse de libérer le jeune médecin emmené à Annecy, en échange de quoi les maquisards relâchent leurs prisonniers. Cet engagement ne sera pas tenu. 3 MARS Le groupe F.T.P. de Marius Cochet (“ Franquis ”) monte au Plateau et se met aux ordres de Tom Morel. Il devient la section « Coulon ». Avec la ème section « Chamois », il forme la 3 compagnie du bataillon des Glières commandée par Louis Le ravitaillement du plateau Morel (« Forestier ») chargée de défendre d’une part le Col de l’Enclave et le Col de Landron, et, d’autre part le débouché du Pas du Roc. NUIT DU 5 AU 6 MARS : DEUXIÈME PARACHUTAGE Désormais le « Bataillon des Glières » compte environ 320 hommes, ce qui est encore C’est à peine le début de la période favorable insuffisant face aux Forces de l’Ordre qui ont aux parachutages. -

Programme Interministériel De Recherche « Cultures, Villes Et Dynamiques Sociales »
Programme interministériel de recherche « cultures, villes et dynamiques sociales » MEMOIRES DE LA RESISTANCE ET DE LA GUERRE : REDEPLOIEMENTS EN REGION RHONE-ALPES 13 juin 2007 Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation Lyon Séminaire organisé dans le cadre de l’atelier de recherche « Travail de mémoire, mémoires partagées : vérités, traduction, événement, reconnaissance » MoDyS-UMR 5264CNRS 1 MEMOIRES DE LA RESISTANCE ET DE LA GUERRE : REDEPLOIEMENTS EN REGION RHONE-ALPES Séminaire organisé dans le cadre du programme de recherches territorialisées 2005-2007 « Travail de mémoire et mémoires partagées : vérités, traduction, événements, reconnaissance ». Autour de la Résistance et de la guerre s’est forgée depuis 60 ans en France une mémoire nationale qui se voulait unifiée et qui a été marquée par des divisions et des polémiques politiques. Des travaux d’historiens, bénéficiant de l’ouverture d’archives et de récits de témoins, revisitent progressivement ces années noires. Les musées et mémoriaux de la Résistance, dont certains ont vocation nationale, s’appuient sur ces travaux, tout en s’inscrivant dans des sites et des territoires - ce qui les conduit à dialoguer avec les mémoires à l’œuvre et avec les institutions qui soutiennent leur travail de mise en patrimoine dans un souci pédagogique et parfois de valorisation d’une ressource touristique. Aujourd’hui l’attention à l’émergence de nouveaux acteurs, de nouveaux récits et de nouveaux usages publics de la mémoire incite à poser l’hypothèse d’un redéploiement mémoriel. Ce redéploiement prend l’allure d’un événement contemporain qui modifie une mémoire héroïsante et doloriste, figée dans le seul devoir de mémoire, pour s’enrichir, sous des formes singulières et localisées, par des croisements et des partages en deçà et au-delà de la seule échelle nationale. -

Les Raisons De Glières Pour
l’autre, à l’ouest, le secteur de la vallée du Fier et COMPRENDRE GLIÈRES FÉVRIER / MARS 1944 celle de la Filière. Par la suite d’autres groupes Les événements des premiers mois de 1944 de maquisards, notamment en provenance du liés au Maquis des Glières occupent une nord du département (Vallée Verte, Giffre et place prééminente dans la mémoire Chablais) viennent renforcer ce dispositif, pour collective de la Haute-Savoie. Le Plateau est faire face au harcèlement par les Forces de plus que jamais une icône de la Résistance. l’Ordre du gouvernement de Vichy. Leur nombre Autour de lui se sont développées deux finit par atteindre, au mois de mars, environ 460 légendes contradictoires : d’un côté la légende combattants répartis en quatre compagnies dorée d’un héroïsme à la hauteur de la bataille encadrées par des officiers et des sous-officiers des Thermopyles invoquée par André Malraux issus en majorité du 27ème B.C.A.. Intégrés à ce dans un discours célèbre, et, de l’autre, la petit bataillon de l’Armée Secrète, se trouvent légende noire du sang versé pour rien. Il serait deux groupes de Francs-Tireurs et Partisans qui temps de mettre en lumière la signification ont rejoint le Plateau pour échapper à la réelle de ce qui ne fut pas simplement un drame pression des forces de l’ordre. de plus dans l’histoire sanglante des maquis. Pour comprendre l’enchaînement des LES RAISONS DU RASSEMBLEMENT DES événements, il faut prendre en compte GLIÈRES l’interaction des cinq protagonistes qui se sont affrontés par maquisards interposés : d’un côté, L’histoire des Glières commence véritablement la Résistance locale, la France Libre à le 27 janvier, à Londres. -

Glières, Première Bataille De La Résistance
1 GLIERES, « PREMIERE BATAILLE DE LA RESISTANCE ». Le texte ci-après reprend très largement les éléments de synthèse figurant sur le site www.glieres-resistance.org ouvert par l’Association des Glières à l’occasion du 64ème anniversaire des événements de mars 1944. Comme c’est souvent le cas, en dépit de la notoriété nationale des combats des Glières, connus comme l’un des hauts faits de la Résistance, rares sont ceux qui en ont une connaissance précise, voire exacte. Pour un grand nombre, la confusion avec le Vercors est fréquente (dans les deux cas, il s’agit d’un Plateau, situé dans les Alpes). Pour d’autres, là où on a pu célébrer une « épopée », les faits seraient infiniment plus modestes et leur relation relèverait de la légende. On a par ailleurs souvent retenu l’idée de « sacrifice », les uns pour le célébrer, les autres pour dénoncer là une erreur stratégique et tactique. En fait, selon André Malraux, Glières « est une simple et belle histoire ». Cette histoire, dans sa vérité, c’est celle, entre janvier et mars 1944, du rassemblement au Plateau des Glières, au cœur de la Haute-Savoie, de plusieurs centaines de maquisards, essentiellement de l’Armée Secrète (AS), mais aussi des Francs-Tireurs Partisans (FTP), sous les ordres du lieutenant Morel, dit Tom, puis, après la mort de celui-ci, du capitaine Anjot, tous deux du 27ème Bataillon de Chasseurs Alpins (BCA), pour y réceptionner les parachutages d’armes massifs dont les maquis du département avaient un impérieux besoin. C’est celle de leur combat inégal, d’abord contre les forces de Vichy, puis contre une division de la Wehrmacht, jusqu’à leur esquive et à leur dispersion à la fin mars, qui se soldera par la mort de plus d’une centaine d’entre eux. -

Lire La Suite De L'article En
p27-28 . 27ème BCA.qxp_Mise en page 1 28/09/2020 15:21 Page1 CROIX DE GUERRE ET VALEUR MILITAIRE Le 27ème Bataillon de chasseurs alpins Le 27ème Bataillon de chasseurs alpins porte les fourragères de la croix de Guerre, de la Médaille militaire, de la Légion d’honneur et de la Valeur militaire, acquise en Afghanistan. Le 27ème Bataillon de Chasseurs Al - d’élite qui, sous les ordres du com - pins (BCA) appartient à la 27ème Bri - mandant Richier puis du capitaine gade d’infanterie de montagne. Charpentier, a justifié une fois de plus La spécificité « montagne » se définit sa réputation de troupe de choc in - comme l’ensemble des aptitudes mo - comparable. Engagé le 31 août sur rales, physiques, techniques et tac - une partie du front particulièrement U tiques permettant de vivre et de com - résistante, a entamé les lignes enne - battre dans un milieu montagneux et mies dès le premier jour ; puis, ba - N dans des conditions climatiques ex - taillon d’avant-garde, a mené la pour - I trêmes. Les troupes de montagne sont existent. Les bataillons de chasseurs suite avec une ténacité et une T créées, en 1888, pour défendre la possèdent un drapeau unique. A sa souplesse manœuvrière des plus re - É frontière des Alpes. L’organisation ac - cravate est accrochée la Légion d’hon - marquables. A fait au cours de ces S tuelle du 27ème BCA comprend 6 neur. La garde du drapeau est confiée journées de combat 85 prisonniers, compagnies de combat (dont 1 de ré - chaque année à un bataillon différent. dont 1 officier, capturant 25 mitrail - serve), 1 compagnie d’éclairage et Le 27ème BCP est créé le 30 janvier leuses et un important matériel. -

Le Maquis Des Glières
Dossier de Presse MARS 2019 75e anniversaire des combats du Plateau des Glières CONTACT PRESSE : Cécile Menu 06 89 19 46 62 / 04 50 33 58 61 [email protected] Sommaire Glières, un patrimoine pour la Haute-Savoie et pour la France p.3 1/ Glières, « Vivre libre ou mourir » p.4 . Le Maquis des Glières . L’héritage de Glières : une certaine idée de la France . La Nécropole Nationale des Glières . Le Monument National à la Résistance . « Ceux des Glières » 2/ Les dépositaires de l’héritage des Glières p.11 . L’Association des Glières . Le Département de la Haute-Savoie 3/ La Haute-Savoie libérée par elle-même p.13 . Les deux France . La lutte contre l’occupant (1943-1944) . La Libération de la Haute-Savoie Annexe : Pour aller plus loin p.18 75e anniversaire des combats du Plateau des Glières – 31 mars 2019 2 Glières, Un patrimoine pour la Haute-Savoie et pour la France Le 31 mars prochain auront lieu en Haute-Savoie, les cérémonies du 75e anniversaire des combats du Plateau des Glières, à la Nécropole Nationale des Glières, à Morette, présidées par le Président de la République. L’année 2019 marque en effet le 75e anniversaire de la Libération de la Haute-Savoie, alors obtenue par les seules forces unies de la Résistance. Cas unique en France, l’exemple haut-savoyard revêt une dimension qui va bien au-delà de sa propre histoire. Voici quelques années, un grand hebdomadaire national qualifiait ainsi le plateau des Glières, en Haute-Savoie, parmi « les hauts-lieux qui ont fait la France ». -

Théodose Morel Dit Tom Morel (1915-1944)
Théodose Morel dit Tom Morel (1915-1944) Tom Morel, Lieutenant, se distingue en juin 1940, reçoit deux citations et est fait chevalier de la Légion d’honneur, âgé que de 24 ans. Il sert ensuite dans l'armée d'armistice à Annecy sous les ordres du commandant Vallette d'Osia et participe au camouflage d'armes et de matériel. En 1941, il est nommé instructeur à Saint-Cyr, alors repliée en zone sud à Aix-en-Provence, où il encourage implicitement ses élèves à entrer dans la Résistance. Après l'invasion de la zone sud par les Allemands en novembre 1942, Tom Morel passe dans la clandestinité et entre dans la Résistance en Haute-Savoie où il contribue à organiser l'AS dont le nombre de volontaires se multiplie après la mise en œuvre du service du travail obligatoire (STO) en Allemagne en février 1943. En septembre 1943, le commandant Vallette d'Osia est arrêté. Tom Morel est nommé chef des maquis du département et reçoit pour mission d'organiser la réception des parachutages alliés sur le plateau des Glières. Le 31 janvier 1944, Tom Morel s'installe sur le plateau avec 120 maquisards. À la fin février, il a sous ses ordres environ 300 hommes qu'il a organisé en trois compagnies. Tom Morel s'illustre par ses talents de chef et d'entraîneur d'hommes venus d'horizons géographiques, sociaux et politiques très divers. Il adopte la devise « vivre libre ou mourir » et instruit son bataillon pour en faire une unité homogène et opérationnelle en vue des combats de la libération. -

Discours Inaugural Du Monument Des Glières Par André Malraux
LES OUTILS VALEURS RÉPUBLICAINES Discours inaugural du monument des Glières par André Malraux Je parle au nom des Associations des Résistants de Haute-Savoie et de l’Ordre de la Libération. En mémoire du Général de Gaulle, pour les survivants et pour les enfants des morts. Lorsque Tom MOREL eût été tué, le maquis des Glières exterminé ou dispersé, il se fit un grand silence. Les premiers maquisards français étaient tombés pour avoir combattu face à face les divisions allemandes avec leurs mains presque nues, non plus dans nos combats de la nuit, mais dans la clarté terrible de la neige. Et à travers ce silence, tous ceux qui nous aimaient encore, depuis le Canada jusqu’à l’Amérique Latine, depuis la Grèce et l’Iran jusqu’aux îles du Pacifique, reconnurent que la France bâillonnée avait au moins retrouvé l’une de ses voix, puisqu’elle avait retrouvé la voix de la mort. L’histoire des Glières est une grande et simple histoire, et je la raconterai simplement. Pourtant, il faut que ceux qui n’étaient pas nés alors — et depuis, combien de millions d’enfants ! — sachent qu’elle n’est pas d’abord une histoire de combats. Le premier écho des Glières ne fut pas celui des explosions. Si tant des nôtres l’entendirent sur les ondes brouillées, c’est qu’ils y retrouvèrent l’un des plus vieux langages des hommes, celui de la volonté, du sacrifice et du sang. Peu importe ce que fut dans la Grèce antique, militairement, le combat des Thermopyles. Mais dans ses trois cents sacrifiés, la Grèce avait retrouvé son âme, et pendant des siècles, la phrase la plus célèbre fut l’inscription des montagnes retournées à la solitude, et qui ressemblent à celles-ci : « Passant, va dire à la cité de Sparte que ceux qui sont tombés ici sont morts selon sa loi ». -

Allocution De Jacques Myard Lors De La
Allocution de Jacques Myard, Maire de Maisons-Laffitte Membre honoraire du Parlement du 8 mai 2021 10 mai 2021 « Paris ! Paris outragé ! Paris brisé ! Paris martyrisé ! mais Paris libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de France, avec l’appui et le concours de la France tout entière, de la France qui se bat, de la seule France, de la France éternelle » De Gaulle - 25 août 1944 Hôtel de Ville La France qui se bat, la seule France, la vraie France, la France éternelle. Ces paroles historiques devenues légendaires de l’Homme du 18 juin martelées à l’Hôtel de Ville de Paris le 25 août 1944 sont chargées d’une rare et forte émotion, elles résonnent désormais dans tous les cœurs, dans tous les esprits. « Pourquoi voulez-vous que nous dissimulions l’émotion qui nous étreint tous ... Non ! nous ne dissimulerons pas cette émotion profonde et sacrée. Il y a là des minutes qui dépassent chacune de nos pauvres vies... » Charles de Gaulle 25 août 1944 La France qui se bat, C’est celle de Jean de Lattre de Tassigny. Plus jeune Général de France, Jean de Lattre de Tassigny commande la 14ème division d’infanterie lors de la bataille de France. En mai 1940, il repousse par trois fois les Allemands à Rethel, il fait 2 000 prisonniers. Puis au sud de Rethel à Saint-Martin l’Heureux, de Lattre dispose ses canons de 75 en lisière de forêt avec ordre de ne tirer qu’à courte distance. Il détruit 40 chars d’une Panzer division. -

DP 75E GLIERES 310319
Dossier de Presse MARS 2019 75e anniversaire des combats du Plateau des Glières CONTACT PRESSE : Cécile Menu 06 89 19 46 62 / 04 50 33 58 61 [email protected] Sommaire Glières, un patrimoine pour la Haute-Savoie et pour la France p.3 1/ Glières, « Vivre libre ou mourir » p.4 . Le Maquis des Glières . L’héritage de Glières : une certaine idée de la France . La Nécropole Nationale des Glières . Le Monument National à la Résistance . « Ceux des Glières » 2/ Les dépositaires de l’héritage des Glières p.11 . L’Association des Glières . Le Département de la Haute-Savoie 3/ La Haute-Savoie libérée par elle-même p.13 . Les deux France . La lutte contre l’occupant (1943-1944) . La Libération de la Haute-Savoie Annexe : Pour aller plus loin p.18 75e anniversaire des combats du Plateau des Glières – 31 mars 2019 2 Glières, Un patrimoine pour la Haute-Savoie et pour la France Le 31 mars prochain auront lieu en Haute-Savoie, les cérémonies du 75e anniversaire des combats du Plateau des Glières, à la Nécropole Nationale des Glières, à Morette, présidées par le Président de la République. L’année 2019 marque en effet le 75e anniversaire de la Libération de la Haute-Savoie, alors obtenue par les seules forces unies de la Résistance. Cas unique en France, l’exemple haut-savoyard revêt une dimension qui va bien au-delà de sa propre histoire. Voici quelques années, un grand hebdomadaire national qualifiait ainsi le plateau des Glières, en Haute-Savoie, parmi « les hauts-lieux qui ont fait la France ».