DP-BERNARD FAVRE.Indd
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Revue De La Fondation De La France Libre
COUV 52_cor_- 08/07/14 16:54 Page1 COUV 52_cor_- 08/07/14 16:54 Page2 SoSmommmaiarie re La Vie de la Fondation Revue d’information Le mot du président 1 trimestrielle de la e Fondation de la 70 anniversaire de la Libération 1 France Libre Réunion des délégués de la Fondation de la France Libre 2 Parution : Juin 2014 Numéro 52 Hommage national aux « dissidents » antillais et guyanais 2 Le 18 juin à Paris 3 En couverture : 5 juin 1944, à Rome, le drapeau tricolore flotte au balcon du palais Farnèse, hissé par le 2 e classe Paul Histoire Poggionovo, Corse de vingt ans Le corps expéditionnaire français en Italie engagé dans le bataillon d’infan- 4 terie de marine et du Pacifique (BIMP), au sein de la 1 re division Félix Éboué, de l’engagement colonial au combat pour la France Libre 9 française libre (1 re DFL), tué dans la forêt de Ronchamp, dans les La querelle des Glières : Une certaine « réalité » contre le « mythe » ? 15 Vosges, le 29 septembre 1944 (photo de l’Office français Le débarquement de Normandie 18 d’information cinématographique, coll. Bongrand Saint Hillier). Hommage à Émile Bouétard 22 En bas, de gauche à droite : un détachement de la 13 e demi- brigade de Légion étrangère (13 e DBLE) sous les ordres du commandant Paul Arnault (à droite) présente les honneurs au général de Gaulle, accompagné du Livres 24 général Juin, commandant du corps expéditionnaire français en Italie, à la villa Médicis, à Rome, le 28 juin 1944 (ECPAD) ; Charles de In memoriam 26 Gaulle accueilli par le gouverneur général Félix Éboué, sans date (Office of War Information Photograph Collection, Library of Congress) ; le général de Gaulle Carnet 28 dans les rues de Bayeux, avec le général Antoine Béthouart (1889- 1982), chef d’état-major de la défense nationale, et Pierre Viénot 29 (1897-1944), ambassadeur du Dans les délégations Gouvernement provisoire de la République française (GPRF) auprès du gouvernement britan - e nique (DR). -

Épisode N° 4 Des Alpes À La Méditerranée, Les Résistances Unifiées
Les Résistances Parcours pédagogique collège Épisode n° 4 Des Alpes à la Méditerranée, les Résistances unifiées COMPÉTENCES TRAVAILLÉES, CYCLE 4, CLASSE DE 3e – S’informer dans le monde du numérique : trouver, sélectionner et exploiter des informations. – Analyser et comprendre un document : extraire des informations pertinentes pour répondre à une question portant sur un ou plusieurs documents. PARCOURS PÉDAGOGIQUE PROPOSÉ PAR Olivier Guiral Professeur d’histoire-géographie, chargé de mission Patrimoine Mémoire – Citoyenneté Délégué académique adjoint à l’éducation artistique et culturelle Rectorat de l’académie de Montpellier. LES Résistances Parcours pédagogique COLLÈGE Questions Vous allez découvrir dans ce webdocumentaire les actions et les engagements des résistants en visionnant des ressources sélectionnées sur cette plateforme et accessibles par un lien direct. Pour chaque question sont indiqués : le timecode de début et de fin des formats longs ainsi que le titre de toutes les ressources (formats longs, films courts et documents interactifs) à consulter afin de construire votre réponse. 1. MONTRER EN QUOI CETTE RÉGION DU SUD-EST SE RÉVÈLE TRÈS TÔT COMME UN TERRITOIRE STRATÉGIQUE POUR LA RÉSISTANCE ? FORMAT LONG 0:25 - 2:33 / 8:05 - 9:19 / 12:24 - 14:10, Les Résistances unifiées DOCUMENTS INTERACTIFS L’occupation italienne en France Lucie et Raymond, les époux Aubrac Ligne de démarcation et invasion de la zone sud Maurice Anjot, chef du maquis des Glières 2. POUR QUELLES RAISONS, DÈS LE DÉBUT DE L’OCCUPATION, LYON S’IMPOSE-T-ELLE COMME CAPITALE DE LA RÉSISTANCE ? FORMATS LONGS 1:45- 2:07, Lyon, capitale de la Résistance 2:35 - 5:40, Les Résistances unifiées 2:08 - 5:05 / 9:05 - 11:39, Lyon, capitale de la Résistance DOCUMENTS INTERACTIFS Ligne de démarcation et invasion de la zone sud Klaus Barbie et la Gestapo Lyonnaise Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation ÉPISODE N° 4 DES ALPES À LA MÉDITERRANÉE, LES Résistances UNIFIÉES 2 LES Résistances Parcours pédagogique COLLÈGE 3. -
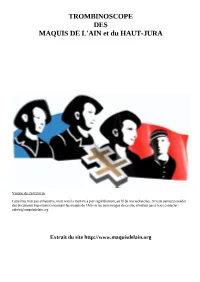
Trombinoscope.Pdf
TROMBINOSCOPE DES MAQUIS DE L'AIN et du HAUTJURA Version du 25/03/2016 Cette liste n'est pas exhaustive, mais nous la mettons à jour régulièrement, au fil de nos recherches. Si vous pensez posséder des documents importants concernant les maquis de l'Ain ou les personnages de ce site, n'hésitez pas à nous contacter : [email protected] Extrait du site http://www.maquisdelain.org #### Claude Claude Groupe franc FUJ Coup de main sur le réseau ferroviaire et parachutages à la veille du débarquement du 6 juin 1944. http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=122 ADAM Jean De Chavannes sur Suran. Fusillé le 17 juillet 1944 http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=178 ADHEMAR Henri dit J3 Du mouvement «Franctireur» chargé de la propagande et de la diffusion des journaux clandestins. A conduit Pierre MARCAULT au camp du Gros Turc en juillet 1943 pour récupérer les 43 réfractaires conduits à la ferme de Morez sur Hôtonnes en Valromey. Un élément de Franc tireur qui a conduit une importante activité au profit de la presse clandestine. http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=62 ADOBATI Lucien Compagnie Chouchou. Tué à Ponthieu, le 15 juin 1944. http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=220 ALLOIN Jean Sergent, Compagnie Chouchou. Tué au combat à PonthieuThézillieu, le 15 juin 1944 http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnages&id=221 ANDRE Robert Pseudo Porthos Maquis du HautJura Service Périclès camp Cyrus Annuaire Périclès_1714_P. Cyrus Né en 1921 à Nancy Réfractaire au STO. -

June 2018 Pdf624,6 KB
June 2018 Volume 1, Number 1 A New Beginning! programs and research. Most importantly, we hope that By Diane Castiglione and Bettina Kaplan, Co-Founders you will share the newsletter with additional family and Descendants of the Jewish Community of Augsburg friends so that they, too, will join our community. One of the responses to our call for reflections on last It’s been about nine months since we started looking year’s Reunion seems to encapsulate what we hope into the possibility of creating some kind of organization DJCA will come to represent for all of us. Claire Jepsen that would enable former residents of Augsburg and their (Cramer and Untermayer families) wrote that, “The descendants to stay in touch with each other and with the reunion last year was very interesting for me, as it gave Jewish Culture Museum Augsburg-Schwaben (JKMAS), me the opportunity to meet other descendants and strengthening the bonds established at the 2017 realize that many of our parents had been friends, school Descendant’s Reunion. We are therefore proud to mates and more. This kind of gave me a new “family.” announce the “birth” of the Descendants of the Jewish As we embark on this venture, we need to Community of Augsburg (DJCA) and the premier edition acknowledge several people who have played key roles of its newsletter! in getting us launched. We want to thank Loren Jaffe Our excitement about this endeavor is only exceeded (Einstein family) for designing such a wonderful logo by the positive and passionate responses through which we can create our brand. -

Chronologie Mars 1944 Pour
CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS MARS 1944 1er MARS 4 MARS Max Knipping, envoyé spécial de Darnand L’équipe des ravitailleurs de la vallée du Borne s’installe à Annecy pour suivre les opérations de dirigée par Roger Broizat fait monter un Haute-Savoie. troupeau de 35 vaches pour nourrir le Plateau. Les G.M.R. arrêtent Michel Fournier, l’assistant du médecin du Plateau, descendu chercher des médicaments au Grand-Bornand comme l’accord passé l’avant-veille devait le lui permettre. 2 MARS En réaction, la compagnie Humbert va investir le poste G.M.R. de Saint-Jean-de-Sixt (à quinze kilomètres du Plateau) et, sans un coup de feu, fait prisonniers la trentaine d’hommes qui s’y trouvent. Par téléphone Humbert obtient du colonel Lelong la promesse de libérer le jeune médecin emmené à Annecy, en échange de quoi les maquisards relâchent leurs prisonniers. Cet engagement ne sera pas tenu. 3 MARS Le groupe F.T.P. de Marius Cochet (“ Franquis ”) monte au Plateau et se met aux ordres de Tom Morel. Il devient la section « Coulon ». Avec la ème section « Chamois », il forme la 3 compagnie du bataillon des Glières commandée par Louis Le ravitaillement du plateau Morel (« Forestier ») chargée de défendre d’une part le Col de l’Enclave et le Col de Landron, et, d’autre part le débouché du Pas du Roc. NUIT DU 5 AU 6 MARS : DEUXIÈME PARACHUTAGE Désormais le « Bataillon des Glières » compte environ 320 hommes, ce qui est encore C’est à peine le début de la période favorable insuffisant face aux Forces de l’Ordre qui ont aux parachutages. -

Épisode N° 4 Des Alpes À La Méditerranée, Les Résistances Unifiées
Les Résistances Parcours pédagogique lycée Épisode n° 4 Des Alpes à la Méditerranée, les Résistances unifiées CAPACITÉS DÉVELOPPÉES, CLASSES DE PREMIÈRE ET TERMINALE Exploiter et confronter des informations – Utiliser les ressources en ligne pour développer son expression personnelle et son sens critique. – Prélever, hiérarchiser et confronter des informations. – Cerner le sens général d’un document ou d’un corpus documentaire, et le mettre en relation avec la situation historique étudiée. Préparer et organiser son travail de manière autonome : mener à bien une recherche individuelle ou au sein d’un groupe. PARCOURS PÉDAGOGIQUE PROPOSÉ PAR Sylvie Borrelly Professeure agrégée d’histoire-géographie, missionnée au service éducatif du Pont du Gard par la DAAC du rectorat de l’académie de Montpellier, formatrice à l’antenne de l’ESPE de Nîmes. LES Résistances Parcours pédagogique LYCÉE Questions Vous allez découvrir dans ce webdocumentaire les actions et les engagements des résistants en visionnant des ressources sélectionnées sur cette plateforme et accessibles par un lien direct. Pour chaque question sont indiqués : le time code de début et de fin des formats longs ainsi que le titre de toutes les ressources (formats longs, films courts et documents interactifs) à consulter afin de construire votre réponse. 1. LYON S’EST IMPOSÉE COMME CAPITALE DE LA RÉSISTANCE. POURQUOI ET COMMENT CETTE MÉTROPOLE DEVIENT-ELLE UNE PLAQUE TOURNANTE DE LA RÉSISTANCE ? FORMATS LONGS 4:30 - 5:40, Les Résistances unifiées 4:13 - 5:15 / 9:19 - 9:41, Lyon, capitale de la Résistance DOCUMENTS INTERACTIFS Ligne de démarcation et invasion de la zone sud Klaus Barbie et la Gestapo lyonnaise Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation 2. -

Programme Interministériel De Recherche « Cultures, Villes Et Dynamiques Sociales »
Programme interministériel de recherche « cultures, villes et dynamiques sociales » MEMOIRES DE LA RESISTANCE ET DE LA GUERRE : REDEPLOIEMENTS EN REGION RHONE-ALPES 13 juin 2007 Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation Lyon Séminaire organisé dans le cadre de l’atelier de recherche « Travail de mémoire, mémoires partagées : vérités, traduction, événement, reconnaissance » MoDyS-UMR 5264CNRS 1 MEMOIRES DE LA RESISTANCE ET DE LA GUERRE : REDEPLOIEMENTS EN REGION RHONE-ALPES Séminaire organisé dans le cadre du programme de recherches territorialisées 2005-2007 « Travail de mémoire et mémoires partagées : vérités, traduction, événements, reconnaissance ». Autour de la Résistance et de la guerre s’est forgée depuis 60 ans en France une mémoire nationale qui se voulait unifiée et qui a été marquée par des divisions et des polémiques politiques. Des travaux d’historiens, bénéficiant de l’ouverture d’archives et de récits de témoins, revisitent progressivement ces années noires. Les musées et mémoriaux de la Résistance, dont certains ont vocation nationale, s’appuient sur ces travaux, tout en s’inscrivant dans des sites et des territoires - ce qui les conduit à dialoguer avec les mémoires à l’œuvre et avec les institutions qui soutiennent leur travail de mise en patrimoine dans un souci pédagogique et parfois de valorisation d’une ressource touristique. Aujourd’hui l’attention à l’émergence de nouveaux acteurs, de nouveaux récits et de nouveaux usages publics de la mémoire incite à poser l’hypothèse d’un redéploiement mémoriel. Ce redéploiement prend l’allure d’un événement contemporain qui modifie une mémoire héroïsante et doloriste, figée dans le seul devoir de mémoire, pour s’enrichir, sous des formes singulières et localisées, par des croisements et des partages en deçà et au-delà de la seule échelle nationale. -

Les Raisons De Glières Pour
l’autre, à l’ouest, le secteur de la vallée du Fier et COMPRENDRE GLIÈRES FÉVRIER / MARS 1944 celle de la Filière. Par la suite d’autres groupes Les événements des premiers mois de 1944 de maquisards, notamment en provenance du liés au Maquis des Glières occupent une nord du département (Vallée Verte, Giffre et place prééminente dans la mémoire Chablais) viennent renforcer ce dispositif, pour collective de la Haute-Savoie. Le Plateau est faire face au harcèlement par les Forces de plus que jamais une icône de la Résistance. l’Ordre du gouvernement de Vichy. Leur nombre Autour de lui se sont développées deux finit par atteindre, au mois de mars, environ 460 légendes contradictoires : d’un côté la légende combattants répartis en quatre compagnies dorée d’un héroïsme à la hauteur de la bataille encadrées par des officiers et des sous-officiers des Thermopyles invoquée par André Malraux issus en majorité du 27ème B.C.A.. Intégrés à ce dans un discours célèbre, et, de l’autre, la petit bataillon de l’Armée Secrète, se trouvent légende noire du sang versé pour rien. Il serait deux groupes de Francs-Tireurs et Partisans qui temps de mettre en lumière la signification ont rejoint le Plateau pour échapper à la réelle de ce qui ne fut pas simplement un drame pression des forces de l’ordre. de plus dans l’histoire sanglante des maquis. Pour comprendre l’enchaînement des LES RAISONS DU RASSEMBLEMENT DES événements, il faut prendre en compte GLIÈRES l’interaction des cinq protagonistes qui se sont affrontés par maquisards interposés : d’un côté, L’histoire des Glières commence véritablement la Résistance locale, la France Libre à le 27 janvier, à Londres. -

Télécharger Le
Yad Vashem Jérusalem, September 2016, Nº55 Le Calendrier 2016-2017 Joseph Oppenheimer 1876, Würzburg, Allemagne - 1966, Montréal, Canada Portrait de Brigitte Flatau (Yallen), Berlin, 1927 Huile sur toile | 75 x 64 cm Don de Brigitte Yallen, Australie Actualité "Vous êtes les architectes de l'avenir du peuple juif" Le Président Reuven Rivlin s'adressant à la délégation de la Mission internationale Leadership de Yad Vashem La délégation de la Mission Leadership, lors du concert de clôture de Doudou Le président de l'Etat Reuven Rivlin accueille la délégation à sa résidence, lors de Fischer dans la Vallée des Communautés. l'arrivée de la Mission Leadership en Israël. a Mission internationale Leadership de Yad Vashem s'est déroulée Shoah. Israël existe parce que les Juifs ont droit à l'autodétermination en Pologne et en Israël du 6 au 12 juillet 2016. La délégation se nationale dans leur patrie historique. Mais nous ne pouvons pas et ne L composait d'amis de Yad Vashem et de dirigeants de comités de voulons pas refuser la place centrale de la Shoah dans notre existence soutien de différents pays. Le but de ce voyage était de retrouver les présente. La Shoah façonne notre engagement et notre détermination traces de la vie juive d'avant-guerre en Europe, d'examiner le passé, à être assez fort pour défendre nos citoyens contre la violence et la songer au présent et former l'avenir de nos enfants, et enfin de rallier les terreur et pour préserver la solidarité juive, et notre lien avec la diaspora. uns et les autres au travail de mémoire de Yad Vashem. -

Les Résistances Parcours Pédagogiques Lycée Dossiers D’Accompagnement De La Collection De Web-Documentaires Sur La Résistance Dans Les Régions Françaises
Les Résistances Parcours pédagogiques Lycée Dossiers d’accompagnement de la collection de web-documentaires sur la Résistance dans les régions françaises [En ligne] http://lesresistances.france3.fr AGIR Sommaire 3 CÔTÉ PROF 4 La Résistance, entre histoire et mémoires 6 Les Résistances et les programmes d’enseignement au collège et au lycée 8 Le webdocumentaire, un outil pour enseigner l’histoire 9 Les Résistances, médiagraphie sélective 11 ÉPISODE N° 1 LE GRAND LIMOUSIN, L’ESPRIT DE RÉSISTANCE 12 Questions 14 Éléments de réponse 19 ÉPISODE N° 2 CORSE, GARDE À VOUS ! 20 Questions 22 Éléments de réponse 26 ÉPISODE N° 3 DU NORD À LA VENDÉE, AUX PORTES DE LONDRES 27 Questions 29 Éléments de réponse 33 ÉPISODE N° 4 DES ALPES À LA MÉDITERRANÉE, LES RÉSISTANCES UNIFIÉES 34 Questions 37 Éléments de réponse 43 ÉPISODE N° 5 DES ARDENNES AU JURA, AUX PORTES DE L’ALLEMAGNE NAZIE 44 Questions 47 Éléments de réponse 54 ÉPISODE N° 6 DU MASSIF CENTRAL À LA MÉDITERRANÉE, RÉSISTER ! NE PAS COLLABORER 55 Questions 57 Éléments de réponse 63 ÉPISODE N° 7 DU POITOU AUX PYRÉNÉES, LES COMBATS D’UNE RÉSISTANCE PLURIELLE 64 Questions 66 Éléments de réponse 72 ÉPISODE N° 8 PARIS-CENTRE-BOURGOGNE, LE COMBAT POUR LE PROGRÈS ET LA LIBERTÉ 73 Questions 76 Éléments de réponse Les Résistances parcours pédagogique lycée Côté prof – La Résistance, entre histoire et mémoires – Les Résistances et les programmes d’enseignement au collège et au lycée – Le webdocumentaire, un outil pour enseigner l’histoire – Les Résistances, médiagraphie sélective LES RÉSISTANCES PArcOURS PÉDAGOGIQUE LYCÉE La Résistance, entre histoire et mémoires Histoire et mémoire constituent deux modes privilégiés de relation avec le passé, deux approches complémentaires mais en réalité fondamentalement différentes ; la première se veut une démarche scientifique basée sur une problématique destinée à reconstituer ce qui n’est plus, à redonner vie à un passé qui a laissé des traces, des documents et des archives. -

Glières, Première Bataille De La Résistance
1 GLIERES, « PREMIERE BATAILLE DE LA RESISTANCE ». Le texte ci-après reprend très largement les éléments de synthèse figurant sur le site www.glieres-resistance.org ouvert par l’Association des Glières à l’occasion du 64ème anniversaire des événements de mars 1944. Comme c’est souvent le cas, en dépit de la notoriété nationale des combats des Glières, connus comme l’un des hauts faits de la Résistance, rares sont ceux qui en ont une connaissance précise, voire exacte. Pour un grand nombre, la confusion avec le Vercors est fréquente (dans les deux cas, il s’agit d’un Plateau, situé dans les Alpes). Pour d’autres, là où on a pu célébrer une « épopée », les faits seraient infiniment plus modestes et leur relation relèverait de la légende. On a par ailleurs souvent retenu l’idée de « sacrifice », les uns pour le célébrer, les autres pour dénoncer là une erreur stratégique et tactique. En fait, selon André Malraux, Glières « est une simple et belle histoire ». Cette histoire, dans sa vérité, c’est celle, entre janvier et mars 1944, du rassemblement au Plateau des Glières, au cœur de la Haute-Savoie, de plusieurs centaines de maquisards, essentiellement de l’Armée Secrète (AS), mais aussi des Francs-Tireurs Partisans (FTP), sous les ordres du lieutenant Morel, dit Tom, puis, après la mort de celui-ci, du capitaine Anjot, tous deux du 27ème Bataillon de Chasseurs Alpins (BCA), pour y réceptionner les parachutages d’armes massifs dont les maquis du département avaient un impérieux besoin. C’est celle de leur combat inégal, d’abord contre les forces de Vichy, puis contre une division de la Wehrmacht, jusqu’à leur esquive et à leur dispersion à la fin mars, qui se soldera par la mort de plus d’une centaine d’entre eux. -

Ingo Wille Transport in Den Tod Von Hamburg-Langenhorn in Die
Ingo Wille Transport in den Tod Von Hamburg-Langenhorn in die Tötungsanstalt Brandenburg Lebensbilder von 136 jüdischen Patientinnen und Patienten Mit Beiträgen von Nelly Birgmeier Sigurd Brieler Björn Eggert Ursula Häckermann Maria Koser Heidemarie Kugler-Weiemann Georg Lilienthal Margot Löhr Susanne Lohmeyer Klaus Möller Gunhild Ohl-Hinz Anika Reineke Susanne Rosendahl Frauke Steinhäuser Hildegard Thevs Schülerinnen des Beruichen Gymnasiums „Der Ravensberg“, Klasse 11e, Kiel, mit Unterstützung durch die ver.di-Projektgruppe (2010) wille_deportationen_fahnen_druck.indd 1 25.09.2017 13:58:08 wille_deportationen_fahnen_druck.indd 2 25.09.2017 13:58:08 Ingo Wille Transport in den Tod Von Hamburg-Langenhorn in die Tötungsanstalt Brandenburg Lebensbilder von 136 jüdischen Patientinnen und Patienten wille_deportationen_fahnen_druck.indd 3 25.09.2017 13:58:08 Die Landeszentrale für politische Bildung ist Die Büroräume benden sich in der Teil der Behörde für Schule und Berufsbildung der Dammtorstraße 14, 20354 Hamburg. Freien und Hansestadt Hamburg. Ein pluralistisch zusammengesetzter Beirat sichert die Überpartei- Der Informationsladen ist im lichkeit der Arbeit. Dammtorwall 1, 20354 Hamburg. Öffnungszeiten des Informationsladens: Zu den Aufgaben der Landeszentrale für politische Montag bis Donnerstag: 12.30 Uhr bis 17.00 Uhr, Bildung gehören: Freitag: 12.30 Uhr bis 16.30 Uhr Erreichbarkeit: Telefon: (040) 42823 - 4808 – Herausgabe eigener Schriften Telefax: (040) 427 31 0673 – Erwerb und Ausgabe von themengebundenen Publikationen E-Mail: [email protected] – Koordination und Förderung der politischen Internet: www.hamburg.de/politische-bildung Bildungsarbeit – Beratung in Fragen politischer Bildung Die Verfasserinnen/Verfasser haben die Bildrechte – Zusammenarbeit mit Organisationen und eingeholt. Sollte dies nicht in allen Fällen möglich Vereinen gewesen sein, bitten wir die Rechteinhaber, sich – Finanzielle Förderung von Veranstaltungen an die Landeszentrale zu wenden.