« L'affaire Regeni »
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
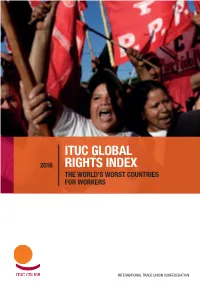
ITUC Global Rights Index WORKERS for COUNTRIES WORST WORLD's THE
ITUC GLOBAL 2016 RIGHTS INDEX THE WORLD’S WORST COUNTRIES FOR WORKERS D/2015/11.962/9 ITUC International Trade Union Confederation 5 Bd Roi Albert II, Bte 1 – B-1210 Brussels, Belgium Tel.: + 32 2 224 02 11 – Fax: +32 2 224 02 97 E-mail: [email protected] – www.ituc-csi.org PUBLISHER RESPONSIBLE IN LAW: Sharan Burrow, General secretary INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION THE WORLD'S WORST COUNTRIES FOR WORKERS The 2016 ITUC Global Rights Index | 2 The International Trade Union Confederation (ITUC) is a confederation of national trade union centres, each of which links trade unions of that particular country. It was established on 1 November 2006, bringing together the organisations which were formerly affiliated to the ICFTU and WCL (both now dissolved) as well as a number of national trade union centres which had no international affiliation at the time. The new Confederation has 333 affiliated organisation in 162 countries and territories on all five continents, with a membership of 180 million, 40 per cent of whom are women. It is also a partner in “Global Unions” together with the Trade Union Advisory Committee to the OECD and the Global Union Federations (GUFs) which link together national unions from a particular trade or industry at international level. The ITUC has specialised offices in a number of countries around the world, and has General Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations. The 2016 ITUC Global Rights Index | 4 Foreword .............................................7 Kenya .................................................62 -

The Italian Approach to Libya
Études de l’Ifri "PLAYING WITH MOLECULES" The Italian Approach to Libya Aldo LIGA April 2018 Turkey/Middle East Program The Institut français des relations internationales (Ifri) is a research center and a forum for debate on major international political and economic issues. Headed by Thierry de Montbrial since its founding in 1979, Ifri is a non-governmental, non-profit organization. As an independent think tank, Ifri sets its own research agenda, publishing its findings regularly for a global audience. Taking an interdisciplinary approach, Ifri brings together political and economic decision-makers, researchers and internationally renowned experts to animate its debate and research activities. The opinions expressed in this text are the responsibility of the author alone. ISBN: 978-2-36567-861-2 © All rights reserved, Ifri, 2018 Cover: “A scratched map of Libya hanging on the walls inside a reception centre for unaccompanied and separated migrant and refugee minors in Western Sicily”. © Aldo Liga. How to quote this document: Aldo Liga, “‘Playing with Molecules’: The Italian Approach to Libya”, Études de l’Ifri, Ifri, April 2018. Ifri 27 rue de la Procession 75740 Paris Cedex 15 – FRANCE Tel.: +33 (0)1 40 61 60 00 – Fax: +33 (0)1 40 61 60 60 Email: [email protected] Website: Ifri.org Author Aldo Liga is a freelance analyst on Middle East and North Africa issues and energy. He works for a Swiss-NGO which implements assessment, monitoring & evaluation and organisational capacity-building programmes. He holds a MA in International Security from Sciences Po Paris and a BA in Political Science from the “Cesare Alfieri” School of Political Sciences of Florence. -
Identity Crisis in Italy This Page Intentionally Left Blank IDENTITY CRISIS in ITALY
168 25 168 Spurred by ongoing conflicts between city-states and the nobility, unification for Italy was a gradual and difficult process. While such divisions shortly subsided to allow the peninsula to become unified, Italy has always been troubled by the difficulties of cultivating a national identity. Identity Crisis Throughout the past and in the present, Italy has been a nation of division. But recently this division has become deeper because of the growing differences between the various parts of the country caused by ITALY IN DENTITY CRISIS unresolved political, institutional, economic and secu- rity problems. The need for academic discourse on the in Italy division encouraged scholars to cooperate and identify the most important causes and elements of the Ital- ian identity crisis such as the political crisis caused by feelings of lack, instability or injustice, the economic 238 and financial crises leading to the erosion of social cohesion and the insecurity linked to immigration. This book presents the result of this dialogue. Fanni Tanács-Mandák (ed.): I (ed.): Tanács-Mandák Fanni The work was created in commission of the National University of Public Service under the priority project PACSDOP-2.1.2- CCHOP-15-2016-00001 entitled “Public Service Development Establishing Good Governance.” Edited by: FANNI TANÁCS-MANDÁK European Social Fund INVESTING IN YOUR FUTURE Identity Crisis in Italy This page intentionally left blank IDENTITY CRISIS IN ITALY Edited by Fanni Tanács-Mandák Dialóg Campus Budapest, 2019 The work was created in commission of the National University of Public Service under the priority project PACSDOP-2.1.2- CCHOP-15-2016-00001 entitled “Public Service Development Establishing Good Governance”. -

The Populist Challenges to the EU Foreign and Security Policy Towards Egypt and Tunisia: a Case of De-Europeanisation?
The populist challenges to the EU foreign and security policy towards Egypt and Tunisia: A case of de-Europeanisation? Adrià Rivera Escartinab Abstract At a time when populism conquers political agendas in the European Union (EU) and elsewhere, it is pertinent to scrutinize which are the policy implications of such a surge for the EU, not only intra-institutionally, but also for its foreign and security policy in third country contexts. Populist parties in government, such as for example the Lega or Fidesz have a declared interest in the European Neighbourhood Policy (ENP) in Northern Africa. Their main focus centre around the importance they give to migration control, border management and the security sector in these countries. It is thus relevant to investigate to what extent populism is shaping the thinking about the ENP as it is evolving from a normative-based towards a much more “interest-based” policy. This paper will examine the implications of populist pressure on the ENP in third country contexts, using Tunisia and Egypt for in-depth case studies. In the case of Tunisia, Italian demands for more Tunisian efforts on border management have exacerbated inconsistencies in EU-Tunisia liberalization efforts. The case of Egypt has been one of parallel and separate discussions of the European Council/EU Presidency and of the Visegrad group headed by Hungary on matters relating to regional security as well as migration. The ENP’s coherence and effectiveness has suffered as a consequence. The paper also aims to contribute conceptually to current debates on de-Europeanisation or not of the EU foreign and security policy. -

Il Caso Regeni Nell'egitto Di Al-Sīsī: Ricadute Nazionali E Internazionali
Corso di Laurea Magistrale in Lingue, Economie e Istituzioni dell’Asia e dell’Africa Mediterranea (ordinamento ex D.M. 270/2004) Tesi di Laurea Il caso Regeni nell’Egitto di al-Sīsī: ricadute nazionali e internazionali Relatore Ch.ma Prof.ssa Barbara De Poli Correlatore Ch.ma Prof.ssa Patrizia Zanelli Laureando Lucia Pastorino Matricola 846471 Anno Accademico 2017 / 2018 1 Indice: Muqaddima ....................................................................................................................................... 3 Introduzione ..................................................................................................................................... 7 1 Chi era Giulio Regeni e perché il suo omicidio è diventato un caso diplomatico ...................... 10 1.1 La sparizione e il ritrovamento del corpo ............................................................................. 10 1.2 Dal “caso isolato” al caso diplomatico ................................................................................. 18 2 Il contesto politico egiziano del 25 gennaio 2016 ....................................................................... 19 2.1 La “primavera araba” egiziana ............................................................................................. 19 2.2 La fine delle proteste e l’ascesa dei militari ......................................................................... 25 2.3 L’avvento di al-Sīsī e la transizione democratica ................................................................. 26 2.4 I servizi -

The Functioning of Diplomatic Protection and the Case of Giulio Regeni
Master’s Degree programme – Second Cycle (D.M.270/2004) in Comparative International Relations Final Thesis The functioning of diplomatic protection and the case of Giulio Regeni Supervisor Ch. Professor Sara De Vido Assistant supervisor Ch. Arianna Vettorel Graduand Sofia Franceschini 854168 Academic Year 2019/2020 1 2 Be the change you want to see in the world 3 TABLE OF CONTENTS Abstract……………………………………………………………………………..pg 8 Abbreviations……………………………………………………………………….pg 14 Introduction………………………………………………………………………....pg 16 Chapter I – Diplomatic Protection: the origins……………………………………..pg 20 Premise……………………………………………………………………..pg 20 1. Diplomatic Protection: an historical overview……………………………pg 21 2. The Calvo Doctrine: diplomatic protection as a weapon for supremacy....pg 29 3. The diplomatic protection of individuals and their properties, as one of the raison d’être of diplomatic and consular relations…………………………….……………………………………..pg 36 4. The State internationally responsible for a wrongful act and the mechanism of diplomatic protection: two sides of the same coin?....................................pg 40 Chapter II – Diplomatic Protection: an explanation of the conditions necessary for its invocation…………………………………………………………………………..pg 56 Premise……………………………………………………………………..pg 56 1. The evolution of the concept of nationality as a precondition for a State to act on behalf of an individual injured abroad………………………………pg 57 2. The European Citizenship enforcing the right of diplomatic protection on behalf of European citizens: the dilemma between consular and diplomatic protection……………………………………………………………….pg 71 3. The rule of prior exhaustion of local remedies: an outdated customary principle?.................................................................................................pg 78 4 4. The clean hands doctrine: a principle of international law excluded from the Draft Articles on Diplomatic Protection………………………………..pg 83 5. The use of force to protect citizens abroad applied to implement the mechanism of diplomatic protection. -
En En Motion for a Resolution
European Parliament 2014-2019 Plenary sitting B8-0377/2016 8.3.2016 MOTION FOR A RESOLUTION with request for inclusion in the agenda for a debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law pursuant to Rule 135 of the Rules of Procedure on Egypt, notably the case of Giulio Regeni (2016/2608(RSP)) Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Lynn Boylan, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric on behalf of the GUE/NGL Group RE\P8_B(2016)0377_EN.doc PE579.790v01-00 EN United in diversity EN B8-0377/2016 European Parliament resolution on Egypt, notably the case of Giulio Regeni (2016/2608(RSP)) The European Parliament, - having regard to its previous resolutions on Egypt, in particular on freedom of expression and assembly in Egypt (17/07/2014), on the situation in Egypt (15/01/2015) and on the case of Ibrahim Halawa, potentially facing the death penalty (16/12/2015) - having regard to the EU Foreign Affairs Council conclusions on Egypt of August 2013 and February 2014; - Having regard to the EU-Egypt Association Agreement; - having regard to the EU Guidelines on the Death Penalty and on Torture and other Forms of Ill-Treatment; - having regard to the Constitution of Egypt, notably articles 52 (prohibition of torture -

Jesus Votes in Cockerel
e Independent Student Newspaper Issue 806 Friday 19th February 2016 Published in Cambridge since 1947 www.varsity.co.uk 3 News: May Week controversies 6 News: Vince Cable interview 18 Culture: e-Luminate 24-25 Fashion: CUCFS Homerton cancels bops after student damage Jack Hggns & Tom Freeman Homerton College has cancelled all bops for the rest of the academic year after excrement, urine and vomit were found after a bop held at the college. An email sent to undergraduates at the college claims that a bop that took place on Saturday 13th February caused damage worth a four-fi gure sum. Both accommodation blocks and the Mary Allan Building (MAB), which houses both the Porters’ Lodge and the college library, suff ered damage after the party organised by the college’s JCR. In the email, the Bursar, Deborah Griffi n, said that the college was “shocked and disappointed” at the stu- dents’ behaviour. “ e HUS [Homerton Union of Students] Committee have worked ex- ‘Positive repatriation process’: Students debated last night on proposals to return Jesus College’s Benin Bronze cockerel to Nigeria ceptionally hard to ensure that these events are safe and enjoyable,” Griffi n said. “However, the subsequent noise and damage caused by some students, in- cluding excrement, urine and vomit found across several of the residences Jesus votes in cockerel row and MAB, is unacceptable.” e damage during the bop, enti- Joe Robnson the committee set forth detailed plans Jesus since 1930 was recovered from He emphasised the need for a “posi- tled ‘Homerton’: e Great Unknown Senor News Edtor for “returning [the Benin Bronze] the royal palace of the Oba during the tive repatriation process” and sought Summer Ball Launch’ which was held to its place of origin”. -

Questions and Answers Before the Shareholders' Meeting 2017
Cover e ultima pagina gialla ITA.pdf 1 12/04/17 14:45 Eni SpA Ordinary Shareholders' Meeting 13 April 2017 Answers to the questions received prior to the Shareholders' Meeting, pursuant to art. 127-ter of Italian Legislative Decree No. 58/1998 C M Y CM MY CY CMY K The Italian text prevails over the English translation. Ordinary Shareholders’ Meeting of Eni SpA on 13th April 2017 Replies to questions submitted before the Shareholders’ Meeting under Art. 127-ter of Italian Legislative Decree No. 58/1998 Page Marco Bava………………………………………………………………………………………………………….…….…2 Fondazione Culturale Responsabilità Etica……………………………………………………………….……..37 Jacopo Fo…………………..………………………………………………………………………………………….…….65 Investimenti Sud Italia ………………………………………………………………………………………….…….66 Marinella Garino………………….………………………………………………………………………………..........84 Tommaso Marino……….……..………………………………………………………………………………………….87 1 Shareholders’ Meeting 2017 SHAREHOLDER MARCO BAVA 1) 8th January 2017 - the President of the Republic of Egypt, Abdel Fattah el-Sisi, and Eni’s Chief Executive Officer, Claudio Descalzi, met a few days ago in Cairo. The meeting was an opportunity to analyse the extensive activity carried out by Eni in Egypt, with an overall investment in the country of $2.7 billion in 2016. During the meeting, the CEO Descalzi and President el-Sisi discussed the progress of work on development of the Zohr oil field. The project is progressing extremely rapidly, in line with expectations, and start of production at the end of 2017 was confirmed. Does Eni intend to take a stance on the murder of Regeni? Reply Giulio Regeni was a victim of a terrible crime that horrified us all. It is vital that light be brought to bear on this matter and we hope that the work of the judicial authorities and governments of Egypt and Italy does just that. -

Your Ad Here Your Ad Here
Eye on the News [email protected] Truthful, Factual and Unbiased Vol:X Issue No:201 Price: Afs.15 www.afghanistantimes.af www.facebook.com/ afghanistantimes www.twitter.com/ afghanistantimes SATURDAY. FEBRUARY 20. 2016 -Hoot 01, 1394 HS Yo ur Yo ur ad ad he re he re 0778894038 0778894038 ISLAMABAD: The Senate was informed on Thursday that at present 1.55 million registered Afghan Refugees are residing in Pakistan. Minis- ter for States and Frontier Region Abdul Qadir Baloch told the House during the question hours, that the Prime Minister recently extended the legal stay of registered Afghan refugees till 30th of June this year. How- ever, there is also a proposal for extension of these refugees for till the end of next year. The Minister said since 2002, 3.9 million Afghan refugees have been repatriated to their homeland. Replying to a supple- By Ali M. Latifi and Shashank Bengali mentary, he said Pakistan has commitment with the international com- munity to repatriate Afghan Refugees with dignity and honour. He said As military and political setbacks sition to negotiations. Meanwhile, of its longtime leader, Mullah Mo- regarded as solidly in government the guns, it’s us who have fought the issue of repatriation has repeatedly been taken up with the Afghan mount, Afghanistan’s embattled the Taliban has papered over a lead- hammed Omar, and gained strength hands. “Right now, they are think- for more than 20 years,’” Massoud government but it has expressed inability to provide necessary facilities president, Ashraf Ghani, has in- ership crisis following the death in northern and southern areas once ing: ‘We have the territory, we have said of the Taliban. -
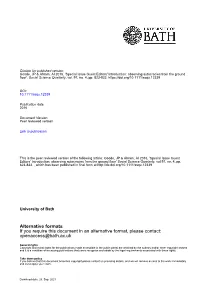
01 Introduction
Citation for published version: Goode, JP & Ahram, AI 2016, 'Special Issue Guest Editors' Introduction: observing autocracies from the ground floor', Social Science Quarterly, vol. 97, no. 4, pp. 823-833. https://doi.org/10.1111/ssqu.12339 DOI: 10.1111/ssqu.12339 Publication date: 2016 Document Version Peer reviewed version Link to publication This is the peer reviewed version of the following article: Goode, JP & Ahram, AI 2016, 'Special Issue Guest Editors' Introduction: observing autocracies from the ground floor' Social Science Quarterly, vol 97, no. 4, pp. 823-833. , which has been published in final form at http://dx.doi.org/10.1111/ssqu.12339 University of Bath Alternative formats If you require this document in an alternative format, please contact: [email protected] General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 29. Sep. 2021 Special Issue Editors’ Introduction: Observing Autocracies from the Ground Floor* J. Paul Goode, University of Bath Ariel I. Ahram, Virginia Tech University Writers, artists, and teachers have long understood that repressive governments manipulate the ways we understand them, twisting knowledge and education to their own ends. In seeking to justify their existence, the Soviet Union, Nazi Germany, and Mao’s China (to name a few) generated national histories, educational systems, and scientific doctrines in line with official ideologies. -
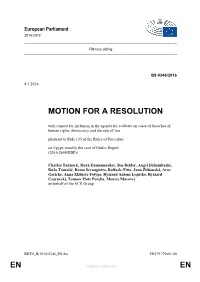
En En Motion for a Resolution
European Parliament 2014-2019 Plenary sitting B8-0346/2016 8.3.2016 MOTION FOR A RESOLUTION with request for inclusion in the agenda for a debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law pursuant to Rule 135 of the Rules of Procedure on Egypt, notably the case of Giulio Regeni (2016/2608(RSP)) Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei on behalf of the ECR Group RE\P8_B(2016)0346_EN.doc PE579.779v01-00 EN United in diversity EN B8-0346/2016 European Parliament resolution on Egypt, notably the case of Giulio Regeni (2016/2608(RSP)) The European Parliament, - having regard to its previous resolutions on Egypt, in particular that of 17 December 2015 and that of 15 January 2015; - having regard to the 1948 Universal Declaration of Human Rights; - having regard to the 1966 International Covenant on Civil and Political Rights, to which Egypt is a party; - having regard to the Arab Charter on Human Rights, to which Egypt is a party; - having regard to the Constitution of the Arab Republic of Egypt; - having regard to the EU-Egypt Association Agreement of 2004; - having regard to the European Neighbourhood Policy and the most recent progress report on Egypt of 25 March 2015; - having regard to the results of the Egyptian Parliamentary elections of October and December 2015; - having regard to Rule 123 of its Rules of Procedure; A. Whereas Giulio Regeni was a 28-year-old Italian PhD student at Cambridge University conducting research on Egypt’s labour movements; B.