Rapport Burundi & Rwanda 2013
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Boletim Da Sociedade De Geografia De Lisboa
BOLETIM DA SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA SÉRIE 133 - N.OS 1-12 JANEIRO - DEZEMBRO - 2015 SUMÁRIO A SOCIEDADE DE GEOGRAFIA E O CONCEITO ESTRATÉGICO NACIONAL // LUCIANO CORDEIRO NO CONTEXTO DA ÉPOCA DA FUNDAÇÃO DA SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA // O PAPEL DA SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA NA DELIMITAÇÃO DAS FRONTEIRAS DAS ANTIGAS COLÓNIAS PORTUGUESAS EM ÁFRICA E DE TIMOR // A SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA E AS EXPLORAÇÕES GEOGRÁFICAS DE ANGOLA À CONTRA COSTA // A SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA E AS CIÊNCIAS SOCIAIS // O VALOR DO BOLETIM DA SOCIEDADE DE GEOGRAFIA PARA A HISTÓRIA DE PORTUGAL // A SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA, A MARINHA E O MAR // O ESPÓLIO CULTURAL DA SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA: A BIBLIOTECA, A CARTOTECA, A FOTOTECA E O MUSEU ETNOGRÁFICO E HISTÓRICO // OS LITERATOS NA SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA // OS 140 ANOS DA SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA // CONDECORAÇÃO // PRÉMIO GAGO COUTINHO // IN MEMORIAM ÓSCAR SOARES BARATA // A ALEGRIA DE CONHECER // DOCUMENTOS SOLTOS INÉDITOS SOBRE GAGO COUTINHO // ACTIVIDADES DA SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA // ACTIVIDADES DA BIBLIOTECA // ACTIVIDADES DO MUSEU ETNOGRÁFICO REDACÇÃO E ADMINISTRAÇÃO NA S.G.L., RUA DAS PORTAS DE SANTO ANTÃO LISBOA-PORTUGAL BOLETIM DA SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA Esta publicação contou com o apoio do Ministério da Defesa Nacional – Exército Português do Secretário de Estado da Cultura – Fundo de Fomento Cultural e da Fundação Eng. António de Almeida Série 133 - N.os 1-12 Janeiro - Dezembro - 2015 SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA Direcção PRESIDENTE Prof. Cat. Luis António Aires-Barros VICE-PRESIDENTES Comandante Filipe Mendes Quinto Almirante Nuno Gonçalo Vieira Matias TGen. -

Universidade De São Paulo Faculdade De Educação Reverberações Do Debate Decadência
Universidade de São Paulo Faculdade de Educação Reverberações do debate decadência/atraso em Portugal e no Brasil em fins dos Oitocentos: histórias conectadas Roni Cleber Dias de Menezes São Paulo 2011 Reverberações do debate decadência/atraso em Portugal e no Brasil em fins dos Oitocentos: histórias conectadas Roni Cleber Dias de Menezes Tese de doutorado apresentada à Banca Examinadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, como exigência parcial para a obtenção do título de Doutor em Educação, , sob a orientação da Profª. Drª. Maria Lúcia Spedo Hilsdorf. São Paulo 2011 AUTORIZO A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE TRABALHO, POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO, PARA FINS DE ESTUDO E PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE. Catalogação na Publicação Serviço de Biblioteca e Documentação Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo 371.305 Menezes, Roni Cleber Dias M543r Reverberações do debate decadências/atraso em Portugal e no Brasil em fins dos oitocentos: histórias conectadas. orientação Maria Lúcia Spedo Hilsdorf São Paulo: s.n., 2011. 232 p.; Dissertação (Doutorado – Programa de Pós-Graduação em Educação. Área de Concentração: História da Educação e Historiografia) - - Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. 1. Intelectuais 2.Decadência (Portugal) I.Hilsdorf, Maria Lúcia Spedo orient. MENEZES , Roni Cleber Dias de. Reverberações do debate decadência/atraso em Portugal e no Brasil em fins dos Oitocentos: histórias conectadas . São Paulo, FEUSP, -

The Book of Burtoniana
The Book of Burtoniana Letters & Memoirs of Sir Richard Francis Burton Volume 2: 1865-1879 Edited by Gavan Tredoux i [DRAFT] 8/26/2016 4:36 PM © 2016, Gavan Tredoux. http://burtoniana.org. The Book of Burtoniana: Volume 1: 1841-1864 Volume 2: 1865-1879 Volume 3: 1880-1924 Volume 4: Register and Bibliography Contents. LIST OF ILLUSTRATIONS. .................................................................................... VIII 1865-1869. ........................................................................................................... 1 1. 1865/—/—? RICHARD BURTON TO SAMUEL SHEPHEARD....................................... 1 2. 1865/01/01? ISABEL BURTON TO MONCKTON MILNES. ........................................ 1 3. 1865/01/03. KATHERINE LOUISA (STANLEY) RUSSELL............................................ 2 4. 1865/01/07. LORD JOHN RUSSELL..................................................................... 3 5. 1865/01/08. LORD JOHN RUSSELL..................................................................... 4 6. 1865/01/09. LORD JOHN RUSSELL..................................................................... 5 7. 1865/01/09. KATHERINE LOUISA (STANLEY) RUSSELL............................................ 5 8. 1865/02/09. ISABEL BURTON TO MONCKTON MILNES. ......................................... 5 9. 1865/04/22. RICHARD BURTON TO FRANK WILSON. ............................................ 6 10. 1865/05/02? RICHARD BURTON TO JAMES HUNT. ........................................... 7 11. 1865/06/02. FREDERICK HANKEY TO MONCKTON -

The Slave Trade and the Origins of Mistrust in Africa
The Slave Trade and the Origins of Mistrust in Africa Nathan Nunn∗‡ Harvard University and NBER Leonard Wantchekon∗§ New York University November 2009 ABSTRACT: We investigate the historical origins of mistrust within Africa. Combining contemporary household survey data with historic data on slave shipments by ethnic group, we show that individuals whose ancestors were heavily raided during the slave trade today exhibit less trust in neighbors, relatives, and their local government. We confirm that the relationship is causal by using the historic distance from the coast of a respondent’s ancestors as an instrument for the intensity of the slave trade, while controlling for the individ- ual’s current distance from the coast. We undertake a number of falsification tests, all of which suggest that the necessary exclusion restriction is satisfied. Exploiting variation among individuals who live in locations different from their ancestors, we show that most of the impact of the slave trade works through factors that are internal to the individual, such as cultural norms, beliefs, and values. ∗We thank the editor Robert Moffitt and two referees for comments that substantially improved the paper. We are also grateful to Daron Acemoglu, Michael Bratton, Alejandro Corvalan, William Darity, William Easterly, James Fenske, Patrick Francois, Avner Greif, Joseph Henrich, Karla Hoff, Joseph Inikori, Petra Moser, Elisabeth Ndour, Ifedayo Olufemi Kuye, Torsten Persson, Warren Whatley, and Robert Woodberry for valuable comments, as well as seminar participants at Boston University, Columbia University, Dalhousie University, Dartmouth College, Georgia Tech, Harvard Business School, Harvard University, LSE, MIT, Simon Fraser University, UCL, University of Michigan, Universitat Pompeu Fabra-CREI, University of Alberta, University of British Columbia, Warwick University, Yale University, ASSA Meetings, EHA meetings, NBER Political Economy Program Meeting, and Sieper’s SITE conference. -

Do Minho Ao Mandovi
Do Minho ao Mandovi: um estudo sobre o pensamento colonial de Norton de Matos Autor(es): Neto, Sérgio Publicado por: Imprensa da Universidade de Coimbra URL persistente: URI:http://hdl.handle.net/10316.2/39869 DOI: DOI:https://doi.org/10.14195/978-989-26-1173-0 Accessed : 5-Oct-2021 11:11:50 A navegação consulta e descarregamento dos títulos inseridos nas Bibliotecas Digitais UC Digitalis, UC Pombalina e UC Impactum, pressupõem a aceitação plena e sem reservas dos Termos e Condições de Uso destas Bibliotecas Digitais, disponíveis em https://digitalis.uc.pt/pt-pt/termos. Conforme exposto nos referidos Termos e Condições de Uso, o descarregamento de títulos de acesso restrito requer uma licença válida de autorização devendo o utilizador aceder ao(s) documento(s) a partir de um endereço de IP da instituição detentora da supramencionada licença. Ao utilizador é apenas permitido o descarregamento para uso pessoal, pelo que o emprego do(s) título(s) descarregado(s) para outro fim, designadamente comercial, carece de autorização do respetivo autor ou editor da obra. Na medida em que todas as obras da UC Digitalis se encontram protegidas pelo Código do Direito de Autor e Direitos Conexos e demais legislação aplicável, toda a cópia, parcial ou total, deste documento, nos casos em que é legalmente admitida, deverá conter ou fazer-se acompanhar por este aviso. pombalina.uc.pt digitalis.uc.pt DO minho ao mandovi um estudo sobre o pensamento colonial de norton de matos SÉRGIO NETO SÉRGIO NETO licenciou-se em História, pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, em 2000, com a média final mais alta desse ano, tendo-lhe sido atribuído o Prémio Eng.º António de Almeida. -
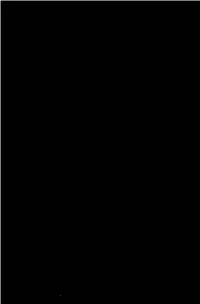
Hg-15911-V 0000 1-352 T24-C-R0150.Pdf
EXPOSIÇÃO HISTÓRICA DA OCUPACÃO / II VOLUME agência geral das colónias 19 3 7 da EXPOSIÇÃO HISTÓRICA DA OCUPAÇÃO DEP. LEG. ' ;ír 0 \\ km s REPÚBLICA PORTUGUESA MINISTÉRIO DAS COLÓNIAS /V r,,i t EXPOSIÇÃO HISTÓRICA DA OC UPAÇAO II VOLUME AGÊNCIA GERAL DAS COLÓNIAS 19 3 7 ? 6 IC O 1.A GALERIA PENETRAÇÃO E POVOAMENTO ENETRAÇÃO, povoamento... — mas é tôda a coloni- zação! Obra que não é de hoje, nem de um século, — mas que começa no próprio dia da invenção pelos portu- gueses do Mundo até at ignorado. Chegados os navegadores até às novas paragens povoa- das, logo a ânsia lusíada buscava inquietamente descobrir, depois das terras, as riquezas, as gentes e os costumes; e nunca houve curiosidade mais viva e audaz, nem sensações mais frescas e perturbantes que as dos soldados, dos missio- nários, dos aventureiros portugueses entranhados na rudeza da barbarie ou no mistério subtil de milenárias civilizações. Levados pelo espirito de aventura, pelo ardor evan- gélico ou pela cobiça do oiro, ei-los que navegam rios e esca- lam montes, que travam relações com indígenas, que se em- brenham em florestas inexploradas, que palmilham a Pérsia, a China e o Japão, vivendo incríveis lances e triunfando por admiráveis rasgos. 7 Assim correu a fase heróica da penetração, de carácter sobretudo individual: quantas vezes um só português não conquista, pela persuação e pelo prestígio pessoal, tribus e reinos para os vir depor aos pés do seu rei! É que no cora- ção de cada um dêsses arrojados exploradores iam, inteiras, as aspirações imperiais e os ideais da civilização da sua pátria! Mas a penetração não se féz só assim, caprichosamente, ao sabor da imaginação e da vontade de portugueses isolados: também revestiu outras vezes aspecto metódico, seguindo um plano, ora por meio de entendimentos diplomáticos com os soberanos locais, ora por lenta infiltração pacífica, ora sob a forma de expedições punitivas ou visando a mera afirmação de poderio. -
Carregadores, Guias E Caçadores: Trabalho E Resistência Na Expedição Portuguesa Ao Interior Da África (1884 - 1885)
Carregadores, guias e caçadores: trabalho e resistência na expedição portuguesa ao interior da África (1884 - 1885) Antônio José Alves de Oliveira Doutorando do Programa de Pós-Graduação em História Cultural na Univer- sidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Bolsista da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). Graduado em História pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e Mestre pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Ênfase em pesquisas na área de História Ambiental, principalmente no que concerne às ideias, valores e percepções do mundo natural na extensão do Império colonial português, na segunda metade do século XVIII. Endereço eletrônico: [email protected] José Nilo Bezerra Diniz Doutorando do Programa de Pós-Graduação em História Cultural na Universida- de Federal de Santa Catarina (UFSC). Graduado em História pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e Mestre pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Desenvolve trabalhos em História da África, principalmente no que concerne à movimentação dos reinos e impérios, hidrografi a e cartografi a ao longo do século XIX. Endereço eletrônico: [email protected] Durante a segunda metade do século XIX, pulularam ex- pedições científi cas na África, auspiciadas pelas então potências europeias, notadamente Inglaterra, França, Bélgica, Alemanha e Portugal. Essas incursões pelo interior do continente só foram possíveis pela presença de centenas de trabalhadores africanos, quer aqueles engajados em atividades logísticas, como o carre- gamento dos materiais científi cos, dos víveres, dos presentes e Revista de Ciências Sociais, Fortaleza, v. 46, n. 2, jul/dez, 2015, p. 93-115 94 ANTONIO JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA e JOSÉ NILO BEZERRA DINIZ dos produtos de troca; quer aqueles responsáveis pela caça e pelo preparo dos alimentos, além de intérpretes e guias. -
Ancient Coins
Ancient coins Greek 1 2 3 1 Thessalian League (late 2nd to mid 1st century BC), silver stater, magistrates Pausanias and Diodoros, hd. of Zeus right, wearing laurel wreath; EP to left, rev. Athena Itonia striding right; ΠAYΣ-ANIAΣ above spear, ΔI-O/Δ-Ω/P-OΣ in three lines across central fields, wt. 6.20gms. (BCD. Thessaly II 860; HGC.4, 209),about extremely fine £100-150 2 † Lycia, Pericles (c.390-360 BC), silver tetrobol, lion scalp facing, rev. triskeles, head of Hermes in field, wt. 3.12gms. (S.5242), authenticated and graded by NGC as Choice Very Fine - Strike 4/5, Surface 4/5 £250-300 3 Pamphylia, Aspendos, c.330/25-300/250 BC, silver stater, two wrestlers grappling; ΠO between, rev. slinger standing r., to r., forepart of horse above monogram, wt. 10.64gms. (Tekin Series 5; SNG. BN 110), lightly toned, very fine £200-250 *ex Kallman collection, Pegasi XVIII, 1 April 2008, lot 146 Roman 4 Faustina II (AD 161-164), denarius, FAVSTINA AVGVSTA, dr. bust r., rev. IVNONI REGINAE, Juno standing left holding patera and long sceptre; peacock at foot to left, wt. 3.30gms. (RIC.696); Lucilla (AD 163-181), denarius, LVCILLAE AVG ANTONINI AVG F, dr. bust r., rev. VOTA PVBLICA within laurel wreath, wt. 3.5gms. (RIC.791), about extremely fine (2) £100-200 5 Carausius (AD 286-293), denarius, IMP CARAVSIVS PF AVG, laur. dr. cuir. bust r., rev. ROMANO RENOVA, Capitoline she-wolf stg. r. nursing Romulus and Remus, in ex. RSR, wt. 4.30 gms. (RIC.572), uncleaned, good very fine £1500-2000 PAS recorded, Kent – 573662. -

“Para Depois Mostrar Aos Brancos Na Sua Terra”: Construindo O Império (Também) Através Da Literatura
“Para depois mostrar aos brancos na sua terra”: construindo o império (também) através da literatura Leonor Pires Martins No relato De Benguella às Terras de Iácca (1881), Hermenegildo Capelo e Roberto Ivens contam que, certo dia, ao dirigirem-se para o Cuango, receberam o convite de um chefe local para visitarem a sua aldeia. Chegados à casa do acerca do motivo das suas andanças por aquelas terras. Andavam em busca de anfitrião, os dois exploradores dispuseram-se a satisfazer a curiosidade indígena negativas, deixando o interlocutor africano cada vez mais intrigado. marfim?Capelo Queriam e Ivens comprar acabaram cera? então Gente? por Borracha? explicar queAs respostas viajavam sósucediam-se para “ver” e “escrever”, esclarecendo que as fazendas e missangas que transportavam serviam apenas como moeda de troca para a obtenção de mantimentos. “E para que servem esses escritos?”, quis ainda saber o chefe africano. “Para depois e Ivens 1881: 219-220, I volume). mostrar aos brancos na sua terra”, disseram,A pornarrativa fim, os exploradoresdeste encontro (Capelo bem pode ser lida como uma explicação graciosa de uma actividade literária que, do meu ponto de vista, ocupa um lugar intersticial na literatura de viagens ultramarinas. Capelo e Ivens não são já os viajantes-cronistas que metropolitanasrevelarão novas geografias, que os aguardam povos, floras com e expectativa.faunas, costumes O tempo e religiões das descobertas às audiências e da na obra destes “navegadores terrestres”, é já umexpansão tempo ultramarina, distante, há muito evocado documentado tão amiúde por uma vasta literatura descritiva e narrativa que apresentou várias formas, desde os grandes tratados históricos às (Fig. -

Portugal Volume
Histoire et Philatélie Le Portugal Dr. Guy COUTANT Volume III: Le Portugal des “ Descobrimentos “ 1 Le Portugal des “ Descobrimentos “ 2 Le Portugal des “ Descobrimentos “ I) Le temps des “ Descobrimentos “ II) Le prince Henrique, le Navigateur III) Les grands noms: - João Gonçalves Zarco - Tristão Vaz Teixeira - Bartolomeu Perestrelo - Diogo de Silves - Gonçalo Velho - Gil Eanes - Nuno Tristão - Diogo Gomes - João Vaz Corte-Real - Diogo Cão - Bartolomeu Dias - Pêro da Covilhã - Vasco da Gama - Duarte Pacheco Pereira - Pedro Àlvares Cabral - João da Nova - João de Lisboa - Fernão de Magalhães - Estevão Gomes - Pero Lopes de Sousa - João Rodrigues Cabrilho - João de Castro - Tomé de Sousa - Pedro Fernandes de Queirós - Bento de Góis - João Fernandes Vieira - Alexandre de Serpa Pinto - Roberto Ivens IV) Les derniers pionniers: la traversée de l’Atlantique Sud par Gago Coutinho et Sacadura Cabral 3 Le temps des “ Descobrimentos “ Le temps des découvertes commence au Portugal avec l’avénement de la dynastie d’Aviz, qui commence en 1385 avec João Ier, qui régna de 1385 à 1433. C’est avec lui que le Portugal commença à se développer pour devenir progessivement la plus grande puissance coloniale de l’époque. Mais le grand moteur de l’expansion fut sans conteste Henrique le Navigateur, un des fils de João Ier, qui, s’étant retiré à Sagres, à l’extrême pointe méridionale du Portugal, conseilla, dirigea, encouragea et paya pendant 40 ans un nombre incalculable d’aventuriers et de navigateurs, pour réaliser son rêve: acquérir les îles de l’Atlantique ( Madère, Açores, Cap Vert, etc. ), qui devaient servir de bases maritimes pour contourner l’Afrique du Sud et offrir ainsi une voie facile au commerce lucratif des épices. -

Dissertação. Marcos Coelho
Universidade Federal da Bahia Faculdade De Filosofia e Ciências Humanas Programa de Pós Graduação Multidisciplinar em Estudos Étnicos e Africanos MARCOS VINICIUS SANTOS DIAS COELHO O HUMANO, O SELVAGEM E O CIVILIZADO DISCURSO SOBRE A NATUREZA EM MOÇAMBIQUE COLONIAL, 1876-1918 Salvador, 2009 2 MARCOS VINICIUS SANTOS DIAS COELHO O HUMANO, O SELVAGEM E O CIVILIZADO DISCURSO SOBRE A NATUREZA EM MOÇAMBIQUE COLONIAL, 1876-1918 Dissertação apresentada ao Programa Multidisciplinar em Estudos Étnicos e Africanos, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia, como requisito para o grau de Mestre em Estudos Étnicos e Africanos. Orientador: Prof. Dr. Valdemir Donizette Zamparoni. Salvador 2009 3 Biblioteca CEAO–UFBA C672 Coelho, Marcos Vinicius Santos Dias. O humano, o selvagem e o civilizado: discursos sobre a natureza em Moçambique colonial 1876-1918 / por Marcos Vinicius Santos Dias Coelho. - 2009. 129f. Orientador: Profº Dr. Valdemir Zamparoni. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 2009. 1. Natureza e Civilização – Moçambique - História. 2. Moçambique – História – 1876-1918. 3. Moçambique - Civilização - Influências africanas. 4. Moçambique - Civilização - Influências européias. 5. Portugal - Colônias - África. I. Zamparoni, Valdemir, 1957- II. Universidade Federal da Bahia. Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. III. Título. CDD – 967.902 4 MARCOS VINICIUS SANTOS DIAS COELHO O HUMANO, O SELVAGEM E O CIVILIZADO DISCURSO SOBRE A NATUREZA EM MOÇAMBIQUE COLONIAL, 1876-1918 Dissertação apresentada ao Programa Multidisciplinar em Estudos Étnicos e Africanos, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia, como requisito para o grau de Mestre em Estudos Étnicos e Africanos. Salvador, ___ de Dezembro de 2009. -

Geological Exploration of Angola from Sumbe to Namibe
G Model CRAS2A-3287; No. of Pages 9 C. R. Geoscience xxx (2015) xxx–xxx Contents lists available at ScienceDirect Comptes Rendus Geoscience ww w.sciencedirect.com History of Sciences Geological exploration of Angola from Sumbe to Namibe: A review at the frontier between geology, natural resources and the history of geology a b, Pierre Masse , Olivier Laurent * a Total E&P Angola, Exploration Division, Kwanza Department, R. Rainha Ginga, Torre Total 2, Luanda, Angola b Total Exploration Division, Tour Coupole, 92078 Paris-La De´fense, France A R T I C L E I N F O A B S T R A C T Article history: This paper provides a review of the Geological exploration of the Angola Coast (from Received 6 June 2015 Sumbe to Namibe) from pioneer’s first geological descriptions and mining inventory to the Accepted after revision 23 September 2015 most recent publications supported by the oil industry. We focus our attention on the Available online xxx following periods: 1875–1890 (Paul Choffat’s work, mainly), 1910–1949 (first maps at country scale), 1949–1974 (detailed mapping of the Kwanza–Namibe coastal series), Handled by Isabelle Manighetti 1975–2000, with the editing of the last version of the Angola geological map at 1:1 million Keywords: scale and the progressive completion of previous works. Since 2000, there is a renewal in Angola geological fieldwork publications on the area mainly due to the work of university teams. Geology This review paper thus stands at the frontier between geology, natural resources and the History history of geology.