Feuille De Style
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Carroll-March-MEMHS-Meeting-1
Dear members of MEMHS, I’ve attached a chapter of my dissertation for our discussion on March 23. I am considering either revising the chapter for a book manuscript or dividing it up into several articles. Given my current career trajectory at the Sheridan Center, I am unsure which of these publication formats makes the most sense for me professionally, so I invite feedback on the paper’s potential in either of these formats (along with any other feedback you may wish to provide). I look forward to discussing the paper, and the project as a whole, with you all next Tuesday. Sincerely, Charlie Carroll CHAPTER 4 TO KNOW THE ORDINANCES OF THE HEAVENS: PREACHING MANLINESS AT THE UNIVERSITY OF PARIS When Guillaume d’Auvergne, bishop of Paris, began his sermon on the Vigil of All Saints in 1230, his words likely echoed around an empty nave. Looking up from the pulpit, he would have glanced out at a much-depleted audience, an audience likely comprised largely of students and clergy.1 This was more than a year and a half since a drunken brawl between a band of students and an innkeeper over the price of wine led to an immediate strike of students and masters, thereby endangering both the establishment of the University and the economy of the city of Paris. The dispute, which had begun in the faubourg of Saint-Marcel on Shrove Tuesday in 1229, had quickly escalated from pulling hair and striking blows to, on the following day, an all-out street riot with students armed with wooden clubs.2 The bishop, along with the prior of Saint-Marcel and 1 The sermon is included in Paris, Bibliothèque nationale de France, MS nouv. -

The Medieval Culture of Disputation
The Medieval Culture of Disputation Unauthenticated Download Date | 5/6/16 12:15 PM ................. 18418$ $$FM 07-24-13 14:54:07 PS PAGE i THE MIDDLE AGES SERIES Ruth Mazo Karras, Series Editor Edward Peters, Founding Editor A complete list of books in the series is available from the publisher. Unauthenticated Download Date | 5/6/16 12:15 PM ................. 18418$ $$FM 07-24-13 14:54:08 PS PAGE ii The Medieval Culture of DISPUTATION Pedagogy, Practice, and Performance Alex J. Novikoff university of pennsylvania press philadelphia Unauthenticated Download Date | 5/6/16 12:15 PM ................. 18418$ $$FM 07-24-13 14:54:08 PS PAGE iii Copyright ᭧ 2013 University of Pennsylvania Press All rights reserved. Except for brief quotations used for purposes of review or scholarly citation, none of this book may be reproduced in any form by any means without written permission from the publisher. Published by University of Pennsylvania Press Philadelphia, Pennsylvania 19104-4112 www.upenn.edu/pennpress Printed in the United States of America on acid-free paper 10987654321 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Novikoff, Alex J. The medieval culture of disputation : pedagogy, practice, and performance / Alex J. Novikoff. — 1st ed. pages cm — (The Middle Ages series) Includes bibliographical references and index. ISBN 978-0-8122-4538-7 (hardcover : alk. paper) 1. Civilization, Medieval—12th century. 2. Civilization, Medieval—13th century. 3. Learning and scholarship—Europe—History—Medieval, 500–1500. 4. Scholasticism—Europe—History—To 1500. 5. Academic disputations—Europe—History—To 1500. 6. Religious disputations—Europe—History—To 1500. 7. Debates and debating—Europe—History—To 1500. -

Leçon 2 : Après Le Bac
www.cbsefrench.com CBSE.French WebTutes & Teachers’ Resources Grade X Entre Jeunes 2 Translation & Solutions LEÇON 2 : APRÈS LE BAC When I will have finished After my baccalaureate, I my baccalaureate, I will will go to college . do engineering/technical studies. Pauline et Ali vont terminer leur bac. Ils discutent sur leurs projets d'études dans la cafétéria de leur lycée. (Pauline and Ali are going to finish their baccalaureate. They discuss their plans for education in the cafeteria of their high school) Pauline : Salut Ali ! (Hi Ali) Ali : Salut Pauline! Ça va? (Hi Pauline! How’s life?) Pauline : Ça va ! Pourquoi as-tu un air inquiet ? (Fine! Why do you look worried?) Ali : Je m'inquiète de mon avenir. Quand j'aurai (I am worried about my future. I don’t know what fini mon bac, je ne sais pas quoi faire. to do when I will have finished my Baccalaureate) Pauline : Pourquoi ? Qu'est-ce que tu désires faire? (Why? What do you want to do?) Ali : Je veux conti nuer mes études à l'université. (I want to continue my studies at the university) Pauline : Bien ! Et alors? (Well! So?) Ali : Vois-tu, les études à l'université coûtent (You see, studies at the university are very très cher. Mes parents au Sénégal, auront- expensive. Will my parents in Senegal they have the means to pay the expenses of my studies?) ils les moyens de payer les frais de mes études ? Entre Jeunes X | Leçon 2 : Après le Bac | Page 1 of 10 © cbsefrench.com. All Rights Reserved Pauline : Pourquoi faut-il dépendre entièrement de (Why is it necessary to depend entirely on your tes parents ? Tu pourras avoir des bourses parents? You will be able to get government grants. -

High Middle Ages: the Search for Synthesis – Unit 8 General Events
High Middle Ages: The Search for Synthesis – Unit 8 General Events: 987 Paris made center of feudal kingdom of Hugh Capet 11th cent. Capetian kings consolidate power and expand French kingdom 1096-1099 First Crusade, capture of Jerusalem by Christians 1141 Saint Nernard of Clairvaux leads condemnation of Abelard c. 1150-1160 Universities of Paris and Bologna founded c. 1163 Oxford University founded 1180 Phillip Augustus assumes throne of France; Promotes Paris as the capital 1202-1204 Fourth Crusade; crusaders sack Constantinople on way to the Holy Land c. 1209 Cambridge University founded (Peterhouse) 1215 Magna Carta signed by King John at Bury St. Edmund’s (England), limiting powers of the king c. 1220 Growth begins of mendicant friars; Franciscans and Dominicans 1258 Robert de Sorbon, founds Paris hospice for scholars, forerunner of the Sorbonne 1270 Eighth Crusade, death of Saint Louis of France c. 1271-1293 Marco Polo travels to China and India 1291 Fall of Acra, last Christian stronghold in the Holy Land 1348-1367 Universities based on Paris model founded in Prague, Vienna, Kracow, Pecs (Hungary) Literature and Philosophy: 12th cent. Golden Age of the University of Paris under scholastic masters 1113 Abelard begins teaching in Paris; meets Heloise 1121 Abelard, Sic et Non, birth of Scholasticism after 1150 Rediscovery of lost texts of Aristotle and others via Arabic translations 13th cent. Era of secular poems; Goliardic verse c. 1224-1226 Saint Francis of Assisi, “Canticle of Brother Sun” c. 1267-1273 Aquinas, Summa Theologica 1300 Dante exiled from Florence c. 1303 -1323 Dante, Divine Comedy c. -

THE PECIA SYSTEM and ITS USE Alison Joan Ray
THE PECIA SYSTEM AND ITS USE IN THE CULTURAL MILIEU OF PARIS, C1250-1330 Alison Joan Ray UCL Submitted for the degree of PhD in History 2015 1 I, Alison Joan Ray, confirm that the work presented in this thesis is my own. Where information has been derived from other sources, I confirm that this has been indicated in the thesis. Signed, ___________________ 2 ABSTRACT This thesis is an examination of the pecia system in operation at the University of Paris from c1250 to 1330, and its use in the cultural milieu of the city during this period. An appendix (1) lists the manuscripts with user notes on which the thesis is primarily based. As the university community rose as a leading force in theology and philosophy, so too did the book trade that supported this network. The pecia system of book production mass-produced texts efficiently and at a low cost to its users, mainly university masters, students, preachers, and visitors to the Paris cultural community. Users interacted with pecia manuscripts by leaving a wide range of marginalia in works. Marginalia are classified according to a devised user typology scheme and include ownership marks, passage summaries, and comments on the main text. We have two further surviving sources for the Paris system: bookseller lists of pecia-produced works from 1275 and 1304. Chapters 1 to 10 examine separate genres of texts available on the pecia lists, theological and philosophical works as well as preaching aids. That Paris pecia manuscripts were used in action as preaching aids is one of the conclusions the user notes help to establish. -

Feeding the Poor to Commemorate the Dead: the Pro Anima Almsgiving of Henry III of England, 1227-72
Feeding the Poor to Commemorate the Dead: The Pro Anima Almsgiving of Henry III of England, 1227-72 Sally Angharad Dixon-Smith University College London Ph D Thesis ProQuest Number: 10010404 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. uest. ProQuest 10010404 Published by ProQuest LLC(2016). Copyright of the Dissertation is held by the Author. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. Microform Edition © ProQuest LLC. ProQuest LLC 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106-1346 T h e sis A bstr a c t Henry III regularly fed thousands of poor for the souls of the dead to commemorate a whole range of individuals: holy ancestors, immediate family, Savoyard and Lusignan in laws and fallen yeoman soldiers. My research investigates the vast wealth of English chancery records, and the details it gives of pro anima practices, in the light of German writing on the phenomenon of memoria. (liturgical commemoration of the dead). Caring for and honouring the dead was a continuation of the bonds of loyalty, reward and gift-exchange which bound individuals in life. Good kingship was epitomised by the virtue of largesse, and almsgiving was an extension of this culture of generosity and reciprocity. -
Banishing Usury: the Expulsion of Foreign Moneylenders in Medieval Europe, 1200-1450
Banishing Usury: The Expulsion of Foreign Moneylenders in Medieval Europe, 1200-1450 The Harvard community has made this article openly available. Please share how this access benefits you. Your story matters Citation Dorin, Rowan William. 2015. Banishing Usury: The Expulsion of Foreign Moneylenders in Medieval Europe, 1200-1450. Doctoral dissertation, Harvard University, Graduate School of Arts & Sciences. Citable link http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:23845403 Terms of Use This article was downloaded from Harvard University’s DASH repository, and is made available under the terms and conditions applicable to Other Posted Material, as set forth at http:// nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:dash.current.terms-of- use#LAA Banishing Usury: The Expulsion of Foreign Moneylenders in Medieval Europe, 1200-1450 A dissertation presented by Rowan William Dorin to the Department of History in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the subject of History Harvard University Cambridge, Massachusetts July 2015 © 2015 Rowan William Dorin All rights reserved. Banishing Usury: The Expulsion of Foreign Moneylenders in Medieval Europe, 1200-1450 Abstract Starting in the mid-thirteenth century, kings, bishops, and local rulers throughout western Europe repeatedly ordered the banishment of foreigners who were lending at interest. The expulsion of these foreigners, mostly Christians hailing from northern Italy, took place against a backdrop of rising anxieties over the social and spiritual implications of a rapidly expanding credit economy. Moreover, from 1274 onward, such expulsions were backed by the weight of canon law, as the church hierarchy—inspired by secular precedents—commanded rulers everywhere to expel foreign moneylenders from their lands. -

Une Offre De Services Adaptée Aux Comportements Des Étudiants ?
Formation initiale des bibliothécaires d’Etat Une offre de services adaptée aux comportements des étudiants ? PPP / octobre 2008 Evaluation et propositions dans le cadre du SCD de Reims Champagne- Ardenne Dossier d’aide à la décision Gaëlenn Gouret Sous la direction de Marie-France Peyrelong Enseignant-chercheur – ENSSIB école nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques Remerciements Je tiens à remercier plus particulièrement Marie-France Peyrelong, pour sa disponibilité et la pertinence de ses conseils Lucile Pellerin de la Vergne, pour son accompagnement tout au long de l’année, même après son départ du SCD Christophe Evans et Françoise Gaudet, pour leur accueil à la Bpi et leurs conseils méthodologiques Julien Logre et Nicolas Alarcon, pour le partage de leur expérience mes collègues rémois, pour leur accueil et leur soutien sans oublier l’ensemble de mes collègues de la Fibe R, pour leur optimisme à toute épreuve et l’année passée à leurs côtés… GOURET Gaëlenn | FIBE | PPP | octobre 2008 - 3 – Résumé : Souhaitant se positionner comme un élément moteur dans la réussite des étudiants, le SCD de l’Université de Reims Champagne-Ardenne est aujourd’hui amené à s’interroger sur la pertinence de son offre de services. Deux ans après l’ouverture de la bibliothèque Robert de Sorbon, il est nécessaire d’établir un bilan des pratiques pour comprendre les comportements et l’évolution des usages. L’évaluation de leur adéquation à l’offre existante permettra d’envisager des améliorations pour mieux adapter les services aux besoins. Descripteurs : Bibliothèques -- Évaluation -- France -- Reims (Marne) Bibliothèques -- Services aux utilisateurs -- France -- Reims (Marne) Bibliothèques -- Publics -- France -- Reims (Marne) Bibliothèques -- Enquêtes -- France -- Reims (Marne) Bibliothèques universitaires -- France -- Reims (Marne) Abstract : As it has to contribute to the student’s success, the library of the University of Reims Champagne-Ardenne has decided to evaluate its services. -

Spotlights Radiant Renewal
Spotlight on Radiant Renewal in 13th-century Paris Part 1 Testimonies of Change DR. JÖRN GÜNTHER · RARE BOOKS AG Manuscripts & Rare Books Basel & Stalden “Radiant Renewal” inspired by Royal Patronage, Artists, and Scholarship Compelling innovation in book production in 13th-century Paris was brought about by royal patronage, scholarship, and artists bringing in new ideas and concepts. Four exemplary book types in their brilliant designs are presented in two spotlights. Here in part 1: theological and legal glossed texts, in part 2 (soon to follow): the Psalter-Hours, and the one-volume Bible. Three major Parisian locations, all within walking distance of each other, are symbolic to this emerging innovation: the ‘rayonnante’ Sainte-Chapelle in the Royal Palace (1248), commissioned by King Louis IX and his mother Blanche of Castile. The Rue Erembourg de Brie (Boutebrie), where talented libraires and illuminators lived and worked, and the Collège de Sorbonne, where Masters and students eagerly shared knowledge. All of this contributed to and resulted in creations that are still highly inspirational today. During the first half of the 13th century, Blanche of Cas8le (d. 1252), queen mother and twice regent of France, oCen resided in Paris where she oversaw the educa8on of her children. Her dedica8on as a mother and educator is recorded in various works of art, especially in the manuscripts of the Bible Moralisée (moralized Bible), a new genre with hundreds of images. It was through her extensive patronage of art that Blanche had a las8ng effect. Both she and her son, King Louis IX (1214-1270) were patrons of the royal chapel, Ste-Chapelle. -
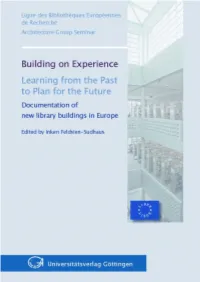
Building on Experience 2008
Inken Feldsien-Sudhaus (Ed.) Building on Experience This work is licensed under the Creative Commons License 2.0 “by-nc-nd”, allowing you to download, distribute and print the document in a few copies for private or educational use, given that the document stays unchanged and the creator is mentioned. Commercial use is not covered by the licence. Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche Architecture Group Seminar Building on Experience Learning from the Past to Plan for the Future Documentation of new library buildings in Europe Edited by Inken Feldsien-Sudhaus 14th Seminar of the LIBER Architecture Group in Hungary: Budapest and Debrecen, 8 – 12 April 2008 Universitätsverlag Göttingen 2008 Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar. LIBER Architecture Group (LAG) Ulrich Niederer (chair) Alessandro Bertoni Isabelle Boudet Steen Bille Larsen Marie-Françoise Bisbrouck Graham Bulpitt Inken Feldsien-Sudhaus Ewa Kobierska-Maciuszko Elmar Mittler (corresponding member) Tanja Notten Sylvia van Peteghem Márta Virágos This work is protected by German Intellectual Property Right Law. It is also available as an Open Access version through the publisher’s homepage and the Online Catalogue of the State and University Library of Goettingen (http://www.sub.uni-goettingen.de). Users of the free online version are invited to read, download -

Individuals and Institutions in Medieval Scholasticism
Individuals and Institutions in Medieval Scholasticism EDITED BY ANTONIA FITZPATRICK AND JOHN SABAPATHY Individuals and Institutions in Medieval Scholasticism New Historical Perspectives is a book series for early career scholars within the UK and the Republic of Ireland. Books in the series are overseen by an expert editorial board to ensure the highest standards of peer-reviewed scholarship. Commissioning and editing is undertaken by the Royal Historical Society, and the series is published under the imprint of the Institute of Historical Research by the University of London Press. The series is supported by the Economic History Society and the Past and Present Society. Series co-editors: Heather Shore (Manchester Metropolitan University) and Jane Winters (School of Advanced Study, University of London) Founding co-editors: Simon Newman (University of Glasgow) and Penny Summerfield (University of Manchester) New Historical Perspectives Editorial Board Charlotte Alston, Northumbria University David Andress, University of Portsmouth Philip Carter, Institute of Historical Research, University of London Ian Forrest, University of Oxford Leigh Gardner, London School of Economics Tim Harper, University of Cambridge Guy Rowlands, University of St Andrews Alec Ryrie, Durham University Richard Toye, University of Exeter Natalie Zacek, University of Manchester Individuals and Institutions in Medieval Scholasticism Edited by Antonia Fitzpatrick and John Sabapathy LONDON ROYAL HISTORICAL SOCIETY INSTITUTE OF HISTORICAL RESEARCH UNIVERSITY OF LONDON PRESS Published in 2020 by UNIVERSITY OF LONDON PRESS SCHOOL OF ADVANCED STUDY INSTITUTE OF HISTORICAL RESEARCH Senate House, Malet Street, London WC1E 7HU © Chapter authors, 2020 The authors have asserted their rights under the Copyright, Designs and Patents Act 1988 to be identified as the authors of this work. -

Nation Building and Law Collections: the Remarkable Development of Comparative Law Libraries in the United States*
LAW LIBRARY JOURNAL Vol. 109:4 [2017-26] Nation Building and Law Collections: The Remarkable Development of Comparative Law Libraries in the United States* David S. Clark** This article focuses on the evolution of comparative law libraries in the United States, in particular on the Law Library of Congress. It argues that much of the impetus behind this development was a self-conscious component of nation building. This effort led many American law libraries to build exceptional collections of foreign, comparative, and international law. Introduction .........................................................500 History of the Library Until 1500 .......................................503 History of the Library in the Early Modern Era ...........................506 University Libraries .................................................507 The Vatican Library ................................................510 Royal and Noble Libraries ...........................................510 The Impact of the Protestant Reformation .............................511 Development of Major Libraries in the United States ......................512 Private and Public Libraries ..........................................512 The Library of Congress .............................................516 The Role of Copyright and Legal Deposit in the Growth of Libraries .........519 Europe ..............................................................519 United States. 521 The Emergence of National Libraries ..................................523 The Development of Law