PPR Note Presentation Cheny
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Votre Question Concerne
Feuille1 Votre commune ... Votre question concerne... COMMUNE SIP SIE SPF C.D.I.F. -
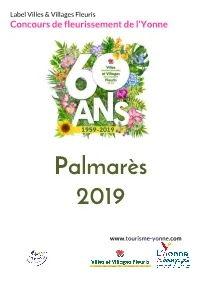
Palmarès 2019
Label Villes & Villages Fleuris Concours de fleurissement de l'Yonne Palmarès 2019 www. tourisme-yonne .com DÉPARTEMENT DE L'YONNE – CONCOURS DE FLEURISSEMENT 2019 ______________________________________________________________________________________________________________________ LES COMMUNES DE L'YONNE LABELLISÉES VILLES ET VILLAGES FLEURIS LASSON - Yonne Tourisme © F. Dufer Communes Communes Communes Aillant-sur-Tholon/Montholon Bléneau Appoigny Arces-Dilo Cheny Avallon Champcevrais Chevannes Chablis Chichery-la-Ville Cravant/Deux Rivières Joigny Chitry-le-Fort Escamps Migennes Crain Gron Monéteau Étigny Lavau Paron Gland Quincerot Saint-Georges-sur-Baulches Gurgy Saint-Clément Saint-Julien-du-Sault L'Isle-sur-Serein Saint-Denis-lès-Sens Villebougis Lasson Saint-Privé Massangis Sauvigny-le-Bois Perrigny Tonnerre Commune Quarré-les-Tombes Toucy Sens Rogny-les-Sept-Écluses Villeneuve l'Archevêque Saint-Fargeau Saint-Florentin Sainte-Colombe-sur-Loing Val-de-Mercy Vaudeurs Villeneuve-sur-Yonne Yonne Tourisme - novembre 2019 DÉPARTEMENT DE L'YONNE – CONCOURS DE FLEURISSEMENT 2019 ______________________________________________________________________________________________________________________ VILLES ET VILLAGES FLEURIS PROPOSITIONS DU JURY DÉPARTEMENTAL POUR 2020 Suite à ses visites du mois de juillet 2019, le Jury départemental a établi les propositions suivantes, qui seront évaluées en 2020 par le jury conjoint département-région mis en place en 2019 : Pour le label 1 fleur, les communes de : - CARISEY - 374 h. - COLLAN - 188 h. -

Stories from the Vineyard $80
As with Chef Crenn’s menus, which are inspired by her travels, so too is the beverage program where we seek out selections from the world at large. Petit Crenn proudly presents a wine pairing that is an opportunity to sit back and relax while exploring the world via the senses. Take a trip in our hospitable hands. STORIES FROM THE VINEYARD $80 A focused yet whimsical wine pairing that dives into many pockets of the world that concentrates on the roots of Petit Crenn: France and California. A sense of place and ethos. A connection with both the fruit and the farmer. This is an excellent opportunity to enjoy something unexpected, and visit hidden gems of classic wine regions. This evening we welcome you to be a part of Petit Crenn’s wine infinity. Wine Director Mikayla Cohen A service included beverage experience. BY THE GLASS SPARKLING NV Désiré Petit, Brut Rosé, Pinot Noir, Crémant du Jura 18 NV Gaston Chiquet, Brut Rosé, 1er Cru, Champagne 30 NV Lancelot-Royer, Blanc de Blancs, Grand Cru, Champagne 25 WHITE 2018 Hourglass, Sauvignon Blanc, ‘Estate,’ Calistoga 20 2015 Kunin, Chenin Blanc, ‘Jurassic Park,’ Santa Ynez Valley 18 2016 Hirtzberger, Weissburgunder Smaragd, ‘Steinporz,’ Wachau 28 2017 Pierre Yves Colin-Morey, ‘Les Cailloux,’ Rully, Burgundy 35 ROSÉ 2018 Arnot-Roberts, Touriga Nacional/Tinta Cao, North Coast 15 2017 Domaine de Terrebrune, Bandol, Provence 20 RED 2018 Combe, Trousseau, ‘Stolpman,’ Ballard Canyon 18 2017 Occidental, Pinot Noir, ‘Freestone,’ West Sonoma Coast 35 2016 Vieux Télégraphe, ‘Télégramme,’ Châteaneuf-du-Pape 28 A service included beverage experience. -

Recensement Des Bonnes Pratiques 2013
Réforme des Rythmes Scolaires et Éducatifs Groupe d’appui PEDT89 Recensement des bonnes pratiques 2013 Préambule Ce guide a vocation à accompagner les collectivités et leurs partenaires dans la mise en œuvre de la réforme des rythmes éducatifs et scolaires. Il a été élaboré par le groupe d’appui PEDT composé des partenaires suivants : DSDEN, DDCSPP, CAF, Francas, UDMJC, ACLM, Ligue de l’enseignement, USEP, PSY, à partir de l’étude des PEDT et d’une enquête réalisée en direction des territoires ayant appliqué la réforme à la rentrée 2013. Ce document reprend les choix faits par les collectivités lors des différentes étapes jugées indispensables à la mise en œuvre de la réforme. Il n’a pas vocation à être exhaustif et pourra être amendé autant que de besoin. Il peut venir en complément d’autres documents comme par exemple « Le guide pratique pour des activités périscolaires de qualité », téléchargeable, comme d’autres documents, sur les sites de la DSDEN ou de la DDCSPP en utilisant les liens suivants : • http://ia89.ac-dijon.fr/?reforme_des_rythmes_scolaires • http://www.yonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sports-et-vie-associative/Jeunesse/Reforme-des-rythmes- educatifs-et-scolaires L’élaboration d’un PEDT n’est pas une démarche obligatoire pour la collectivité, toutefois il constitue une plus-value indéniable en permettant une large collaboration locale dont l’objectif est de mobiliser toutes les ressources d’un territoire. Il permet un partenariat entre les collectivités, les acteurs éducatifs, les associations, les services de l’Etat, et favorise les échanges entre les acteurs éducatifs (parents, enseignants, animateurs, …). -

Région Territoire De Vie-Santé Commune Code Département Code Commune Bourgogne-Franche-Comté Aillant-Sur-Tholon Aillant-Sur
Code Code Région Territoire de vie-santé Commune département commune Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Aillant-sur-Tholon 89 89003 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Beauvoir 89 89033 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Chassy 89 89088 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Égleny 89 89150 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon La Ferté-Loupière 89 89163 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Fleury-la-Vallée 89 89167 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Guerchy 89 89196 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Laduz 89 89213 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Neuilly 89 89275 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Les Ormes 89 89281 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Poilly-sur-Tholon 89 89304 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Saint-Aubin-Château-Neuf 89 89334 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Saint-Maurice-le-Vieil 89 89360 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Saint-Maurice-Thizouaille 89 89361 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Senan 89 89384 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Sommecaise 89 89397 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Villiers-sur-Tholon 89 89473 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Volgré 89 89484 Bourgogne-Franche-Comté Aix-en-Othe Bagneaux 89 89027 Bourgogne-Franche-Comté Aix-en-Othe Boeurs-en-Othe 89 89048 Bourgogne-Franche-Comté Aix-en-Othe Cérilly 89 89065 Bourgogne-Franche-Comté Aix-en-Othe Coulours 89 89120 Bourgogne-Franche-Comté Aix-en-Othe Courgenay 89 89122 Bourgogne-Franche-Comté Aix-en-Othe -

Stories from the Vineyard $80
As with Chef Crenn’s menus, which are inspired by her travels, so too is the beverage program where we seek out selections from the world at large. Petit Crenn proudly presents a wine pairing that is an opportunity to sit back and relax while exploring the world via the senses. Take a trip in our hospitable hands. STORIES FROM THE VINEYARD $80 A focused yet whimsical wine pairing that dives into many pockets of the world that concentrates on the roots of Petit Crenn: France and California. A sense of place and ethos. A connection with both the fruit and the farmer. This is an excellent opportunity to enjoy something unexpected, and visit hidden gems of classic wine regions. This evening we welcome you to be a part of Petit Crenn’s wine infinity. Wine Director Mikayla Cohen A service included beverage experience. BY THE GLASS SPARKLING NV Domaine Taille Aux Loups, ‘Triple Zéro Rosé,’ Touraine 19 2011 Charlot, ‘L’Écorché de la Genette,’ Extra Brut Rosé, Champagne 35 NV Pierre Gimonnet, ‘Sélection Belles Années,’ Champagne 26 WHITE 2016 Franz Hirtzberger, Riesling Federspiel, ‘Steinerterrassen,’ Wachau 25 2017 Corison, Gewurztraminer, ‘Corazon,’ Anderson Valley 19 2017 Two Wolves, Sémillon, ‘Estate Vineyard,’ Santa Barbara County 29 2017 Jean-Philippe Fichet, Auxey-Duresses, Burgundy 35 ROSÉ 2018 Château de Pibarnon, ‘Cuvée Crenn,’ Bandol, Provence 23 RED 2017 Valentin Zusslin, Pinot Noir, ‘Ophrys,’ Alsace 24 2014 Château du Hureau, ‘Les Fevettes,’ Saumur-Champigny 19 2015 Radio-Coteau, Syrah, ‘Las Colinas,’ Sonoma Coast 29 A service included beverage experience. EVERYBODY LOVES ‘PETIT’ BOTTLES CHAMPAGNE NV Paul Bara, Rosé, Grand Cru 105 NV René Geoffroy, Rosé de Saignée 108 NV Ruinart, Rosé 170 NV Krug, Rosé 425 NV R.H. -
Annexe Basse Yonne
PREFET DE L’YONNE LOCATION PAR L’ETAT DU DROIT DE PECHE AUX LIGNES SUR LE DOMAINE PUBLIC FLUVIAL DU 1 er JANVIER 2017 AU 31 DECEMBRE 2021 ------------ COURS D’EAU : BASSE YONNE ------------ TABLEAU DE DESIGNATION DES LOTS ET PRESCRIPTIONS PARTICULIERES NB : Ce tableau est accompagné du cahier des charges fixant les prescriptions particulières LONGUEUR PRIX du N° LOT LIMITES M LOT 2017 Vieux pont à AUXERRE à 1 980 45.67 € Ecluse barrage de la Chaînette Réserve : Sas écluse de la rivière Yonne situés entre deux portes Ecluse barrage de la Chaînette à 2 1 325 61.75 € Ecluse de l' Ile Brûlée Réserve : Sas écluse de la rivière Yonne situés entre deux portes Ecluse de l' Ile Brûlée à 3 1 738 80.99 € Ecluse des Dumonts Réserve : Sas écluse de la rivière Yonne situés entre deux portes Ecluse des Dumonts à 4 1 462 68.13 € Ecluse des Boisseaux Réserve : Sas écluse de la rivière Yonne situés entre deux portes Ecluse des Boisseaux à 5 1 580 73.63 € Ecluse de MONETEAU Réserve : Sas écluse de la rivière Yonne situés entre deux portes Ecluse de MONETEAU à Barrage de GURGY 6 3 072 143.16 € Réserve : Sas écluse de la rivière Yonne situés entre deux portes + réserve au lieu-dit « L'Ile Pôle », rive gauche, du PK 9,6 au PK 9,75 Origine de la dérivation de GURGY 7 à 1 425 66.41 € Chaumes au pont Pont des Chaumes 8 853 39.75 € à Pont Biais d'APPOIGNY Pont Biais d'APPOIGNY à 9 1 142 53.22€ Ecluse de Néron Réserve : Sas écluse de la rivière Yonne situés entre deux portes Ecluse de Néron à 10 Ecluse de Raveuse à l'extrémité aval de 1 380 64.31 € la dérivation -

Feuille Du Mois
- JUILLET ET AOÛT 2021 Prière pour les vacances Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux qui prennent la route : qu’ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage. Que ce temps de vacances soit pour nous tous un moment de détente, de repos, de paix! Sois pour nous, Seigneur, l’Ami que nous retrouvons sur nos routes, qui nous accompagne et nous guide. Donne-nous le beau temps et le soleil qui refont nos forces et qui nous donnent le goût de vivre. Donne-nous la joie simple et vraie de nous retrouver en famille et entre amis. Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons pour leur donner un peu d’ombre quand le soleil brûle trop, pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et l’orage les surprennent, pour partager notre pain et notre amitié quand ils se trouvent seuls et désemparés. Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous quand nous reprendrons le chemin du retour: que nous ayons la joie de nous retrouver pour vivre ensemble une nouvelle année, nouvelle étape sur la route du salut. “Prières pour les jours incontournables” (éditions du Signe 2001) Infos KT Permanences au presbytère pour l’inscription des CE2 et des arrivants: Réunions de rentrée des parents Samedi 28 août 10h – 12h Mercredi 1°septembre 10h – 12h CE2 : samedi 11 septembre à 10h Lundi 6 septembre 18h30 – 19h30 Pensez à venir avec une photo, la date et le lieu CM1 : vendredi 10 septembre 19h du baptême (certificat si non fait à Migennes) (1° rencontre des enfants dimanche 12 septembre 9h30 - 12h) Rencontres des enfants CE2 et CM2 : mercredi 10h – 12h, une CM2 : mercredi 8 septembre 18h e semaine sur deux (participation à la messe) 6 : vendredi 10 septembre 18h CM1 et 6° : dimanche 9h30 – 12h, une (1° rencontre des enfants dimanche 12 septembre à 9h30 –12h) semaine sur deux (participation à la messe) Pèlerinages Vézelay, en l’honneur de Sainte Marie-Madeleine, le 22 juillet; Messe à 11H. -

Liste Des Regroupements Pédagogiques
ÉLECTIONS AUX CONSEILS D'ÉCOLE ANNÉE SCOLAIRE 2008-2009 Écoles maternelles REGROUPEMENTS PÉDAGOGIQUES AUTONOMES où le Instituteurs responsables des conseil d’école est à * Établissement scolaire intercommunal opérations de vote pour le mettre en place sous la regroupement Regroupements pédagogiques intercommunaux responsabilité de la directrice AVALLON ACCOLAY - BAZARNES Mme NOIR AVALLON AISY SUR ARMANCON - CRY SUR ARMANCON M. BALSIMINI AVALLON ANCY LE FRANC - CHASSIGNELLES M. DELAGNEAU x AUXERRE III ANDRYES - DRUYES LES BELLES FONTAINES M. TOLLET AVALLON ANNAY LA COTE - GIROLLES Mlle HENRY SENS II ARCES – DILO - VILLECHETIVE Mme SAUVANT x JOIGNY CY BASSOU – BONNARD mat. - CHICHERY LA VILLE Mme REUX x AUXERRE III BEAUVOIR - EGLENY - PARLY Mme RIBOULOT x AUXERRE I BEINES - BLEIGNY LE CARREAU Mme CHAILLOUX JOIGNY CY BEON - CHAMVRES M. MARTIN x AVALLON BLANNAY – GIVRY - MONTILLOT M. DUPLESSIS AUXERRE III BRANCHES - FLEURY LA VALLEE M. BACHELET x SENS II BRANNAY - LIXY - ST SEROTIN – VILLETHIERRY * Mme PROFILLET x JOIGNY CY BRION - BUSSY EN OTHE M. BENARD x JOIGNY CY BUTTEAUX – PERCEY M. CHASSEPOT x JOIGNY CY CARISEY - JAULGES - VILLIERS VINEUX Mme GUIDEZ x JOIGNY CY CHAILLEY - TURNY M. MAGNANI x AUXERRE III CHAMBEUGLE - CHENE ARNOULT M. CORBET AUXERRE III CHAMPCEVRAIS - ROGNY LES SEPT ECLUSES Mme ARCHAMBAULT x JOIGNY CY CHAMPLAY - PAROY SUR THOLON Mlle AUBINEAU x AUXERRE III CHAMPVALLON - VILLIERS SUR THOLON - VOLGRE Mme DOS SANTOS x AUXERRE III CHARENTENAY - MIGE Mme OLSZEWSKI x AUXERRE III CHASSY - POILLY SUR THOLON - ST MAURICE LE VIEIL - ST MAURICE THIZOUAILLES Mme JOLIBOIS x JOIGNY CY CHARMOY – EPINEAU LES VOVES Mme CROCCO x AVALLON CHATEL-GERARD - SARRY Mme LAVAUT x SENS II CHAUMONT - SAINT AGNAN Mme SEGUELAS x AVALLON CHENEY - DANNEMOINE - TRONCHOY Mme FAUVEAU SENS II CHEROY - DOLLOT – VALLERY * M. -

Pôle Ressource Et Fonctionnement Du Rased
CIRCONSCRIPTION JOIGNY CENTRE YONNE PÔLE RESSOURCE ET FONCTIONNEMENT DU RASED Année scolaire 2020/2021 Fonctionnement du pôle ressource La loi n°2013-595 du 8 Juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre, de progresser et de réussir, affirme l’objectif d’inclusion scolaire de tous les élèves et intègre la prise en compte de la difficulté scolaire qu’elle entend réduire. L’objectif de l’école est de développer les potentialités de tous les élèves, de les conduire à la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture en assurant pour chacun d’eux les conditions de la réussite au sein de chaque cycle d’enseignement. La difficulté, inhérente au processus d’apprentissage, est prise en compte par chaque enseignant dans son action quotidienne au sein de la classe. Toutefois, l'aide apportée par l'enseignant, avec l'appui de l'équipe pédagogique du cycle et, là où il est mis en œuvre, le dispositif à effectif réduit peut ne pas suffire pour certains élèves. Le réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED), composé d’enseignants spécialisés et d’un psychologue scolaire, occupe une place fondamentale dans la gestion de la difficulté scolaire. La circulaire parue au BO n°31 du 18/08/14 a pour objectif de conforter les missions des personnels spécialisés des RASED tout en permettant de bien cibler leur action sur l'aide et le suivi des élèves rencontrant des difficultés persistantes et la prévention de ces situations. -

S O M M a I R E
S O M M A I R E N° d’arrêté Date Objet de l’arrêté Page PREFECTURE DE L’YONNE Cabinet Arrêté n° du 18 novembre 2008 conférant l’honorariat à Monsieur PREF/CAB/2008/0805 18/11/2008 Michel MOUROT ancien adjoint au maire de la commune de 3 THURY Arrêté portant renouvellement d’agrément pour les formations aux PREF/CAB/2008/0811 24/11/2008 premiers secours de l’Unité de Développement des Premiers 3 Secours de l’Yonne (UDPS 89) Arrêté portant renouvellement d’agrément pour les formations aux PREF/CAB/2008/0812 24/11/2008 premiers secours de l’Association Départementale de Protection 4 Civile (ADPC 89) Arrêté portant renouvellement d’agrément pour les formations aux PREF/CAB/2008/0813 24/11/2008 premiers secours de l’Union Nationale des Associations de 4 Secouristes et Sauveteurs de la Poste et de France Télécom Arrêté portant renouvellement d’agrément pour les formations aux PREF/CAB/2008/0816 24/11/2008 premiers secours de la Délégation Départementale de la Croix- 5 Rouge Française de l’Yonne (CRF 89) Direction des collectivités et du développement durable 07/11/2008 Commission départementale d’équipement commercial 5 Arrêté modifiant le périmètre du Schéma d’aménagement et de PREF/DCDD/2008/0516 14/11/2008 Gestion des Eaux (S.A.G.E.) du bassin de l'Armançon, sur les 6 départements de l’Aube, de la Côte d’Or et de l’Yonne Arrêté portant création d'une zone de développement de l’éolien PREF/DCDD/2008/0518 12/11/2008 (ZDE) sur le territoire des communes de MERRY-SEC et 6 OUANNE 20/11/2008 Commission départementale d’équipement commercial 7 -

Secteur Des Collèges Selon La Commune De Résidence
SECTEURS DES COLLÈGES SELON LA COMMUNE DE RÉSIDENCE BASSIN SUD - AUXERRE BASSIN SUD - AVALLON 1. Secteur Clg Albert Camus - Auxerre 1. Secteur Clg Parc des Chaumes - Avallon Auxerre Rouvray Avallon Provency Héry Seignelay Beauvilliers Quarré les Tombes Jonches Sougères sur Sinotte Bussières Saint André en Terre plaine Laborde Venouse Chastellux sur Cure Saint Brancher Monéteau Villeneuve St Salves Cisery Saint Germain des Champs Montigny la Resle Cussy les Forges Saint Léger Vauban Domecy sur Cure Sainte Magnance 2. Secteur Clg Bienvenu Martin - Auxerre Guillon Sauvigny le Beuréal Auxerre Lindry Island Sauvigny le Bois Gurgy Vallan Magny Savigny en Terre Plaine Gy l'Evèque Ménades Sceaux Montréal Trevilly 3. Secteur Clg Denfert Rochereau - Auxerre Pierre Perthuis Vignes Auxerre Venoy Pontaubert 4. Secteur Clg de Paul Bert - Auxerre 2. Secteur Clg Maurice clavel - Avallon Annay la côte Fontenay près Vézelay Auxerre Escolives Ste Camille Annéot Girolles Augy Jussy Asnières sous Bois Givry Bleigny le Carreau Quenne Asquins Lucy le Bois Champs sur Yonne Saint Bris le Vineux Athie Montillot Coulanges La Vineuse Vaux (Auxerre) Avallon Saint Père Blannay Sermizelles 5. Secteur Clg Jean Bertin - St Georges sur Baulche Brosses Tharoiseau Chamoux Tharot Appoigny Perrigny Domecy sur Vault Thory Charbuy St Georges sur Baulche Etaule Vault de Lugny Chevannes Villefargeau Foissy lès Vézelay Vézelay 3. Secteur Clg Milès de Noyers - Noyers Angely Marmeaux Annay sur Serein Massangis Annoux Molay Bierry les Belles Fontaines Moulins en Tonnerrois Blacy Nitry Censy Noyers Châtel Gerard Pasilly Civry sur Serein (Massangis) Pizy Coutarnoux Poilly sur Serein Dissangis Sainte Colombe Etivey Sainte Vertu Fresnes Santigny Grimault Sarry Isle sur serein (L') Talcy Jouancy Thizy Joux la Ville Vassy 4.