Table Des Matières
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

B E N I N Benin
Birnin o Kebbi !( !( Kardi KANTCHARIKantchari !( !( Pékinga Niger Jega !( Diapaga FADA N'GOUMA o !( (! Fada Ngourma Gaya !( o TENKODOGO !( Guéné !( Madécali Tenkodogo !( Burkina Faso Tou l ou a (! Kende !( Founogo !( Alibori Gogue Kpara !( Bahindi !( TUGA Suroko o AIRSTRIP !( !( !( Yaobérégou Banikoara KANDI o o Koabagou !( PORGA !( Firou Boukoubrou !(Séozanbiani Batia !( !( Loaka !( Nansougou !( !( Simpassou !( Kankohoum-Dassari Tian Wassaka !( Kérou Hirou !( !( Nassoukou Diadia (! Tel e !( !( Tankonga Bin Kébérou !( Yauri Atakora !( Kpan Tanguiéta !( !( Daro-Tempobré Dammbouti !( !( !( Koyadi Guilmaro !( Gambaga Outianhou !( !( !( Borogou !( Tounkountouna Cabare Kountouri Datori !( !( Sécougourou Manta !( !( NATITINGOU o !( BEMBEREKE !( !( Kouandé o Sagbiabou Natitingou Kotoponga !(Makrou Gurai !( Bérasson !( !( Boukombé Niaro Naboulgou !( !( !( Nasso !( !( Kounounko Gbangbanrou !( Baré Borgou !( Nikki Wawa Nambiri Biro !( !( !( !( o !( !( Daroukparou KAINJI Copargo Péréré !( Chin NIAMTOUGOU(!o !( DJOUGOUo Djougou Benin !( Guerin-Kouka !( Babiré !( Afekaul Miassi !( !( !( !( Kounakouro Sheshe !( !( !( Partago Alafiarou Lama-Kara Sece Demon !( !( o Yendi (! Dabogou !( PARAKOU YENDI o !( Donga Aledjo-Koura !( Salamanga Yérémarou Bassari !( !( Jebba Tindou Kishi !( !( !( Sokodé Bassila !( Igbéré Ghana (! !( Tchaourou !( !(Olougbé Shaki Togo !( Nigeria !( !( Dadjo Kilibo Ilorin Ouessé Kalande !( !( !( Diagbalo Banté !( ILORIN (!o !( Kaboua Ajasse Akalanpa !( !( !( Ogbomosho Collines !( Offa !( SAVE Savé !( Koutago o !( Okio Ila Doumé !( -

Annales Flash Déc 2016 Vol 2 N°22
UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI République du Bénin ANNALES de la FACULTE DES LETTRES, ARTS ET SCIENCES HUMAINES N°22 Volume 2, Décembre 2016 SOMMAIRE AFFO (Alphonse M.) : Implication des enfants dans la prostitution au Bénin : entre « niche de vie » et 4 « marche sauvage » DOHOU (Modeste C.) ; TINGBE-AZALOU (Albert) et AHODEKON (S. C. Cyriaque) : Gestion de 21 l’indiscipline des élèves dans les collèges d’Enseignement Général publics de Porto-Novo (Bénin) OGA (Armelle) et FOURN (Elisabeth) : Les grossesses dans les établissements de l’enseignement 34 secondaire du département du Borgou: analyse de quelques déterminants COOVI (Gilbert) : Gouvernances et dynamiques des réformes du système éducatif du Dahomey au 44 Bénin du renouveau démocratique DJAOUGA (Mama) ; THOMAS (Omer) et MAZO (Ismaël) : Cartographie de l’environnement urbain 62 et périurbain de la ville de Djougou et de sa dynamique au Bénin KANGAH (K. Marcelin) : Les femmes au sein de l’exécutif en Côte-d’Ivoire sous la première 77 République (1960-2000) AKOUÉTÉ-HOUNSINOU (Florentine) et KARSENTI (Thierry) : Analyse des besoins de formation 88 continue des enseignants de l’enseignement secondaire général public du Bénin sur les TIC DJAHA (N’de Tano) : André Brink, ou l’écrivain sud-africain d’inspiration française 105 TOZO (A. Dominique) ; COOVI (Gilbert) ; ANATO (Emile N.) ; AHODEKON (Sessou) et COOVI 113 (Cyriaque) : Les déterminants socioculturels de la déperdition scolaire en milieu ‘‘Gando’’ à Péonga, Commune de Kalalé AROUNA (Ousséni) : Caractérisation de la biodiversité végétale des jachères dans l’Arrondissement 129 de Bagou (Commune de Gogounou) au Bénin ANATO (Emile N.) ; MONTCHO (Rodrigue S.) ; BABADJIDE (Charles L.) et BIAOU (Gauthier) : 144 Gestion participative des infrastructures sociocommunautaires comme baromètre social : cas des équipements marchands à Allada (Bénin) AFOUDA (A. -

Population Étrangère Dans L'alibori Synthèse Des Principaux Résult
REPUBLIQUE DU BENIN ------------------- MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT ------------------- Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique Synthèse des principaux résultats du RGPH-4 de l’ALIBORI 1- Etat et structure de la population de l’Alibori Evolution de la population de l’Alibori de 2002 à 2013 Taux d'accroissement Poids DIVISIONS RGPH4-2013 RGPH3-2002 intercensitaire démographique ADMINISTRATIVES en % (2002- en % en 2013 Total Masculin Féminin Total Masculin Féminin 2013) BENIN 10 008 749 4 887 820 5 120 929 6 769 914 3 284 119 3 485 795 3,52 ALIBORI 867 463 431 357 436 106 521 093 259 588 261 505 4,61 8,7 Banikoara 246 575 122 445 124 130 152 028 75 829 76 199 4,37 28,4 Gogounou 117 523 58 018 59 505 80 013 39 759 40 254 3,46 13,5 Kandi 179 290 88 998 90 292 95 206 47 600 47 606 5,76 20,7 Karimama 66 353 33 149 33 204 39 579 19 792 19 787 4,68 7,6 Malanville 168 641 83 681 84 960 101 628 50 263 51 365 4,58 19,4 Ségbana 89 081 45 066 44 015 52 639 26 345 26 294 4,77 10,3 En 2013, le département de l’Alibori compte 867 463 habitants soit 8,7% Evolution (en %) de la structure par âge de la population de l'Alibori au RGPH-1992, RGPH-2002 25,0 de la population béninoise. Le taux et RGPH-2013 1992 2002 2013 d’accroissement intercensitaire de 20,0 On constate depuis 1992 une 4,61% est supérieur à la moyenne augmentation de la proportion de la nationale. -

Carte Pédologique De Reconnaissance De La République Populaire Du Bénin À 1/200.000 : Feuille De Djougou
P. FAURE NOTICE EXPLICATIVE No 66 (4) CARTE PEDOLOGIQUE DE RECONNAISSANCE de la République Populaire du Bénin à 1/200.000 Feuille de DJOUGOU OFFICE OE LA RECHERCHE SCIENTIFIWE ET TECHNIOUE OUTRE-MER 1 PARIS 1977 NOTICE EXPLICATIVE No 66 (4) CARTE PEDOLOGIQUE DE RECONNAISSANCE de la RepubliquePopulaire du Bénin à 1 /200.000 Feuille de DJOUGOU P. FAURE ORSTOM PARIS 1977 @ORSTOM 2977 ISBN 2-7099-0423-3(édition cornpl8te) ISBN 2-7099-0433-0 SOMMAI RE l. l INTRODUCTION ........................................ 1 I .GENERALITES SUR LE MILIEU ET LA PEDOGENESE ........... 3 Localisationgéographique ............................ 3 Les conditionsde milieu 1. Le climat ................... 3 2 . La végétation ................. 6 3 . Le modelé et l'hydrographie ....... 8 4 . Le substratum géologique ........ 10 Les matériaux originels et la pédogenèse .................. 12 1 . Les matériaux originels .......... 12 2 . Les processus pédogénétiques ...... 13 II-LESSOLS .......................................... 17 Classification 1. Principes de classification ....... 17 2 . La légende .................. 18 Etudemonographique 1 . Les sols minérauxbruts ......... 20 2 . Les sois peuévolués ............ 21 3 . Les sols ferrugineuxtropicaux ....... 21 4 . Les sols ferraliitiques ........... 38 CONCLUSION .......................................... 43 Répartitiondes' sols . Importance relative . Critèresd'utilisation . 43 Les principalescontraintes pour la mise en valeur ............ 46 BIBLIOGRAPHIE ........................................ 49 1 INTRODUCTION La carte pédologique de reconnaissance à 1/200 000, feuille DJOUGOU, fait partie d'un ensemble de neuf coupures imprimées couvrant la totalité du terri- toire de la République Populaire du Bénin. Les travaux de terrain de la couverture générale ont été effectués de 1967 à 1971 par les quatre pédologues de la Section de Pédologie du Centre O. R.S. T.O.M. de Cotonou : D. DUBROEUCQ, P. FAURE, M. VIENNOT, B. -

The Geography of Welfare in Benin, Burkina Faso, Côte D'ivoire, and Togo
Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized The Geography of Welfare in Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, and Togo Public Disclosure Authorized Nga Thi Viet Nguyen and Felipe F. Dizon Public Disclosure Authorized 00000_CVR_English.indd 1 12/6/17 2:29 PM November 2017 The Geography of Welfare in Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, and Togo Nga Thi Viet Nguyen and Felipe F. Dizon 00000_Geography_Welfare-English.indd 1 11/29/17 3:34 PM Photo Credits Cover page (top): © Georges Tadonki Cover page (center): © Curt Carnemark/World Bank Cover page (bottom): © Curt Carnemark/World Bank Page 1: © Adrian Turner/Flickr Page 7: © Arne Hoel/World Bank Page 15: © Adrian Turner/Flickr Page 32: © Dominic Chavez/World Bank Page 48: © Arne Hoel/World Bank Page 56: © Ami Vitale/World Bank 00000_Geography_Welfare-English.indd 2 12/6/17 3:27 PM Acknowledgments This study was prepared by Nga Thi Viet Nguyen The team greatly benefited from the valuable and Felipe F. Dizon. Additional contributions were support and feedback of Félicien Accrombessy, made by Brian Blankespoor, Michael Norton, and Prosper R. Backiny-Yetna, Roy Katayama, Rose Irvin Rojas. Marina Tolchinsky provided valuable Mungai, and Kané Youssouf. The team also thanks research assistance. Administrative support by Erick Herman Abiassi, Kathleen Beegle, Benjamin Siele Shifferaw Ketema is gratefully acknowledged. Billard, Luc Christiaensen, Quy-Toan Do, Kristen Himelein, Johannes Hoogeveen, Aparajita Goyal, Overall guidance for this report was received from Jacques Morisset, Elisée Ouedraogo, and Ashesh Andrew L. Dabalen. Prasann for their discussion and comments. Joanne Gaskell, Ayah Mahgoub, and Aly Sanoh pro- vided detailed and careful peer review comments. -

Cage Project Final Evaluation 2001-2005
COMMUNITY ACTION FOR GIRLS EDUCATION WORLD LEARNING / USAID CAGE PROJECT FINAL EVALUATION 2001-2005 June 2005 Justin DONGBEHOUNDE François GAUTHO Consultants CONTENTS Pages 0- SUMMARY OF CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 3 I- BACKGROUND 5 II- OBJECTIVES AND EVALUATION METHODOLOGIES 5 III- EVALUATION PROBLEMS 7 IV- EVALUATION RESULTATS 7 1. Level of results achievement and objectives 7 2. Analysis of the approach, strategies and stakeholders 17 3. Management and coordination of the project 19 4. Sustainability durability and replication of the experience 20 5. Strengths and weaknesses of the project 21 V- CONCLUSIONS 22 VI- RECOMMENDATIONS 23 VII- APPENDICES 24 CAGE project final evaluation O- SUMMARY OF CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS Conclusions · The four objectives set are met both quantitatively and qualitatively. · The starting hypothesis of the project, that well stimulated community participation could lead to better results in the promotion of girls education is verified and it is correct. In fact, CAGE project has succeeded in arousing a high community mobilization and a strong commitment of CRL (Local representative Committees) and CCEF with meaningful results in their quantity and quality, in their dimension and depth. · This ability to stimulate the local/social support and mobilization comes from CAGE approach that is the entire process and steps leading to the set up of CRL and CCEF, the vision analysis and strategies, up to the micro project funding, all this back up with a very good social communication. · In this process, the set up of CRL and their composition played an important role. Truly the intension is a representative committee. Initially the social communication showed that members would be like pioneers, with no specific advantages, but more sacrifices and a lot of work to do. -

Trade Setting and Market Structure (1970S - 1990S)
UvA-DARE (Digital Academic Repository) Trade and Traders. The Making of the Cattle Market in Benin Quarles van Ufford, P.E.J. Publication date 1999 Link to publication Citation for published version (APA): Quarles van Ufford, P. E. J. (1999). Trade and Traders. The Making of the Cattle Market in Benin. Thela Thesis. General rights It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open content license (like Creative Commons). Disclaimer/Complaints regulations If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You will be contacted as soon as possible. UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl) Download date:07 Oct 2021 Trade setting and market structure (1970s - 1990s) The present chapter pursues the historical line embarked upon in Chapter 3. It deals with the period between the 1970s and the 1990s. Its specific focus is on the developments and changes in the trade setting and in the market structure which occurred over this period. -

Caractéristiques Générales De La Population
République du Bénin ~~~~~ Ministère Chargé du Plan, de La Prospective et du développement ~~~~~~ Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique Résultats définitifs Caractéristiques Générales de la Population DDC COOPERATION SUISSE AU BENIN Direction des Etudes démographiques Cotonou, Octobre 2003 1 LISTE DES TABLEAUX Tableau 1: Population recensée au Bénin selon le sexe, les départements, les communes et les arrondissements............................................................................................................ 3 Tableau G02A&B : Population Résidente recensée dans la commune de KANDI selon le sexe et par année d’âge ......................................................................... 25 Tableau G02A&B : Population Résidente recensée dans la commune de NATITINGOU selon le sexe et par année d’âge......................................................................................... 28 Tableau G02A&B : Population Résidente recensée dans la commune de OUIDAH selon le sexe et par année d’âge............................................................................................................ 31 Tableau G02A&B :Population Résidente recensée dans la commune de PARAKOU selon le sexe et par année d’âge (Commune à statut particulier).................................................... 35 Tableau G02A&B : Population Résidente recensée dans la commune de DJOUGOU selon le sexe et par année d’âge .................................................................................................... 40 Tableau -
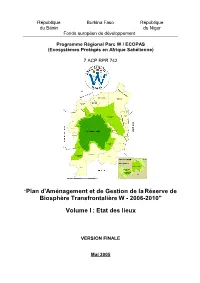
Volume I : Etat Des Lieux
République Burkina Faso République du Bénin du Niger Fonds européen de développement Programme Régional Parc W / ECOPAS (Ecosystèmes Protégés en Afrique Sahélienne) 7 ACP RPR 742 "Plan d'Aménagement et de Gestion de la Réserve de Biosphère Transfrontalière W - 2006-2010" Volume I : Etat des lieux VERSION FINALE Mai 2005 Programme Régional Parc W / ECOPAS 7 ACP RPR 742 "Plan d'Aménagement et de Gestion de la Réserve de Biosphère Transfrontalière W - 2006-2010" janvier - novembre 2004 Réalisé par le Programme Régional Parc W / ECOPAS en collaboration avec les Administrations de tutelles et les Communautés riveraines , avec l’appui technique de : Alain BILLAND, Marie Noël DE VISSCHER, KIDJO Ferdinand Claude, Albert COMPAORE, Amadou BOUREIMA, Alexandra MOREL, Laye CAMARA ; Frank CZESNIK, Nestor René AHOYO ADJOVI Adresse : Consultant Bureau de Coordination du Programme Consortium ECOPAS : Régional Parc W / ECOPAS Agrer S.A., Agriconsulting S.p.A., 01 BP 1607 CIRAD, GFA Terra Systems GmbH, Imm. PPI BF face BIB avenue du Temple Deutsche Gesellschaft für Technische Ouagadougou 01 Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Burkina Faso Tél./Fax: (+226) 335261 s/c GFA Terra Systems GmbH [email protected] Eulenkrugstr. 82 D – 22359 Hamburg Tel.: (+49)40-60306-111 Fax: (+49)40-60306-119 E-Mail: [email protected] Plan d'Aménagement et de Gestion de la RBT W (Bénin, Burkina Faso, Niger) Etat des lieux – Version finale ETAT DES LIEUX DE LA RESERVE DE BIOSPHERE TRANSFRONTALIERE W Sommaire 1 LISTE DES ABREVIATIONS .............................................................................................. 10 2 ELABORATION DU PLAN D’AMENAGEMENT ET DE GESTION............................... 14 3 HISTORIQUE........................................................................................................................ 16 3.1 HISTORIQUE DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DES PARCS NATIONAUX...................... -

The Cross-Border Transhumance in West Africa Proposal for Action Plan
Food and Agricultural Organization of the United Nations in collaboration with Economic Community of West African States The cross-border transhumance in West Africa Proposal for Action Plan June 2012 TABLE OF CONTENT TABLE OF CONTENT ...................................................................................................................................... 2 EXECUTIVE SUMMARY.................................................................................................................................. 5 Acronyms and Abbreviations ....................................................................................................................... 7 1. Introduction ........................................................................................................................................ 10 2. Background of livestock in West Africa .................................................................................................. 12 2.1. Increasing livestock numbers .......................................................................................................... 12 2.2. Many animal breeds but some endangered ................................................................................... 12 2.3. Livestock production systems in West Africa .................................................................................. 15 2.3.1. Pastoral systems ....................................................................................................................... 15 2.3.2. Urban and peri-urban livestock -

Processus De Recrutement Des Amod
1 Processus de Recrutement des AMOd 001/2016 Le Gouvernement de la République du Bénin a obtenu, du Fonds Mondial pour l’Assainissement (GSF) une subvention de 5 millions de dollar US, pour les cinq ans de mise en œuvre du Programme d’amélioration de l’accès à l’Assainissement et aux Pratiques d’Hygiène en milieu Rural (PAPHyR). L’objectif global de ce programme est de favoriser l’accès durable et équitable des populations démunies des zones rurales aux services d’assainissement, avec de bonnes pratiques d’hygiène en vue d’accélérer l’amélioration de la santé et de la qualité du cadre de vie des communautés pour l’atteinte des cibles OMD et post OMD. Medical Care Development International (MCDI), SELECTION DES 14 COMMUNES POUR LA MISE l’Agence d’Exécution (AE) du programme, met à EN OEUVRE DU PREMIER TOUR DE disposition une partie de ces fonds pour FINANCEMENT subventionner des ONG ou des Associations en qualité d’Agence de Mise en Œuvre déléguée (AMOd) pour l’exécution des activités du Suite à la publication de l’avis n° programme dans les vingt-sept (27) communes de 01/2015/PAPHyR-MCDI relatif à l’Appel à sa zone d’intervention. Manifestation d’Intérêt (AMI) le 17 août 2015 dans le quotidien ‘’La Nation’’, les 27 communes MCDI dispose à ce titre d’une enveloppe de d’intervention du PAPHyR ont envoyé à l’AE leur 1 100 000 dollars US de subvention (pour le dossier de manifestation d’intérêt pour le suivi des premier tour de financement) à répartir dans les activités du programme dans leurs communes quatre (4) départements d’intervention du respectives. -

Plan Directeur D'electrification Hors Réseau
Plan Directeur d’Electrification Hors Réseau Prévision de la demande - 2018 Annexe 3 Etude pour la mise en place d’un environnement propice à l’électrification hors-réseau Présenté par : Projet : Accès à l’Électricité Hors Réseau Activité : Etude pour la mise en place d’un environnement propice à l’électrification hors-réseau Contrat n° : PP1-CIF-OGEAP-01 Client : Millennium Challenge Account-Bénin II (MCA-Bénin II) Financement : Millennium Challenge Corporation (MCC) Gabriel DEGBEGNI - Coordonnateur National (CN) Dossier suivi par : Joel AKOWANOU - Directeur des Opérations (DO) Marcel FLAN - Chef du Projet Energie Décentralisée (CPED) Groupement : IED - Innovation Energie Développement (Fr) PAC - Practical Action Consulting Ltd (U.K) 2 chemin de la Chauderaie, 69340 Francheville, France Consultant : Tel: +33 (0)4 72 59 13 20 / Fax: +33 (0)4 72 59 13 39 E-mail : [email protected] / [email protected] Site web: www.ied-sa.fr Référence IED : 2016/019/Off Grid Bénin MCC Date de démarrage : 21 nov. 2016 Durée : 18 mois Rédaction du document : Version Note de cadrage Version 1 Version 2 FINAL Date 26 juin 2017 14 juillet 2017 07 septembre 2017 17 juin 2017 Rédaction Jean-Paul LAUDE, Romain FRANDJI, Ranie RAMBAUD Jean-Paul LAUDE - Chef de projet résident Relecture et validation Denis RAMBAUD-MEASSON - Directeur de projet Off-grid 2017 Bénin IED Prévision de la Demande Localités non électrifiées Scenario 24h Première année Moyen-terme Horizon Population Conso. Pointe Part do- Conso. (kWh) Pointe Part do- Conso. Pointe Part do- Code Localité