Annales Flash Déc 2016 Vol 2 N°22
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

THÈSE DE DOCTORAT DE L'université D'abomey-CALAVI Analyse Spatiotemporelle Du Risque De Transmission Palustre Dans Les Dé
MINISTER DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR RT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI ECOLE DOCTORALE PLURIDISCIPLINAIRE « ESPACES, CULTURES ET DÉVELOPPEMENT » Ad majorem scientiae gloriam THÈSE DE DOCTORAT DE L’UNIVERSITÉ D’ABOMEY-CALAVI Présentée par : SOMINAHOUIN Aimé André Option: Géographie et Gestion de l’Environnement Spécialité: Entomologie environnementale, Santé et Développement N° d'enregistrement/.............../EDP/FASHS/UAC Analyse spatiotemporelle du risque de transmission palustre dans les départements de l’Alibori, de l’Atacora et de la Donga au Bénin, Afrique de l’Ouest. Directeur de thèse : Co-directeur de thèse : Martin C. AKOGBETO, Christophe S. HOUSSOU, Professeur Titulaire des Universités CAMES Professeur Titulaire des Universités CAMES Composition du jury: Président : Expédit W. VISSIN, Professeur Titulaire, Université d’Abomey-Calavi, Bénin Directeur de Thèse : Martin C. AKOGBETO, Professeur Titulaire, Université d’Abomey-Calavi, Bénin Co-directeur de thèse : Christophe S. HOUSSOU, Professeur Titulaire, Université d’Abomey-Calavi, Bénin Examinateur : Jean Mianikpo SOGBEDJI, Professeur Titulaire, Uuniversité de Lomé, Togo Examinateur : Sékou F. TRAORE, Professeur Titulaire, Université de Bamako, Mali ANNEE ACADEMIQUE: 2019-2020 Soutenue publique : le ………..2020 1 D Sommaire Dédicace ..................................................................................................................................... 3 Remerciements .......................................................................................................................... -

International Journal of Research Culture Society
INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH CULTURE SOCIETY ISSN (O): 2456-6683 Monthly Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Research Journal Internationally approved Journal with Global Indexing Impact Factor: 4.526 Publishes original research papers/articles, reviews, mini-reviews, case studies, synopsis, research project and short research communications of all subjects/topics Volume: 2 Issue: 9 Sept: 2018 Benefits to publish the Paper in IJRCS IJRCS is an Open-Access, peer reviewed, Indexed, Refereed International Journal with wide scope of publication. Author Research Guidelines & Support. Platform to researchers and scholars of different study field and subject. Reliable and Rapidly growing Publication with nominal publication fees. Prestigious Editorials from different Institutes of the world. Communication of authors to get the manuscript status time to time. Full text of all articles in the form of PDF format. Individual copy of “Certificate of Publication” to all Authors of Paper. Indexing of paper in all major online journal databases like Google Scholar, Academia, Scribd, Mendeley, and Internet Archive. Open Access Journal Database for High visibility and promotion of your article with keyword and abstract. Organize Conference / Seminar and publish its papers with ISSN. Provides ISSN to Conference / Seminar Proceeding papers. RESEARCH CULTURE SOCIETY & PUBLICATION Email: [email protected] Web Email: [email protected] Cont. No: +91 9033767725 WWW.IJRCS.ORG INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH CULTURE SOCIETY ISSN : 2456 - 6683 A monthly Peer-Reviewed, Refereed, Indexed International Research Journal Certificate of Publication IMPACT FACTOR – 4.526 is awarded to PAPER ID – 201809008 Adolphe AHONNON For the research paper / article titled PRIMARY COURSE DROP OUT IN THE municipality OF DJOUGOU : DESCRIPTIVE STUDY Published in ‘International Journal of Research Culture Society’, Vol - 2, Issue - 9, Sept - 2018. -

Villages Arrondissement D~GARADEBOU: 14 Villages 1
REPUBLIQUE DU BENIN PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Loi n° 2013-05 DU 27 MAI2013 portant création, organisation, attributions et fonctionnement des unités administratives locales en République du Bénin. L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 15 février 2013. Suite la Décision de conformité à la Constitution DCC 13-051 du 16 mai 2013, Le Président de la République Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE PREMIER DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : Conformément aux dispositions de l'article 33 de la loi n° 97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l'administration territoriale en République du Bénin, la commune est démembrée en unités administratives locales sans personnalité juridique ni autonomie financière. Ces unités administratives locales qui prennent les dénominations d'arrondissement, de village ou de quartier de ville sont dotées d'organes infra communaux fixés par la présente loi. Article 2 : En application des dispositions des articles 40 et 46 de la loi citée à l'article 1er, la présente loi a pour objet : 1- de déterminer les conditions dans lesquelles les unités administratives locales mentionnées à l'article 1er sont créées; 2- de fixer la formation, le fonctionnement, les compétences du conseil d'arrondissement et du conseil de village ou quartier de ville d'une part et le statut et les attributions du chef d'arrondissement, du chef de village ou quartier de ville d'autre part. Article 3: Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin, la commune est divisée en arrondissements. -
Sous-Projet Construction/Rehabilitation Du Lycee Technique Agropastoral De Djougou
REPUBLIQUE DU BENIN MINISTÈRE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIENATIONALE DE L’EFTP PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES POUR L’EMPLOI DANS LES SECTEURS PRIORITAIRES (PDCESP) TRAVAUX DE CONSTRUCTION/REHABILITATION DE LYCEES TECHNIQUES AGRICOLES ET INDUSTRIELS FINANCEMENT DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT (BAD) SOUS-PROJET CONSTRUCTION/REHABILITATION DU LYCEE TECHNIQUE AGROPASTORAL DE DJOUGOU ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL SIMPLIFIEE RAPPORT FINAL CABINET DE RECHERCHES ET D’ETUDES POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE Tél. +229 96 43 12 12 / 63 09 22 91/95 05 93 95 Octobre 2020 [email protected] Etude d’Impact Environnemental et Social simplifiée du sous-projet construction/réhabilitation du Lycée Technique Commercial et Industriel de Djougou TABLE DES MATIERES TABLE DES MATIERES ....................................................................................................... 2 LISTE DES TABLEAUX ........................................................................................................ 7 LISTE DES FIGURES ........................................................................................................... 9 LISTE DES PHOTOS ...........................................................................................................10 LISTE DES PLANCHES .......................................................................................................10 RESUME EXECUTIF ...........................................................................................................14 -
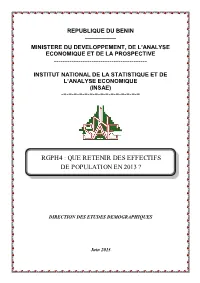
Resultats Definitifs RGPH4.Pdf
REPUBLIQUE DU BENIN _____________ MINISTERE DU DEVELOPPEMENT, DE L’ANALYSE ECONOMIQUE ET DE LA PROSPECTIVE ------------------------------------------ INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE L’ANALYSE ECONOMIQUE (INSAE) -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= RGPH4 : QUE RETENIR DES EFFECTIFS DE POPULATION EN 2013 ? DIRECTION DES ETUDES DEMOGRAPHIQUES Juin 2015 La nécessité de disposer de données pertinentes, fiables, diversifiées et désagrégées jusqu’au niveau géographique le plus fin et à jour, est unanimement reconnue par la communauté internationale. Appréciant ce besoin d’information, de nombreuses opérations statistiques se réalisent dans le but de disposer de données fiables facilitant une prise de décision éclairée, tant au niveau des décideurs politiques, qu’au niveau de la communauté scientifique et économique. Au titre de ces opérations, le Recensement Général de la Population et de l’Habitation est la source qui permet de disposer de façon exhaustive des données jusqu’aux plus petites unités administratives. Les travaux de dénombrement du RGPH4 au Bénin se sont déroulés du 11 au 31 Mai 2013 sur toute l’étendue du territoire national. Cette grosse opération a mobilisé près de 17.500 agents de terrain : agents recenseurs, chefs d’équipes, contrôleurs et superviseurs. En dehors des ressources du Budget National, elle a bénéficié de l’appui des partenaires au développement du Bénin, notamment la Coopération Suisse, la Banque Mondiale, l’UNICEF et l’UNFPA. A la suite de la collecte, les travaux de traitement ont démarré avec l’archivage des questionnaires, la vérification, la codification, la saisie et l’apurement des données. Après plusieurs étapes de validation par le Conseil Scientifique de l’INSAE, le Conseil des Ministres en sa séance du jeudi 21 mai 2015 a adopté les résultats définitifs du RGPH4. -

Republique Du Benin
REPUBLIQUE DU BENIN MINISTERE DE L’ENERGIE, DE L’EAU ET DES MINES (MEEM) AGENCE NATIONALE D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE EN MILIEU RURAL Financement : Banque Mondiale PLAN DIRECTEUR DE DEVELOPPEMENT DU SOUS-SECTEUR DE L’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE EN MILIEU RURAL DU BENIN CONTRAT MODIFICATIF DE SERVICE N°7187182 du 9 er Mars et 1 Mai R3 – Principes et priorités du Plan Directeur Juin 2017 Ingénieurs Conseils Bénin – www.igipafrique-bj.com Projet N°HSU31 Mission de préparation du Plan Directeur de Développement du sous-secteur de 2 l’Approvisionnement en eau potable en milieu rural du Bénin Rapport R3 : Principes et priorités du Plan Directeur TABLE DES MATIERES INTRODUCTION 6 1 RAPPEL DU CONTEXTE INSTITUTIONNEL ET STRATEGIQUE 9 1.1 Principaux Intervenants institutionnels pour l’élaboration et la mise en œuvre du Plan 9 1.2 Cohérence du plan Directeur avec la politique et stratégie sectorielle 10 1.2.1 Cohérence avec le PAG 10 1.2.2 Cohérence avec la Stratégie sectorielle 10 2 PERIMETRE D’INTERVENTION DU PLAN 12 2.1 Limite rural et urbain 12 2.2 Population et localités rurales EN 2016 13 2.2.1 Données démographiques 13 2.2.2 Population rurale en 2016 13 2.2.3 Typologie des localités rurales en 2016 14 3 RESSOURCES EN EAU 15 4 OUVRAGES DE CAPTAGES 16 5 OUVRAGES HYDRAULIQUES 17 5.1 répartition et état des ouvrages hydrauliques 17 5.2 Source d’énergie des ouvrages hydrauliques 18 5.3 Gestion du service de l’eau en milieu rural 19 5.4 Coût du service de l’eau 19 6 TAUX DE DESSERTE EN MILIEU RURAL 20 7 PRINCIPES EN TERMES DE TYPE DE -

Cahier Des Villages Et Quartiers De Ville
République du Bénin ~~~~~ Ministère Chargé du Plan, de La Prospective et du Développement ~~~~~~ Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique Cahier des villages et quartiers de ville Département de la DONGA DDC COOPERATION SUISSE AU BENIN Direction des Etudes Démographiques Cotonou, Mai 2004 2 DEPARTEMENT DE LA DONGA CARTE Atacora N KOPARGO DJOUGOU OUAKE Togo BASSILA Borgou Collines 01020Kilometers Mai 2004 3 DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DU DEPARTEMENT DE LA DONGA Présentation du département de la Donga Le département de la Donga occupe la zone sud de l’ancien département de l’Atacora. Il s’étend sur une superficie de 11 126 km2. Il compte 177 villages ou quartiers de ville répartis dans quatre communes à savoir les communes de Djougou, de Bassila, de Copargo et de Ouaké. Le département de la Donga est composé de 26 arrondissements. Milieu naturel Le relief du département de la Donga est constitué des chaînons des Tanékas (654 m) et surtout de plaines mollement ondulées de 150 m à 200 m d’altitude. Le climat est du type soudano-guinéen, caractérisé par une saison sèche qui couvre la période de mi-octobre à mi-avril et une saison pluvieuse entre mi-avril et mi-octobre. La normale des précipitations se situe entre 1 200 mm et 1 300 mm avec le mois d'août comme le mois le plus pluvieux. C’est dans ce département que le fleuve Ouémé prend sa source (Tanéka-Koko) et coule vers l’Océan Atlantique. En saison pluvieuse, les cours d’eau entraînent des submersions favorables à la pratique de la riziculture dans les bas-fonds. -

Titre Premier Des Dispositions Generales
REPUBLIQUE DU BENIN PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Loi n° 2013-05 DU 27 MAI2013 portant création, organisation, attributions et fonctionnement des unités administratives locales en République du Bénin. L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 15 février 2013. Suite la Décision de conformité à la Constitution DCC 13-051 du 16 mai 2013, Le Président de la République Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE PREMIER DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : Conformément aux dispositions de l'article 33 de la loi n° 97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l'administration territoriale en République du Bénin, la commune est démembrée en unités administratives locales sans personnalité juridique ni autonomie financière. Ces unités administratives locales qui prennent les dénominations d'arrondissement, de village ou de quartier de ville sont dotées d'organes infra communaux fixés par la présente loi. Article 2 : En application des dispositions des articles 40 et 46 de la loi citée à l'article 1er, la présente loi a pour objet : 1- de déterminer les conditions dans lesquelles les unités administratives locales mentionnées à l'article 1er sont créées; 2- de fixer la formation, le fonctionnement, les compétences du conseil d'arrondissement et du conseil de village ou quartier de ville d'une part et le statut et les attributions du chef d'arrondissement, du chef de village ou quartier de ville d'autre part. Article 3: Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin, la commune est divisée en arrondissements. -

Effectifs De La Population Des Villages Et Quartiers De Ville Du Benin (Rgph-4, 2013)
REPUBLIQUE DU BENIN &&&&&&&&&& PRIMATURE &&&&&&&&&& INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE L’ANALYSE ECONOMIQUE (INSAE) &&&&&&&&&& EFFECTIFS DE LA POPULATION DES VILLAGES ET QUARTIERS DE VILLE DU BENIN (RGPH-4, 2013) Février 2016 REPUBLIQUE DU BENIN &&&&&&&&&& PRIMATURE &&&&&&&&&& INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE L’ANALYSE ECONOMIQUE (INSAE) &&&&&&&&&& EFFECTIFS DE LA POPULATION DES VILLAGES ET QUARTIERS DE VILLE DU BENIN Février 2016 DEPARTEMENT DE L’ALIBORI Divisions administratives RGPH4-2013 Nombre ménages Total Masculin Féminin Taille ménage BENIN 1 803 123 10 008 749 4 887 820 5 120 929 5,6 DEP: ALIBORI 108 351 867 463 431 357 436 106 8,0 COM: BANIKOARA 26 895 246 575 122 445 124 130 9,2 ARROND: FOUNOUGO 4 414 47 026 23 138 23 888 10,7 BOFOUNOU-PEULH 128 1 381 695 686 10,8 FOUNOUGO A 913 9 899 4 923 4 976 10,8 FOUNOUGO B 731 6 838 3 363 3 475 9,4 FOUNOUGO PEULH 122 1 985 942 1 043 16,3 GNINGNIMPOGOU 289 3 397 1 675 1 722 11,8 GOUGNIROU-BARIBA 163 1 824 881 943 11,2 GOUGNIROU PEULH 125 1 163 583 580 9,3 IGRIGGOU 679 7 096 3 452 3 644 10,5 KANDEROU 467 5 912 2 946 2 966 12,7 KPAKO GBARI 380 3 806 1 850 1 956 10,0 SAMPETO 417 3 725 1 828 1 897 8,9 ARROND: GOMPAROU 2 204 22 803 11 418 11 385 10,3 BOUHANROU 274 2 891 1 428 1 463 10,6 GOMPAROU A 403 3 969 1 956 2 013 9,8 GOMPAROU B 261 2 521 1 247 1 274 9,7 GOMPAROU PEULH 83 899 442 457 10,8 KPESSANROU 167 1 908 965 943 11,4 NIEKOUBANTA 77 828 415 413 10,8 PAMPIME 426 4 778 2 394 2 384 11,2 TIGASSOUNON 445 4 137 2 137 2 000 9,3 GOUROUEDE 68 872 434 438 12,8 ARROND: GOUMORI -

Etude D'impact Environnemental Et Social
REPUBLIQUE DU BENIN ************** MINISTERE DE L’ENERGIE (ME) ************** Agence Béninoise d’Electrification Rurale et de Maitrise d’Energie (ABERME) ************** Projet d’électrification de 100 localités rurales du Bénin financé par la Banque Africaine de Développement (BAD) Etude d’impact environnemental et social Rapport Final Mai 2019 1 SOMMAIRE LISTE DE FIGURES ........................................................................................................................ 3 LISTE DES PHOTOS ....................................................................................................................... 4 LISTE DES TABLEAUX ................................................................................................................... 5 LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES ............................................................................................... 6 1. RESUME ANALYTIQUE .......................................................................................................... 8 2. INTRODUCTION .................................................................................................................. 11 3. DEMARCHE METHODOLOGIQUE D’EVALUATION DES IMPACTS DES ACTIVITES DU PROJET 11 4. CADRE STRATEGIQUE, JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF ....................................................... 23 5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DU PROJET ...................................................................... 38 6. DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT DU PROJET ............................................................. -

Informations Complementaires Au Cahier Special De Charges Ben 541
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES AU CAHIER SPECIAL DE CHARGES BEN 541 Acquisition de matériels et équipements biomédicaux destinés à la prise en charge des maladies chroniques non transmissibles dans les centres de santé et hôpitaux de zone de la Donga, du Mono et du Couffo 1. La date de dépôt des offres initialement fixée au Vendredi 13 Avril 2018 est prolongée jusqu’au Mardi 24 Avril 2018 à 10h 00 mn. 2. Le soumissionnaire introduit un original de l’offre et deux copies. 3. Aucune garantie de soumission n’est requise. Le cautionnement de 5% (article 4.5 dispositions contractuelles particulières ) est une garantie de bonne exécution du marché. 4. Les soumissionnaires doivent déposer leurs offres à l'adresse suivante : Secrétariat du Programme d’Appui au Secteur de la Santé (PASS SOUROU) sis au Ministère de la Santé à Akpakpa, Cotonou. 5. Au point « 3.4.4 Eléments inclus dans le prix » 7°les droits de douane et d’accise, le CSC reprend tout simplement tous les éléments que l’art 32.AR du 18.04.2017 prévoit de prendre en compte dans « Prix ». Il s’agit donc d’un standard de la Loi. En ce qui concerne Enabel, elle est exonérée des Droits de Douanes et de la TVA. Ces taxes ne doivent donc pas être pris en compte dans le montant de l’offre. 6. L’incoterm à utiliser est DDP. 7. Les lieux de livraison et de réception des fournitures sont les suivants : - Départements du Mono et du Couffo : Bureau de zone snitaire ADD à Aplahoué Bureau de zone sanitaire CBGH à Comé Bureau de zone sanitaire KTL à Klouékanmè Direction Hôpital de zone Comè à Comè Direction CHD Lokossa à Lokossa Direction Hôpital de zone Klouékanmè à Klouékanmè Direction CHD Aplahoué à Aplahoué. -

Analysis of Vulnerability and Mobility of Herders in the Djougou Municipality
ANALYSIS OF VULNERABILITY AND MOBILITY OF HERDERS IN THE DJOUGOU MUNICIPALITY Agricultural Engineer Degree Ogoudele Simon Codjo April 2011 University of Parakou, Parakou i Analysis of Vulnerability and Mobility of Herders in the Djougou Municipality Thesis subbmited to obtain Agricultural Engineer Degree in Rural Economy and Sociology By Ogoudele Simon Codjo April 2011 University of Parakou, Parakou ii Analyse de la Vulnerabilite et de la Mobilite des Eleveurs Transhumants de la Commune de Djougou Thèse pour l’obtention du diplôme d’Ingénieur Agronome en Economie et Sociologie Rurales Presentée par Ogoudele Simon Codjo Avril 2011 Université de Parakou, Parakou iii Certification Nous certifions que ce travail a été réalisé sous notre supervision par Ogoudélé Simon CODJO à la Faculté d’Agronomie (FA) de l’Université de Parakou (UP), en vue de l’obtention du Diplôme d’Ingénieur Agronome, option Economie et Sociologie Rurales (ESR). Le superviseur : Le co-superviseur : Dr. Ir. Ange Honorat EDJA Prof. Marcel HOUINATO iv Dédicaces A Marie mère de Dieu, A mon père Samuel CODJO, A ma mère Salomé BOLLA et, A ma sœur Elvire CODJO. v Remerciements Ils sont nombreux à apporter de près ou de loin, directement ou indirectement, leur pierre à l’édification de cette œuvre. Dieu sait qu’ils sont nombreux. Je ne puis épuiser leur liste. Cependant, je crois indispensable d’évoquer quelques noms : Mon directeur de thèse, Le Docteur Ingénieur Ange Honorat EDJA, ce père dynamique au cœur maternel. Il a su former et modeler mon esprit d’ingénieur en herbe suivant sa rigueur et ses pertinentes remarques dans la conduite de ce travail.