La Préface De Robert Desoille
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Image and Imagination As Therapeutic Support. Know Oneself and Re-Educate Oneself Through Vision †
Proceedings Image and Imagination as Therapeutic Support. Know Oneself and Re-Educate Oneself through Vision † Anna Marotta * and Rossana Netti DAD (Department of Architecture and Design), Politecnico di Torino, 10129 Torino, Italy; [email protected] * Correspondence: [email protected] † Presented at the International and Interdisciplinary Conference IMMAGINI? Image and Imagination between Representation, Communication, Education and Psychology, Brixen, Italy, 27–28 November 2017. Published: 18 January 2018 Abstract: This research aims to identify and understand the possible approaches in psychological environment, through the images and imaginary as a therapeutic tool. The image is investigated in the film “projection”: this latter is not only intended as a visual projection on the plane of expression, but it is also the projection of the self, implemented by the director and the actors, but also by the spectator, who becomes a participating observer of the story told. An example that combines all these aspects can be identified in Hitchcock’s figure, for his film culture, for the recording technique, but also for his complex psychic characteristics. The critical synthesis of the most significant works of his film production, can be a possible example for the research proposed here. In particular, some elements of vision and representation were privileged in relation to the relationship between image, imaginary and psychological aspects. Keywords: imagination; vision; fantasy; metaphor; therapeutic aid 1. Introduction Mental images, such as dreams, are emerging symbols from the unconscious that can be investigated and understood to modify and enhance the approach to the real world, but also with oneself. To imagine is not always a simple process to put into practice: for some the production may be excessive or disorderly, for other deficient or problematic and moreover the mind may not be able to distinguish reality from fantasy. -

Inventaire Du Fonds Pierre-Bernard Schneider
Institut universitaire d’histoire de la médecine et de la santé publique Bibliothèque d’histoire de la médecine et d’éthique médicale Inventaire du Fonds P. BERNARD SCHNEIDER CHUV | Bibliothèque d’histoire de la médecine et d’éthique médicale Inventaire du fonds Pierre-Bernard Schneider Réalisé sous la direction de Daniela Vaj DV IUHM, Lausanne, 2011 IUHM - Fonds Schneider P.B. 1 Bibliothèque d’histoire de la médecine et d’éthique médicale Institut universitaire d’histoire de la médecine et de la santé publique Avenue de Provence 82, CH-1007 Lausanne Tél. 021 314 70 52 / mailto : [email protected] Site : www.chuv.ch/iuhmsp/bibliothèque Equipe : Daniela Vaj, responsable de la bibliothèque Marie-Dominique Casse, bibliothécaire assistante Caroline Hofer, bibliothécaire assistante IUHM - Fonds Schneider P.B. 2 Présentation Note biographique Pierre-Bernard Schneider (1916 - 2005) Pierre-Bernard Schneider naît le 29 septembre 1916 à St-Imier dans une famille d’horlogers originaire de Seeberg, dans le canton de Berne. Il partage ses études de médecine entre plusieurs villes de Suisse, Vienne et Paris, puis se spécialise en psychiatrie. Il obtient son doctorat en médecine en 1944 et son habilitation en 1954. Ses voyages aux Etats-Unis l’ouvrent aux progrès de la médecine psychosomatique et de la psychologie médicale. A l'Université de Lausanne il est privat-docent (1953-1957), puis professeur extraordinaire de policlinique psychiatrique (1957-1965). Il donne également des cours de psychiatrie à la Faculté de droit (1957-1982) et accède au professorat ordinaire de psychologie médicale et de psychiatrie en 1965. Doyen de faculté de médecine (1964-1966), il crée et dirige la Policlinique psychiatrique universitaire entre 1948 et 1982, date de sa retraite. -

Viewed As Providing a Symbolic Bridge Between Our Conscious and Unconscious Thoughts
Cronicon OPEN ACCESS EC PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY Thematic Article Imaginative Movement Therapy: A Jungian Psychotherapeutic Approach Laner Cassar* SITE (MALTA), International Network for the Study of Waking Dream Therapy (INSWDT), Malta *Corresponding Author: Laner Cassar, SITE (MALTA), International Network for the Study of Waking Dream Therapy (INSWDT), Malta. Received: March 15, 2021; Published: April 28, 2021 Abstract This paper highlights the main procedural steps of the neo-Jungian psychotherapeutic modality known as Imaginative Move- ment Therapy which integrates aspects of Desoille’s Directed Waking Dream method into Jung’s Active Imagination technique while respecting the main principles of analytical psychology. This therapeutic modality facilitates the patient’s access the help of the therapist to his or her own unconscious by engaging in a waking dream which is started by the therapist. The patient is encouraged symbolically in a collaborative phase between therapist and patient. Despite the relative guidance of the therapist in I.M.T., the thera- to explore, experience and confront unconscious figures encountered. These waking dreams are then reflected upon and elaborated pist has to be particularly attentive to be respectful of the patient’s unconscious material and only intervenes with prompting inter- ventions to start the waking dream, to explore it and when he or she needs to be provided with safety. Keywords: Imagination; Movement; Waking Dreams; Imaginative Experience Imaginative Movement Therapy is a relational and imaginative form of psychotherapy which makes use of the patient’s imagination in therapeutic modality developed from Carl Jung’s method of Active Imagination which also integrates aspects of Robert Desoille’s Directed order to access his or her unconscious and to help undo the stuckness that he or she may find themselves in. -

First Lecture on the Waking Dream, a French Approach to Psychotherapy
First lecture on the Waking Dream, a French Approach to Psychotherapy For the Child and Adolescent Psychotherapy Program Washington School of Psychiatry, Washington, DC Tom Holman, Ph.D. This evening we are examining the Waking Dream, a French approach to psychotherapy and psychoanalysis, and the work of Nicole Fabre, the major proponent of this approach. While the Waking Dream is used with children, adolescents, and adults, we will be examining its application in child psychotherapy and psychoanalysis. Your reading for this class includes three chapters from a book by Nicole Fabre, which I have translated from the French. I have translated the title of the book as "You Can Dream While You're Wide Awake: Child Psychotherapy and the Realm of the Imaginary" (the literal translation of the title is “The Work of the Imaginary in Child Psychotherapy”). In making these translations and in learning about the Awaking Dream, I have had wonderful opportunities to discuss these subjects with Fabre and her colleagues in their professional organization, the International Group for the Waking Dream in Psychoanalysis (the French acronym for this organization is GIREP). GIREP is a very active organization that publishes a journal, runs a training program, offers lectures and seminars, and organizes a conference every other year. GIREP also maintains an extensive web site (www.le-reve-eveille-en- psychanalyse.com). Because the literature on the Waking Dream is almost entirely in French, this approach is virtually unknown in the United States. Nicole Fabre writes beautifully in French, and any awkwardness or mistakes in the readings are entirely my own. -

The First International Conference on Waking Dream Therapy
THE MALTA DEPTH PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION ANNOUNCES THE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON WAKING DREAM THERAPY: REVERIES FROM THE PAST AND STIMULI TO THE FUTURE 23rd -24th May, 2014 wakingdreamtherapy.org MALTA, EUROPE This conference is being organised by the Malta Depth Psychological Association under the auspices of S.I.S.P.I (Scuola Internazionale con la Procedura Imnaginativa) - Address: Via C. Menotti, 11/c IT-20129 Milano, Italy. Website: www.sispi.eu Robert Desoille (1890 -1966) In 2014, it would be over 90 years since the French Robert Desoille (1890 -1966) discovered the therapeutic potential of the waking dream which he later developed into the psychotherapeutic method of Rêve-éveillé-dirigé (RED) - Directed Waking Dream. Since then his method has continued to evolve and transform in different modalities which continued to emphasize the therapeutic force of the imagination. This 1st International Conference will be dedicated to the theme of ‘Waking Dream Therapy: Reveries from the Past and Stimulus to the Future.’ Like the ancient Roman two-faced God Janus, this conference is aimed to honour Desoille’s legacy in the field of imaginative psychotherapeutic methods. It also aims to investigate the developments of waking dream therapies in our contemporary world. It further offers to throw new light on the history of European psychotherapy, especially in respect of the imaginative therapeutic methods as introduced by Carl Jung, Robert Desoille and Roberto Assagioli. This conference will also highlight the European legacy of applying mental imagery to therapeutic methods of the twentieth century. Malta is a particularly appropriate site for the Conference. Not only is it a central island in the middle of the Mediterranean Sea but also one of the most picturesque, and friendly islands in Europe. -
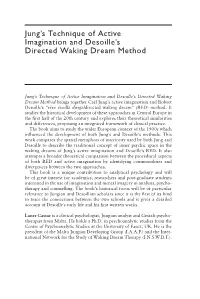
Jung's Technique of Active Imagination and Desoille's Directed
Jung’s Technique of Active Imagination and Desoille’s Directed Waking Dream Method Jung’s Technique of Active Imagination and Desoille’s Directed Waking Dream Method brings together Carl Jung’s active imagination and Robert Desoille’s “rêve éveillé dirigé/directed waking dream” (RED) method. It studies the historical development of these approaches in Central Europe in the first half of the 20th century and explores their theoretical similarities and differences, proposing an integrated framework of clinical practice. The book aims to study the wider European context of the 1900s which influenced the development of both Jung’s and Desoille’s methods. This work compares the spatial metaphors of interiority used by both Jung and Desoille to describe the traditional concept of inner psychic space in the waking dreams of Jung’s active imagination and Desoille’s RED. It also attempts a broader theoretical comparison between the procedural aspects of both RED and active imagination by identifying commonalities and divergences between the two approaches. This book is a unique contribution to analytical psychology and will be of great interest for academics, researchers and post-graduate students interested in the use of imagination and mental imagery in analysis, psycho- therapy and counselling. The book’s historical focus will be of particular relevance to Jungian and Desoillian scholars since it is the first of its kind to trace the connections between the two schools and it gives a detailed account of Desoille’s early life and his first written works. Laner Cassar is a clinical psychologist, Jungian analyst and Gestalt psycho- therapist from Malta. -

Socratic Asceticism and the Philosophical Life D.C
Philosophy, Culture, and Traditions Vol. 4 2007 ISSN 1609-2392 ___________________________________________________________ Table of Contents Theme: Culture, Diversity, and Shared Values On Being Invisible: Socratic Asceticism and the Philosophical Life D.C. Schindler 7 The Ethical Imagination in Bachelard’s reading of Nietzsche Kuan-Min Huang 19 The Negation of Public Values in Neoliberalism: Market Versus State or State Versus Citizenship? Dionysios G. Drosos 31 Feminist Epistemology and Human Values in African Culture B.A. Lanre-Abass 57 Tempels et la philosophie bantoue Mejame Ejede Charley 73 The Claim of Truth and the Claim of Freedom in Religion Tran Van Doan 89 Dialogue entre la philosophie bouddhiste et la théorie critique de l’École de Francfort. Véronique Tomaszewski Ramses 103 Ambivalence and Rebellion: Yoder and Hauerwas on Democracy Anthony G. Siegrist …..127 Cosmopolitanism, Stoicism, and Liberalism Doug Al-Maini 141 Accidental Democrats? Calvinism’s Ambiguous Contribution to Modern Democratic Ideals James Gerrie 161 The Analytic – Synthetic Distinction in Indigenous African Language Francis Offor 187 Platonic Dialogue and Transformative Philosophy Bharathi Sriraman 197 Non-thematic papers Beyond Natural Law Stephen Theron 209 Faith and the Sublation of Modernity: Kierkegaard, Quixote and the Transformation of Fideism James Mark Shields 231 Book Reviews Philip Manning, Freud and American Sociology, Patricia Cormack 249 Louis Groarke, The Good Rebel Doug Al-Maini 252 Jack Martin, Jeff Sugarman, Janice Thompson, Psychology and the Question of Agency Irene Sonia Switankowsky 256 CONTRIBUTORS D.C. Schindler is an Assistant Professor of Philosophy in the Department of Humanities at Villanova University. His forthcoming book bears the working title, Plato's Critique of Impure Reason: On Goodness and Truth in the Republic. -
THE DIRECTED DAYDREAM by ROBERT DESOILLE First Lecture—January 11, 1965
THE DIRECTED DAYDREAM By ROBERT DESOILLE First Lecture—January 11, 1965 Ladies and Gentlemen: You have expressed a desire to learn something about the technique of the directed daydream. It is an honor for me to reply to this desire, and I do it with the greatest pleasure. First let us consider the experiment and the phenomena that can be observed. Later we will try to explain them and to understand how they can be used for the cure of the neuroses. The basic procedure of this experiment is quite simple: It consists of having the subject engage in a daydream while he is stretched out on a couch as comfortably as possible in a state of muscular relaxation. It is not necessary that he be completely relaxed, but he should be isolated from noise and should be in semi-darkness with his eyes dosed. This helps the subject to avoid disturbing distractions while contemplating his mental images. But while the spontaneous daydream is generally a compensatory device, the directed daydream does not become such because of the fact that we guide it. Here is how this is done: We give the patient a starting image, for example, a sword, or possibly, a seashore where the water is very deep. We have him describe this image as thoroughly as possible, and ask him questions so as to evoke details, if necessary. If it is an object—for example, a sword or a vase—we ask the patient to tell us where the object is located and where he himself is. -

The MALTA DEPTH PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION
Highlights edited by Laner Cassar, Alberto Passerini, Lily Said THE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON WAKING DREAM THERAPY: REVERIES FROM THE PAST AND STIMULI TO THE FUTURE 23rd -24th May, 2014, MALTA, EUROPE wakingdreamtherapy.org organised by the MALTA DEPTH PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION under the auspices of S.I.S.P.I. Scuola Internazionale di Specializzazione con la Procedura Immaginativa - Milano, Italy - www.sispi.eu – [email protected] & Ambassade de France à Malte Welcome Speech by H.E. Ms. Marie Louise Coleiro-Preca President of the Republic of Malta Welcome by Rev. Jimmy Bonnici - Rector of the Archbishop’s Seminar Welcome by Mr. Laner Cassar & Mr. Alberto Passerini - Co-chairs of the Programme committee DAY 1: SESSION 1 Theme: Waking Dream Therapy in the historical psychotherapeutic context of the twentieth century 10.05 – 10.40 Keynote Speech: Gunther Langwieler (DGAP, Germany) Psychiatrist & Jungian Analyst, President of the C.G..Jung Society, Berlin. The Discovery of the World Inside. The Imaginations of Carl-Gustav Jung: Sources and Clinical Practise of Active Imagination 10.40 – 11.15 Laner Cassar* (MDPA, Malta) & Sara Zoja** (Italy) *Clinical Psychologist & Psychotherapist, President of MDPA **Clinical Psychologist & Jungian Psychotherapist From Mnemosyme to Clio: Tracing the historical connections between the Jungian and Desoillian psychotherapeutic movements 11.15 – 11.25 Coffee Break 11.25 – 12.05 Giovanni Sorge (ETH, Switzerland) Historian of Jungian Psychoanalysis, Researcher at the Swiss Federal Institute of Technology in Zurich ( ETH University) Eliade, Jung and the technique of the Rêve-Eveillé-Dirigé 12.05 – 12.35 Nicole Fabre (G.I.R.EP, France) Psychoanalyst, ex-President of G.I.R.E.P, Paris Robert Desoille – Personal Recollections 12.35 - 13. -
F I L O S O F I E Nr
A n a l e l e U n i v e r s i t ă ţ i i d i n C r a i o v a S e r i a: F i l o s o f i e Nr. 41 (1/2018) ANNALES DE L’UNIVERSITÉ DE CRAIOVA – SERIE DE PHILOSOPHIE, nr. 41 (1⁄2018) 13 rue Al. I. Cuza, Craiova, ROUMANIE On fait des échanges des publications avec des institutions similaires du pays et de l’étranger ANNALS OF THE UNIVERSITY OF CRAIOVA – PHILOSOPHY SERIES, nr. 41 (1⁄2018) Al. I. Cuza Street, no. 13, Craiova, ROMANIA We exchange publications with similar institutions of our country and abroad Annals of The University of Craiova. Philosophy Series publishes two issues per year, in June and December. The journal is available in print, but it is also available for download as PDF document at http://cis01.central.ucv.ro/analele_universitatii/filosofie/ Editor-in-Chief: Adriana Neacşu, University of Craiova Editorial Board: Anton Adămuţ, Alexandru Ioan Cuza Niculae Mătăsaru, University of Craiova University of Iaşi Alessandro Attilio Negroni, Università di Genova Alexandru Boboc, Romanian Academy Ionuţ Răduică, University of Craiova Giuseppe Cacciatore, University of Naples Vasile Sălan, University of Craiova Federico II Giovanni Semeraro, Federal University Giuseppe Cascione, University of Bari of Rio de Janeiro Teodor Dima, Romanian Academy Gabriella Farina, Roma Tre University Alexandru Surdu, Romanian Academy Ştefan Viorel Ghenea, University of Craiova Tibor Szabó, University of Szeged Vasile Muscă, Babeş-Bolyai University, Cluj- Cristinel Nicu Trandafir, University Napoca of Craiova Gheorghe Vlăduţescu, Romanian Academy Secretary: -

Logotherapy with Boeschemeyer's Value-Oriented Imagery in Multicultural Contexts
LOGOTHERAPY WITH BOESCHEMEYER’S VALUE-ORIENTED IMAGERY IN MULTICULTURAL CONTEXTS by MONIKA MEYER-PRENTICE submitted in accordance with the requirements for the degree of DOCTOR OF LITERATURE AND PHILOSOPHY In the subject PSYCHOLOGY at the UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA Supervisor: DR EM CRONJÉ Co-supervisor: PROF JM NIEUWOUDT March 2013 - ii - Declaration I declare that LOGOTHERAPY WITH BOESCHEMEYER’S VALUE-ORIENTED IMAGERY IN MULTICULTURAL CONTEXTS is my own work and that all the sources that I have used or quoted have been indicated and acknowledged by means of complete references. -------------------------------------------------- -------------------------------------- Place, Date Ms Monika Meyer-Prentice (Student number: 3514-471-8) - iii - Acknowledgements I want to thank everybody who was involved in making this doctoral thesis possible and a most rewarding experience. First of all, a heart-felt thank you to the 18 South African participants of the study: without your curiosity about Value-Oriented Imagery and your trust in me this study would have been impossible. Thank you for allowing me to witness different landscapes and personifications of your inner worlds. These touched me, resonated within me, facilitated our deep and rich encounters and also left beautiful memories and traces in my soul. And I wish to thank Prof. Uwe Boeschemeyer, Dr. Stephan Peeck and Andreas Boeschemeyer who introduced me to the work with Value-Oriented Imagery, accompanied my path with it, trained me at it and availed themselves for the expert interviews. I admire all three of you for your courageous paths and wonderful work. I thank all the individuals and groups in Germany and elsewhere who gave me the opportunity to practice WIM® with them and to continue learning from their experiences. -

Guided Imagery
GUIDED IMAGERY: A Psychosynthesis Approach History and Manual for Practitioners by Martha Crampton, Ph.D First published in 1974 by the Quebec Center for Psychosynthesis Inc., 3496 Marlowe Avenue, Montreal First revised edition published in 1977 by the Canadian Institute of Psychosynthesis, Inc. Second revised edition published by The Synthesis Center Inc. in 2005 www.synthesiscenter.org AUTHOR’S PREFACE TO THE NEW EDITION In the years since this monograph was first published, the field of guided imagery has grown by leaps and bounds. It has now become part of the mainstream, not only in psychotherapy, but in fields such as mind- body medicine, creative problem-solving, education, and the popular self-help literature. The power of the mind to create health or disease is now widely recognized. A wide spectrum of practitioners from diverse schools of thought now incorporate imagery techniques in their work. In recent years, The Academy for Guided Imagery has trained practitioners in the skills of “interactive imagery”, particularly in the health care field. Their web site, academyforguidedimagery.com has information on their conferences, educational materials, and other resources. Dr. Marty Rossman, a co-founder of the Academy, has written a book, Guided Imagery for Self-Healing, which provides information on more recent developments in the field. Dr. Rossman has a web site of his own, thehealingmind.net, which also provides a wealth of resources for self help. As I re-read the history part of this monograph I was once again touched to connect with the work and the spirit of the great pioneers of Guided Imagery (originally called “mental imagery”).