La Vocation Actuelle De L'agriculture, Cas De La
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
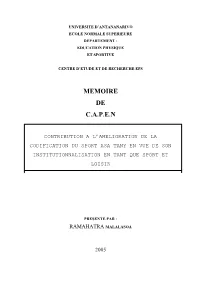
Memoire De C.A.P.E.N
UNIVERSITE D’ANTANANARIVO ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEPARTEMENT : EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE CENTRE D’ETUDE ET DE RECHERCHE EPS MEMOIRE DE C.A.P.E.N CONTRIBUTION A L’AMELIORATION DE LA CODIFICATION DU SPORT ASA TANY EN VUE DE SON INSTITUTIONNALISATION EN TANT QUE SPORT ET LOISIR PRESENTE PAR : RAMAHATRA MALALASOA 2005 1 UNIVERSITE D’ANTANANARIVO ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEPARTEMENT EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE CENTRE D’ETUDE ET DE RECHERCHE ENS. /EPS Promotion : « VARATRA » MEMOIRE DE FIN D’ETUDE POUR L’OBTENTION DU CERTIFICAT D’APTITUDE PEDAGOGIQUE DE L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE (CAPEN) « CONTRIBUTION A L’AMELIORATION DE LA CODIFICATION DU SPORT ASA TANY EN VUE DE SON INSTITUTIONNALISATION EN TANT QUE SPORT ET LOISIR » Présenté et soutenu publiquement le : 26 Octobre 2005 Par : RAMAHATRA Malalasoa Né le : 08 Mars 1978 A : Arivonimamo MEMBRE DU JURY : Président : ANDRIANAIVO Victorine Juge : RASOLONJATOVO Haingo Harinambinina Rapporteur : RAKOTONIAINA Jean Baptiste 2 TITRE : «CONTRIBUTION A L’ AMELIORATION DE LA CODIFICATION DU « SPORT ASA TANY » EN VUE DE SON INSTITUTIONALISATION EN TANT QUE SPORT ET LOISIR » AUTEUR : RAMAHATRA Malalasoa NOMBRE DE PAGES : 76 NOMBRE DE TABLEAUX : 10 RESUME : La richesse culturelle de Madagascar mérite une recherche particulière, au niveau de la tradition aussi bien que de sa civilisation. En effet, le présent mémoire essaie d’apporter des améliorations à la codification, de la pratique du sport asa tany que l’association sport asa tany Madagascar a déjà essayé dans quelques territoires malgache et ailleurs, mais elle n’est pas arrivée à le sportiviser comme le cas des autres sports traditionnels. De ce faite, l’existence des règlements officiels et uniques facilite l’organisation des championnats qui peut entraîner la naissance des clubs, les sections et la fédération sportive pour ce nouvel sport venant des paysans malgaches. -

And. 4. - I-Iavoaka Amin' Ny Gazetim-Panjakan' Ny Repoblika Art
Andininy voalohany. - Ny fepetra voalazan' ny tovana amin' ny Article jJremier. - Les dispositions de I'annexe de la loi lalima laharana faha-94-00 I mametra ny isa, ny famariparitana, ny nO 94-00 I fixant Ie nom bre, la delimitation, la denomination et Ics fiantsoana ary ny renivohitry ny Vondrom-bahoakam-paritra chefs-lieux des Collectivites territoriales decentralisees sont itsinjaram-pahefana dia ovana toy izao manaraka izao amin' izay modifiees comme suit en ce qui concerne Ie Departernent mikasika ny Departemantan' Antananariva-Avaradrano. d' Antananarivo-Avaradrano. "Tsy anisan' ny Kaominina ao anatin' ny Departemantan' "La Commune de Talata-Volonondry ne fait plus partie des Antananarivo-Avaradrano intsony ny Kaominin' i Talata- Communes composantes du Departement d' Antananarivo- Volonondry". Avaradrano." And. 2. - Atsangana ny Departemanta vaovao iray antsoina hoe: Art. 2. - II est cree un nouveau Departement denomme "Mandiavato-Mananara" izay manana ny renivohim-paritra ao "Mandiavato-Mananara" ayant pour chef-lieu Talata-Volonondry et Talata-Volonondry, ka anisan' ny Kaominina ao anatiny :' dont les Communes composantes sont,: - Talata- VolonOrfdry (Renivohim-paritra); - Talata-Volonondry (chef-lieu); - Ambatomcna; - Ambatomena; - Ankazondandy; -Ankazondandy; - Sadabe; - Sadabe; - Ambohitrulomahitsy; -Ambohitrolomahitsy; - Antsahalalina; - Antsahalalina; - Soavinandriana; - Soavinandriana; - Ambohitseheno; - Ambohitseheno; - Ambohitrony; - Ambohitrony. And. 3. - Foanana ary dia foana ny fepetra rehetra teo aloha sy A11. 3. - Toutes les dispositions anterieures et contraires a la mifanohitra amin' izao lalana izao indrindra ny fepetra voalazan' ny presente loi sont et dcmcurent abrogees notamment les dispositions tovana amin' ny lal;:lna laharana faha-94-00 I tam in' ny 26 aprily de I'annexe de la loi nO 94-00 I du 26 avril 1995 fixant Ie nombre, la 1995 mametra ny isa, ny famariparitana, ny fiantsoana ary ny delimitation, la denomination et les chefs-lieux des Collectivites renivohitry ny Vondrom-bahoakam-paritra itsinjaram-pahefana. -

Table Des Matieres La Region…………………………………………………….…………………..……………….1 1 Milieu Physique
TABLE DES MATIERES LA REGION…………………………………………………….…………………..……………….1 1 MILIEU PHYSIQUE ........................................................................................................................13 1.1 RELIEF .......................................................................................................................................13 1.2 GEOLOGIE .................................................................................................................................13 1.3 CLIMAT ......................................................................................................................................14 1.3.1 Le réseau de stations météorologiques ................................................................................15 1.3.2 Température ........................................................................................................................16 1.3.3 Pluviométrie ........................................................................................................................17 1.3.4 Diagrammes ombrothermiques ...........................................................................................18 1.3.5 Cyclones ..............................................................................................................................19 1.4 HYDROLOGIE ...........................................................................................................................19 1.5 SOLS ET VEGETATIONS .........................................................................................................20 -

Rapport D'activités 2019
LOT D 140 BIS AMBODIVONDAVA ALASORA ANTANANARIVO (103) MADAGASCAR ASSOCIATION TETEZANA MADA - Rapport d’activités 2019 Page 1 PROJET SOUTIEN A DISTANCE PROJET SOUTIEN A DISTANCE (SaD) EN COLLABORATION AVEC L’ASSOCIATION TETEZANA ONLUS - ITALIE L’Association TETEZANA MADA a signé avec l’organisme non gouvernemental TETEZANA ONLUS Italie un protocole d’accord le 16 novembre 2012, dont l’objet est la mise en place et la réalisation d’un projet nommé « SOUTIEN A DISTANCE » ou SaD, financé en partie par TETEZANA ONLUS Italie. Le SAD consiste à prendre en charge la scolarisation de quelques enfants et jeunes issus de familles défavorisées éparpillées dans la Capitale d’Antananarivo, mais aussi de quelques familles dans la province de Mahajanga. Chaque enfant est ainsi soutenu par le projet pour tout ce qui concerne sa scolarisation, mais aussi la santé, le développement moral et social. Pour ce faire, l’association fait les démarches pour qu’ils soient admis dans des écoles publiques et privées selon le cas, et prend en charge les équipements et fournitures scolaires nécessaires ainsi que les frais de scolarité durant toute l’année scolaire. Les enfants vont ainsi dans leurs écoles respectives suivant chaque emploi du temps. Parallèlement, ils viennent au siège de l’association pour des cours de soutien scolaire donnés par un maitre répétiteur ou « responsable de site » engagé à l’effet. Le site est ouvert tous les jours pour accueillir les enfants qui ont du temps libre par rapport à son emploi du temps à l’école. Principalement ils viennent en masse les mercredi après-midi et le samedi. -

Madagascar Household Outcome Monitoring Survey Comparisons 1 After the Political Crisis in 2009, in Response to the U.S
MADAGASCAR HOUSEHOLD OUTCOME MONITORING SURVEY 2007–2010 COMPARISONS This publication was produced for the United States Agency for International Development. It was prepared by Orlando Hernandez under the USAID Hygiene Improvement Project by the Academy for Educational Development. The USAID Hygiene Improvement Project (HIP) is a six-year (2004-2010) project funded by the USAID Bureau for Global Health, Office of Health, Infectious Diseases and Nutrition, led by the Academy for Educational Development (contract # GHS-I-00-04-00024-00) in partnership with ARD Inc., the IRC International Water and Sanitation Centre, and the Manoff Group. HIP aims to reduce diarrheal disease prevalence through the promotion of key hygiene improvement practices, such as hand washing with soap, safe disposal of feces, and safe storage and treatment of drinking water at the household level. April 2011 Contact Information: USAID Hygiene Improvement Project Academy for Educational Development 1825 Connecticut Avenue, NW Washington, DC 20009-5721 Tel. 202-884-8000; Fax: 202-884-8454 [email protected] - www.hip.watsan.net Submitted to: Merri Weinger Office of Health, Infectious Diseases and Nutrition Bureau for Global Health U.S. Agency for International Development Washington, DC 20523 Acknowledgements Special thanks to Orlando Hernandez, Clement Randriantelomanana, Dr. Odile Randriamanajara, PENSER, the enumerator teams, and community members who participated in this survey. CONTENTS INTRODUCTION ........................................................................................................................................... -
Commune Rurale D'ambohitrolomahitsy
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana Région de : ANALAMANGA Distict de : MANJAKANDRIANA PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (PCDEA) COMMUNE RURALE D’AMBOHITROLOMAHITSY (Version provisoire) Période 2015-2016 Réalisation Ce Plan Communal de Développement de la Commune Rurale d’Ambohitrolomahitsy établit la situation existante et expose les priorités, ainsi que les axes d’orientation et les actions décidés par les acteurs de la commune rurale pour l’amélioration de l’accès à l’eau potable, de l’hygiène et de l’assainissement sur le territoire communal pour l’année 2016. Ce document a été établit avec les acteurs locaux et en concertation avec les intervenants du secteur dans la commune rurale. Le PCDEA a pour rôle de planifier et de coordonner les efforts d’interventions au niveau de la Commune dans le domaine de l’eau et de l’assainissement et de l’éducation à l’hygiène. Ce plan est un outil évolutif, il sera revu et réactualisé chaque année afin de faire le bilan des réalisations/ prévisions et de planifier les actions pour l’année suivante. PCDEA Commune Rurale d’Ambohitrolomahitsy, Décembre 2015 Page 2 1. Données générales sur la commune rurale ........................................................................ 3 1.1. Caractéristiques générales ................................................................................................................... 3 a. Situation géographique. ...................................................................................................................................... -

L'influence De La Capitale Nationale Sur Le
DOMAINE ARTS, LETTRES ET SCIENCES HUMAINES MENTION GEOGRAPHIE PARCOURS ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MEMOIRE DE MASTER EN GEOGRAPHIE L’INFLUENCE DE LA CAPITALE NATIONALE SUR LE DEVELOPPEMENT DU DISTRICT DE MANJAKANDRIANA Présenté par Herizo RAZANAKOTOARIMANANA Sous la direction de Gabriel RABEARIMANANA, Maître de Conférences Février 2018 DOMAINE ARTS, LETTRES ET SCIENCES HUMAINES MENTION GEOGRAPHIE PARCOURS ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MEMOIRE DE MASTER EN GEOGRAPHIE L’INFLUENCE DE LA CAPITALE NATIONALE SUR LE DEVELOPPEMENT DU DISTRICT DE MANJAKANDRIANA Présenté par Herizo RAZANAKOTOARIMANANA Sous la direction de Gabriel RABEARIMANANA Maître de Conférences Membres du jury Président : M. James RAVALISON, Professeur titulaire Rapporteur : M. Gabriel RABEARIMANANA, Maître de Conférences Juge : Mme. Ravoniarijaona VOLOLONIRAINY, Maître de Conférences 26 février 2018 REMERCIEMENTS Pour la réalisation de ce dossier, nos sincères remerciements, pour le Domaine de Formation Arts, Lettres et Sciences Humaines qui nous a permis de faire ce travail, y compris le Département de Géographie et à tous les enseignants chercheurs qui ont contribué à notre formation pour arriver à ce cursus. En outre, notre reconnaissance s’adresse spécialement aux jurys qui auront une grande responsabilité pour ce dossier - M. James RAVALISON, Professeur titulaire. - Mme. Ravoniarijaona VOLOLONIRAINY, Maître de Conférences. Nous remercions, particulièrement de son aide précieux, le Directeur de Recherche Gabriel RABEARIMANANA, Maître de Conférences, qui a appuyé à l’élaboration de ce dossier. Enfin et non le moindre, nos vifs remerciements aux acteurs de cette recherche, nos familles, nos amis qui nous ont soutenu durant la préparation de ce travail. Veuillez recevoir l’expression de nos sincères remerciements. i SOMMAIRE REMERCIEMENTS ................................................................................................................ -

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR Institut National De La Statistique (INSTAT)
Enquête Projet SEECALINE Madagascar – Manuel Technique Enquête Seecaline (2011) REPUBLIQUE DE MADAGASCAR Institut National de la Statistique (INSTAT) ENQUETE PROJET SEECALINE (Surveillance et Education des Ecoles et des Communautés en matière d’Alimentation et de Nutrition Elargie) MANUEL TECHNIQUE DE L’ENQUETE SEECALINE Mai – Juillet 2011 1 Enquête Projet SEECALINE Madagascar – Manuel Technique Enquête Seecaline (2011) TABLE DES MATIERES 1. Informations Générales .............................................................................................................. 3 1.1 Informations sur SEECALINE ............................................................................................. 3 1.2 Le Contexte et les Objectifs de l’Enquête SEECALINE 2011 ............................................ 3 2. Structure et Méthodologie .......................................................................................................... 4 2.1. Couverture Géographique ................................................................................................... 4 2.2. La Structure ......................................................................................................................... 5 Les Questionnaires ................................................................................................................. 5 Les Manuels ........................................................................................................................... 6 Autres Documents ................................................................................................................. -

RAMAHATRA Malalasoa CAPEN N°
UNIVERSITE D’ANTANANARIVO ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEPARTEMENT : EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE CENTRE D’ETUDE ET DE RECHERCHE EPS MEMOIRE DE C.A.P.E.N CONTRIBUTION A L’AMELIORATION DE LA CODIFICATION DU SPORT ASA TANY EN VUE DE SON INSTITUTIONNALISATION EN TANT QUE SPORT ET LOISIR PRESENTE PAR : RAMAHATRA MALALASOA 2005 1 UNIVERSITE D’ANTANANARIVO ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEPARTEMENT EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE CENTRE D’ETUDE ET DE RECHERCHE ENS. /EPS Promotion : « VARATRA » MEMOIRE DE FIN D’ETUDE POUR L’OBTENTION DU CERTIFICAT D’APTITUDE PEDAGOGIQUE DE L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE (CAPEN) « CONTRIBUTION A L’AMELIORATION DE LA CODIFICATION DU SPORT ASA TANY EN VUE DE SON INSTITUTIONNALISATION EN TANT QUE SPORT ET LOISIR » Présenté et soutenu publiquement le : 26 Octobre 2005 Par : RAMAHATRA Malalasoa Né le : 08 Mars 1978 A : Arivonimamo MEMBRE DU JURY : Président : ANDRIANAIVO Victorine Juge : RASOLONJATOVO Haingo Harinambinina Rapporteur : RAKOTONIAINA Jean Baptiste 2 TITRE : «CONTRIBUTION A L’ AMELIORATION DE LA CODIFICATION DU « SPORT ASA TANY » EN VUE DE SON INSTITUTIONALISATION EN TANT QUE SPORT ET LOISIR » AUTEUR : RAMAHATRA Malalasoa NOMBRE DE PAGES : 76 NOMBRE DE TABLEAUX : 10 RESUME : La richesse culturelle de Madagascar mérite une recherche particulière, au niveau de la tradition aussi bien que de sa civilisation. En effet, le présent mémoire essaie d’apporter des améliorations à la codification, de la pratique du sport asa tany que l’association sport asa tany Madagascar a déjà essayé dans quelques territoires malgache et ailleurs, mais elle n’est pas arrivée à le sportiviser comme le cas des autres sports traditionnels. De ce faite, l’existence des règlements officiels et uniques facilite l’organisation des championnats qui peut entraîner la naissance des clubs, les sections et la fédération sportive pour ce nouvel sport venant des paysans malgaches. -

Carte De Référence Antananarivo Avaradrano
Ankazobe Anjozorobe Ambohidratrimo MA002 Ampahitrizina Antaninandro ! Antanetibe Antsahafilo ! Andrainarivo S! adabe Ambato Ambohipihaonana ! Ambatomiranty Sadabe Anosy ! Ampohibe ! Andriankely ! Manjakavaradrano Amparafara Antsahafilo ! Antanimietry Analakely ! Ankazodandy Ambohitrerana Ambohitsaratany ! Avaratra ! Manjakavaradrano ! Ambohitrankatso Avaratrambolo Ambohitrolomahitsy ! Andozoka ! Ankatso ! Ankazondandy Ambohipihaonana ! Ambohibemasoandro Marohary ! Ambolo ! ! Ambohimiadana Ambohimanjaka ! Ambohitrolomahitsy Ambohitra Andranomasina ! ! Ambohitrandraina Ankoromba Ambohimanarina ! Antsahamaro ! ! Mahitsy ! ! Analamanjaka Tsarahonenana Ampamaho ! ! ! Ankorombe Ambatondralambo Analakely ! ! Atsimo ! Ambohitraza Ambohitrango A! nkadivoribe Ankazotokana ! ! ! Moraranodilana ! Avaratsena Merimandroso ! Ambohitrony Alatsinainy TALATA Antokala Ampanataovana ! Ambohibao ! VOLONONDRY Ambohimanarivo Ambohibao Ambohimahavelona ! ! ! Sud Atsimo Belanitra Merimandroso ! Talata Ambohibary Ambatomitokona ! ! Mangarano ! M!ahitsy ! Ambohipoloalina AMBOHIMANGA Volonondry Mamoriarivo Antsahalalina ! Antanety ! ! Andranotsimi!hozo Bemasoandro Ambodiala ! Atsinanana Amboatany ! Antanetilava ! Ambohimandroso Ambohitsoa Ambohidava ! ! Ampahidralambo Ampaneva Ambohitsimeloka ! Ankosy ! ! ! Fonohasina ! Ampaneva Atsimontsena Ifalimanjaka ! Mangazaka Ankafotra ! ! Morarano ! ! Kelifaritra ! Fiakarana Ambohimanga Ambohidrabiby ! Ambohitrakely ! Falimanjaka ! ! ! Anjomakely Ro!va ! Ambodifahitra Ambatomahamanina Ambodivona Manakasina ! Vakinampasika -

Assessment of Hygiene Promotion in Madagascar 2007-2008.Pdf
Assessment of Hygiene Promotion in Madagascar 2007-2008 Comparisons for Households, Schools, and Health Facilities USAID Hygiene Improvement Project By Orlando Hernandez USAID Contract #: GHS-I-00-04-00024-00, Order 1 June 2009 Prepared By: Academy for Educational Development 1825 Connecticut Avenue, NW Washington, DC 20009 Contents Acronyms ............................................................................................................................................................ 4 Executive Summary ........................................................................................................................................... 5 Introduction ........................................................................................................................................................ 6 The Hygiene Improvement Project in Madagascar ...................................................................................... 6 Methodology ....................................................................................................................................................... 9 Samples ................................................................................................................................................................ 9 Households ................................................................................................................................................. 9 Schools and Health Facilities .................................................................................................................. -

MONOGRAPHIE DE Ta COMMUNE RURALE D"Àmtsohit&Otomahrrsy MONOGRAPHIE DE LA COMMUNE RURALE D'ambohitrolomahitsy
MONOGRAPHIE DE tA COMMUNE RURALE D"ÀMtsoHIT&otoMAHrrsY MONOGRAPHIE DE LA COMMUNE RURALE D'AMBOHITROLOMAHITSY 1. HISTRORIQUE : Quand Ambohidrabiby a commencé a être occupé, les Zafin-dRalambo et Ravoromanga appelés aussi Zafind-d Ravoromanga ont immigré vers le Nord. Ils ont occupé plusieurs régions parmi lesquels Tsimahabeomby (près d'Ambohibemasoandro). Quand ils eurent élu domicile dans cette région, ils furent souvent en guerre avec les Zanatsilany et Zanak'Andrianato qui occupérent Ambalanirana ftctuellement Ambohibemasoandro). Un jour, en visite, le Roi Andrianampoinimerina eut vent de cette guerre entre les deux clans décida d,y mettre fin en éloignant I'un des deux clans. Pour cela, il organisa un concours et celui perdra quittera les lieux. Le Roi Andrianampoinimerina Ieur fit aligner des monnaies, les Zanatsilany et Zanak'Andrianato furent vainqueur et I'autre partie n'a plus insisté à rester, sur la base de Ia convention, et partie immédiatement. Devant ce comportement, le Roi était fier et les a qualifiés de gens droits et décida d,appeler le lieu qu,ils occupérent : vohitry ny olona mahitsy. D'où l'appelation Ambohitrolomahitsy. Du temps des corons, Ambohitroromahitsy était déjà un canton. 2. PRESENTATION DE LA COMMUNE : La Commune Rurale d'Ambohitrolomahitsy fait partie du Province Autonome d'Antananarivo et elle se trouve dans la partie ouest de la sous-préfecture de Manjakandriana, situé à 37 km au Nor d,Antananarivo. Elle est situé 1460 ) mètres draltitude, 1g'46 s de latitude et4T" Ede la longitude. 2.1. GARTE DE LOCATION : Iffi.-E,r-l - ff#'i.F=:l - :,' ..r t;* -*; r 'v.