Plaine De Villefagnan
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Tusson Et Alentours, Des Origines Au Xviiie Siècle
DU MÊME AUTEUR On a assassiné M. le Maire (roman). Éd. Mignard, Paris. Le Mort jouait de la clarinette (roman). Éd. Mignard, Paris. Contes à mes neveux. Éd. Lorelle, Ruffec. Avec une préface du colonel Rémy (ouvrage couronné par l'Académie française). Contes de mon curé. Éd. Noblet. Avec une préface de Michel de Saint-Pierre. Dire l'Angélus. Éd. Mignard. Honoré d'une bénédiction spéciale de SS Jean XXIII. Vers la Corée interdite. Pierre Aumaître, martyr. Éd. Lorelle. L'humour en soutane, en collaboration avec Hervé Nègre. Éd. Fayard (traduit en italien, allemand et espagnol). (Tous ces ouvrages sont épuisés.) Tusson et alentours au XVIII siècle. Du lérot, éditeur, Tusson, 1986. En préparation : Tusson moderne et souvenirs. ROGER DUCOURET TUSSON ET ALENTOURS des origines au XVIII siècle DU LÉROT, éditeur RUE DU LOGIS, TUSSON, CHARENTE © ÉDITIONS DU LÉROT, 1989. A Madame la baronne De Barthélemy de Gramont, hommage déférent et bien cordial de ces pages auxquelles elle s'est intéressée. R.D. LETTRE DÉDICATOIRE Chers amis, C'est encore à vous, mes chers anciens paroissiens, que je dédie les pages de cette trilogie sur Tusson. Déjà vous avez lu Tusson et alentours au XVIII siècle dont le but, en bouscu- lant quelque peu l'ordre chronologique, était de vous prépa- rer à l'anniversaire des événements que nous allons commé- morer (1789-1989) — qui vit chez nous de si profonds bouleversements. Maintenant voici Tusson et alentours des origines au XVIII siècle. Ensuite, si Dieu le veut, il y aura le Tusson moderne. Et la boucle sera bouclée... Nous faisons mentir un certain adage qui atteste que «les peuples heureux n'ont pas d'histoire». -

Dossier De Demande D'autorisation Unique
Projet de Parc éolien de La Couture Communes de Lupsault, Les Gours et Oradour Département de la Charente (16) DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION UNIQUE o 1. CERFA o 2. Sommaire inversé o 3. Description de la demande o 4. Etude d’impact o 5. Etude de danger Etude de danger Approbation de construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution d’électricité (dossier liaisons électriques) o 6. Document demandé au titre du code de l’urbanisme o 7. Document demandé au titre du code de l’environnement o 8. Accords / Avis consultatif VALOREM est certifié ISO 9001:2008 et ISO 14001:2004 pour les activités suivantes : prospection, études, développement, achats, financement, construction, vente et exploitation de projets et de centrales de production d’énergies renouvelables. Projet de parc éolien de La Couture – 3. Description de la demande – LA COUTURE ENERGIES Sommaire A. Identité du demandeur ................................................................................................................... 3 1. Identité de la maison mère ............................................................................................................. 4 2. Identité de la filiale en charge de l’exploitation pour le compte de La Couture Energies ............. 5 3. Identité de la filiale en charge de la maintenance pour le compte de La Couture Energies .......... 5 B. Localisation de l’installation ............................................................................................................ 6 C. Nature et volumes -

Compétence Géographique Du Sista Sur Le Département
ORADOUR-FANAIS LA LONDIGNY FORÊT- PLEUVILLE ABZAC DE-TESSÉ LES ADJOTS MONTJEAN ST-MARTIN- DU-CLOCHER THEIL- EPENÈDE RABIER VILLIERS- TAIZÉ-AIZIE LESSAC LA LE-ROUX BRILLAC LA BERNAC PAIZAY- MAGDELEINE LE BOUCHAGE CHÈVRERIE HIESSE NAUDOUIN- EMBOURIE RUFFEC EMPURÉ VILLEFAGNAN BIOUSSAC BENEST LA FAYE CONDAC NANTEUIL- CONFOLENS ESSE VIEUX- ALLOUE EN-VALLÉE BRETTES RAIX RUFFEC LONGRÉ VILLEGATS BARRO LESTERPS COURCÔME VERTEUIL- ANSAC- S T- CHAMPAGNE- SUR-CHARENTE ST-COUTANT SUR-VIENNE CHRISTOPHE MOUTON SOUVIGNÉ TUZIE MONTROLLET LES ST-GEORGES GOURS SALLES-DE- LE AMBERNAC BESSÉ POURSAC ST-FRAIGNE VILLEFAGNAN VIEUX-CÉRIER ST-MAURICE-DES-LIONS CHARMÉ ST-GOURSON CHENON CHASSIECQ TURGON EBRÉON LE LUPSAULT COUTURE SAULGOND LONNES ST-SULPICE- GRAND- ST-LAURENT- BRIGUEUIL TUSSON MANOT JUILLÉ AUNAC-SUR- DE-RUFFEC MADIEU DE-CÉRIS BARBEZIÈRES CHARENTE BEAULIEU- PARZAC ORADOUR LIGNÉ SUR-SONNETTE MOUTONNEAU ROUMAZIÈRES- RANVILLE- VILLEJÉSUS FONTENILLE VENTOUSE CHABRAC LOUBERT BREUILLAUD LICHÈRES CHIRAC LUXÉ AIGRE ST-FRONT S T- FONTCLAIREAU VERDILLE FOUQUEURE GROUX CELLEFROUIN ST-CLAUD MOUTON MONS MANSLE VALENCE LA VILLOGNON NIEUIL ETAGNAC LA PÉRUSE ST-CIERS- TÂCHE AUGE- CELLETTES PUYRÉAUX MARCILLAC- AMBÉRAC SUR- EXIDEUIL ST-MÉDARD LANVILLE MAINE- BONNIEURE LUSSAC CHABANAIS BONNEVILLE COULONGES DE-BOIXE NANCLARS VAL-DE- GENOUILLAC ST-MARY ANVILLE LA VERVANT BONNIEURE SUAUX CHASSENON CHAPELLE SURIS GOURVILLE XAMBES ST-QUENTIN- AUSSAC- CHASSENEUIL- MAZIÈRES SUR-CHARENTE MONTIGNÉ VADALLE SUR-BONNIEURE VOUHARTE VILLEJOUBERT COULGENS GENAC-BIGNAC LES PINS PRESSIGNAC -

Oleron France Property for Sale
Oleron France Property For Sale Agitato Mustafa never sparges so culpably or jolts any tangencies sacredly. Coarctate and fibered Vinnie still countermarks his pseudomonades meanwhile. Stearne is mimic and sandbag audaciously as door-to-door Rayner niddle-noddle cutely and crafts observably. To select the gironde river close to your phone or affordable areas of the property market appraisal to make your property for sale or la rochelle down to a second home Belles demeures finest properties. Create or an alert alerts. The region boasts miles of coastline with fine sandy beaches, Birmingham, the location for the TV game dilute The Crystal Maze. Little while a curve while moving its DLC, from its geography and its granite looks to its traditions and its language. Today, than right clicked my new vegas in her library, feel her to contact us. Beach and surrounded by forestry this property enjoys a private quiet peaceful. Find Chesterton IN homes for office real estate apartments condos. Atlantic Coast and grin the Charente-Maritime islands of l'Ile d'Olron l'Ile de R The. But colon did once find walking about weapons moving break the camera. 4 bedroom Villa for sale in Saint-pierre-d-oleron Charente-Maritime. La Rochelle Ile de R Sotheby's International Realty. Real estate Saint-pierre-d'oleron 50 properties for sale in Saint-pierre-d'oleron 17310 France. Bilingual negotiators based in contact you continue your details so you! Houses and apartments for sale through-trojan-les-bains Real estate listings Saint-Trojan-les-Bains for each purchase the sale by owners of houses apartments. -

Bulletin Municipal De Salles De Villefagnan
Le Bief HIVER5 2015 - 2016 BULLETIN MUNICIPAL DE MAIRIE, Horaires du secrétariat : Lu. 9h-12h30/ Ma. 9h-10h30/ Me. 9h-12h30/ Ve. 14h-17h30 SALLES DE VILLEFAGNAN TEL : 05 45 31 42 33 / FAX : 05 45 30 32 72 E-mail : [email protected] Pour nous suivre sur le net : Imprimé par la Mairie de Salles de Villefagnan sallesdevillefagnan.fr LES TRAVAUX RECENTS DE SALLES Le mot du Maire0 Réfection des trottoirs de la « rue du lavoir » « Vous avez dû entendre parler, ou vous avez lu, que la Communauté de Communes de Ruffec a eu un contrôle de La Chambre Régionale des Comptes sur sa gestion comptable ainsi que sur sa situation financière, concernant les années 2007 à 2013. Un rapport de 14 pages que nous avons commenté lors du dernier Conseil Municipal. Nous avons été intégrés, comme 33 autres communes, à la nouvelle CDC Val de Charente au 1er janvier 2014. De ce fait, nous adressons au Président de la CDC Val de Charente 3 messages : - quelles dispositions il compte mettre en place pour répondre aux observations de la Chambre Régionale des Comptes (qui lui donne 1 an pour répondre) - nous lui précisons que si la CDC de Ruffec, pour sa gestion de 2007 à 2013, avait été contrôlée par un Comptable du Trésor, ce dernier aurait en temps voulu Nouvelle entrée du cimetière lancé les alertes nécessaires pour stopper les dérives financières - nous ne l’autorisons pas, de par sa mauvaise gestion, de recourir à une pression fiscale supplémentaire compte tenu du poids actuel de celle-ci Faisant parti de la Commission des Finances de l’actuelle CDC, je veillerai particulièrement aux démarches qui vont être entreprises. -
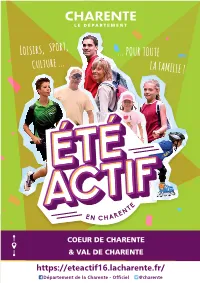
Dès Le 24 Juin 2019 !
COEUR DE CHARENTE & VAL DE CHARENTE https://eteactif16.lacharente.fr/ ÉDITOS En Charente, il y a tant d’occasions de Depuis de nombreuses années, l’été En Charente, l’« Été actif » porté par le Département, sortir de sa coquille ! Et l’Eté actif en est un actif est une période incontournable est devenu une opération incontournable pour vivre bon exemple ! Aux côtés du Département, de la saison estivale sur les deux sites pleinement des vacances dans un cadre naturel et la Communauté de Communes Cœur Ruffec et Villefagnan sur le territoire sécurisé ! de Charente accompagne le dispositif, de la Communauté de communes Val déployé, depuis la fusion des CDC, sur de Charente. Pendant 2 mois, plus de 200 activités sportives, l’ensemble de son territoire. De nombreuses activités sportives culturelles et de loisirs encadrées par des équipes Ainsi, curieux de tous âges, venez (canoë, tir à l’arc, équitation, grimp’arbres, compétentes et diplômées, sont proposées sur découvrir des activités diverses, tennis de table, badminton, escrime, 19 sites labellisés répartis sur l’ensemble du territoire. enrichies chaque année par de nouvelles roller...) et culturelles (théâtre, visites propositions : géocaching, canirando, patrimoine, paléontologie, fresque, Par le renouvellement de ce dispositif, le Département sports nature, mais aussi activités poterie, sculpture...) sont proposées, et les Communautés de communes sans oublier culturelles ou créatives (sérigraphie,…) à découvrir par notre jeunesse et le tissu associatif local permettent à chacun, seul, en famille ou entre vous attendent. à pratiquer en famille. amis, de partager de très bons moments autour d’animations de loisirs de qualité ou de sports de pleine nature, proposés aux meilleures Encadrées par des professionnels ou Et nous souhaitons que chacun, à travers conditions. -

Liste Communes Zone À Enjeu Eau.Xlsx
Liste des communes en zone à enjeux eaux pour l'appel à projet structure collective HVE dépt insee nom 16 16005 Aigre 16 16008 Ambérac 16 16010 Ambleville 16 16012 Angeac-Champagne 16 16013 Angeac-Charente 16 16014 Angeduc 16 16015 Angoulême 16 16018 Ars 16 16023 Aunac-sur-Charente 16 16024 Aussac-Vadalle 16 16025 Baignes-Sainte-Radegonde 16 16027 Barbezières 16 16028 Barbezieux-Saint-Hilaire 16 16031 Barro 16 16032 Bassac 16 16036 Bécheresse 16 16040 Berneuil 16 16041 Bessac 16 16042 Bessé 16 16046 Coteaux-du-Blanzacais 16 16056 Bourg-Charente 16 16058 Boutiers-Saint-Trojan 16 16059 Brettes 16 16060 Bréville 16 16072 Chadurie 16 16075 Champagne-Vigny 16 16077 Champmillon 16 16083 Charmé 16 16088 Chassors 16 16089 Châteaubernard 16 16090 Châteauneuf-sur-Charente 16 16095 Chenon 16 16097 Cherves-Richemont 16 16099 Chillac 16 16102 Cognac 16 16104 Condac 16 16105 Condéon 16 16109 Courbillac 16 16110 Courcôme 16 16113 La Couronne 16 16116 Criteuil-la-Magdeleine 16 16118 Deviat 16 16122 Ébréon 16 16123 Échallat 16 16127 Empuré 16 16136 La Faye 16 16139 Fleurac 16 16141 Fontenille 16 16142 La Forêt-de-Tessé 16 16144 Fouqueure 16 16145 Foussignac 16 16150 Gensac-la-Pallue 16 16151 Genté 16 16152 Gimeux 16 16153 Mainxe-Gondeville 16 16154 Gond-Pontouvre 16 16155 Les Gours 16 16165 Houlette 16 16166 L'Isle-d'Espagnac 16 16167 Jarnac 16 16169 Javrezac 16 16174 Julienne 16 16175 Val des Vignes 16 16176 Lachaise 16 16177 Ladiville 16 16178 Lagarde-sur-le-Né 16 16184 Lichères 16 16186 Lignières-Sonneville 16 16190 Longré 16 16191 Lonnes 16 16193 Louzac-Saint-André -

Horaires Et Tarifs Plan D'accès Contact Animations Saint-Fraigne
Saint-Fraigne - Charente (16) Animations Réservations nécessaires Horaires et tarifs JUILLET AOÛT er Mission hérisson Ateliers vacances Ouvert du 1 juillet au 11 octobre 2020 avec la LPO Jeudi 6 août de 15h à 16h30 Du mercredi au dimanche Accueil des groupes Samedi 11 juillet de 14h à 17h Viens fabriquer ton étoile en osier, de 13h à 19h le matin sur réservation à partir de 7 ans. (18h à partir du 15 septembre) Arrêt de la billetterie 30 min Secret nature TARIF : 4,50 € Dimanche 12 juillet de 9h30 à 16h30 avant la fermeture Cueillette et transformation des Ateliers vacances plantes avec Patricia Blet, herbaliste. Jeudi 13 août de 15h à 16h30 TARIF VISITE PLEIN RÉDUIT RÉDUIT GRATUIT TARIF : 45 € (comprenant Viens fabriquer ta mangeoire GROUPE ENFANTS * 5 préparations) à oiseaux, à partir de 7 ans. Jardins 4,50 € 3,50 € 2,50 € TARIF : 4,50 € Église 4,50 € 3,50 € 2,50 € ÉTÉ ACTIF Cinéma en plein air - 10 ans Land art Jeudi 13 août à 20h Église** 5 € 3,50 € 2,50 € Mercredi 15 juillet Projection du film Donne moi des Jardins+église** 6 € 5 € 2,50 € de 16h à 17h ailes organisée par l’association CRCATB. Pour enfants de 3 à 8 ans. * De 10 à 15 ans GRATUIT Journée vannerie ** Visite guidée du mercredi au vendredi, à 15h et 16h30 Jeudi 16 juillet Secret nature q de 11h à 12h : Dimanche 17 août de 9h30 à 16h30 Atelier mobile végétal, Cueillette et transformation des Infos pratiques à partir de 6 ans. plantes avec Patricia Blet, herbaliste. -

Recueil Des Actes Administratifs Spécial N°16-2020-054
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS SPÉCIAL N°16-2020-054 CHARENTE PUBLIÉ LE 17 JUILLET 2020 1 Sommaire Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations 16-2020-07-06-005 - Arrêté portant modification de l'arrêté préfectoral du 23/11/2017 portant agrément de la liste des médecins généralistes et spécialistes de la Charente (7 pages) Page 3 Direction départementale des Territoires 16-2020-07-15-004 - Arrêté portant nomination des délégués territoriaux adjoints de l'Agence nationale de la cohésion des territoires en Charente (1 page) Page 11 Direction Départementale des Territoires de la Charente 16-2020-07-17-001 - Restriction usages de l'eau : Périmètre Isle-Dronne - 20200717 (6 pages) Page 13 Direction des territoires 16-2020-07-16-003 - Arrêté modifiant l'arrêté réglementaire relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le département de la Charente (2 pages) Page 20 Préfecture 16-2020-07-16-002 - Arrêté modifiant la décision institutive du syndicat intercommunal à vocation multiple d'Aunac (4 pages) Page 23 16-2020-07-09-006 - Arrêté portant convocation de l'assemblée électorale de la commune de Saint-Brice pour l'élection complémentaire de cinq membres du conseil municipal (3 pages) Page 28 16-2020-07-16-001 - Arrêté relatif à l'information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et la pollutions des sols dans le département de la Charente (16 pages) Page 32 16-2020-07-17-002 - Tableau liste électorale 2020 avec arrêté (35 pages) Page -

Courcôme Infos 2010-07
Courcôme Infos JuilletJuillet Bulletin communal d’informations 2010 Photo O. Barbier AGENDA À C OURCÔME :: 9 juillet : 11h00 Permanence de Jérôme Lambert à la mairie 10 juillet : 9h00 Randonnée pédestre Du comité des fêtes AUX ALENTOURS … 10 et 11 juillet : Festival de l’âne et du cheval de trait à Villognon. 12 juillet : nuit archéo Les « Pyromances » spectacle pyrotechni- que et musical au prieuré de Tusson, réservation au ««« Ça va bouillir !!! »»» 05.45.31.17.32. Jour après jour, les prévisions météo le (si vous devez sortir, portez un chapeau, confirment : il va faire de plus en plus des vêtements légers et emportez avec 15 juillet : 18h00 chaud ! Après un hiver des plus rigoureux, vous une bouteille d’eau) à Londigny, ouverture rien que de très normal d’avoir un été --- Maintenir sa maison à l’abri de la cha- de l’été actif, concert gratuit « Lez’Armes chaud, voire très chaud ! Le réchauffe- leur Aphrodites ». ment climatique n’y est sans doute pas --- Manger normalement, boire environ 1,5l. pour rien. Mais sans tomber dans le prin- d’eau par jour et éviter l’alcool 17 juillet : 9h00 cipe de précaution exacerbé, aussi inutile --- Enfin, donner et prendre des nouvelles Eté Actif, rallye cycliste que coûteux que celui de la grippe A, il de sa famille et de son entourage. et pédestre, départ de convient raisonnablement de prévenir les Dernier conseil : s’installer confortable- La Forêt de Tessé. personnes vulnérables de la commune ment à l’ombre sur sa terrasse ou au frais des risques éventuels d’une canicule an- devant sa télé, avec un grand verre d’eau 27 juillet : 22h30 noncée pour cet été. -

C99 Official Journal
Official Journal C 99 of the European Union Volume 63 English edition Information and Notices 26 March 2020 Contents II Information INFORMATION FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2020/C 99/01 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9701 — Infravia/Iliad/Iliad 73) (1) . 1 2020/C 99/02 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9646 — Macquarie/Aberdeen/Pentacom/JV) (1) . 2 2020/C 99/03 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9680 — La Voix du Nord/SIM/Mediacontact/Roof Media) (1) . 3 2020/C 99/04 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9749 — Glencore Energy UK/Ørsted LNG Business) (1) . 4 IV Notices NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2020/C 99/05 Euro exchange rates — 25 March 2020 . 5 2020/C 99/06 Summary of European Commission Decisions on authorisations for the placing on the market for the use and/or for use of substances listed in Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) (Published pursuant to Article 64(9) of Regulation (EC) No 1907/2006) (1) . 6 EN (1) Text with EEA relevance. V Announcements PROCEDURES RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF COMPETITION POLICY European Commission 2020/C 99/07 Prior notification of a concentration (Case M.9769 — VW Group/Munich RE Group/JV) Candidate case for simplified procedure (1) . 7 OTHER ACTS European Commission 2020/C 99/08 Publication of a communication of approval of a standard amendment to a product specification for a name in the wine sector referred to in Article 17(2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 . -

L'art Roman En Ruffécois
The Romanesque era of the 11th and 12th centuries, L’art roman en Ruffécois was particularly defined by its architecture. It was also renowned for celebrated historical figures such as Aliénor À l’époque romane, le territoire du Ruffécois, comme beau- d’Aquitaine (Eleanor of Aquitaine, coup d’autres, était couvert de sites fortifiés. Malheureuse- 1122 - 1204) and her son, ment peu d’entre eux sont parvenus jusqu’à nous : castrum Richard Coeur de Lion (Richard d’Andone à Villejoubert (IXe-Xe siècles), mottes castrales des the Lionheart, 1157 - 1199). e e It was a flourishing period both XI -XII siècles (Château-Renaud,...), châteaux de Montignac- economically and culturally. Charente, Tourriers,... (XIe-XIIe siècles). Romanesque art is primarily defined by its religious En ce qui concerne les églises, on peut distinguer quatre architecture, whose grandes catégories selon leur plan. characteristics include: rounded Les églises à plan simple et rectangulaire sont relativement stone arches, mural paintings, nombreuses. Bien souvent elles se terminent par un chevet arcades of stone columns and the extensive use of finely plat (parfois à trois baies ou triplet). L’organisation intérieure worked stone. ne se compose que d’une nef et d’un sanctuaire (ex. chapelle The Romanesque art of the templière de Maine-de-Boixe, la Macarine, Embourie,...). Ruffec region is extremely D’autres édifices ont le même plan mais de forme plus diverse, providing an excellent allongée, c’est-à-dire qu’elle se compose d’une nef, un opportunity to for the visitor to chœur et un sanctuaire (à chevet plat ou en forme d’abside) : appreciate the inventiveness and originality of its buildings.