Tahiti – Le Havre
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

R , TALL SH~P TALES
-r , TALL SH~P TALES ' . ·-- - -... -- -···-·· ···- - _ , ... ....__ ... ~-.. , ... ----- ---- -·- ·· .. --- ~ ·· - ··- -·- ···- .... ·- . - -· ·-- - .... ----- -··· . ... · ~-- ( - - --- AN ACCOUNr OF ~0 YEARS ABOARD THE USS NEWPORr, A BARKENl'INE RIGGED TRAINING SHIP OF THE NEW YORK • l STATE NAUTICAL SCHOOL, NCM THE MARITIME COLLEGE OF THE STATE UNIVmSITY OF NEW YORK. By Edward F. "Nick" Carter Class of 129 l •. .. ,:.. • .. I - <,, ~ ' .. J; '- ~.\, ( .· ., .... .. ' ..... 1 The US3 NEWPORT~ an aux:Uiary barkentine ~ was our training ship. She had been buil.t by Bath Iron Works in 1897 .as a gunboat~ and as we were told, £or use on the China station, where~ in times o£ quiet she could cruise umer her square rigged foremast and schooner rigged main and mizzen and conserve her coal bunkers wb:lch might be needed £or an emergency :rtm under steam. She was o£ composite construction, steel frames, steel shell plating above the water line and wood pl.ank:ing with copper sheathing below the water line. All decks were o£ wood. Her water line lengt;h was 168 feet, beam 36 feet and she displaced a little over 1000 tons. Propulsion machi.uery' was a triple expansion engine supplied by' two coal burn:Lng Scotch boilers. Speed 'lmder power was about twelve knots. Sail area was about 12000 square feet. She had three sister ships: ( IIANNAPOLIS"' "PRINCETON" and 11VICKSBtlRG11 • The NEWPORT had been loaned by the navy to the New York state Nautical School, present~ known as the Maritime College of the state University of New York. The ship was based at Bedloe 1s Island~ the statue of Li.ber(;y' island, where there. was a small a.rm;y post. -

Alan Martienssen & Zebedee
Hall of Fame - Alan Martienssen by Graham Cox Alan Martienssen 1958 - In the days of Slocum, Pidgeon and Gerbault, all small boat voyagers sailed without engines. By the middle of the 20th century, as engines became smaller, lighter and more reliable, sailing engineless became the rare mark of either a purist or an impoverished sailor. For Alan Martienssen, on Zebedee, the decision to sail without an engine began in the impoverished camp and has gone on, over one and a half circumnavigations, and as many decades, to be a matter of choice. Alan is a pragmatic man, a veterinary surgeon who cheerfully admits he has no mystical or spiritual inclinations. When, beset by domestic tribulation in his native England, he decided to get a boat and sail over the horizon - despite little knowledge and less experience - he simply chose to follow precedent. A friend had given him a copy of Annie Hill’s Voyaging on a Small Income and he decided to build an exact copy of Badger, stock it with the same type of food (dried beans etc) and head west. If it worked for Annie, he reasoned, it should work for him. For many people this might have been a Alan steering Zebedee recipe for disaster, or at least disappointment, but for the largely unflappable Alan it worked like a charm. For those unfamiliar with Badger, this vessel is a to the Gulf Islands, followed by the USA’s San Juan plywood-hulled, timber-sparred, junk-rigged, dory- Islands, before heading north to Desolation Sound, and hulled schooner, 34ft on deck. -

Guia ENG WEB.Pdf
TITULO SECCIÓN I GS 1 SUMMARY GS3 THE RACE · 3RD EDITION OF THE BARCELONA WORLD RACE THE ADVENTURE BEGINS! 04 THE EDUCATIONAL RACE · EXCITEMENT REACHES THE SCHOOLS! 08 · COOPERATIVE WORK IN THE CLASSROOM 13 HUMAN BEING · THE IMPORTance of a good night’s sleep 16 · THE BALANCED DIET OF THE SAILORS 19 · THE PIONEERS 24 MAIN DOSSIER · LOS PROTAGONISTAS DE LA BARCELONA WORLD RACE 28 SAILING · THE PROTAGONISTS OF THE BARCELONA WORLD RACE 38 · GREEN ENERGY ON BOARD 40 · THE STRATEGY IN A TRIP AROUND THE WORLD 42 PLANET SEA · ANTARCTICA, NATURAL RESERVE FOR PEACE AND SCIENCE 44 · CLIMATE CHANGE IN THE SOUTH POLE 49 · AN OCEANOGRAPHER BEHOLDING THE MYSTERIES OF THE SEA 51 PRACTICAL GUIDE · SPORTS WITHOUT LIMITS 54 · THE SEA TEACHES 56 · PROPOSALS RELATED TO THE SEA 58 EDITORIAL Commitment to education and science The latest edition of the Barcelona World Race, organised humanistic and technologic Scientific Research (CSIC). The by the Barcelona Foundation for Ocean Sailing (FNOB), disciplines applied to and act of turning the IMOCA 60s into returns to the city. On this occasion, the event is developed during the Barcelona “scientific vessels” with sensors strengthening its commitment to the world of education, a World Race. that measure aspects such as the commitment most clearly evidenced through the school- Both initiatives serve to salinity, temperature and presence centred programme “Following the Barcelona World Race”. disseminate the scientific of microplastics in seawater Along these lines, in hopes of consolidating the race as a projects conducted by the race consolidates the Barcelona World tool to enhance education and help spread knowledge, in cooperation with specialised Race not only as a leading sporting we created the “Barcelona World Race Ocean Campus”. -

TAHITI NUI Tu-Nui-Ae-I-Te-Atua
TAHITI NUI Tu-nui-ae-i-te-atua. Pomare I (1802). ii TAHITI NUI Change and Survival in French Polynesia 1767–1945 COLIN NEWBURY THE UNIVERSITY PRESS OF HAWAII HONOLULU Open Access edition funded by the National Endowment for the Humanities / Andrew W. Mellon Foundation Humanities Open Book Program. Licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 In- ternational (CC BY-NC-ND 4.0), which permits readers to freely download and share the work in print or electronic format for non-commercial purposes, so long as credit is given to the author. Derivative works and commercial uses require per- mission from the publisher. For details, see https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. The Cre- ative Commons license described above does not apply to any material that is separately copyrighted. Open Access ISBNs: 9780824880323 (PDF) 9780824880330 (EPUB) This version created: 17 May, 2019 Please visit www.hawaiiopen.org for more Open Access works from University of Hawai‘i Press. Copyright © 1980 by The University Press of Hawaii All rights reserved. For Father Patrick O’Reilly, Bibliographer of the Pacific CONTENTS Dedication vi Illustrations ix Tables x Preface xi Chapter 1 THE MARKET AT MATAVAI BAY 1 The Terms of Trade 3 Territorial Politics 14 Chapter 2 THE EVANGELICAL IMPACT 31 Revelation and Revolution 33 New Institutions 44 Churches and Chiefs 56 Chapter 3 THE MARKET EXPANDED 68 The Middlemen 72 The Catholic Challenge 87 Chapter 4 OCCUPATION AND RESISTANCE 94 Governor Bruat’s War 105 Governor Lavaud’s -

Bibliotheca Polynesiana”
Skrifter fra Universitetsbiblioteket i Oslo 5 Svein A.H. Engelstad Catalogue of the “Kroepelien collection” or “Bibliotheca Polynesiana”, owned by the Oslo University Library, deposited at the Kon Tiki Museum in Oslo Catalogue of the “Kroepelien collection” or “Bibliotheca Polynesiana”, owned by the Oslo University Library, deposited at the Kon Tiki Museum in Oslo Svein A.H. Engelstad Universitetsbiblioteket i Oslo 2008 © Universitetsbiblioteket i Oslo 2008 ISSN 1504-9876 (trykt) ISSN 1890-3614 (online) ISBN 978-82-8037-017-4 (trykt) ISBN 978-82-8037-018-1 (online) Ansvarlig redaktør: Bente R. Andreassen Redaksjon: Jan Engh (leder) Bjørn Bandlien Per Morten Bryhn Anne-Mette Vibe Trykk og innbinding: AIT e-dit 2008 Produsert i samarbeid med Unipub AS Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med åndsverkloven eller med andre avtaler om kopiering inngått med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Introduction The late Bjarne Kroepelien was a great collector of books and other printed material from the Polynesia, and specifically the Tahiti. Kroepelien stayed at Tahiti for about a year in 1918 and 1919. He was married there with a Tahitian woman. He was also adopted as a son of the chief in Papenoo, Teriieroo, and given his name. During his stay at Tahiti, the island was hit by the Spanish flu and about forty percent of the inhabitants lost their lives, among them his dear wife. Kroepelien organised the health services of the victims and the burials of the deceased, he was afterwards decorated with the French Order of Merit. He went back to Norway, but his heart was lost to Tahiti, but he chose never to return to his lost paradise, and he never remarried. -

The Journal of the Ocean Cruising Club ®
2018/2 The Journal of the Ocean Cruising Club ® 1 BoatyardBoatyard oorr BBackyardackyard The crowning touch for brightwork of all kinds, Epifanes offers you a range of premium quality varnishes formulated with less solvent and more solids – tung oil, alkyd and phenolic resins. Our varnishes build up faster for an unparalleled finish protected by our unique UV filtering ingredients. Experience the superior quality that has made our clear finishes a first choice for boat owners and boatyard professionals worldwide. Look for Epifanes varnishes and paints wherever fine marine products are sold. AALSMEER, HOLLAND Q THOMASTON, MAINE Q ABERDEEN, HONG KONG +1 207 354 0804 Q www.epifanes.com FOLLOW US 2 OCC FOUNDED 1954 offi cers COMMODORE Anne Hammick VICE COMMODORES Simon Currin REAR COMMODORES Daria Blackwell Jenny Crickmore-Thompson REGIONAL REAR COMMODORES GREAT BRITAIN Chris & Fiona Jones IRELAND Alex Blackwell NORTH EAST USA Dick & Moira Bentzel SOUTH EAST USA Bill & Lydia Strickland WEST COAST NORTH AMERICA Ian Grant CALIFORNIA & MEXICO (W) Rick Whiting NORTH EAST AUSTRALIA Nick Halsey SOUTH EAST AUSTRALIA Paul & Lynn Furniss ROVING REAR COMMODORES Bill & Laurie Balme, David Bridges, Suzanne & David Chappell, Andrew Curtain, Franco Ferrero & Kath McNulty, David & Juliet Fosh, Ernie Godshalk, Bob & Judy Howison, Simon & Hilda Julien, Jonathan & Anne Lloyd, Pam McBrayne & Denis Moonan, Sue & Andy Warman PAST COMMODORES 1954-1960 Humphrey Barton 1960-1968 Tim Heywood 1968-1975 Brian Stewart 1975-1982 Peter Carter-Ruck 1982-1988 John Foot 1988-1994 -
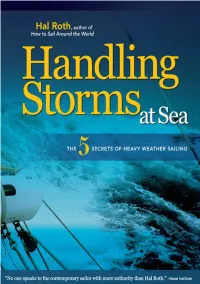
Handling Storms at Sea : the Five Secrets of Heavy Weather Sailing
HANDLING STORMS AT SEA Overleaf: What is blue-water sailing really like when it’s stormy and big seas are running? Here’s my Santa Cruz 50 hurrying eastward near Marion Island in the Southern Ocean. The ever-faithful windvane is steering nicely while I play with the mainsail reefs and adjust the sails as the boat races through the water and makes great whooshing sounds as she surfs forward on a wave. You know that the yacht will rise up as the next crest comes, but sometimes you wonder if she is buoyant enough. You take a deep breath and say a silent prayer. ALSO BY HAL ROTH Pathway in the Sky (1965) Two on a Big Ocean (1972) After 50,000 Miles (1977) Two Against Cape Horn (1978) The Longest Race (1983) Always a Distant Anchorage (1988) Chasing the Long Rainbow (1990) Chasing the Wind (1994) We Followed Odysseus (1999) How to Sail Around the World (2004) The Hal Roth Seafaring Trilogy (2006) HANDLING STORMS AT SEA The 5 Secrets of Heavy Weather Sailing Hal Roth INTERNATIONAL MARINE / MCGRAW-HILL CAMDEN, MAINE • NEW YORK • CHICAGO • SAN FRANCISCO • LISBON • LONDON • MADRID • MEXICO CITY • MILAN • NEW DELHI • SAN JUAN • SEOUL • SINGAPORE • SYDNEY • TORONTO Copyright © 2009 by Hal Roth. All rights reserved. Except as permitted under the United States Copyright Act of 1976, no part of this publication may be reproduced or distributed in any form or by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher. ISBN: 978-0-07-164345-0 MHID: 0-07-164345-1 The material in this eBook also appears in the print version of this title: ISBN: 978-0-07-149648-3, MHID: 0-07-149648-3. -

Notes and References
Notes and References Introduction 1. On the French empire in this period, see Gilbert Comte, L'Empire triomphant (1871-1936). I. Afrique occidentale et equatoriale (Paris, 1988) and Jean Martin, L 'Empire triomphant (1871-1936). II. Maghreb, Indochine, Madagascar, lies et Comptoirs (Paris, 1990), and for a more interpretative approach, Jean Bouvier, Rene Girault and Jacques Thobie, Impenalisme Ii la franr;aise (Paris, 1986). For a new general history of French coloni alism, see Jean Meyer,Jean Tarrade, Annie Rey-Goldzeiguer and Jacques Thobie, Histoire de la France coloniale. Des Origines Ii 1914 (Paris, 1991) and Jacques Thobie, Gilbert Meynier, Catherine Coquery-Vidrovitch and Charles-Robert Ageron, Histoire de la France colonia Ie. 1914-1990 (Paris, 1990). On the renewed importance of empire in the 1930s, Charles-Robert Ageron, 'La Perception de la puissance francaise en 1938-1939: Ie mythe imperial', Revue franr;aise d'histoire d'outre-mer 69 (1982), pp. 7-22, and on the apogee of colonialism in this period, Jacques Marseille, L'Age d'or de la France coloniale (Paris, 1986), and, more generally, Thomas August, 'Locating the Age of Imperialism', Itinerario 10 (1986), pp. 85-97. 2. The following paragraphs sum up some of the main points of my The French Presence in the South Pacific, 1842-1940 (London, 1990). 3. See my 'European Expansion in the Island Pacific: An Historiographical Review', Itinerario 13 (1989), pp. 87-102, which also gives references to Japanese expansionism. 1 The Second World War in the French Pacific 1. Henri Sautot, Grandeur et decadence du Gaullisme dans Ie Pacifique (Mel bourne, 1949). -

Puillandre Et Al 2014 MPE.Pdf
When everything converges: Integrative taxonomy with shell, DNA and venomic data reveals Conus conco, a new species of cone snails (Gastropoda: Conoidea) Nicolas Puillandre, Reto Stöcklin, Philippe Favreau, Estelle Bianchi, Frédéric Perret, Audrey Rivasseau, Loïc Limpalaër, Eric Monnier, Philippe Bouchet To cite this version: Nicolas Puillandre, Reto Stöcklin, Philippe Favreau, Estelle Bianchi, Frédéric Perret, et al.. When everything converges: Integrative taxonomy with shell, DNA and venomic data reveals Conus conco, a new species of cone snails (Gastropoda: Conoidea). Molecular Phylogenetics and Evolution, Elsevier, 2014, 80, pp.186-192. 10.1016/j.ympev.2014.06.024. hal-02458200 HAL Id: hal-02458200 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02458200 Submitted on 28 Jan 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. 1 When everything converges: integrative taxonomy with shell, DNA and venomic data 2 reveals Conus conco, a new species of cone snails (Gastropoda: Conoidea) 3 a,b,* b b b b 4 Puillandre Nicolas , Stöcklin Reto , Favreau Philippe , -

French Polynesia Destination Report
Tahiti, Society Islands, French Polynesia OVERVIEW Introduction A name synonymous with tropical relaxation, Tahiti is the busy hub of French Polynesia, located 160 mi/260 km southeast of Bora Bora. Most of the activity is centered around the city of Papeete (pronounced pah-pay-EH-tay). It's the part of the island most visitors see, if only in passing. We recommend you stick around in Papeete for at least a two-night stay. This exciting city has many flashy boutiques, a colorful local market, a black pearl museum and active nightlife. As the only real city in French Polynesia, Papeete can teach you a lot about life in the South Pacific. And although you will experience some traffic jams and noise, it's relatively clean, safe and efficient for a tropical city. Geography Tahiti has something of an hourglass shape with a larger portion (Tahiti Nui—where Papeete is located) and a smaller one (Tahiti Iti). Mountains soar to 7,352 ft/2,241 m in central Tahiti Nui and to 4,430 ft/1,323 m on Tahiti Iti. SEE & DO Sightseeing If you have the time to venture out of Papeete, we suggest you head out along the north shore of the island. Make a stop at Point Venus, on the outskirts of Papeete. Matavai Bay, which is enclosed by the point, was used as an anchorage by many of the early European ships to reach Tahiti. Captain Cook built a fort on the point during his first visit to the island. The black-sand beach near the point is a popular seaside destination. -

French Polynesia
FRENCH POLYNESIA Alain Gerbault World Ecology Day 1976 1976 Pres. Pompidou 1976 90FR 18FR 42FR 49FR Dugout Canoes 1976 25FR 30FR 75FR 100FR FRENCH POLYNESIA Centenary of First Telephone Call 1976 37FR Sailing Ships 1977 20FR 50FR 85FR 120FR Flowers 1978-79 10FR 13FR 16FR 22FR FRENCH POLYNESIA 20th Anniversary of Stamps 1978 20FR 28FR 36FR Ships 1978 15FR 30FR 75FR 100FR Coral 1979 32FR 37FR FRENCH POLYNESIA 20th Anniversary of Stamps 1978 SOUVENIR SHEET OF 3 FRENCH POLYNESIA Landscapes 1979 1FR 2FR 3FR 4FR 5FR 6FR Dance Costumes 1979 45FR 51FR 74FR Rotary Rowland Hill, Rotary Issue International British and Tahitian Stamps Surcharged 1979 1979 1980 47FR 100FR 77FR ON 47FR FRENCH POLYNESIA Shells 1979 20FR 28FR 35FR Fish 1980 7FR 8FR 12FR CNEXO Fish Hatchery Papeete Post Office 1980 1980 15FR 22FR 50FR Birds 1980 35FR 25FR 45FR FRENCH POLYNESIA South Pacific Arts Festival De Gaulle 1980 1980 34FR 39FR 49FR 100FR Marine Life 1981 13FR 16FR 24FR Fish Breeding 1981 23FR 41FR FRENCH POLYNESIA South Pacific Arts Festival 1980 SOUVENIR SHEET OF 3 FRENCH POLYNESIA Folk Dancers 1981 44FR 26FR 28FR Birds 1981 53FR 65FR 47FR Islands 1981 34FR 134FR 136FR FRENCH POLYNESIA Fish 1982 30FR 31FR 45FR Pearl Industry 1982 7FR 8FR 10FR Energy Sources 1982 Hobie-Cat Championships 1982 PHILEXFRANCE 1982 46FR 90FR 150FR Islands 1982 20FR 33FR 35FR FRENCH POLYNESIA PHILEXFRANCE 1982 150FR S OUVENIR S HEET FRENCH POLYNESIA Coronation Ceremony 1982 12FR 13FR 17FR Birds 1982 39FR 37FR 42FR Fish 1983 8FR 10FR 12FR FRENCH POLYNESIA Religious Sculpture 1983 7FR 21FR -

Panama Canal Record
THE PANAMA CANAL RECORD VOLUME 27 Gift ofthe Panama Canal Museum UNiV. OF FL. L B JUL 1 7 m Digitized by tine Internet Archive in 2010 with funding from Lyrasis IVIembers and Sloan Foundation http://www.archive.org/details/panamacanalr27193334isth THE PANAMA CANAL RECORD PUBLISHED MONTHLY UNDER THE AUTHORITY AND SUPER- VISION OF THE PANAMA CANAL AUGUST 15, 1933 TO JULY 15, 1934 VOLUME XXVII WITH INDEX THE PANAMA CANAL BALBOA HEIGHTS, CANAL ZONE 1934 THE PANAMA CANAL PRESS MOUNT HOPE, CANAL ZONE 1934 For additional copies of this publication address The Panama Canal, Washington, D. C, or Balboa Heights, Canal Zone. Price of bound volumes, $1.00; for foreign postal delivery, $1.50. Price of current subscription, $0.50 a year, foreign Sl.OO. .. ... THE PANAMA CANAL RECORD OFFICIAL PUBLICATION OF THE PANAMA CANAL. PUBLISHED MONTHLY. Subscription rates, domestic, $0.50 per year; foreign, $1.00; address The Panama Canal Record, Balboa Heights, Canal Zone, or, for United States and foreign distribution. The Panama Canal, Washington, D. C. Entered as second-class matter February 6, 191.S, at the Post Office at Cristobal, C. Z., under the Act ol March 3, 1S79. Certificate.—By direction of the Governor of The Panama Canal the matter contained herein is published as statistical information and is required for the proper transaction of the public business. Volume XXVII. Balboa Heights, C. Z., August 15, 1933. No. i. Traffic Through the Panama Canal in July 1933 The total vessels of all kinds transiting the Canal during the month of July in the two